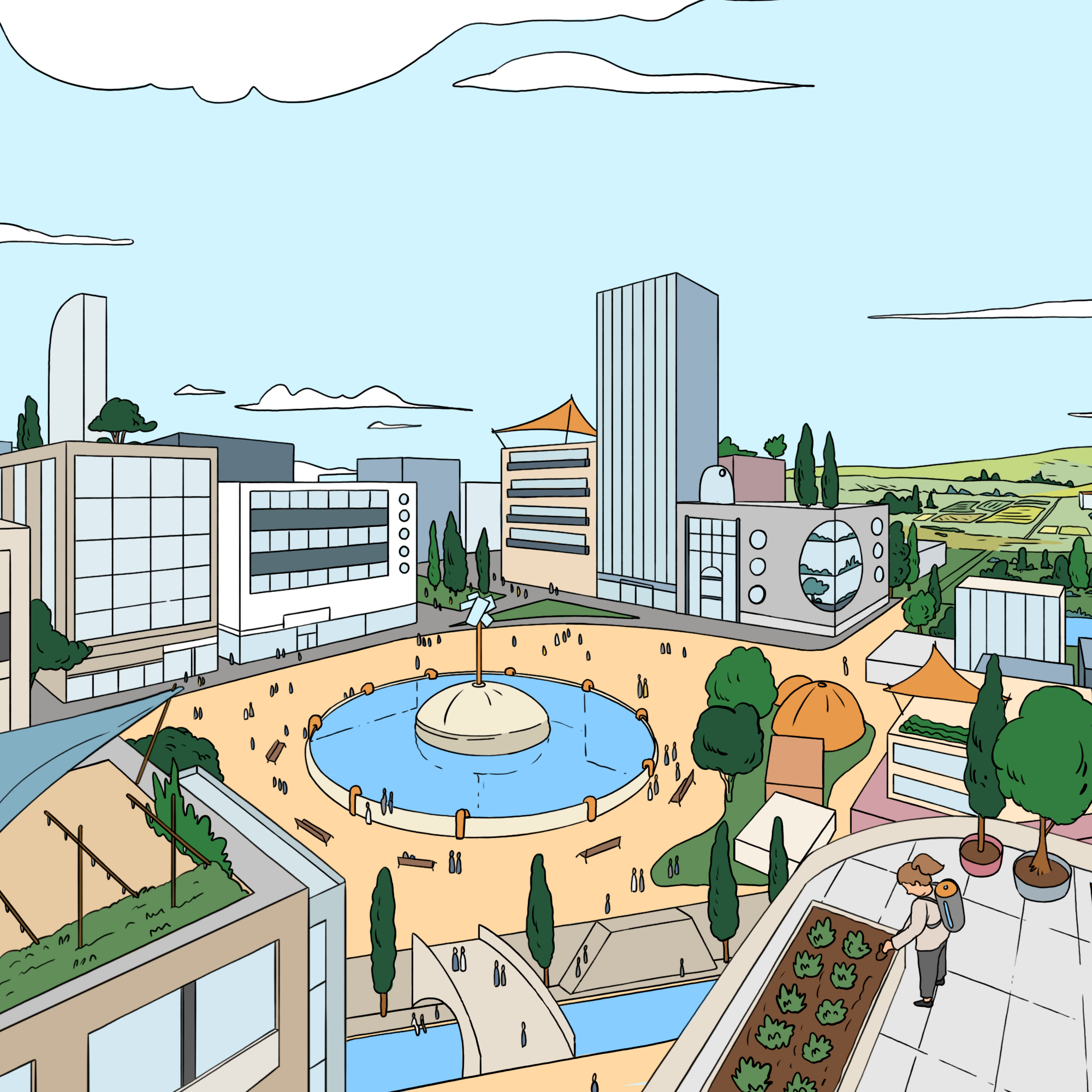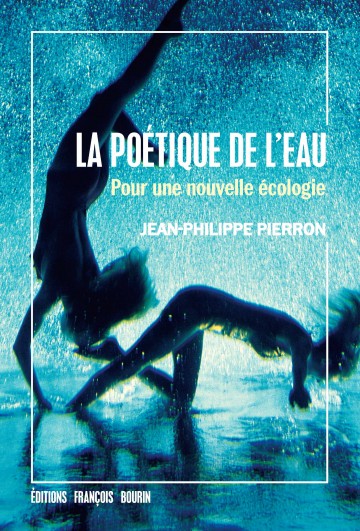La question du nombre maximum d’humains que la terre peut porter turlupine les savants depuis plusieurs siècles. Au début, il s’agissait seulement de prévoir la date de la fin du monde qui, selon les écritures, devait survenir quand la terre serait « pleine ». Les deux premiers savants à lancer une prédiction furent le philosophe politique William Petty et le médecin Antoni van Leeuwenhoek, à la fin du XVIIe siècle. Ils pronostiquèrent le chiffre de 14 milliards d’humains, correspondant à « une personne par acre de terre cultivable », soit environ 200 habitants au kilomètre carré. C’était effectivement la population que l’on pouvait nourrir à l’époque, étant donné les faibles rendements (moins de 10 quintaux de blé à l’hectare, alors que la moyenne actuelle en France frise les 100 quintaux).
C’était aussi la densité que l’on rencontrait déjà dans certains comtés anglais et en Normandie.
Par la suite, de nombreux auteurs se lancèrent dans la prédiction de la population maximale de la terre. Certains firent preuve d’un optimisme délirant au XIXe siècle, persuadés qu’avec les progrès de la chimie et l’invention de l’électricité, on pourrait multiplier le pouvoir alimentaire de la terre par 10 000, comme Marx l’écrivit dans une lettre à son ami Engels. Progressivement, au XXe siècle, l’enthousiasme retomba, mais la diversité des estimations de la population maximale est demeurée importante. Le démographe américain Joel Cohen a recensé plus de 60 estimations scientifiquement argumentées depuis celles, pionnières, de Petty et Leuwenhoek. Elles s’étagent de 4 à 40 milliards.
Tentons d’expliquer pourquoi cette fourchette n’est pas déraisonnable, malgré les apparences.
Grand écart entre approche positiviste et pessimiste
Au cours des années 1970, les 40 milliards ont été annoncés par Roger Revelle, fondateur du centre d’études de la population à Harvard. Revelle suppose que l’agriculture atteindra partout le rendement maximum observé dans l’état américain de l’Iowa, et que la surface cultivable de l’ensemble du globe restera constante, ainsi que le climat. Il calcule alors la production totale de céréales, la convertit en calories, et divise ce total par la consommation annuelle de calories nécessaire pour vivre correctement (100 000 par an et par personne). Il arrive ainsi aux 40 milliards. De son côté, Paul Ehrlich, professeur réputé d’écologie à Stanford, part d’un point de vue radicalement différent. Il suppose que tous les humains atteindront le niveau de consommation en aliments de l’Américain moyen, et divise la production de l’époque par cette consommation moyenne. Résultat, la terre ne peut pas nourrir plus de 4 milliards d’hommes. L’énoncé des deux méthodes laisse entrevoir deux sources de différences entre les deux raisonnements.
En positiviste, Revelle pense que l’agriculture performante de l’Amérique pourra être exportée dans le monde entier indépendamment des problèmes de formation de la main d’œuvre, d’outillage, de ressources en eau. Certes, il existe des potentiels importants en Afrique tropicale et équatoriale où malgré les pluies et la chaleur, la production de céréales stagne à 10 quintaux à l’hectare, mais vaincre les résistances des mentalités et équiper les pays pauvres ne sera pas aisé, sans oublier la raréfaction de l’eau disponible (l’agriculture représente déjà 75 % de la consommation mondiale d’eau).
En pessimiste, Ehrlich pense que l’on ne dépassera pas les productions actuelles, que les terres s’épuiseront et seront gagnées par la désertification. Le chiffre de 4 milliards auquel il arrive montre aussi que l’on a déjà dépassé, à cette époque, la population totale que la terre peut entretenir à long terme, en partie à cause du niveau de consommation de produits animaux par les Américains. On touche ici à la seconde différence. Revelle raisonne comme si l’on ne consommait que des céréales, et que l’on ne perdait aucune nourriture entre la récolte et l’assiette. Or, actuellement, près de 20 % de la production est gâchée, soit faute d’être stockée convenablement, soit laissée dans l’assiette.
Amateurs de viande ou végétariens, les chiffres varient
Surtout, consommer de la nourriture d’origine animale suppose que l’on élève ces animaux en leur donnant à manger. Jusqu’à une époque récente, une partie des terres cultivables était utilisée en prairie pour nourrir les ruminants. Depuis un demi-siècle, la croissance de la demande de viande, de lait, de beurre, de fromage est telle que les prairies naturelles ou artificielles ne suffisent plus. On nourrit de plus en plus les animaux avec des céréales ou du soja. Selon l’Organisation mondiale de l’agriculture (la FAO), la nourriture des animaux domestique, qui accaparait 35 % de la production mondiale de céréales en 1990, en utilise près de la moitié actuellement. Qu’importe, dira-t-on, puisqu’il s’agit d’un détour de production : on mangera sous forme de blanc de poulet, d’œuf ou de steak, le maïs et le blé qu’on a donné aux poules et aux vaches. C’est méconnaitre une loi d’airain des chaînes écologiques : d’un maillon au suivant dans la chaîne alimentaire, on ne récupère que 10 à 20% des calories ingérées. Ainsi, au mieux pour du lait ou des œufs, il faut donner 4 calories de céréales pour obtenir une calorie de ces mets. Au pire, pour la viande de bœuf, il faut donner 10 calories pour en récupérer une.
Selon donc que l’on est gros consommateur de lait, de viande et de fromage ou végétarien, on absorbe beaucoup ou peu de calories végétales. En admettant qu’en moyenne on ne récupère qu’une calorie animale pour six végétales fournies, la terre peut accueillir six fois plus de végétariens purs et durs que de mangeurs de viande invétérés. C’est donner une idée de l’incertitude où l’on se trouve pour déterminer une population mondiale maximale. Car les écarts de consommation de calories animales sont importants à l’échelle de la planète : la ration alimentaire du Nigérian ou du Bengali ne comporte que 4 % de calories d’origine animale. Celle du Français, 46 %, juste après l’Esquimau qui dépasse les 50 %. Actuellement, la ration moyenne d’un humain, quel que soit son pays, contient 18 % de calories animales.
Dans un récent ouvrage, la directrice de l’INRA, Marion Guillou, plaide pour une ration de 25 %, donc un peu supérieure (c’est celle des Japonais qui ont la plus longue espérance de vie au monde), mais réalisable. On comprend alors mieux les débats sur la surpopulation. D’un côté, les pays du Nord qui souhaitent conserver leur style de consommation accusent les pays du Sud de ne pas maitriser leur croissance démographique, de laisser l’explosion se produire. Ils savent en effet que leur modèle d’alimentation ne peut pas être étendu au reste du monde. Ils appliquent alors la méthode Ehrlich. De l’autre côté, les pays du Sud accusent le mode de vie des pays du Nord d’être responsable de leur crise alimentaire. Comme le disait Alfred Sauvy, ils considèrent que leurs rivaux ne sont pas les pauvres du Nord mais les vaches des pays du Nord. Ils suivent en quelque sorte le mode de raisonnement végétarien de Revelle. On comprend aussi la persistance de la faim dans le monde et la stagnation du nombre des affamés (même si leur proportion décroît légèrement avec la croissance de la population mondiale). Alors que la production mondiale de céréales s’est accrue nettement plus vite que la population mondiale depuis 50 ans (la production moyenne par humain a augmenté de 30 %), l’accroissement de l’utilisation des céréales pour nourrir les animaux a accaparé la plus grande part de cette croissance, particulièrement au cours des dernières décennies, durant lesquelles les pays émergents ont adopté le mode de consommation occidental. La consommation de viande a ainsi été multipliée par vingt en Chine depuis trente ans, sans cependant atteindre le niveau européen ou américain.
Incertitudes sur la productivité agricole
On voit qu’il est impossible d’évaluer l’effectif de la population maximale indépendamment d’un style d’alimentation, et qu’il est impossible d’imposer un style unique d’alimentation. Si à l’extrême on considérait que tout régime alimentaire dans le monde doit comprendre un kilo de caviar ou de truffes par mois, alors l’effectif maximal de population qui pourrait être nourri dans de telles conditions n’atteindrait pas le million d’habitants. On ne doit pas non plus oublier l’autre cause d’incertitude, celle qui concerne la hausse de la productivité de l’agriculture, hausse importante depuis la seconde guerre mondiale, et qui peut se poursuivre grâce notamment aux OGM massivement utilisés en Inde ou au Brésil. Beaucoup de raisonnements oublient de prendre en compte cette hausse de la productivité agricole. Or c’est aussi elle qui contrôle l’effectif maximum : si l’on devait calculer la population maximale de la terre à l’époque des chasseurs cueilleurs de Cromagnon, on trouverait qu’elle ne pouvait pas excéder un million de personnes. À l’époque de Louis XIV, on trouverait un peu près un milliard, et maintenant nettement plus comme on l’a vu.
Ces éléments d’incertitude donnent cependant une vision optimiste du futur de la population humaine, et écartent assez largement le spectre de la surpopulation. Un nouveau sujet d’inquiétude est cependant apparu avec les biocarburants de première génération, qui utilisent le blé mais surtout le maïs et la canne à sucre. Plus de 15 % de la production mondiale de maïs va aux biocarburants, l’éthanol essentiellement, et la croissance de ce chiffre est rapide. Ce ne sont plus seulement les vaches des riches qui menacent ceux qui souffrent de la faim, mais leurs 4×4. Or cette concurrence peut s’avérer beaucoup plus dangereuse, car elle repose sur le prix comparé du pétrole et des céréales. Si le prix du pétrole continue d’augmenter, les agriculteurs seront de plus en plus tentés de produire des biocarburants. Le XIXe et le XXe siècles ont connu la mondialisation du commerce des céréales en vue de l’alimentation, le XXIe connaîtra la généralisation de leur usage à de nombreuses productions, avec les risques que cela comporte pour les plus démunis, car les prix dépendront de plus en plus des aléas de la conjoncture globale.