Les apports principaux de l’Église de Lyon à l’Église de France

Interview de Monseigneur Thierry
Évêque auxiliaire de Lyon
Interview de Bernard HUSSON

<< Il est indispensable aujourd’hui pour les habitants de Lyon, catholiques comme pour tous, de se réinvestir dans des mouvements de pensée et de réflexion fortement articulés à l'action >>.
Propos recueillis par Catherine Panassier le 19 mai 2010
Bernard Husson : présentation
Né à Saint Etienne en 1946, Bernard Husson a suivi des études de sciences économiques à l’université de Lyon. Devenu Docteur en économie, il a participé et dirigé de nombreux travaux d’études, de capitalisation sur le développement et la coopération. Il a contribué à la mise en place de nombreux réseaux, institutions et collectifs en France et dans les pays de coopération. Il dispose d’une longue expérience d'évaluation de politiques publiques sous les angles techniques, financiers, institutionnels et d’une bonne connaissance des différentes échelles de coopération, ainsi que de leur articulation. Les travaux qu'il a menés sur le terrain ont toujours été associés à une réflexion sur le contexte national et international dans lequel ils s'inscrivaient, et ont fréquemment conduit à la mise en place d'institutions pour accompagner les acteurs. A Lyon, Bernard Husson a notamment fondé le Ciedel - Centre international d’études pour le développement local - où il a assuré pendant de longues années un enseignement, puis Résacoop, un dispositif au service des acteurs rhônalpins de la coopération internationale.
CIEDEL - Centre international d’études pour le développement local -
Le CIEDEL, Institut universitaire créé au sein de l’Université Catholique de Lyon en 1990, est constitué depuis 2005 en association loi 1901. Se situant comme médiateur entre la réflexion et l’action, l’institut propose une formation universitaire et professionnelle en ingénierie de développement local à Lyon, tout en agissant comme opérateur d’appui à des actions de développement local en France et à l’international.
Autour de la formation, le CIEDEL met en œuvre quatre champs complémentaires : une expertise de terrain sur les questions de développement local, de décentralisation et de coopération internationale et décentralisée ; l’appui aux acteurs de développement en région Rhône-Alpes (RESACOOP) ; la mise en réseau au niveau international de centres de formation d’agents de développement local (PROFADEL) ; la production de connaissances sur des thématiques liées au développement local, à la décentralisation et à la coopération décentralisée.
L’articulation entre ces quatre champs et la formation favorise l’ancrage opérationnel de l’institut sur les problèmes clefs repérés par les acteurs du développement. Elle permet de privilégier l’approche de ces problèmes par les acteurs eux-mêmes, à une échelle où ils peuvent exercer un pouvoir organisé. Dans cette interview, Bernard Husson expose sa vision du « modèle lyonnais » marqué par une influence du catholicisme social. Il retrace la création du Ciedel dans le contexte lyonnais des années 1980/1990 et le rôle de l’Université catholique dans son fondement, mais aussi dans son développement. Enfin, il présente son point de vue sur l’évolution des politiques d’aide au développement, les modes d’engagement et souligne la nécessaire création de lieux qui conjuguent la réflexion et l’action.
Qu’est-ce qui caractérise la démarche du Ciedel et le sens de votre démarche ?
La spécificité de la démarche du Ciedel est d’approcher les questions à partir d’un travail de terrain. La manière dont il est mené et les résultats enregistrés, s’ils sont analysés avec rigueur, permettent de produire des connaissances, d'un égal intérêt avec celles produites par la réflexion intellectuelle. Le Ciedel essaye depuis son origine de travailler à trois niveaux :
-comprendre ce qui se passe sur le terrain en accompagnant les actions
- produire des connaissances et construire une réflexion à partir des travaux menés en vraie grandeur (formalisation, typologisation…),
- mettre en place des institutions pour pérenniser les actions et diffuser les connaissances acquises.
C’est cette démarche, cette volonté de favoriser la production de connaissances et l'émergence d'institutions ancrées sur des pratiques qui ont fondé la création du Ciedel, mais aussi de Résacoop, de la revue « Histoires de Développement » à Lyon, du groupe « Urgence - Réhabilitation - Développement » au niveau national et de bien d'autres encore.
Cette approche n'est pas concurrente de celles des universités, elles sont complémentaires. L'approche du Ciedel est reconnue pour le niveau et la qualité des travaux réalisés.
Comment positionnez-vous le Ciedel dans le mouvement catholique social lyonnais ?
Je distingue deux mouvements d’influence chez les catholiques à Lyon, l'un qui veut être ancré dans la vie sociale que représente des institutions comme Economie et Humanisme qui prône une économie humaine ou la Chronique sociale, l'autre tourné vers la formation, notamment des jeunes, dont, par exemple, les Jésuites sont porteurs. Personnellement je me sens proche du premier mouvement, historiquement porté par le Père Lebret ; professionnellement j'ai travaillé de longues années au sein de l'Université catholique, plus en phase avec le second depuis plusieurs décennies. Il me semble que le Ciedel se situe dans une interaction entre ces deux mouvements. Cette situation n’a pas été spécialement voulue, n’est probablement pas explicite pour beaucoup, mais de fait me parait bien réelle.
Quelle a été l’implication de l’Université catholique dans la création et le développement du CIEDEL ?
L’implication de l’Université catholique a été fondamentale dans la création du Ciedel. Elle a apporté un très fort soutien en termes logistiques et financiers. Elle l'a accueilli dans ses locaux, l'a doté de moyens notamment informatiques, elle a accepté des déficits. Cependant, si elle a permis au Ciedel de se développer, elle n'a pas saisi la dynamique et l'originalité de cet institut. La situation était différente pour l’ISSA et l'IESL, instituts qui ont précédé le Ciedel. L’Université catholique, et l'image qui est la sienne à travers le vocable courant « la Catho », est d'être un lieu de formation. Il n’est pas dans ses usages et ses pratiques d’être opérateur. Cela est vrai pour l’institution, mais aussi par ses membres. Or, le propre du Ciedel est justement d’être à l’articulation entre la formation et l’action. Cette posture est difficilement compréhensible pour « la Catho » qui voit mal comment une telle démarche peut se construire, malgré son expérience au sortir de la guerre. Par exemple, le Ciedel a travaillé sur la mise en place d'un système de financement des communes au Mali, y compris par le recouvrement des impôts locaux et en a tiré des thèmes de formation. C'est effectivement loin des modes de fonctionnement de l'Université. L’Université catholique a donc laissé progresser le Ciedel sans s’impliquer, et ce développement a été possible au sein de l'Université pour trois raisons : la culture universitaire est peu ou pas interventionniste sur les orientations et le fonctionnement des instituts d'une part, parce que le domaine du développement, à l’inverse des questions bioéthiques par exemple, n’est pas une question conflictuelle entre l'institution ecclésiale et une partie de la société d'autre part, enfin parce qu'être rattaché à l’Université catholique obligeait le Ciedel à une qualité des travaux. La création de Résacoop illustre bien l'existence de ces trois facteurs qui dépassent les relations entre l'Université catholique et le Ciedel. Aucun élu politique par exemple, quelle que soit son adhésion, ne s'est opposé à ce que Résacoop soit installé au sein de « la Catho », mais cette dernière n’a pas saisi cette occasion pour consolider et diversifier son image auprès des institutions membres du réseau.
Comment expliquez-vous que l’Université catholique n’ait pas profité de l’image positive du Ciedel pour sa propre valorisation ?
Ce déficit n'est pas spécifique au Ciedel. L'Université catholique sait mal valoriser la reconnaissance extérieure lorsqu'il ne s'agit pas d'un domaine universitaire "classique". Le fait que René Valette, doyen d'une des facultés de « la Catho », devienne Président national du CCFD, ou que je contribue à créer le Haut Conseil à la Coopération Internationale qui était directement rattaché au premier ministre, étaient des signes forts de reconnaissance de l’extérieur qui validaient le sens de notre démarche, mais que « la Catho » n’a pas saisi. Le fonctionnement du Ciedel générait des incompréhensions, voire des craintes. Toutes les ressources financières générées par les contrats réalisés à l’étranger étaient-elles bien enregistrées pour le compte de l'Université ? Il est évident que la règle absolue, sous peine d'éclatement de l'équipe, était une signature institutionnelle de tous les contrats. Le discours sur le développement du Ciedel, décalé et nouveau, s'est aussi probablement heurté à des conceptions de l’aide au développement bien différentes, que l'on rencontrait au sein de « la Catho », mais bien au-delà aussi. Par exemple, alors que nous démontrions les dérives de la "coopération conteneurs" qui détruit les efforts des organisations locales par l'envoi de matériel ou d’objets divers, matériels scolaires, machines usagées…, des collectes étaient organisées au sein de l’université comme il en était organisé dans beaucoup d'autres lieux. Il est plus difficile, mais tellement préférable de soutenir des circuits de distribution plutôt que de faire don de médicaments, d'accompagner des programmes de régénération des sols plutôt que former des agriculteurs déjà compétents, de renforcer les collectivités locales dans l'exercice de leurs responsabilités hydrauliques plutôt que de se substituer à leur compétence pour l'adduction d'eau potable….
Comment cette approche du développement et la perception des pays en voie de développement a-elle évolué au cours de ces trente dernières années ?
Il y a eu peu d’évolution, en tout cas, pas suffisamment. Certes, on n’envoie plus de lait ou de farine, mais on continue à envoyer de l’argent sans prendre garde que des systèmes de microcrédit existent à peu près partout, et sans considérer la nature de leurs besoins. L’enjeu n’est pas d’augmenter leurs capacités de prêts, mais de les consolider par le recrutement de vrais professionnels pour qu'ils fonctionnent au mieux. Au lieu de favoriser la création de modèles adaptés aux cultures et réalités des pays, nous avons toujours tendance à exporter nos modèles, même si les discours affirment le contraire. Nous exportons par exemple notre système scolaire segmenté entre l’école primaire, le collège, le lycée, puis l’université. Pour nous, ces découpages institutionnels correspondent à des tranches d’âges déterminées, enfance, préadolescence, adolescence et premier temps de l'âge adulte. Ces temps ont leur équivalent sur le plan socio-familial ou religieux. Par exemple à l’entrée à l’école, la famille apprend à l’enfant à traverser la rue ; à l’entrée au collège, il se déplace seul ; à l’entrée au lycée, il acquiert le droit de sortir seul après le dîner. Sur le plan religieux, pour les catholiques, on a les mêmes étapes aux mêmes âges pour les sacrements. Ces périodes qui mènent un garçonnet ou une fillette jusqu'à l'âge adulte sont convergentes qu'il s'agisse de l'école, du contexte socio familial, de la dimension religieuse. Mais ne sont-elles pas propres à notre culture ? Sont-elles universelles ? En proposant notre modèle d'école, on reproduit des approches, des conceptions et des fonctionnements qui ne sont pas nécessairement adaptés aux rythmes de formation des personnes des pays en voie de développement. Et l'école n'est qu'un exemple parmi de nombreux autres !
Sans le définir vraiment, on a souvent tendance à faire référence au « modèle lyonnais », comment le qualifiez-vous ?
Je ne sais pas s’il existe un « modèle lyonnais », cependant il semble certain que Lyon a des caractéristiques qui lui sont propres. C’est une ville qui a un fort potentiel, mais qui le mesure et l’exploite insuffisamment. Lyon ne sait pas jouer de ses marges d’autonomie. Elle est frileuse pour engager des innovations et construire son développement, et ce trait de caractère semble bien ancré. Lyon renvoie l’image d’une ville qui ne fait pas de vague, une caractéristique qui se diffuse à travers toutes les catégories sociales et dans tous les domaines.
Par exemple, on a voulu être moderne lorsque s’est construit le boulevard Vivier Merle, mais sans oser jouer la carte de l’originalité. A l'exception d'un ou deux ensembles, les bâtiments qui le bordent ne restent pas en mémoire comme dans d'autres villes. Comparez les gares TGV de Lille-Europe et de la Part Dieu ! D'autres exemples montrent cette frilosité : toutes les grandes villes d’Europe ont créé de véritables espaces piétons au cœur de la ville, Lyon s'en tient à un axe Perrache - Cordeliers, la faible valorisation de l'aéroport du point de vue fret alors que l'agglomération est au carrefour des axes d'échanges entre les grands pays du Nord et du Sud de l'Europe… Milan, Munich ou Lyon étaient il y a 40 ans des villes de poids similaires. En 2010, il n'en est plus de même au profit des premières. Il est vrai que le système centralisateur français ne facilite pas l'émergence de villes de niveau européen.
On pourrait dresser le même constat au niveau social. Par exemple, Cap Services est une idée intéressante pour accompagner la création d'activité. Mais son action reste confidentielle et ses résultats trop peu exploités. Au niveau culturel, si l’on met de côté le Défilé de la Biennale de la danse, on peut également regretter que Lyon ne saisisse pas mieux ses atouts. Par exemple, les jeunes qui dansent au pied de l’opéra ont été mis en valeur, mais de façon contenue alors que ce sont des dynamiques qui pourraient être plus largement amplifiées. D'autres exemples pourraient être encore cités comme la valorisation du musée des tissus qui pourrait être le support de toute une dynamique autour du textile.
Je ne dis pas qu’il ne se passe rien à Lyon, l’aménagement des berges du Rhône est une très belle chose, et le défilé de la Biennale de la danse une formidable réalisation, mais à l’évidence cette ville manque d’ambition par rapport à l’énorme potentiel dont elle bénéficie grâce à sa situation géographique et à ses atouts intrinsèques, notamment sa taille et sa puissance économique.
Comment expliquez-vous ce manque d’ambition ?
… On est là loin de mes domaines de compétences ! Lyon est marquée par une culture bourgeoise prudentielle. Cet esprit répond à une certaine crainte de l’originalité et de la prise de risques. Au moment des élections locales, les grandes questions font rarement l'objet de débats comme, par exemple, un débat sur l'avenir de la chimie. Y a t-il une place à Lyon pour la chimie dans les cinquante ans qui viennent, laquelle veut-on lui donner ?
Un autre trait (révélateur ?) repose sur la relation à l’international. Lyon se veut une ville internationale, mais cela nécessite une véritable politique d’accueil au-delà de l'existence d'institutions de promotion spécialisées ou de formation comme l'ENS ou le lycée international. Si historiquement, la ville est ouverte sur le monde, il n'est pas dans sa culture d'être démonstrative ; c’est probablement une qualité, mais c'est aussi une limite pour générer des effets d'entrainement. La difficulté de conjuguer volonté d'être une grande métropole et modestie dans les attitudes a de fortes répercussions sur l’ambition collective qui demeure de fait confinée.
L’art de la conciliation est-il un trait de caractère de notre ville et dans l’affirmative comment se traduit-il ?
Lyon est une ville de recherche de consensus. A Lyon nous agissons dans une étroite bande qui se situe entre volonté de conciliation et refus de l'affrontement malgré des positions divergentes parfois manifestes !
Lyon est-elle une ville « humaniste » ?
A Lyon, il y a des discours, des cultures et des groupes sociaux qui font référence à des courants « humanistes ». Pour autant, je ne saurais affirmer que Lyon est une ville humaniste. Édouard Herriot représentait un courant radical fortement implanté à Lyon. Ce courant s’est associé/confronté avec l’humanisme des démocrates chrétiens et réciproquement. Longtemps Lyon a été irrigué par ces deux sources. Pauline Jaricot, figure lyonnaise du premier tiers du XIXème siècle manifestait cette « tension/attraction » en soutenant d’un côté le combat des canuts et en fondant d’un autre l’Office Pontifical Missionnaire. La relation entre ces deux courants n’est pas seulement un enjeu pour gouverner la ville, mais est une culture qui innerve l’ensemble de la société locale.
Comment avez-vous réagi quand Charles Million s’est allié au Front National pour remporter les élections régionales de 1998 ?
Malheureusement je n’ai pas été vraiment surpris par cette attitude. Ce que j'ai regretté dans cette situation, c'est la manière dont elle a été tranchée. C'est par décision du tribunal que l'élection de Charles Million a été invalidée et non par un acte de l'assemblée. Certes, le résultat est le même, mais un acte de l'assemblée qui l'avait élu aurait eu plus de sens qu'un acte judiciaire.
Lyon : capitale de l’humanitaire ?
S’il est trop tranché d’affirmer que Lyon est une ville humaniste, il me semble qu’elle est effectivement marquée par l’humanitaire. Je fais bien la différence entre ces deux qualificatifs. L’humanitaire à Lyon a probablement été un exutoire : on n’ose pas afficher une ambition collective pour la ville, alors on se tourne vers l’humanitaire, et au sein de celui-ci vers l’international aussi. Ce n'est pas nouveau. Les Monts du Lyonnais ont été de grands pourvoyeurs de missionnaires et les pères blancs en sont un exemple probant. La création d’Handicap international, de VSF ou d’Equilibre n’est pas étrangère à cette histoire.
Dans une interview pour millénaire3, Bruno Rebelle l’un des fondateurs de VSF pense que Lyon a raté l’occasion de bâtir un véritable pôle de santé publique humanitaire dans les années 1990 et qu’aujourd’hui, l’humanitaire à Lyon est surtout un discours non nourri. Comment réagissez-vous à ses propos ?
Je partage l'avis de Bruno Rebelle pour dire que Lyon a raté un certain nombre d’occasions pour être reconnue comme « capitale de l’humanitaire », comme le titrait le journal Libération au moment de l’organisation du premier festival du film humanitaire.
A mon sens, deux raisons principales expliquent cette "défaillance". La première est liée aux acteurs de l’humanitaire eux-mêmes. Très parcellisés, ils n’ont pas su faire bloc commun entre les "grands", les plus médiatisés comme Handicap International, VSF ou Bioforce et ceux, plus anciens et aux ressources plus modestes, comme Terre des hommes ou Peuples Solidaires. De plus, la force d'Equilibre, organisme d'intervention d'urgence, qui avait su largement capter l’oreille des politiques a pesé lourd.
La seconde raison est d'ordre politique. Nous étions à la grande période du Comité pour Léré au Mali, les collectivités publiques locales n'avaient pas défini de politique de coopération propre. Cette situation entrainait une confusion de rôles entre les collectivités locales et les ONG. En raison de cette confusion, il ne pouvait pas y avoir d’ambition partagée. C'est d'ailleurs là une des raisons qui avait incité le Ciedel à prendre l'initiative de créer RESACOOP. Pour faire de Lyon une "capitale" de l'humanitaire", il aurait fallu une ambition politique affirmée et mettre en place les dispositifs correspondant. L'absence de présence de la ville de Lyon au colloque « Mondialisation et Développement, des enjeux contradictoires » organisé à l'Université catholique - le premier en France sur ce thème - qui réunissait plus de 400 personnes dont la plus grande partie des universitaires, responsables d'ONG, experts du développement français travaillant sur ce thème – en est une bonne illustration. Plus globalement, la coopération au développement nécessite de croiser des compétences diverses. De ce point de vue, les opportunités qui existaient à Lyon étaient favorables. Que ce champ de travail puisse participer au rayonnement de la ville n'a pas été compris.
Lyon, ville humanitaire : est-ce trop tard ?
Il n’est jamais trop tard. Si deux ou trois acteurs se mobilisaient, il serait possible de relever à nouveau le défi, en prenant en compte les réalités actuelles. Le niveau national est et doit rester celui où se rencontrent des organisations de même statut. L’échelon régional doit au contraire s’affirmer comme celui de la transversalité, et Rhône Alpes est probablement une région idéale pour cela compte tenu du nombre et de la qualité de ses acteurs. Notre démarche était peut-être trop futuriste dans les années 1990. Aujourd'hui, il est largement admis que la coopération n'est pas une affaire de projets à démultiplier, mais avant tout, un accompagnement des organisations du Sud dans l'exercice de leurs compétences que ce soit dans le domaine institutionnel comme l'instauration et le fonctionnement de communes, la consolidation des systèmes financiers locaux, le domaine socioéconomique par l'appui à des organisations d'éleveurs ou d'artisans, ou pour la protection de l'environnement… Cette volonté d’aller plus loin dans la compréhension de l’autre et du fonctionnement des autres sociétés porte peut-être le sceau d'une génération issue de soixante huit, peu à peu remplacée par une génération moins militante de la "transformation sociale", mais beaucoup plus ouverte sur le monde. Jean Michel Daclin, adjoint à l'International est, me semble t-il, prêt à soutenir de nouvelles démarches et à soutenir un projet solide s'il est partagé.
Lyon : ville de l’économie sociale et solidaire ?
La crise financière et économique, aux graves conséquences sociales que l’on connaît aujourd’hui, impose une remise en cause du fonctionnement du système capitaliste. Par ailleurs, si certains pays comme la Chine, l’Inde ou le Brésil ont pu prendre le train de la croissance, les pays les plus pauvres et notamment ceux de l’Afrique demeurent à l’écart des dynamiques de développement. La politique, respectueuse de la culture de ces pays, bâtie autour de la notion « d’économie humaine », que le CIEDEL prône n’est-elle pas particulièrement d’actualité ? L’économie sociale et solidaire n’est-elle pas une thématique qui correspond bien à notre ville ?
Je ne connais pas suffisamment le domaine de l’économie sociale et solidaire en France pour répondre précisément. Mais, ce que je sais, c’est que l’on peut réintégrer des expériences de pays de développement chez nous pour corriger nos modèles défectueux !
Par exemple, inspiré des systèmes financiers locaux, on pourrait imaginait qu'une partie des dépôts faits dans les caisses d'épargne de la poste, disons 20%, soit affectée au soutien d'actions démarrant dans les quartiers où elles sont présentes. Le commerçant, l'artisan ainsi aidé saurait qu'il peut démarrer son activité grâce à l’épargne des résidents de son quartier, et ces derniers se sentiraient probablement plus responsables de la réussite du jeune entrepreneur, et plus globalement de celle des activités de leur quartier.
Autre exemple, venant du Cameroun, la possibilité d’acheter des études de préfaisabilité, véritables supports à la décision, pour ceux qui ont envie de se lancer dans la création d’une activité. On pourrait imaginer de proposer un même service aux créateurs en France.
Ou encore pour la connaissance des métiers manuels. En Afrique, on connaît ces métiers car ils sont dans la rue. En France, on tente de créer des forums pour les faire connaître. Peut-être dans l’aménagement de nos villes, devrions-nous penser des espaces où ces métiers seraient visibles, ce qui contribuerait à leur valorisation.
Il reste un travail énorme à faire pour que les mentalités évoluent. Il est urgent de démonter le tropisme français vers l’Afrique Subsaharienne. La plupart des pays d'Amérique latine et d'Asie connaissent un développement rapide même si une grande partie de leurs habitants vit encore dans des conditions infrahumaines. Des pays, notamment en Afrique subsaharienne, demeurent à l’écart. Bien que nombreux, ils représentent une minorité de population. Il ne s'agit bien évidemment pas de les abandonner. Mais l'émergence de nouveaux pays perturbe nos habitudes de pensée et le confort de discours bien rodés sur le développement. Il nous faut pourtant très vite intégrer que le monde ne se réduit pas à l'Europe, à l'Amérique du Nord et aux anciennes colonies africaines.
Comment définissez-vous le catholicisme social ?
Comme un engagement dans la société afin que la dimension humaine soit toujours au centre des relations économiques, interinstitutionnelles, culturelles… Il implique une forte dimension politique, non pas partisane, mais d'engagement dans la société.
A travers quelles structures ou organisations, les catholiques sociaux lyonnais se sont-ils investis ?
A l’évidence les catholiques sociaux lyonnais se sont investis à travers des institutions comme Economie et Humanisme, l’Université catholique, Habitat et Humanisme, Handicap International, Notre Dame des Sans Abri, le MCC, mais aussi la CFDT ou encore à travers des associations comme le CCO de Villeurbanne. Dans le monde économique aussi, on trouve (ou trouvait) des organisations nourries par ce courant.
Vous même, vous percevez-vous comme un catholique social ?
Non, je ne me perçois pas comme un catholique social, j'en ignore trop les assises doctrinales. Cependant, dans ma manière de voir les choses, je sais que je suis profondément marqué par cette "culture". Et si j’ai agi comme je l’ai fait tout au long de ma vie professionnelle et dans toutes les activités que j'ai entreprises, c’est évidemment parce que je suis imprégné de cette culture alors que je connais très mal le contenu de la doctrine qui la supporte.
A votre avis qu’elle a été la réelle influence du mouvement du catholicisme social dans la construction du modèle lyonnais, avez-vous des exemples concrets ?
C'est un constat que la vie associative a été grandement animée par des personnes issues de mouvements chrétiens, de la Sauvegarde de l’enfance à l'ADAPEI, de clubs sportifs à l'accompagnement de jeunes chômeurs. Le scoutisme des années cinquante et soixante a été un fort pourvoyeur de responsables pour le monde associatif, comme bénévoles ou professionnels. Il y a eu une influence aussi dans le monde économique, que je saurai moins définir. Cependant, il me semble que les chefs d'entreprises, composantes de la bourgeoisie catholique lyonnaise, n’ont pas été aussi ouverts que leurs homologues du Nord de la France dont ils partageaient pourtant la même préoccupation sociale.
Comment avez-vous vu évoluer le mouvement catholique social au cours de ces trente ou quarante dernières années ?
Il y a encore deux ou trois ans j’aurais dit que l’on constatait un affaissement de l’influence du catholicisme social. Mais aujourd’hui, et je m’en étonne, j’ai l’impression d’une certaine résurgence.
Qu’elle est la place ou l’importance de l’Université catholique de Lyon dans le mouvement catholique social aujourd’hui, et comment a-t-elle évolué depuis les années 1980 ?
L’Université catholique était beaucoup plus influente avant les années 1970 qu’aujourd’hui. Cela s’explique par la diminution de sa taille relative en même temps qu'augmentait le nombre de jeunes qui accédaient à l'enseignement supérieur et à sa volonté de développer des formations conventionnelles. Aussi, ces dernières années, l’Université était-elle moins présente dans la cité. Ce choix de privilégier la formation était un choix stratégique que je respecte, même si je ne le partageais pas. Aujourd’hui, depuis l'ouverture du site Carnot, les choses semblent changer. L'université mesure mieux les enjeux d’ouverture et de présence dans la vie sociale.
Aujourd’hui, l’engagement est moins religieux ou idéologique. Comment appréciez-vous l’actuel engagement ?
La baisse d'’influence du catholicisme social pose effectivement la question de remettre ou non en débat ses références. Faut-il réactiver des mouvements frappés d'un large déclin, s’interroger sur les conditions de maintien de ce courant, se dire que de nouvelles formes d’engagement émergent sans besoin d'être assises sur ces références, sur ces valeurs ? Pour ma part, je reste persuadé qu'un engagement, quel qu'il soit, n'est solide que si la personne est au clair sur les valeurs qui la motivent. Par exemple dans mon domaine professionnel, j'ai constaté combien les jeunes avaient de la peine à exprimer le pourquoi de leur intérêt pour la "solidarité internationale", ce qui est un risque pour le jour où ils se trouvent confrontés à des situations dont ils ignorent tout. Un travail serait à faire du côté des plus anciens pour redire leur histoire, non pour l'ériger en modèle mais pour en garder mémoire. Un peuple sans passé est un peuple sans avenir, une solidarité sans passé est une solidarité sans avenir.
Ne soulignez-vous pas ainsi la nécessité d’un nouvel espace de confrontation des idées pour faire progresser la réflexion et faciliter la transmission ?
Il est indispensable aujourd’hui pour tout le monde, y compris les catholiques, de se réinvestir dans des mouvements de pensée, d’enquêtes et de réflexion, articulés à l'action. Les questions sont multiples : comprendre le dépeuplement dans les syndicats, les associations, les mouvements d'Eglises… ; mesurer les conséquences de l’individualisation de la société et imaginer comment être solidaires dans la société éclatée d’aujourd’hui... La France du vingtième siècle a été animée par la conviction de progresser, au-delà des moments de violence, vers un avenir partagé fondé sur un mieux vivre ensemble. Aujourd’hui a-t-on encore envie de ce vivre ensemble ? La société n'est-elle pas de plus en plus cloisonnée ? Politiquement, les alliances qui pouvaient s’envisager entre les personnes en situation de grande précarité et une petite classe moyenne ne fonctionnent plus. Une rénovation idéologique est à faire. Très peu de lieux ont la volonté de travailler sur ces problématiques, or par exemple, on ne résoudra pas la ghettoïsation des quartiers si on ne refonde pas les raisons du vivre ensemble. Les valeurs sont toujours là, il convient de les réactualiser, de les revisiter et de les dire.
Comment cet espace peut-il exister ?
Tout le monde rêve de rencontres entre les mondes intellectuel, social et politique, mais elles se révèlent souvent peu pertinentes. Pour qu'elles produisent des résultats, il faut des passerelles, des passeurs qui comprennent les logiques respectives de chacun de ces mondes, qui identifient les points de jonction et les tensions en leur sein et entre eux, et apportent une véritable valeur ajoutée en termes de réflexion. Ce lieu est effectivement aujourd’hui à réinventer à Lyon, même si certains s'y efforcent au nouveau national.
Quels conseils apportez-vous aux jeunes qui souhaitent s’engager dans l’humanitaire ?
Je demande d’abord aux jeunes d'identifier leurs motivations sans se cacher derrière des idées convenues. C'est là un rôle fondamental de l’accompagnement
- Tu veux faire de l’humanitaire, tu dis que tu n’aimes pas l’argent ? J'ai peine à te croire. Des mères Térésa, il n’y en a qu’une par siècle !
- Tu dis être prêt à partir vivre ailleurs, ne pas vouloir fonder de famille. Diras tu la même chose dans cinq ou dans dix ans ?
- Il te paraît évident que l’on mange avec une cuillère, que l’égalité homme/femme est une valeur universelle, Ces affirmations sont-elles évidentes pour tous ? Et si non, qu'elle attitude avoir ?
L’accompagnement consiste à renvoyer les jeunes à leur pratique pour qu'ils puissent ensuite rencontrer les autres sans domination, éventuellement s'affronter avec eux, mais dans une considération réciproque. Il est aussi important de les aider à comprendre, comme les adultes, que toute situation a une origine, une cause, une histoire qu'il est nécessaire de connaître sous peine d'agir dans l'erreur. On conduit à gauche en Angleterre et dans certains pays on écrit de droite à gauche, il y a des raisons et des impacts à ces situations, et il est important de les connaître pour pouvoir agir.
J’ai vu beaucoup de jeunes vouloir s’engager dans l’humanitaire et j'ai mesuré la faiblesse des adultes pour les accompagner. On a tendance à surestimer le don. La générosité est indispensable, mais tout à fait insuffisante. La première chose à faire lorsque l’on rencontre un jeune qui veut « faire de l’humanitaire » est de lui dire qu’il doit d’abord acquérir des compétences, un métier. Ensuite, s’il le désire toujours, et s’il est réellement au clair avec son choix, il pourra exercer son savoir ou son savoir-faire dans un pays en voie de développement. Mais un principe guide les conseils à donner : les plus pauvres ont droit, plus encore que les autres, à avoir des interlocuteurs solides et des professionnels compétents.

Interview de Monseigneur Thierry
Évêque auxiliaire de Lyon

Interview de Jean-Marie Gueullette
Directeur du Centre Interdisciplinaire d'Ethique de l'Université Catholique de Lyon
Texte de Joseph Yacoub

Les métiers du prendre soin souffrent d'un fort turnover. Pourtant, les facteurs d'engagement dans ces métiers très humains ne manquent pas. Alors, que se passe-t-il ?
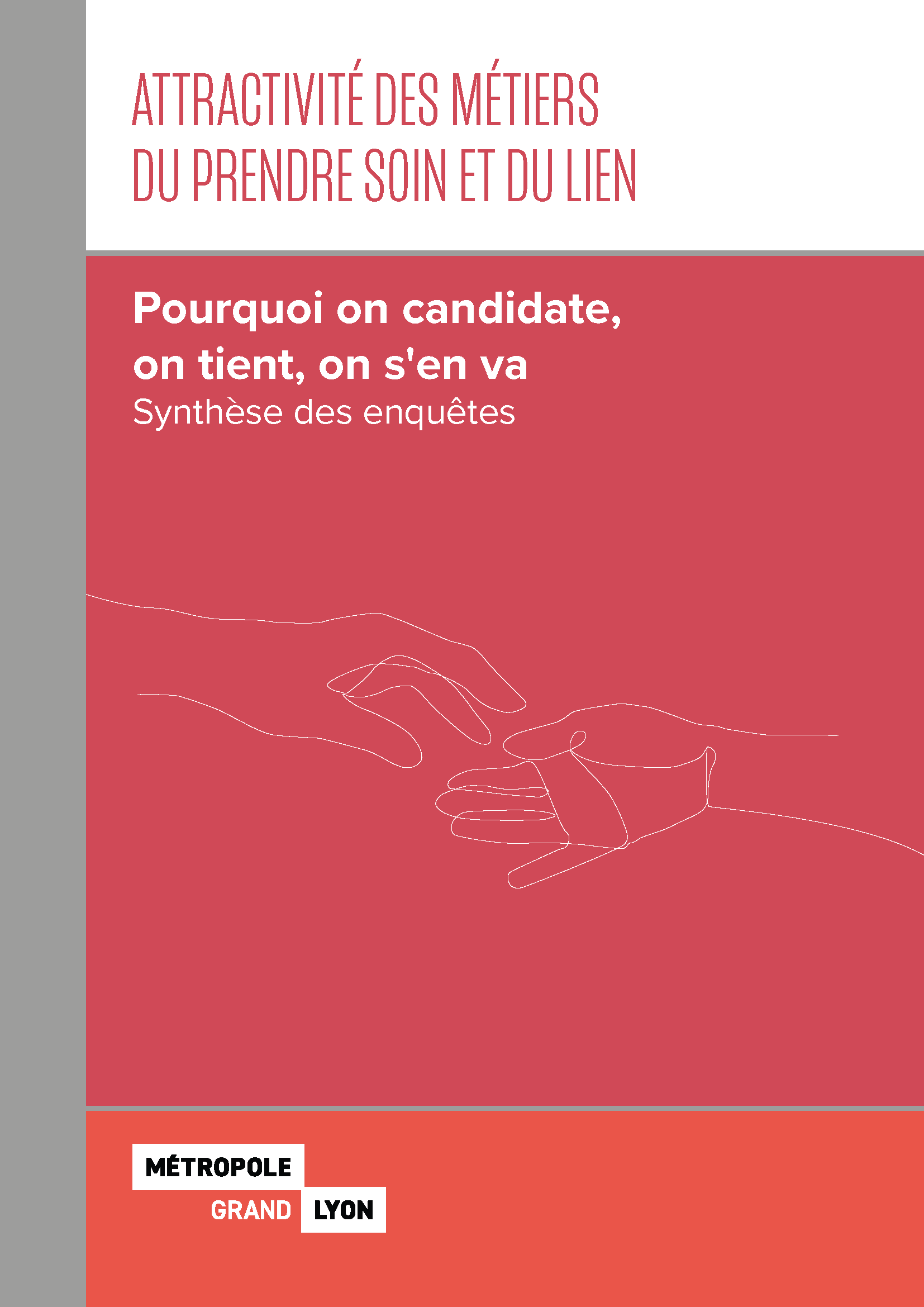
Étude
Comment expliquer le manque d'attractivité des métiers du prendre soin ? pourquoi on candidate, on tient, on s’en va ? Retrouvez la synthèse des enseignements des différentes enquêtes conduites sur ces questions.

Article
Cheminer vers la sobriété : L’altruisme est-il le balancier nécessaire à cette démarche de funambule ? « Pas si simple », répond la mathématicienne Ariadna Fossas Tenas

Article
En 2022, la loi bioéthique ouvrait le don du sang aux homosexuels dans les mêmes conditions aux hétérosexuels. En matière de sentiment d’appartenance à une catégorie sociale, que nous apprennent les controverses qui ont abouti à cette évolution ?

Interview de Elies Ben Azib
Directeur du Centre social La Garde à Marseille