Veille M3 / Pour une meilleure qualité de l’air, l'auto-défense sanitaire ?
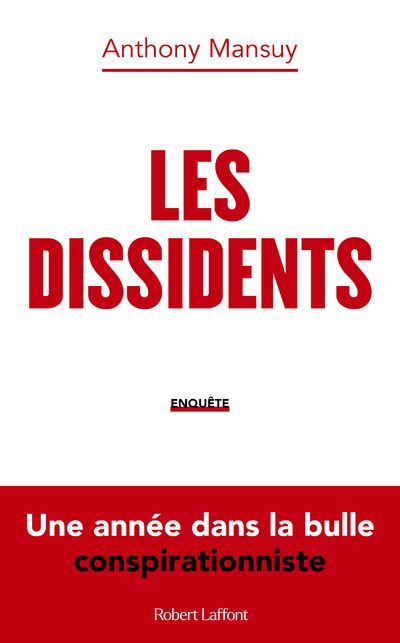
Article
Après la poussée de complotisme constatée pendant la pandémie, quels enseignements tirer pour réconcilier sciences et engagement citoyen ?
Interview de Dominique VINCK

<< L’histoire que les gens racontent semble avoir des effets performatifs sur l’histoire que les gens construisent >>.
Entretien réalisé le 21 mai 2010, propos recueillis par Marianne Chouteau
Dominique Vinck est professeur de sociologie des sciences. Il exerce au laboratoire PACTE de Grenoble et enseigne à l’université Pierre Mendès France. Il est spécialisé en sociologie des sciences et des techniques, en ethnographie des techniques et sociologie de l’innovation. Il est, entre autres, l’auteur de « Ingénieurs au quotidien » (Grenoble, Presses Universitaires de Grenoble, 1999), « Sciences et Sociétés. Sociologie du travail scientifique » (Paris, A. Colin, 2007), « Les nanotechnologies » (Paris, Le cavalier bleu. Collections Idées reçues, 2009) et « Comment les acteurs s’arrangent avec les incertitudes » (Paris, EAC, 2009).
Page personnelle : http://www.pacte.cnrs.fr/spip.php?article298
Comment l’histoire interfère-t-elle dans la construction des savoirs scientifiques ? L’utilisation de l’histoire dans les sciences humaines et sociales est-elle fondatrice et primordiale ? L’histoire peut-elle servir d’expérimentation aux chercheurs en sciences et humaines et sociales. En revenant sur son parcours de sociologue et en analysant ce qui se déroule en sociologie, Dominique Vinck répondra à ces questions à travers cet entretien.
Votre métier de chercheur en sociologie vous permet-il d’apprécier le rôle de l’histoire dans les recherches en sciences humaines et sociales ?
Pour répondre à cette question, il faut que je revienne un peu sur mon parcours. J’ai un parcours atypique puisque j’ai été technicien et ingénieur dans le domaine de la chimie et de l’industrie agro-alimentaire, puis je me suis orienté vers la philosophie des sciences et des techniques et j’ai soutenu un doctorat en socio-économie de l’innovation. Toutefois, ce parcours hétéroclite en matière de disciplines cache une continuité en matière d’intérêt, puisque je me suis toujours intéressé aux liens sciences, techniques et société. C’est pour cette raison que j’ai souhaité orienter mes recherches vers l’innovation. J’ai souhaité comprendre les processus d’émergence de l’innovation, comprendre le fonctionnement de l’activité scientifique et comprendre comment tout cela s’articule avec des phénomènes de société. Je souhaitais mettre en évidence la circulation dans les deux sens : comment des découvertes faites dans les laboratoires en viennent à s’inscrire dans la société et inversement comment des questions ou des phénomènes sociaux vont intervenir dans les laboratoires et éventuellement affecter des dynamiques scientifiques. Par exemple, j’ai effectué un travail d’ethnographie dans un laboratoire de biochimie cellulaire à Namur – orienté recherche fondamentale – où certains chercheurs pensaient pouvoir faire du transfert de technologie et créer une start-up. Mon rôle a été d’observer, d’analyser et de comprendre cette prise de risques. En faisant cette étude, je me suis rendu compte que ce qui se passe dans le laboratoire est très lié à ce qui se passe au dehors via l’histoire individuelle de chaque chercheur. A partir de cela, j’ai considéré le laboratoire comme un nœud d’où circulent des réseaux, des échanges de personnes et de savoirs. Ainsi, je me suis rendu compte qu’il existe des réseaux de coopération scientifique et que ces derniers peuvent être formels ou informels.
Quel peut être le rôle de ces réseaux dans la construction des savoirs ?
Pour le comprendre, il fallait que je sache devant quel type de réseaux, je me trouvais. Pour ce faire, je me suis interrogé sur la nature de ces réseaux de coopération scientifique et notamment via un projet de la Commission des communautés européennes sur un programme de recherche médicale qui mobilisait 3500 équipes de chercheurs, de cliniciens, d’industriels au niveau européen structurés en plus de cent réseaux de coopération. Nous avons réalisé là une immense enquête pour comprendre ce que signifie construire des réseaux de coopération scientifique et ce que cela produit. Nous avons alors mis en évidence l’importance et le rôle des objets intermédiaires qui permettaient aux chercheurs de co-construire du savoir. Cette découverte s’inscrivait dans la lignée des travaux ethnographiques de Bruno Latour avec la notion d’inscription construite à partie d’une ethnographie de laboratoire et des travaux de Michel Callon sur les réseaux de l’innovation.
Avec ma venue à Grenoble, une demande m’était adressée de réaliser un travail similaire de sociologie mais en m’intéressant non plus à la science mais à la technique. On s’est vite rendu compte que si nous avions, dans la littérature, des ethnographies sur des laboratoires scientifiques, nous n’avions rien sur les bureaux d’étude. Nous n’avons pas de littérature ou très peu sur ce sujet, à part la littérature normative et prescriptive en sciences pour l’ingénieur quant aux méthodes et à l’organisation du travail de conception et, de ce fait, nous n’avions aucune idée de la façon dont cela se passe. C’est ainsi que nous sommes entrés dans les bureaux d’étude afin de comprendre les pratiques et l’activité de conception, comment se construit le savoir de conception et comment il se transmet. Là aussi, la notion d’objet intermédiaire s’est révélée particulièrement féconde pour rendre compte des médiations par lesquelles les ingénieurs entre eux mais aussi avec d’autres groupes professionnels échangent des informations et du savoir.
Est-ce ainsi que vous avez fait le lien avec l’histoire et la construction des savoirs ?
Pas tout à fait. En fait, ce lien s’est fait lorsque plus tard, j’ai travaillé à Grenoble sur les nanotechnologies. J’ai étudié le phénomènes de l’intérieur –c’est-à-dire dans les laboratoires – et de l’extérieur – notamment en suivant ce qui se passait dans la rue. La présence d’une recherche en nanotechnologies à Grenoble n’est pas là par le fruit du hasard. Si l’on regarde l’histoire de la construction du paysage de recherche scientifique dans cette ville, on constate que l’implantation des nanotechnologies est l’héritière d’une longue tradition de recherche.
Pouvez-vous nous expliciter ce phénomène ?
Il y a à Grenoble tous les éléments qui permettent d’analyser la création de ce pôle « micro et nano technologies ». L’approche du terrain donne déjà des éléments. Il est intéressant de voir que les acteurs (industriels, chercheurs, politiques, etc.) se sont emparés de l’histoire de ce territoire et la racontent pour expliquer l’émergence à Grenoble de ce pôle « micro et nano technologies ». Mais ce qui est particulièrement pertinent est de voir que le fait qu’ils racontent cette histoire ait aussi des effets. Par exemple, l’idée qui circule à Grenoble est qu’il n’y a pas de barrière. Pas de barrière disciplinaire ; pas de barrière pour entrer dans tel ou tel établissement. Ce n’est évidemment pas juste. Il suffit de voir comment cela se passe avec le CEA par exemple, pour des raisons de sécurité. Mais le fait que les gens disent, en se référant à l’histoire locale, qu’ici, il n’y a pas de barrière, cela a des effets. Cela sous-entend qu’il y a une mobilité plus forte qu’ailleurs, que les gens peuvent passer du privé au public voire d’une institution à l’autre, que les gens coopèrent plus facilement, etc.
Cela signifie donc que ce mouvement de personnes a une influence sur la construction des savoirs ?
Nous pouvons penser que oui. Lorsqu’il s’agit du lien entre recherche scientifique et industrie, nous pouvons imaginer que les liens sont forts et les transferts de connaissances aussi : l’innovation technique baigne dans la recherche scientifique et le milieu industriel est, à son tour, enraciné dans la recherche scientifique. Les chercheurs sont aussi « branchés » sur des questions émanant de l’industrie ; ils s’en emparent et les transforment en questions fondamentales pour ouvrir d’autres champs de recherche. Par exemple, certains chercheurs ont récupéré des machines de production industrielle et ont, sur ces dernières, mis en place des expériences de type « recherche fondamentale ». Ceci fait que le fondamental peut circuler vers l’industriel et vice versa. Ceci n’est sans doute pas neutre dans l’histoire que l’on raconte sur Grenoble et dans le fait qu’on dise « ici, il n’y a pas de barrière ».
En quoi est-ce spécifique à l’histoire de Grenoble ?
Ce n’est sans doute pas unique. Il y a sans doute d’autres villes qui développent ce genre de liens. Toutefois, lorsque je suis arrivé à Grenoble, on m’a dit que c’était là, la ville de l’interdisciplinarité. La ville est petite, les liens entre recherche scientifique et milieu industriel sont opérants et il y a des mélanges entre disciplines ; les sciences dures côtoient les sciences humaines et sociales. Ceci relève sans doute d’une vision un peu utopique ; mais ces histoires qui circulent sur la ville, participent à transmettre cette image d’interdisciplinarité et mettent les personnes concernées dans la possibilité de la fabriquer. L’histoire que les gens racontent semble avoir des effets performatifs sur l’histoire que les gens construisent. Si on reprend l’exemple des nanotechnologies, les gens racontent une histoire presque linéaire de la maîtrise de l’eau à la création du pôle Minatec en passant par l’implantation du CEA, de la présence de Louis Néel ; et dans cette histoire la composante « interdisciplinarité » est toujours évoquée. Mais il faut se rendre compte qu’il s’agit là de linéarités qui se construisent a posteriori en désignant les nano comme le prolongement évident de l’histoire. Il est évident que l’histoire ne peut être si linéaire et qu’il y a forcément des bifurcations. C’est aussi une question de choix. Certes, le traitement de l’eau peut mener aux nanotechnologies mais il a aussi beaucoup contribué au développement de l’industrie papetière. Il n’était donc pas évident non plus que l’on arrive aux nanotechnologies de façon inéluctable. Grenoble, ce n’est pas seulement les nanotechnologies. Mais l’idée est quand même de dire que ce qui se construit au présent est l’héritier des étapes du passé. Il ne faut pas non plus rentrer dans la caricature en se plaçant dans une position déterministe qui consisterait à dire que le passé détermine le présent. Mais il y a parfois des étapes qui s’avèrent être nécessaires pour avancer dans une direction donnée. Par exemple, il ne paraîtrait pas possible que d’autres villes développent à terme un pôle fort en nanotechnologies, si elles ne possèdent actuellement ni les institutions, ni les compétences techniques et scientifiques nécessaires. En revanche, leur excellence est peut-être ailleurs ; c’est notamment le cas pour Lyon dans les domaines de la santé et de la chimie.
Si je comprends bien, l’histoire de la ville et le discours dominant sur une spécialité donnée orientent les stratégies de développement en matière de recherche scientifique et technique ?
Oui, c’est cela. Mais en même temps, les autres secteurs profitent de cela pour se développer. Par exemple, les industries papetière et textile revendiquent leur excellence et veulent profiter de la vague « nanotechnologies ». Le réseau traditionnel des PME de ces domaines s’est alors rapproché des grands laboratoires de recherche pour entamer de nouveaux projets et notamment ceux concernant le papier et le textile intelligents. A travers ces exemples, on voit donc bien qu’il est difficile de décider ce qui est déterminant dans l’histoire d’une métropole. Mais on voit bien également que ce qui a été construit en matière d’institutions, de compétences, de structures mais aussi d’habitudes de travail, d’habitudes de collaboration, etc. dans le passé orientent les stratégies du présent.
Mais pensez-vous que les acteurs impliqués aient conscience de cette histoire et de son influence ?
Oui. Les acteurs se racontent entre eux cette histoire et s’en imprègnent. De plus, si je reste dans l’exemple de Grenoble, il y a de nombreux lieux informels où les gens de différentes institutions se rencontrent et re-fabriquent du diagnostic et de l’histoire. Donc, les décideurs sont imprégnés d’histoire(s). Cela est important et façonne les choses.
A travers ces exemples, vous nous avez bien montré comment l’histoire locale et ce que l’on dit d’elle influencent les orientations et la recherche scientifique, mais observe-t-on ce phénomène avec les sciences humaines et sociales ? Et de façon plus général, l’histoire joue-t-elle un rôle dans la construction des savoirs en sciences humaines et sociales ?
Oui, on voit dans l’histoire grenobloise qu’à un moment donné les sciences économiques étaient très fortes avec des orientations particulières notamment vers l’économie « régulationniste ». Cela a eu de l’influence car ces économistes se sont tournés vers les industriels et ont influencé les formations d’ingénieurs. Ils ont en effet réussi à injecter dans la formation d’ingénieur des sciences humaines et sociales. A la fin des années 1980, une école d’ingénieurs a été créée à l’Institut National Polytechnique de Grenoble (INPG) sous la double tutelle de l’INPG et de l’Université des Sciences Sociales avec un réseau d’économistes, de sociologues, d’ergonomes, d’historiens devant travailler en relation très étroite avec les ingénieurs. On est encore là dans l’héritage de l’histoire et du modèle grenoblois. Ma présence à Grenoble tient d’ailleurs à cette histoire. Mais il faut être méfiant aussi car l’histoire peut influencer de façon négative le développement de recherches et ce, surtout lorsqu’elle est porteuse de polémiques, de scissions, de mésentente. Elle peut enfermer les chercheurs dans des guerres intestines et infécondes. Il faut bien se rendre compte aussi que même pour les sciences humaines et sociales, l’histoire n’est pas déterminante. On peut modifier les choses de façon positive ou négative. Par exemple, en ce moment, le mouvement d’interdisciplinarité qui avait fondé les recherches à Grenoble est en train de perdre de la vitesse au profit d’une orientation disciplinaire. On ne peut évidemment que le déplorer.
En d’autres termes, en tant que sociologue, l’observation et l’analyse de l’interférence entre l’histoire et la construction des savoirs, vous sert d’expérimentation ?
C’est en effet un peu le cas, à la nuance près que je ne suis pas historien et que je ne peux pas toujours reconstruire le passé sans risquer de le faire à la lumière des événements du présent. Mais, en tant que sociologue, je m’intéresse davantage aux histoires que les gens racontent qu’à l’histoire proprement dite. Là où il y a expérimentation, c’est que j’observe le présent, donc des situations qui sont en cours et c’est à partir de ces observations que j’émets des hypothèses. Mais ce qui est encore différent par rapport aux sciences dures est que je ne contrôle pas les conditions d’expérience et je ne suis jamais sûr de ne pas perturber le système : est-ce que les hypothèses que j’énonce ont ou non une influence sur les événements futurs.
Vous évoquiez tout à l’heure Bruno Latour, mais pensez-vous également que nous construisons notre savoir sur le savoir de ceux qui nous ont précédé ou sur notre connaissance de l’histoire de notre discipline de recherche ?
Evidemment, dans les sciences, le savoir se construit largement en référence au savoir déjà construit par d’autres. Le fait de citer d’autres ouvrages et articles dans nos publications exprime notamment la dette intellectuelle que nous avons vis-à-vis des collègues dont nous empruntons des concepts, des méthodes et des données. Cela dit, la référence au travail des collègues, voire à l’histoire de sa propre discipline, peut jouer dans le sens d’un processus de capitalisation et d’accumulation continue de connaissances nouvelles comme dans le sens de la construction de démarcations, de bifurcations et de ruptures. L’histoire de sa propre discipline est souvent moins mobilisées dans les sciences de la nature et de l’ingénieur que dans les sciences sociales où la référence aux pères fondateurs, à des auteurs déjà anciens ainsi qu’aux grandes mutations de la discipline continue à nourrir la pensée la plus à la pointe de la recherche.
Cela voudrait dire que l’on ne peut pas avoir de vision prospective sans connaître le passé ?
Oui, retourner sur le passé pour comprendre le présent et le futur me paraît être déterminant. Le futur n’est pas déterminé par le passé mais cela aide à comprendre certaines choses : que peut-on prévoir ? Sur quelles forces peut-on s’appuyer ?
Il y a des choses qui nous échappent, évidemment et qui modifient le système. Par exemple lorsqu’un grand groupe tel Motorola vient s’installer à Grenoble, cela ne s’explique pas seulement par l’histoire locale. Une entreprise multinationale comme celle-là déploie sa stratégie à l’échelle mondiale ; Grenoble n’est qu’une opportunité éventuellement transitoire de ce point de vue.
Si on se détache un peu des territoires et que l’on s’intéresse aux disciplines, à quel niveau l’histoire peut-elle être déterminante dans les recherches en sciences humaines et sociales ?
La sociologie a plusieurs pères fondateurs. Nous avons donc plusieurs approches sociologiques très différentes les unes des autres et cela constitue un patrimoine intéressant. Cela nous donne aussi une posture de recherche originale dans le sens où nous ne nous enfermons pas dans une façon de faire et de penser unique. Plus précisément pour la sociologie des sciences, se replonger dans l’histoire permet de comprendre pourquoi l’on travaille sur tel ou tel sujet et pourquoi on l’aborde avec une méthodologie précise. On a besoin d’avoir de temps à autre une vision historique de nos recherches. Cela nous permet de nous recadrer et aussi d’envisager des directives de recherche pour l’avenir. C’est aussi pour cela que l’ouvrage – qui permet une recherche complète intégrant des éléments d’histoire – reste un élément très important dans les publications des chercheurs en sciences humaines et sociales. On a besoin de ce genre d’ouvrage et on a besoin que l’institution le valorise. On a besoin de ce type de travaux synthétiques pour que nos recherches soient placées dans un ensemble. On a malheureusement aujourd’hui peu de temps pour réaliser ce genre de travaux et on se trouve dans une situation où de jeunes chercheurs en viennent à ignorer l’histoire de leur discipline au profit d’une réactivité intellectuelle faisant référence aux derniers travaux publiés sur le plan international. Et ceci est d’autant plus vrai en sciences dures.
En d’autres termes interdisciplinarité et histoire sont donc primordiales à la construction de savoirs scientifiques que ce soit en sciences humaines et sociales ou en sciences dures parce qu’elles permettent la prise de recul et l’esprit critique ?
Oui, elles aident à identifier les questions et à les relativiser, à identifier de nouveaux défis aussi. Par contre, les évolutions récentes de la gestion de la carrière des chercheurs et des mécanismes d’évaluation auxquels ils sont soumis ne sont guère favorables à ce genre de pratique scientifique. Les sciences risquent de souffrir de l’absence de réflexivité historique tandis que l’hyperspécialisation conduit inévitablement au fait que les chercheurs manquent de vision d’ensemble. Les travaux de synthèse et de réflexivité sociohistorique sur les sciences, qui doivent aujourd’hui s’appuyer aussi sur la scientométrie et la sociologie des sciences, sont une nécessité pour la communauté scientifique elle-même.
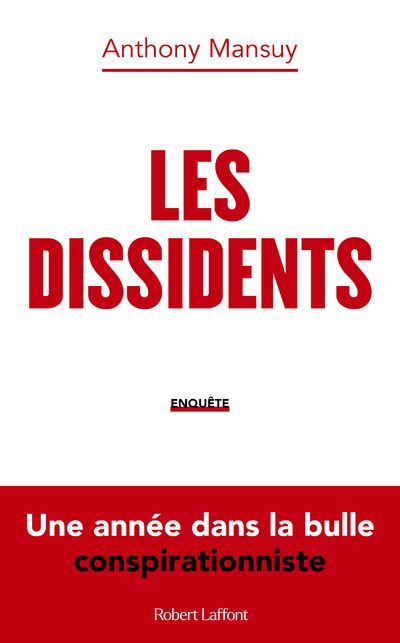
Article
Après la poussée de complotisme constatée pendant la pandémie, quels enseignements tirer pour réconcilier sciences et engagement citoyen ?

Texte de Marianne CHOUTEAU
Comment proposer un cadre normatif à l’exercice de la recherche tout en permettant une indispensable liberté scientifique ?

Des bulletins pour approfondir vos connaissances au sujet de la vie des sciences humaines et sociales de la Métropole Lyon-St Étienne

Étude
Huit récits d'aventures scientifiques dans la région lyonnaise.

Étude
Ce document retrace les collaborations entreprises ou réalisées au cours des 5 premières années d’existence du Grand Lyon en tant que Métropole.
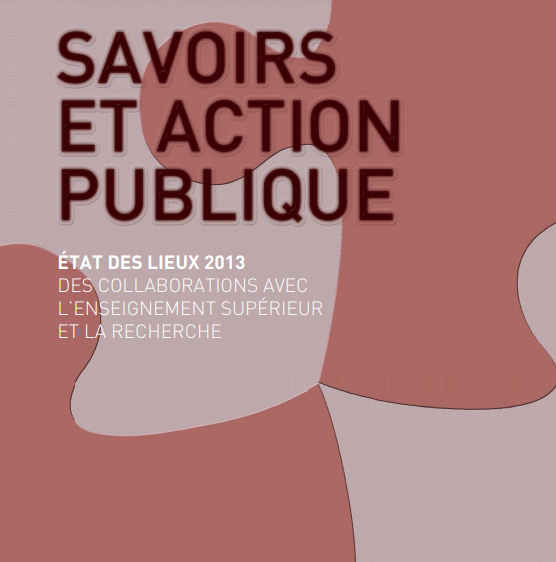
Étude
Cette nouvelle édition traduit un renouvellement significatif des projets engagés avec les sphères académiques. Parmi la cinquantaine de collaborations recensées, la recherche de connaissances au service de l’action apparaît comme un fil conducteur.
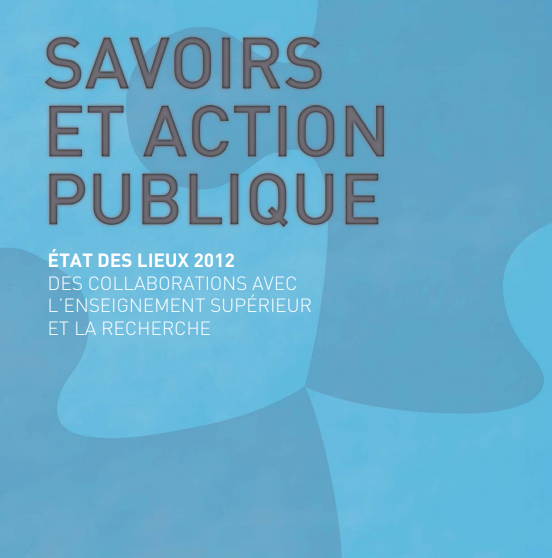
Étude
Cette nouvelle édition du livret des partenariats de recherche entre le Grand Lyon, l’Agence d'urbanisme de Lyon et les milieux académiques s’étoffe en présentant 52 collaborations engagées.

Étude
L’état des lieux présenté dans ce document montre que les collaborations du Grand Lyon et celles de l’Agence d’Urbanisme avec les établissements d’enseignement supérieur et de recherche ne sont pas récentes.

Étude
Qui a peur du grand méchant Mooc ?