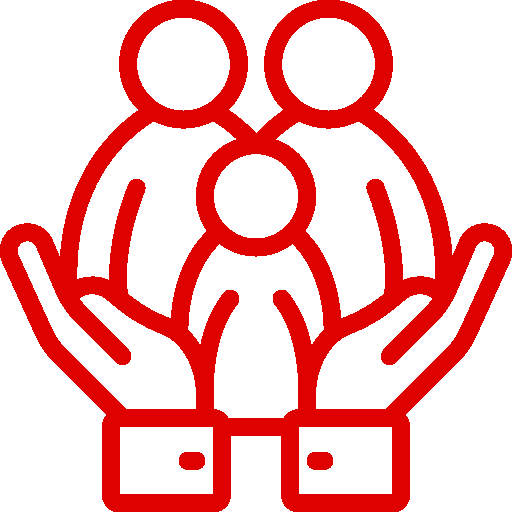Pouvez-vous nous racontez en quelques mots votre parcours jusqu’à la création de Cook&Go ?
Je suis lyonnais d’origine. Après une classe prépa à Lyon, j’ai suivi un parcours école de commerce à l’ESSEC. Tout en ayant en tête l’envie de créer mon entreprise, j’ai débuté ma carrière professionnelle au sein du Groupe Danone sur des fonctions commerciales. Cette expérience m’a permis de bien appréhender la réalité du terrain et du contact client. Au bout de deux ans, je me suis senti suffisamment solide pour franchir le pas. J’ai créé Cook&Go à Lyon en 2006, j’avais 26 ans.
Revenons justement sur la création de Cook&Go. Quelle est l’origine du concept ?
L’idée de départ est venue de mon propre besoin. J’étais jeune actif, j’aimais bien avoir mes amis chez moi, autour d’un bon repas. C’est comme cela que j’ai imaginé des lieux ludique et conviviaux pour des personnes qui souhaitent préparer des bons petits plats pour leurs proches. Et donc Cook&Go est un concept d’atelier de cuisine qui est à la fois un loisir et un service pratique. Ce que nous proposons à nos clients, c’est de marier le plaisir d’apprendre à cuisiner avec un chef et la préparation de repas qu’ils vont ensuite déguster chez eux avec leurs proches.
En effet, ce qui fait le caractère innovant du concept Cook&Go est que nos clients viennent cuisiner chez nous pour des occasions de la vie quotidienne – repas entre amis, diner aux chandelles, anniversaire, repas de famille, etc. – et un nombre précis de personnes. Nous proposons ainsi une carte de menus « entrée-plat-dessert » qui change tous les mois. Les clients, de leur côté, s’inscrivent aux ateliers en choisissant le nombre de personnes pour lesquelles ils souhaitent cuisiner. Lorsque l’on vient à plusieurs, les tarifs sont dégressifs et au-delà d’un certain nombre de personnes, l’atelier peut être privatisé.
Un économiste comme Philippe Moati explique que le secteur du commerce au sens large connait aujourd’hui une mutation profonde, se traduisant avant tout par le fait que les enseignes adopteraient une orientation-client de plus en plus prononcée, avec des concepts commerciaux plus segmentant, s’inscrivant davantage dans une logique servicielle. Le concept Cook&Go ne participe-t-il pas de cette évolution ?
Je ne connais pas ces réflexions, mais je pense également que nous entrons dans un nouveau type de commerce, sur deux aspects principaux. Le premier c’est celui que vous évoquez, à savoir l’accent mis sur l’expérience. Ce que nous proposons chez Cook&Go, c’est avant tout une expérience. Certes, nos clients repartent avec un menu, mais cela n’a rien à voir avec le fait d’aller chez un traiteur ou d’acheter des produits dans un supermarché pour cuisiner chez soi. Venir chez Cook&Go, c’est comme faire une sortie au ciné ou dans un bar à vins avec des copains, c’est une vraie expérience de loisir ! C’est chaleureux, c’est coloré, il y a de la musique, on vous sert un verre de vin pendant que vous cuisinez…
L’expérientiel est essentiel chez nous parce qu’il est au cœur de la valeur proposée au client. Mais je pense qu’il s’agit d’une tendance plus générale consistant à faire de l’acte d’achat une expérience valorisant le client. De mon point de vue, cette importance croissante de l’expérientiel dans le commerce découle de l’essor d’internet. Aujourd’hui, il est plus facile d’acheter une paire de chaussure sur internet qu’en magasin ! Les commerces ne peuvent plus continuer à vendre de la même manière. Pour renouveler l’envie de venir en boutique, cette dernière doit proposer une expérience exceptionnelle. C’est bien ce que nous montrent les Apple Store, les boutiques Hollister ou encore Abercrombie, qui sont en train de renouveler en profondeur la manière avec laquelle on vend de l’électronique grand public ou du prêt-à-porter.
Le deuxième point qui caractérise Cook&Go et qui traduit également une évolution de fond du commerce concerne lui aussi internet. Dès le départ, nous avons donné une place essentielle à internet dans notre stratégie puisque nous nous en servons pour faire venir des personnes dans nos ateliers. Ces dernières années on parle de plus en plus de cross-canal, de web-to-store, etc. Chez Cook&Go, nous mettons en œuvre cette stratégie depuis 2006.
Quelle était votre ambition de départ au moment de la création du concept ?
Dès le début, mon projet était de développer une enseigne multi-points de vente. J’ai travaillé le concept, le marketing et la logistique de façon à ce qu’ils soient facilement modélisables, duplicables et adaptables dans d’autres villes.
Comment on passe du concept à l’entreprise ? Comment avez-vous mis en musique votre projet ?
La première phase, essentielle, est celle de l’expérimentation avec le premier point de vente pilote. On teste tout, on fait des erreurs, on adapte, on peaufine. Nous avons travaillé en particulier deux points clés : l’offre et la logistique. On a beau faire des études de marché approfondies, la réalité du terrain est toujours différente de ce que l’on imaginait. Il faut donc écouter ses clients, comprendre ce qu’ils aiment, ce qu’ils aiment moins, et adapter petit-à-petit l’offre à toutes ces remarques : au niveau des recettes, de la manière d’accueillir, d’animer, etc. Ces premiers mois de lancement sont essentiels. La logistique a également pas mal évoluée, puisque l’augmentation du volume d’activité implique une augmentation des flux de matières alimentaires entrant et sortant. Au début, on accueillait 4/5 personnes par atelier, et lorsqu’il a fallu en accueillir une vingtaine, il a fallu adapter la logistique.
Le fait d’être à Lyon pour lancer votre entreprise, est-ce que ce fut un plus, un handicap, ou est-ce que cela n’a pas eu d’influence ?
Je pense que c’est un plus, pour plusieurs raisons. Tout d’abord, Lyon est une ville abordable financièrement pour démarrer une activité. Quand on a un niveau de loyer cinq fois inférieur à Paris, lorsque l’on fait des premiers mois d’activités pas terrible, on perd moins d’argent et donc on se met moins en danger. C’est un avantage non négligeable. Je pense également que c’est une ville très dynamique économiquement et qui possède des réseaux d’entrepreneurs très efficaces. Je fais partie du Réseau Entreprendre, de l’association des anciens de l’ESSEC et de l’association Croissance Plus. Ces réseaux sont très bien représentés à Lyon. En faire partie permet d’aller plus vite, d’être mis facilement en relation avec les partenaires dont on a besoin pour lancer son activité. D’une manière générale, c’est une ville avec un tissu entrepreneurial où l’on fait connaissance rapidement et où les liens sont assez forts. C’est une taille de ville où l’on arrive vite à une situation où tout le monde se connait, se fait confiance et s’apporte une aide mutuelle. Et puis je peux évoquer l’action de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Lyon (CCIL) et le réseau Lyon Commerce Leader qui aident à partager les bonnes expériences, les bonnes pratiques, etc.
Enfin, je dirais que, dans l’optique de créer une enseigne avec un réseau de points de vente, il est sans doute préférable de démarrer à Lyon plutôt qu’à Paris. Une ville de la taille de Lyon permet plus facilement de valider la possibilité de dupliquer un concept dans des villes de taille inférieure. Cela est moins évident si vous démarrez à Paris. Je le vois avec mes confrères de l’Atelier des Chefs, qui ont un concept un peu différent, davantage axé sur le cours de cuisine traditionnel. Ils ont démarré à Paris avec un atelier pilote de 250m², 600 000 euros d’investissements et un chiffre d’affaires de 800 000 à 1 million d’euros. Mais ce concept n’est duplicable que dans des très grandes villes. Au final, leur potentiel de développement est limité. De notre côté, le concept Cook&Go, c’est 100m², 200 000 euros d’investissement et entre 300 000 et 400 000 euros de chiffres d’affaires. Notre modèle peut donc être adapté à des aires de chalandise plus réduites, ce qui permet d’envisager un potentiel de marché beaucoup plus important. Et en même temps, si ça marche à Lyon, on sait que ce sera beaucoup plus facile de se développer à Paris. Bref, réussir à Lyon permet d’ouvrir de plus larges horizons qu’à Paris. Je pense que c’est un bel atout !
Quelles ont été les grandes étapes du développement de l’enseigne Cook&Go jusqu’ici ?
La phase de consolidation du concept avec le premier point de vente a duré trois ans, jusqu’en 2009. Lorsque l’on arrive à quelque chose qui tient la route, qui est rentable et peut être duplicable, on peut passer à la suite et envisager la création d’autres points de vente. Et pour cela, il faut de l’argent. Un premier choix aurait pu être de suivre un développement très progressif, en fonction de nos seules capacités d’investissement. Nous aurions aujourd’hui deux ou trois points de vente. J’ai préféré lever des fonds auprès de partenaires pour aller vite et prendre une position de leader sur le marché de l’atelier de cuisine grand public. Une fois que l’on a eu les fonds, nous avons construit un plan de développement et structuré les choses au fur et à mesure au niveau de l’organisation humaine.
Les premières duplications ont été réalisées en 2009-2010, avec l’ouverture de deux points de vente à Paris et un à Marseille. On passe donc de un à quatre ateliers. Pour autant, à ce moment-là, on reste encore sur une organisation très light. Concrètement, seules les deux personnes qui géraient l’atelier de Lyon, c’est-à-dire moi-même et mon associé chef cuisinier, montent d’un cran pour superviser l’ensemble. Et l’on recrée les mêmes binômes dans chacun des points de vente. On reste sur un management très direct, sans fonction support. Dans cette première phase de duplication, on garde donc un esprit très TPE.
A partir de 2011, on relève des fonds pour accélérer le développement. En 2011, on ouvre trois nouvelles succursales : Grenoble, Lille et un troisième atelier à Paris. On poursuit avec une deuxième succursale à Lyon en avril 2012, au sein du pôle de commerce Lyon-Confluence. En huit mois, nous doublons de taille avec huit succursales. En parallèle, on engage le développement de la franchise, avec un contrat de franchise qui est prêt fin 2011. Nous participons au salon de la franchise à Paris en 2012, ce qui nous permet d’ouvrir trois ateliers en franchise cette même année, à Nantes, Rennes et Villeneuve d’Ascq. Le développement de la franchise s’accélère ensuite puisque nous ouvrons trois nouveaux points de vente en 2013, à Levallois-Perret, Orléans et Bordeaux. Enfin, cette année ça s’accélère encore puisque nous avons d’ores et déjà ouvert deux franchises, à Tour et Paris, et nous avons six ouvertures en préparation, à Annecy, Montpellier, Aix-en-Provence, Massy-Palaiseau, Pointe-à-Pitre et Strasbourg. Face à une telle accélération, la structuration beaucoup plus forte de l’organisation humaine est devenue indispensable. On atteint une taille de PME, avec une organisation en propre et des organisations en franchise. Nous avons mis en place une tête de réseau avec une direction de la franchise, un service marketing, un service contrôle de gestion, un responsable commercial…
Pourquoi avoir opté également pour un développement par la franchise ?
Il y a un double intérêt d’utiliser la franchise pour nous développer. Le premier renvoie à l’ADN de Cook&Go. Comme je le disais tout à l’heure, nous sommes une enseigne qui propose d’abord une expérience : on vend de la convivialité, du partage, du fun. Et la qualité de cette expérience repose d’abord et avant tout sur l’implication humaine des personnes qui accueillent nos clients. Or, il est beaucoup plus facile de proposer cette expérience lorsque vous vous appuyez sur quelqu’un qui est son propre patron dans son propre commerce, que sur des salariés. Il ne s’agit pas de remettre en cause les qualités des salariés, mais simplement de constater, comme on l’observe dans tous les réseaux de franchises, que l’entrepreneur sera toujours plus impliqué dans le projet qu’un salarié. Et cet aspect, comme je viens de l’expliquer, a d’autant plus d’importance pour nous puisque notre valeur ajoutée repose essentiellement sur la relation humaine qui se noue avec nos clients.
Ensuite, la deuxième raison de cette priorité donnée à la franchise est plus classique. La franchise nous donne la capacité de nous déployer plus rapidement que si l’on fonctionnait à 100% avec des succursales. En effet, les ressources financières nécessaires au développement sont en partie apportées par le franchisé, ce qui permet de réduire le coût du développement à moyen terme. Toutefois, il est faux de considérer que le développement en franchise ne coûte pas cher. Il faut en effet consentir des ressources importantes pour bien modéliser les savoir-faire, pour définir un contrat de franchise solide, pour structurer le service dédié à la franchise, pour bien accompagner nos franchisés dans le lancement de leur activité, pour animer le réseau, etc. Tout cela ne se fait pas sans argent. Par contre, une fois que l’on a atteint une taille critique, il devient beaucoup plus facile d’élargir le réseau.
Voici les deux raisons qui nous amènent à privilégier la franchise. Cela ne veut pas dire que l’on n’ouvrira plus de succursales, mais on souhaite aujourd’hui atteindre un ratio de 25% de succursales pour 75% de franchises.
Quelles ont été les principales difficultés rencontrées dans cette phase de développement rapide ?
Et bien c’est justement les difficultés propres aux entreprises qui se développent de façon accélérée. Lorsque l’on croit de 100% par an, vous rencontrez nécessairement une crise de croissance. Ce rythme de croissance ne peut pas être assuré de façon fluide, où tout serait calé, calibré, graduel… C’est impossible ! Cela génère forcément des tensions. C’est ça le plus difficile. Il y a des tensions humaines parce que tout le monde est sur-sollicité. Il y a des tensions financières parce qu’il faut injecter de l’argent au fur et à mesure pour alimenter le développement. Il y a des tensions en termes d’espace parce que l’organisation s’étoffe, etc.
Quelle est l’ambition de Cook&Go pour les années à venir ?
Avec seize ateliers à notre actif, nous avons d’ores et déjà pris une position de leader sur le marché de l’atelier de cuisine. A la fin de l’année, nous en aurons vingt-quatre. Fin 2015, nous en aurons probablement une trentaine. Mon objectif est d’arriver à une cinquantaine d’unités d’ici trois à cinq ans pour avoir une taille permettant à l’enseigne de gagner en notoriété. Ce point est crucial pour notre développement à venir. Aujourd’hui, ce qui nous manque c’est la notoriété, c’est-à-dire faire reconnaitre par le grand public la spécificité de notre enseigne. Les gens qui ne connaissent pas notre enseigne ne s’attendent pas à trouver un concept comme le nôtre. Nous sommes encore assimilés à un cours de cuisine traditionnel, alors que nous sommes plus que cela, nous proposons un autre mode de consommation autour de la cuisine.
Mon ambition est donc de m’appuyer sur le maillage géographique pour gagner en notoriété auprès des actifs urbains qui consomment des loisirs. Cette nouvelle notoriété serait un véritable un point de bascule dans la mesure où elle nous permettrait de descendre le palier en termes de zones de chalandise, en passant de 100 000 à 50 000 habitants. L’idée est de passer un nouveau cap de développement et de porter notre réseau à une centaine voire deux-cent unités d’ici dix ans.
Vous avez ouvert un atelier à New-York. Est-ce la cerise sur le gâteau ou avez-vous des ambitions à l’international également ?
C’est plutôt la cerise sur le gâteau. Le développement à l’international, c’est assez compliqué. Il y a une demande, mais la cuisine est quelque chose de très culturel. De multiples adaptations sont à apporter au concept, au niveau des menus notamment. Pour l’instant, l’international n’est pas au cœur de notre stratégie de développement.
Si l’on revient à présent sur les soutiens et accompagnements qui ont contribué à la réussite de votre projet entrepreneurial, que vous ont apporté en particulier les réseaux que vous évoquiez tout à l’heure ?
Les réseaux sont très précieux car ils permettent de lever la tête du guidon et de pouvoir « se confier ». En fait, quand on lance son entreprise, on est très seul. On se pose plein de questions tous les jours sur le devenir de l’entreprise, la stratégie et les décisions à prendre : est-ce que mon entreprise va survivre ? est-ce que je dois licencier un salarié ? est-ce que je dois expérimenter un nouveau produit ? etc. Et évidemment on ne va pas partager nos interrogations et notre stress avec les salariés. Donc, sur toutes ces questions stratégiques, pouvoir compter sur des gens qui sont passés ou passent par les mêmes étapes et ont des expériences différentes, c’est quelque chose de très important car cela permet d’éviter beaucoup d’erreurs.
D’ailleurs, les chiffres parlent d’eux-mêmes. Le taux de survie au bout de cinq ans des entreprises qui font partie du Réseau Entreprendre est de 90%, contre une sur deux pour l’ensemble des entreprises en France. Ces réseaux favorisent la pérennisation de l’entreprise mais ils contribuent à la définition de sa stratégie de développement. Par exemple, on peut se demander mutuellement « comment tu fais du web-to-store ? », « c’est quoi ton programme de fidélité ? », « elle ressemble à quoi ta newsletter ? », « comment tu mesures la satisfaction de tes clients ? », etc.
Et sur le versant public, quel soutien avez-vous pu recevoir ?
Votre question est un peu délicate car elle amène à pointer des dysfonctionnements dans la manière avec laquelle l’Etat soutient les entreprises. Le problème essentiel, c’est qu’il soutient beaucoup plus les entreprises en création et les grandes entreprises que les entreprises en développement. En France, il est beaucoup plus facile de créer une entreprise que de la développer. On parle beaucoup des difficultés administratives, règlementaires ou fiscales que rencontreraient les entrepreneurs en France. En réalité, cela ne concerne pas la création. Franchement, créer une entreprise, c’est d’une facilité déconcertante ! Les statuts, on les trouve sur internet et on a juste à mettre le nom de l’entreprise. On les dépose au greffe du tribunal de commerce, ça coute 50 euros. Ensuite, on est indemnisé par Pôle Emploi si l’on a travaillé auparavant, on ne paye pas de charges sociales pendant x années, on nous donne des chèques conseil pour aller voir un avocat ou un comptable gratuitement, et j’en passe. Bien sûr, cela n’enlève pas les difficultés que j’évoquais tout à l’heure. En tous les cas, on ne peut pas dire que la puissance publique met des bâtons dans les roues à ceux qui veulent créer une entreprise.
En revanche, la réalité est tout autre concernant la phase de développement. Au bout de quelques années, les différentes aides auxquelles vous aviez accès disparaissent. Il y a toutes les charges qui vous tombent dessus d’un coup. Plus l’entreprise s’accroit, plus les taux de charges sociales s’élèvent. Ces effets de seuil sont particulièrement négatifs : lorsque l’on atteint dix salariés, vingt salariés, cinquante salariés, les taux de charge montent brusquement. Pourquoi a-t-on autant d’entreprises de 49 salariés en France ? Parce que le cinquantième salarié coute beaucoup plus cher que son seul recrutement. Sans compter que ces seuils impliquent également de mettre en place des délégués du personnel, de financer un Comité d’Entreprise, etc. Vous ajoutez à cela le fait que les banques rechignent plus à prêter à des entrepreneurs qui se développent qu’à ceux qui créent, alors même que le risque de défaut est plus élevé chez ces derniers ! Elles préfèrent recruter de nouveaux clients que soutenir ceux qu’elles ont déjà… Bref, financer le développement de quelque chose qui marche est plus compliqué que financer quelque chose qui n’a pas encore fait ses preuves. D’une manière générale, l’environnement n’apparait pas propice au développement. On pourrait même dire qu’il a un effet plutôt décourageant.
Vous voulez dire que les pouvoirs publics se focalisent trop sur la création et pas assez sur le développement des entreprises ?
En France, c’est assez net. J’ai participé récemment au G20 des entrepreneurs, évènement qui rassemble des délégations d’entrepreneurs des pays membres du G20. Et j’ai pu constater que ce n’est pas le cas partout. Je pense que l’Etat doit prendre conscience que ce sont les entreprises en forte croissance qu’il faut soutenir en priorité ! C’est par elles que passe la lutte contre le chômage puisque ce sont elles qui créent le plus gros des emplois ! Sur les cinq dernières années, dans les vingt pays les plus riches du monde, 85% des emplois créés le sont par des entreprises qui ont entre trois et dix ans ! C’est-à-dire par les entreprises qui ont passé le stade de la création et qui connaissent un développement de leur activité. Ce ne sont pas les grandes firmes qui créent de l’emploi. Au contraire, elles le compressent.
Quant aux entreprises en création, elles réamorcent la pompe et renouvellent le tissu entrepreneurial, mais par définition elles sont dans une phase transitoire pendant laquelle elles mettent à l’épreuve la viabilité de leur concept. On ne peut miser que sur la création pour avoir un effet en termes d’emploi. C’est lorsque que les entreprises sont dans leur phase de développement rapide que l’effet d’entrainement sur l’emploi est le plus fort. Concrètement chez Cook&Go nous sommes passés de deux emplois au départ, c’est-à-dire mon associé et moi, à soixante emplois aujourd’hui. Demain si le réseau de points de vente passe à deux-cents unités, cela fera combien d’emplois à la clé ? Et c’est sans compter les emplois indirects. En définitive, je trouve que l’on est très peu encouragé et remercié par l’Etat de créer des emplois. C’est d’ailleurs assez rageant de voir que les grandes entreprises, c’est-à-dire celles qui contribuent plutôt à détruire de l’emploi, assument en réalité des prélèvements obligatoires inférieurs à nous grâce à leurs stratégies d’optimisation fiscale. Tout cela contribue à donner une mauvaise image de l’entreprise en général, avec tous les poncifs sur les « salaud de patron », alors que nous sommes nombreux à souhaiter développer des emplois.
De mon point de vue, débloquer la création d’emploi passe par la modification de l’environnement réglementaire et fiscal que j’évoquais tout à l’heure. Par exemple, sur les charges sociales, pourquoi accroitre le taux de prélèvement lors que l’entreprise augmente sa taille alors que l’augmentation du volume d’activité permet déjà à la puissance publique d’accroitre ses rentrées fiscales ? Ce qui serait logique selon moi, c’est de faire en sorte que la modulation des taux de charges sociales n’ait pas un effet récessif sur la croissance de l’entreprise mais au contraire contribue à la booster. D’ailleurs il existait certains dispositifs suivant cette logique. Mais ils ont malheureusement disparu. Je pense notamment au dispositif Gazelle qui permettait d’alléger les charges sociales des entreprises qui augmentaient leur masse salariale de plus de 25% par an. Si je reprends l’exemple de Cook&Go, notre masse salariale augmente de plus de 25% par an depuis 2009, par contre les charges salariales augmentent encore plus rapidement du fait que l’on passe des seuils… Encore une fois, j’insiste sur le côté pervers de ces seuils car lorsque l’on est en forte croissance, bien souvent, il faut mettre la charrue avant les bœufs : on commence par recruter les gens avant de créer de la valeur, donc on ne rentabilise pas instantanément le développement de l’entreprise. Bref, tous les chefs d’entreprises en développement vous le diront, le cœur du problème ce sont les effets de seuil concernant les charges sociales. Le reste, ça peut aller : l’impôt sur les sociétés n’est pas excessif, la TVA est à peu près la même partout en Europe…
Donc selon vous la question du soutien aux entreprises en croissance relève d’abord de l’Etat ?
L’Etat est évidemment en première ligne. Mais je pense que, même sur ces aspects de charges sociales, les collectivités peuvent agir. D’une certaine manière, elles pourraient utiliser leurs aides pour atténuer les erreurs nationales. Il faudrait pouvoir dire aux chefs d’entreprises en croissance « si vous augmente votre masse salariale de x% par an, nous vous aiderons à réduire le coût de ces créations d’emplois, le temps qu’elles deviennent rentables ». Cela permettrait de dégoupiller la création d’emplois dans beaucoup d’entreprises et serait un message fort donné à l’extérieur du territoire.
A l’échelle de l’agglomération lyonnaise, des pôles de compétitivité ont été mis en place pour renforcer l’innovation dans les grandes filières exportatrices lyonnaises comme les biotech. Ce type de dispositif vous parait-il pertinent dans le champ du commerce et des services marchands ?
Oui et non. Je suis tout à fait favorable aux aides et aux dispositifs de soutien aux entreprises innovantes. Et ce serait évidemment positif d’étendre ces dispositifs aux entreprises du commerce et des services. Mais encore une fois, il ne faut pas se tromper d’objectif et faire des raccourcis trop rapides. L’engouement actuel autour de l’innovation et des entreprises dites innovantes me parait trompeur. On s’en tient trop souvent à une approche technologique de l’innovation : en caricaturant à peine, on a l’impression que seul l’ingénieur peut innover. Les autres formes d’innovation qui mettent l’accent sur le marketing et le service, et notamment celles qui se développement au plus près des consommateurs comme dans le commerce et les services marchands sont négligées ou ignorées. Pourtant, les entreprises de ces secteurs d’activités montrent que l’on n’a pas nécessairement besoin d’être innovant technologiquement pour connaitre un développement rapide. Il n’y a pas que des entreprises hi-tech parmi les entreprises qui connaissent une croissance accélérée ! Si on jugeait davantage une innovation par son impact sur la croissance du chiffre d’affaires, et même sur l’emploi, on s’apercevrait que la place de l’innovation technologique dans le développement des entreprises est moins importante que ce que l’on pense. D’ailleurs, même si l’on prend un exemple très technologique, comme les produits d’Apple, on s’aperçoit que le savoir-faire de la marque est avant tout un savoir-faire marketing pour définir les bons concepts de produits.
Le problème aujourd’hui, c’est que cette attention donnée à l’innovation technologique tend à masquer justement la question plus large et plus cruciale du développement des entreprises. L’innovation est un levier, il est loin d’être le seul. Si j’avais un message à faire passer, ce serait donc de concentrer les aides non pas sur les entreprises innovantes mais sur les entreprises en croissance, et en particulier sur celles dont l’emploi progresse le plus vite. C’est un critère simple, qui devrait primer sur les autres : aujourd’hui, on semble partir du principe que, parce qu’une entreprise connait un développement rapide, celle-ci n’a plus besoin d’aide. On devrait plutôt se dire : ces entreprises contribuent fortement à la croissance économique nationale, comment faire en sorte qu’elles poursuivent sur leur lancée ? J’ajoute que, même lorsque des dispositifs d’aide mettent l’accent sur le développement, on peut rencontrer une difficulté sur la manière avec laquelle on définit le périmètre des entreprises en croissance. Par exemple, j’ai postulé au dispositif Pépite du Grand Lyon qui est destiné aux entreprises en forte croissance. Or, nous n’avons pas été retenus parce que le dispositif est réservé aux entreprises de l’industrie et des services aux entreprises ! Pourquoi ne pas soutenir toutes les entreprises en développement ?
Pour moi, cette sélection sectorielle a d’autant moins de sens qu’il n’y a pas que les filières industrielles qui ont une capacité exportatrice. Le commerce et les services marchands peuvent contribuer eux-aussi à ramener des richesses sur le territoire lyonnais. En développant un réseau de points de vente dans toute la France, une enseigne comme Cook&Go génère des flux financiers vers le siège social lyonnais : le chiffre d’affaires des succursales, les droits d’entrée et les redevances sur le chiffre d’affaires versés par nos franchisés. Or, c’est bien à Lyon que nous acquittons les impôts locaux sur les entreprises. De plus, puisque le siège est à Lyon, tous les emplois liés aux fonctions de tête de réseau le sont également.
Enfin, pour revenir à votre question, je pense que la logique des pôles de compétitivité doit être adaptée aux secteurs du commerce et des services. Car on ne voit pas bien comment un groupe d’enseignes pourraient collaborer pour mettre au point un concept commercial commun ou créer collectivement des concepts pour chacune d’elles. La création d’un concept commercial peut s’appuyer sur la mobilisation d’un réseau comme je le disais tout à l’heure. Mais cela reste informel, on ne peut pas le formaliser, le planifier et l’organiser comme le font les pôles de compétitivité. En revanche, la logique de projets collaboratifs des pôles de compétitivité pourrait être intéressante pour tout ce qui concerne le développement d’une enseigne. Car il y a de multiples manières d’envisager ce développement, que ce soit au niveau du modèle économique, des relations avec les franchisés, avec les fournisseurs, de la logistique, de la relation client, etc. Un bémol cependant, je ne pense pas que deux enseignes directement concurrentes accepteront de se retrouver autour de la table pour envisager ensemble les conditions de leur développement.