Le citoyen 2.0 et la ville : lequel façonne l’autre ?

Texte de Dominique CARDON
Comment le territoire s'enrichit de l'expérience numérique des utilisateurs.
Interview de Stefana BROADBENT

<< Les pouvoirs publics devraient s'attacher à proposer des espaces d'échanges qui correspondent à une sensibilité européenne, organisés selon une logique non commerciale, et qui puissent faire circuler d'autres types de contenus >>.
Propos recueillis par Catherine Foret pour la revue M3 n°5
La séparation des activités professionnelles et personnelles se trouve mise à mal par l’intrusion des sollicitations via les outils numériques en tout lieu et à toute heure. Débordement de l’intime dans les sphères sociales ? Résistance à la marchandisation de l’attention ? Stefana Broadbent porte son regard d’anthropologue sur ces évolutions sociales qui redéfinissent les frontières de nos libertés.
Pourquoi vous être intéressée aux usages des outils numériques en tant qu’anthropologue ?
J’ai commencé à m’intéresser aux usages numériques dans le monde professionnel il y a une vingtaine d’années, puis j’ai suivi l’entrée d’Internet dans les foyers. Il est important que les sciences sociales se penchent sur ce phénomène, qui induit des transformations tellement radicales. L’anthropologie aime donner une voix aux personnes qui n’en ont pas, que ce soit dans les pays lointains ou près de chez nous : notre approche comporte donc un côté politique, absent dans les disciplines qui abordent traditionnellement les questions relatives à la technologie comme l’informatique ou le marketing. À l’University College of London (UCL) avec mes collègues et mes étudiants, nous eexplorons la dimension interculturelle de ces pratiques, par exemple à travers l’usage de Skype chez les migrants.
Des études portent sur des communautés particulières de hackers, de joueurs, de personnes âgées ou encore sur la manière dont les sans-abri, les ouvriers chinois ou les jeunes professionnels en Inde utilisent ces technologies. L’objectif est toujours de saisir les évolutions de la société en cours.
Vous affirmez que savoir gérer son attention devient un enjeu majeur dans nos sociétés contemporaines. Pourquoi ?
En étudiant les communications personnelles au travail, j’ai été frappée par la quantité des échanges intimes que les gens entretiennent depuis leur lieu d’activité, grâce au téléphone mobile ou à d’autres canaux de communication, comme Internet. J’ai ensuite constaté que l’essentiel de ces communications avait lieu avec un petit nombre de personnes proches, toujours les mêmes, puis remarqué qu’il existait d’énormes disparités sociales en la matière. Alors que les managers ont accès à toutes sortes de canaux dont Facebook, les salariés cantonnés à des postes subalternes sont soumis à des règles d’usage très strictes. La gestion de l’attention d’autrui constitue un véritable élément de discrimination sociale : on donne à certains le droit de gérer leur attention, et pas à d’autres. Et cette distinction correspond étroitement à l’organisation du travail dans les entreprises : plus la gestion s’effectue par projets, plus la liberté d’accès est importante ; plus la gestion se fonde sur la mesure du temps de travail, plus il y a de contrôle. Cela illustre la croyance en la triangulation productivité-isolement- attention, selon laquelle il faudrait isoler les personnes pour qu’elles soient attentives, pour qu’elles puissent être plus productives.
Et ce n’est pas le cas ?
Ce n’est pas si simple, car l’attention est cyclique. Les distractions numériques pas au pic de l’activité professionnelle, mais lors de moments creux, lorsque les personnes arrivent au bout d’une tâche compliquée ou requérant une forte concentration. C’est lorsque l’on souffle un peu, que l’on va envoyer un SMS ou consulter sa messagerie. Nous essayons ainsi d’aborder l’attention sous plusieurs angles, notamment social, cognitif, économique, car elle devient vraiment un sujet central dans l’évolution de nos sociétés avec le développement des activités numériques.
Vous parlez du contrôle de l’attention comme d’une nouvelle étape du capitalisme, en expliquant que nous sommes en train d’assister à la création d’un « marché de l’attention
Ce point est abordé dans un article récent écrit avec Claire Lobet-Maris. Le capitalisme a réalisé le contrôle sur les corps, puis s’est appuyé sur une organisation scientifique du travail. L’étape contemporaine, à l’âge numérique, passe par le contrôle sur l’attention. La plupart des acteurs de l’industrie du numérique fonctionnent sur l’idée de monétariser l’attention, de la transformer en valeur financière. Google et les autres systèmes comparables gagnent de l’argent en utilisant l’attention de chacun comme monnaie.
Constatez-vous des formes de résistance à cette évolution ?
Oui. Des salariées des fabriques de packaging, à Londres, où des caméras contrôlent chaque poste de travail, nous ont expliqué comment elles se cachaient pour téléphoner, en essayant de trouver l’angle mort. Certains nous disent qu’ils font semblant de sortir fumer parce que c’est autorisé, alors qu’il est interdit de téléphoner. Les disparités de traitement observées en la matière risquent de s’estomper. Il est très difficile de contrôler légalement
l’usage des nouveaux téléphones mobiles, car ce sont des outils personnels à l’inverse des ordinateurs, qui appartiennent à l’employeur. Le contrôle est encore très fort dans certains domaines à risque, ou dans les écoles, mais il cède la place à des règles d’usage : il est mal vu de faire certaines choses dans certains contextes… Les normes collectives ne sont pas seulement imposées d’en haut.
L’importance des communications intimes au travail témoigne selon vous d’un besoin de continuité entre nos différentes sphères d’activité, professionnelle, sociale, familiale… Est-ce un phénomène nouveau ?
Oui et non. Il faut rappeler que l’industrialisation du travail a instauré une rupture entre la sphère familiale et la sphère professionnelle, il y a 150 ans. Auparavant, l’économie familiale était intimement imbriquée avec l’économie de production, que ce soit à la campagne ou en ville avec les activités préindustrielles : le continuum relationnel était assuré pour les individus. La crise profonde, économique et financière, que nous traversons, remet à l’ordre
du jour ce besoin de se tenir en contact permanent. Cela tient aussi au fait qu’il existe très peu d’institutions par lesquelles les gens se sentent tenus ou défendus. Le groupe social proche (un partenaire, les parents ou des amis) fonctionne comme soutien moral et psychologique et apparaît comme la seule référence stable à travers le temps, étant donné la flexibilisation du travail, le peu de confiance dans le futur, etc.
La recherche de continuité affective se joue également dans l’espace public. Qu’avez-vous observé comme pratiques ?
Les gens utilisent beaucoup les instruments de communication numériques dans les phases de transition de la journée, comme des outils qui leur servent à passer d’un état à un autre. Le matin, les jeunes commencent par regarder leur mobile, consultent Facebook, vérifient leur boîte mail, etc. Beaucoup planifient ainsi leur journée, se mettent dans un état propice au travail. De même, beaucoup d’appels et de petits messages sont échangés en fin de journée. Nombre de ces communications, qui ont lieu dans les transports et dans les espaces extérieurs, n’ont pas d’autre fonction que de signifier que l’on quitte sa personnalité professionnelle pour entrer dans sa personnalité sociale, personnelle.
Qu’en déduire sur notre rapport aux autres, sur la qualité de notre attention à ce qui nous environne ?
On critique souvent le fait que les gens ne se parlent plus dans la rue. Mais le phénomène a commencé il y a bien longtemps. Michael Bull a abordé ce sujet dans son très beau livre Sound Moves, publié en 2007. Il décrit l’isolement du monde extérieur créé par l’écoute musicale dans la rue, et comment ce moyen est utilisé pour gérer son humeur. C’est une bonne analyse de ce qui est en train de se passer dans les villes européennes : l’aspiration, lorsqu’on est dehors, à demeurer dans un espace personnel, toujours avec son petit monde. Le processus de privatisation de l’espace public, qui a commencé avec la voiture, fonctionne selon le même principe. Les voitures sont devenues des espaces très personnels. Au point que les embouteillages peuvent être intéressants finalement : ce sont des moments à soi, où l’on peut écouter de la musique fort, manger, fumer, se maquiller… En Angleterre, les jeunes
passent moins leur permis de conduire, et la première explication est économique. Mais cela révèle peut-être un fait de société : le véritable concurrent de la voiture serait l’iPod qui permet de se balader dans un lieu public avec ses écouteurs, ses jeux, comme dans une sorte de cocon.
Faut-il voir là une manifestation du déclin de la vie publique, tel que le décrit Richard Sennett ?
Richard Sennett montre qu’il y a sûrement un retrait de la cité, que nous constatons aussi. J’ai un peu d’espoir avec le groupe de travail ONLIFE DG Connect auquel je participe au niveau européen Le monde numérique peut susciter de nouvelles formes de cité. Des activités plus collectives, des formes d’engagement nouvelles apparaissent on line. Certains de mes étudiants travaillent sur des groupes d’activistes, par exemple, et sur l’usage
qu’ils font du Web. Mais cela reste pour l’instant des poches d’activité limitées. La majorité des échanges a lieu au sein de groupes déjà soudés.
Quels enjeux émergent pour les aménageurs et gestionnaires de l’espace urbain ?
Compenser le caractère très individuel des objets numériques dédiés à la personne. en créant des services plus sociaux, comme les fabricants essayent de le faire, me semble moyennement intéressant et mène à l’exclusion. Une autre voie consisterait à exploiter les nouvelles technologies de l’ubiquité pour encourager des usages beaucoup plus collectifs, à l’image de ce qu’évoque Daniel Kaplan, de la Fondation Internet Nouvelle Génération, à propos de la redistribution des données produites par les villes et les organisations. Mais cette optique-là demande un utilisateur relativement engagé, prêt à utiliser ces données.
Il faudrait parvenir à créer du désir autour de ces d’usages ?
Oui, c’est le problème. La grosse machinerie médiatique américaine est très forte pour créer du désir en cultivant nos pires instincts. Sherry Turkle, dans Alone together, explique comment la technologie, souvent, parie sur nos instincts les plus mauvais. Mais rien n’est substitutif, les espaces de communication s’ajoutent. Skype n’élimine pas le téléphone, de même que Facebook n’a pas éliminé LinkedIn : on utilise les deux… Les pouvoirs publics, en Europe, devraient s’attacher à proposer des espaces de discussion, d’échanges, qui correspondent à une sensibilité plus européenne, organisés selon une logique non commerciale, plus civique, et qui puissent faire circuler d’autres types de contenus. Le moment est propice, et c’est un rôle que les villes peuvent prendre. Le niveau local constitue la bonne échelle, parce que la plupart des contacts importants sont de proximité, et parce que les rencontres face à face sont préférées.
Le face-à-face est toujours recherché ?
Toutes les études le montrent : plus les échanges numériques augmentent, plus augmentent aussi les contacts en face-à-face. Facebook marche sur la potentialité d’une vraie rencontre. Les moyens de communication numériques ne sont que des véhicules pour soutenir le face-à-face, pour sa préparation, sa mémorisation… Ils servent à planifier la rencontre, pour prendre des photos, pour les partager, mais le besoin de l’événement est là et le désir d’authenticité reste très fort. Je n’ai aucun doute là-dessus. Les villes doivent continuer à proposer des politiques favorisant les rencontres physiques, parce que le désir est celui-là. Le désir, c’est la rencontre.

Texte de Dominique CARDON
Comment le territoire s'enrichit de l'expérience numérique des utilisateurs.

Article
La Revue dessinée a publié plusieurs reportages sur les conséquences écologiques et sociales de nos usages digitaux. Avec humour, l'un de ces textes nous permet de prendre la mesure du piège écologique que constitue notre addiction au numérique.

Interview de Laetitia Dablanc
urbaniste et enseigne à l’Université Gustave Eiffel

Interview de Samuel Deprez
maître de conférences (HDR) en aménagement et urbanisme à l’Université Le Havre Normandie

Article
Si la transition écologique doit s’envisager comme une réorientation globale et transversale de nos modes de vie, les enjeux de mobilité devront être saisis comme l’un des dénominateurs communs aux différents secteurs d’activité à transformer.
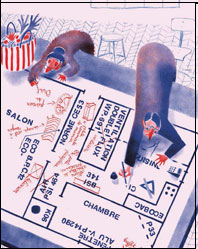
Texte de Gaëtan BRISEPIERRE, Catherine GRANDCLEMENT et Vincent RENAULD
L’appropriation des bâtiments verts, leur bon usage, conditionnent leur efficacité même. Changeons de regard et privilégions les compromis socio-techniques contre la pédagogie verticale.

Étude
Un espace public ? Des espaces publics ? Pour quels usages ? Dans le fond, de quoi parle-t-on ? Nos vidéos vous l’expliquent.

Étude
Dans ce numéro : un dossier consacré à la ville servicielle.

Étude
Cette étude propose une analyse stratégique des acteurs dans/de l’espace public pour intégrer préoccupations écologiques et usages numériques.