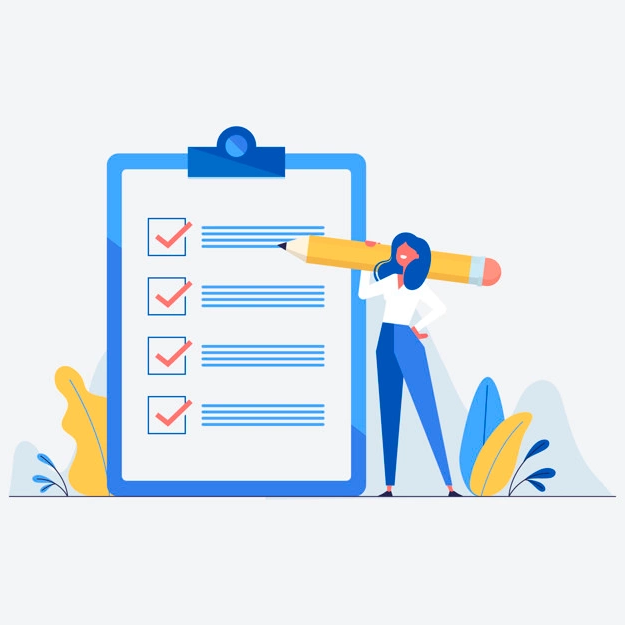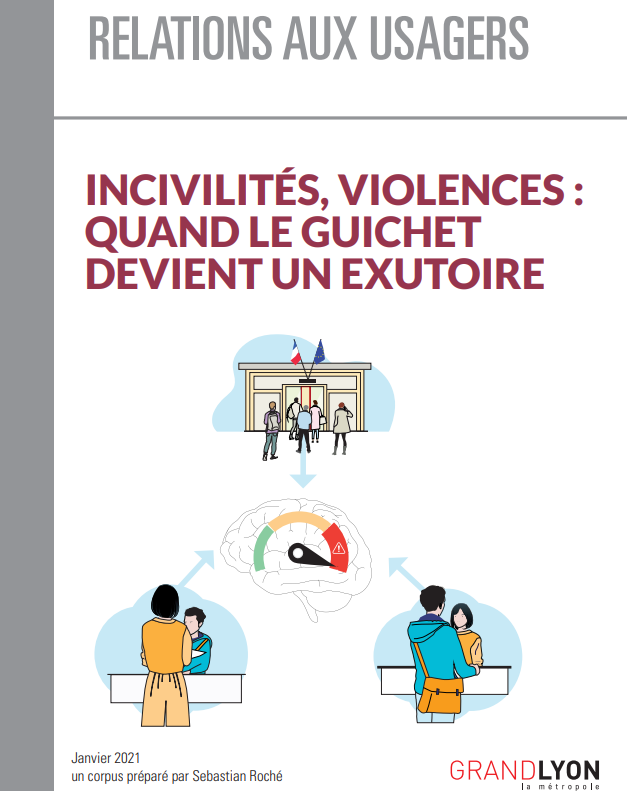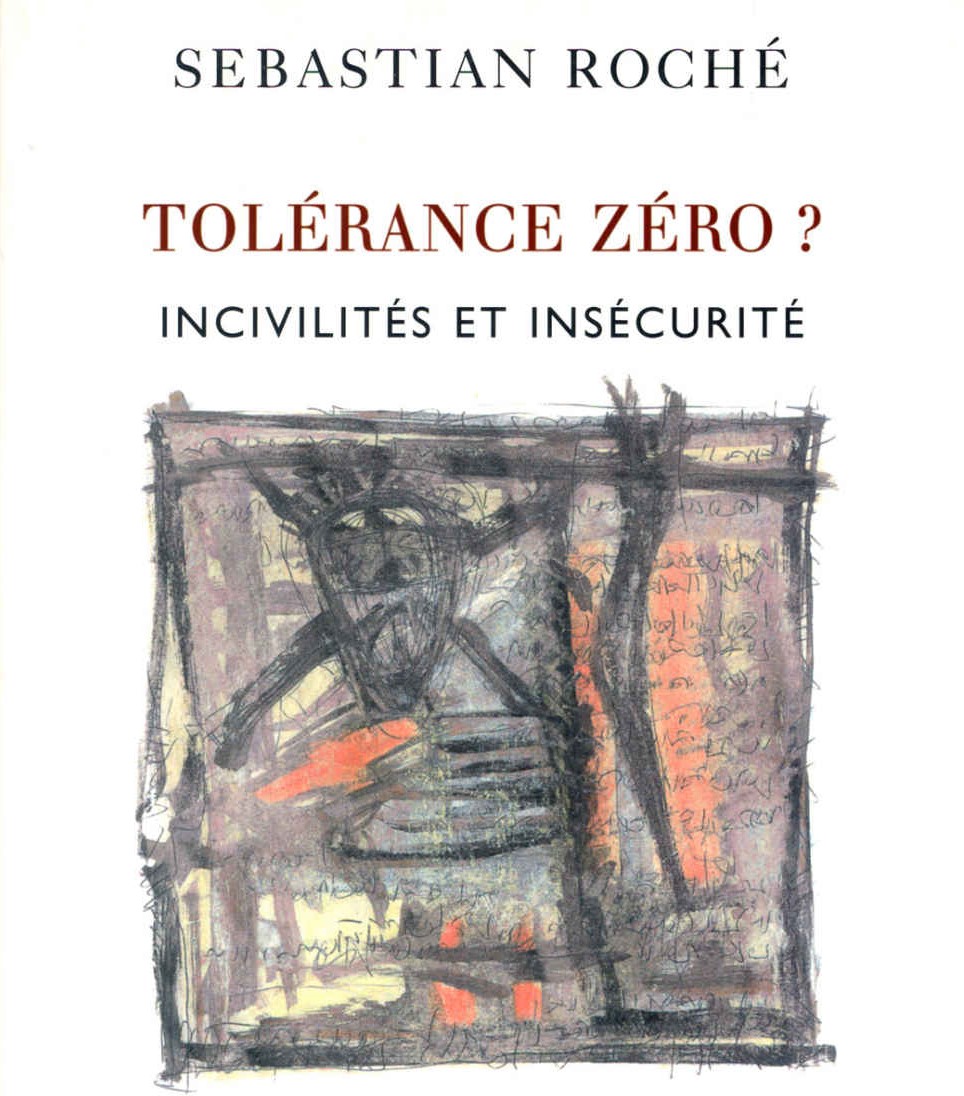Gaëlle Clavandier est Maître de conférences en Sociologie à l’Université Jean Monnet, Saint-Étienne, ET Chercheure au Centre Max Weber - Équipe Dynamiques de la vie privée et des institutions.
Elle a publié La Mort collective. Pour une sociologie des catastrophes, (CNRS Éditions, 2004) et Sociologie de la mort. Vivre et mourir dans la société contemporaine (Armand Colin, 2009). C’est à partir de son travail sur la sociologie des catastrophes et des morts collectives que Gaëlle Clavandier a élargi son champ de recherche au thème de la mort, de la place de la mort, des corps, des cérémonies d’adieu, des sépultures, des cénotaphes, et elle a notamment abordé tout particulièrement la question de la crémation. Inhumation et crémation répondent aux mêmes objectifs, notamment celui d’un respect dû au corps mort, mais surtout celui qui réitère que le souvenir des morts est l’un des principes de base de notre civilisation (Clavandier, 2008c).
Qu'est-ce qu’un rituel funéraire et comment prend-il naissance ?
C'est une question complexe quand on la confronte à la période présente. On peut, peut-être, l’aborder à partir d’une autre question, posée dans les années 1970, à savoir : assiste-t-on à une déritualisation des pratiques funéraires dans un contexte où la pratique religieuse décline ?
Ainsi, la tradition, essentiellement catholique, de la mort en grande pompe, très organisée, appuyée sur un rituel religieux parfois ostentatoire a-t-elle disparu ? Existe-t-il d’autres types de rituel, qui auraient à voir avec un rituel laïc se substituant à cette prise en charge de la mort par le religieux ? Certains chercheurs ont avancé l’idée que, dès lors qu’il s’agissait de formes profanes et laïques, on ne pouvait plus parler de rituel, mais de cérémonial. D’autres, en revanche, ont maintenu la terminologie de rituels. Et certains chercheurs, notamment Louis-Vincent Thomas, à partir des années 70 et jusque dans les années 90, ont considéré qu'on était dans une ère de déritualisation et de désocialisation du rapport à la mort, qui pouvait néanmoins être pris en charge à titre individuel et sans cérémonial.
La question du rituel s’est également posée avec la montée de la crémation.
Pour l'inhumation, on avait suffisamment de recul, et, même si les rituels ont évolué (je pense ici aux funérailles), leur structure et leur organisation sont restées assez proches de ce qu'on pouvait connaître par le passé. En revanche, pour la crémation, il fallait tout inventer. Au départ, un certain nombre d’intellectuels, mais aussi de professionnels se sont élevés contre l'absence de prise en charge, de cérémonial ou de rituel. S’appuyant sur ce constat, il semblerait que les opérateurs funéraires, voire des associations aient mis en place des cérémonies, souvent laïques, qui visent à créer un instant particulier autour de l'adieu.
Comment le rituel fait-il sens par rapport au sacré ?
On a souvent tendance à associer le rituel au sacré. Mais depuis vingt ans on dispose de travaux sur les « rites profanes », notamment ceux de Claude Rivière. Tous les anthropologues ne sont pas d'accord sur cette question, mais l'exemple du Sida, a été très significatif. On s'est rendu compte à cette occasion qu'il existait des rituels profanes, hors de la dimension du sacré, mis en place par des collectifs d’individus, ici, principalement des associations militants pour la reconnaissance de la communauté gay.
S’il n’y a pas de sacré, il y a en revanche une dimension symbolique. C'est sans doute la différence. Le rituel religieux fait sens relativement au sacré. Le rituel profane, relativement au symbolique. On peut aussi parler de « dispositifs », terme plus neutre que celui de rituel, dont on a vu qu’ils ont très bien fonctionné pour les morts du Sida. Après plus généralement il est important de se poser la question de comment se construit le sens ? Quand des rituels sont vendus comme des prestations, on ne se situe pas dans un registre symbolique, de même on ne convoque pas du rituel et on ne paye pas du rituel. C'est une organisation sociale qui fait que le rituel est au cœur d'un dispositif et la dimension symbolique est très importante.
Le rituel est donc l’expression d’un ensemble de codes communs dont la répétition sociale dans un ensemble social fait sens...
Oui, mais il ne s’agit pas simplement de codes, lesquels ne portent pas nécessairement du symbole. On le comprend mieux lorsqu’on pointe la différence entre un pictogramme (qui est un code intelligible avec une seule signification) et un symbole (dont l’interprétation est polysémique). Le rituel se passe sur une scène, avec des acteurs, un protocole, une scénographie, des décors, une finalité, le tout dans une temporalité définie... Souvent on a tendance à vouloir appliquer de manière un peu volontariste les différents attributs du rituel. Certaines entreprises de pompes funèbres ont bien compris qu’il y avait un enjeu de donner du sens aux cérémonies, mais il est difficile de ne pas tronçonner le cérémonial en juxtaposant des moments, des rencontres.
Pour le deuil, à la différence peut-être des mariages et des naissances moins porteurs d'angoisse, je pense qu'on a du mal à réinventer des choses. Sans doute également, notre société de consommation est plus prompte à accompagner des événements heureux.
Quelle est la fonction du rituel funéraire ?
Les sociologues préfèrent éviter d’utiliser le terme de fonction qui renvoie à un courant de recherche désormais décrié, le fonctionnalisme. Mais, pour faire simple et pour répondre à votre question, l’une des premières fonctions du rituel funéraire était d’agir comme un anxiolytique permettant de faire de la mort un fait culturel, donc de dépasser la réalité (décès, processus de thanatomorphose) et de négocier le non-sens de la mort. Aujourd'hui face à un deuil, surtout s’il s’avère « compliqué », douloureux, on va voir le médecin, le psychiatre et on prend des médicaments psychotropes.
On peut également entreprendre une psychothérapie qui vise, par la parole, à libérer certaines tensions occasionnées par le décès d’un proche. Les rituels, et particulièrement les rituels funéraires, avaient une fonction anxiolytique de réassurance avec des étapes obligées décrites par les ethnologues : la séparation d’avec le corps/cadavre, le deuil, la réintégration des endeuillés et du défunt. Chacun va trouver sa place, ou plutôt retrouver une place, grâce à un dispositif d’accompagnement, quel que soit sa forme. On aborde ici la question du passage. L’homme change de statut en mourant. Dans les sociétés traditionnelles, le défunt devenait un ancêtre bienfaiteur et il ne fallait rater aucune étape sans quoi il pouvait devenir un mal-mort, un être non stabilisé (avec ces images de vampire, fantôme, revenant, etc.). D'où l'intérêt de mettre en place un processus rituel pour ne pas être dans la peur, dans le deuil sans fin. Cela posait aussi la question de l’adhésion du rite.
Vous évoquez ici une fonction psychologique, individuelle, mais qui a également une dimension sociale.
Fonction sociale parce que cathartique. Il s’agit de ressentir des émotions en commun. On peut alors parler de communauté d’endeuillés, laquelle a moins de sens aujourd’hui puisque le deuil se construit à une autre échelle, celle de la famille, des relations interindividuelles. Néanmoins, on observe encore ce sentiment de catharsis dans des morts atypiques, comme dans le cas de morts collectives, lors de catastrophes. Si les communautés de vie, villageoise, paysanne ont disparu, la dimension communautaire peut également exister sur le plan religieux. La fonction cathartique et anxiolytique vaut pour le groupe, plus que pour l’individu. La mort d'un personnage connu peut aussi créer des désorganisations sociales qu’il faut réparer et donc anticiper.
De même, à l'échelle d'une famille, quand quelqu'un décède, cela crée un vide et il faut reconstruire quelque chose, redonner une place, et ce qui se fait en fonction du contexte social. Prenons le cas des femmes qui ont perdu leur mari pendant une guerre. Ici, le deuil était levé assez rapidement pour que celles-ci puissent se remarier, avoir des enfants, etc. Le rituel est donc aussi lié au contexte, aux normes en vigueur, lesquelles changent. Ce que je vous décrits depuis le début de cet entretien correspond à une prise en charge de type traditionnelle. Depuis les années 1950, cette organisation sociale pérenne a périclité pour donner lieu à d’autres types de pratiques, moins organisées, plus flottantes mais qui relèvent elles aussi d’un processus de socialisation, avec ces relations, ces préconisations…
Qu’en est-il de la fonction sociale au sens de la représentation sur la scène collective ? Vous parliez tout à l'heure de la pompe, mais aussi d’une scénographie du rituel. Le rituel funéraire a-t-il encore cette fonction sociale d'instaurer une hiérarchie dans le groupe ?
C'est de moins en moins le cas. Pascale Trompette, spécialiste du marché des pompes funèbres, montre que c'est le prix médian des prestations funéraires qui est le plus choisi, quelle que soit la classe sociale ou le milieu social. Bien sûr les familles les plus pauvres vont pouvoir bénéficier d’un accompagnement des pouvoirs publics, mais peu de personnes sont prêtes à sacrifier toutes leurs économies pour les obsèques d’un proche. Il y donc a assez peu de distinctions sociales pour la prise en charge des funérailles. Il demeure quelques signes, comme le faire-part de décès dans les journaux, etc., qui vont concerner les Grandes familles, à Lyon comme ailleurs. Mais cela se voit assez peu par rapport à ce qui a pu se faire. En revanche, si vous vous promenez dans un cimetière pour voir les tombes des années 1880 à 1940, vous verrez ce phénomène de stratification sociale.
La fonction anthropologique est-elle la même que la fonction religieuse ?
Oui, elles sont redondantes. Sauf que, comme je vous l'expliquais, le rituel sacré s'étiolant, soit il va être remplacé par quelque chose, de l’ordre du profane, soit il n’est remplacé par rien, toute la question étant de savoir si cela fait défaut. On est presque dans un jugement quand on dit que cela « fait défaut » parce qu’on présuppose qu'il faut qu'il y ait quelque chose plutôt que rien. C'est une vraie question.
Oui, car si on répond par la négative, cela signifierait que la fonction anthropologique du rituel funéraire n'est pas nécessaire !
J'aurais tendance à penser que si. Mais ce quelque chose est-il nécessairement de l’ordre du rituel ou plus simplement de la prise en charge, des relations, des prescriptions, quelle que soit leur échelle : interindividuelle, familiale, sociétale. Certains chercheurs pensent que ce qui prime, c’est moins la dimension rituelle que celle de la socialisation. Aujourd’hui comme hier, les corps morts ne partent pas à décharge publique. La loi a même intégré que l’on doit traiter le corps mort avec respect, dignité et décence. Il me semble, que nos contemporains pensent qu’il doit y avoir une prise en charge, pas seulement technique et individuelle, que celle-ci soit d'ordre rituel ou pas, mais en tout cas, certainement d'ordre politique, social, psychologique.
Quand vous dites politique ?
Il y a un enjeu politique dans la prise en charge des morts et les cimetières relèvent de la responsabilité des communes. Cette dimension politique reste prégnante. Elle se présente sous sa forme moderne dès la Révolution française comme le montre la création des cimetières « communaux ». On peut étudier l’histoire du rapport à la mort par cette question du politique ou des institutions. Depuis 2009, par exemple, il est interdit de créer des espaces funéraires d'ordre privatif et d’en faire commerce. L'État se pose en garant sur ces questions funéraires en imposant un espace républicain, laïc et public. D’où la place ambigüe des carrés « dits confessionnels » dans le droit français. L’action de l’État, par l'intermédiaire de la loi notamment, se pose donc de manière très forte, de même que les communes, à leur échelle, puisqu’ils gèrent la politique funéraire. On peut tout à fait imaginer qu’un jour, en France, comme c’est déjà le cas dans certains pays, la dispersion des cendres en pleine nature soit interdite.
Quant à l’enjeu social, on peut le formuler ainsi : Une société peut-elle accepter que le mort ne soit plus considéré comme une personne humaine ? A la fois, il y a la personne juridique, mais il y a aussi ce qu'elle représente d'un point de vue social. La question ne renvoie pas forcément aux sentiments, qui sont de l'ordre du privé, de la famille, mais elle se pose tout de même à la croisée entre le statut légal de la personne et les émotions que son décès peut susciter. Une société acceptera-t-elle un jour que des corps soient jetés aux ordures ? On n'en est évidemment pas là, mais ces questions permettent de comprendre la dimension sociale et symbolique du rapport à la mort. La loi de 2009 a justement insisté sur cette question car, jusque-là, un cadavre n'avait pas de statut. De même, les cendres ont désormais un statut, qui est le même que celui du corps.
Constatez-vous des invariants dans les rites funéraires des différentes religions et même dans les rituels laïcs ?
L'invariant, c'est le trajet croisé du défunt et des proches, le fait que chacun trouve une place, ait un rôle à tenir. On va se séparer du défunt, qui va faire un trajet, et qui va être réintégré, dans une mémoire collective, une mémoire familiale. On retrouve cela dans toutes les sociétés : le trajet du défunt et le trajet des proches du défunt.
A l'inverse, voyez-vous des différences irréductibles ?
Oui. La relation au corps et notamment le caractère invasif de certaines pratiques, comme la thanatopraxie. En Occident, on commence à faire des dissections sur les corps à la Renaissance, à partir du moment où le dualisme corps-esprit se conçoit. Aujourd'hui, quand les gens donnent leur corps à la science, ils sont « mis en morceaux » et on ne recrée pas ultérieurement un corps entier susceptible de bénéficier d’une sépulture au sens « classique » du terme. Le rapport au corps a donc changé. Mais dans la plupart des sociétés dites traditionnelles, ce que nous faisons « subir » au corps, notamment par les soins de conservation, est proscrit. Autre chose, le fait de brûler des corps sans que cela entre dans une dimension rituelle, le fait de déverser les cendres sans forcément construire un projet par rapport à ces cendres, c'est nouveau. Moi qui fais des cours sur la crémation et les soins de thanatopraxie, je constate combien ces pratiques choquent les étudiants de culture maghrébine ou turque, qu’ils soient croyants ou pas. Ils ne comprennent pas ce caractère invasif sur le corps, qui relève pour eux de la profanation.
De même, sur un tout autre plan, l’hommage dû aux morts, mais aussi les protocoles à respecter durant le deuil sont moins formalisés et moins prescrits. On observe un assouplissement de certaines obligations sociales et c’est aux individus, aux proches de se positionner, de prendre en charges les funérailles. Pourtant, ce qui pourrait paraître étonnant, c’est qu’il y a assez peu de demandes incongrues, d’actions novatrices. Donc ce sont davantage des individus, dans leur quotidien, qui vont agir.
Le rituel funéraire est à la fois accompagnement et séparation ?
Oui. Pour la séparation, quelqu’un qui vient de perdre un proche, « l’endeuillé » n'est pas tout à fait quelqu'un d'ordinaire. Il y a tout l'imaginaire de la contamination, certes moins prégnant dans la société contemporaine. Il faut que chacun retrouve sa nouvelle place, le mort et les proches. On retrouve la question des trajectoires, au travers des dimensions temporelles, et celle des statuts. La difficulté aujourd'hui, c'est que toutes ces étapes sont soit compressées, soit rendues invisibles et illisibles.
Un de mes collègues suisse, Marc-Antoine Berthod travaille sur le deuil dans le monde du travail et notamment sur la façon dont les ressources humaines prennent en charge ces questions. Est-ce que dans ce cadre, une personne peut ou doit dire qu’elle est en deuil ? Quand doit-on reprendre son activité ? s'arrêter ? Il a été envisagé, dans un contexte d'économies budgétaires, de diminuer le nombre de jours légaux donnés suite à la perte d'un proche — sachant que pour le mariage, ces questions ne se posent pas ! On peut se demander si, dans le processus d'autonomisation de l'individu comme l’étudie Alain Ehrenberg, la mort n’est pas devenue un événement qui relève de l'intime et, surtout, dont on doit se relever très vite, sans quoi l’individu n’est pas « fort », voire manifeste une fragilité psychologique, etc.
Il semble que la contraction des temps dont vous parliez, qui rythmaient l’après mort, soit un des grands changements de ces dernières années. Il n'y a plus de temps dans la maison, de veillées, etc.
C'est vrai que les rituels funéraires se déroulaient sur une période assez longue. Ils engageaient plus que la seule cérémonie d'adieu lors de l'inhumation ou lors de la crémation. C'est ça qui a effectivement le plus changé. Louis-Vincent Thomas l'expliquait bien. L’évolution du rituel funéraire est liée à l’évolution des modes de vie. Si les formes de sociabilités ont évolué, il n’est pas surprenant que celles qui touchent au domaine funéraires se soient également transformées.
Qu'est-ce qui se passe quand on habite un appartement de deux pièces ? quand la famille est disséminée en divers lieux d’habitations sur des territoires élargies (régions, états…) ?
Par exemple très trivialement, il n’est pas possible d’organiser de repas d’adieu. Ce qui peut expliquer que certains centres funéraires intercommunaux proposent des services repas ou traiteur, à la fois parce qu’il s’agit d’un marché, mais aussi parce qu’il existe assez peu de solutions alternatives pour passer un moment en commun après la cérémonie.
Quant à la veillée, rares sont les corps qui peuvent être conservés « à la maison ». Certes, on peut le veiller un proche dans un salon funéraire, mais il est difficile de le faire jour et nuit. Il est vrai que ce sont des pratiques de moins en moins courantes. Dans certains milieux, dans certaines communautés, notamment chez les musulmans, la présence du corps reste un élément important, même si, toujours pour les musulmans, l'inhumation doit avoir lieu très rapidement après le décès.
Le fait de ne plus le porter, de ne plus s'habiller en noir et, finalement de ne plus reconnaître le deuil, renvoie-t-il à un déni ou signifie-t-il que la mort est devenue taboue ?
C'est très discuté aujourd'hui. À partir des années 1920-30, certains chercheurs américains ont commencé à parler de la libéralisation du marché de la mort. Geoffrey Gorer a été le premier à vraiment travailler la question dans les années 1950-60, en évoquant un nouveau tabou, celui de la mort, lequel venait suppléer à celui du sexe. En France, depuis les années 1970, nombre d’intellectuels, philosophes, historiens, anthropologues ont défendu la thèse d’un « déni » de la mort. L’usage du terme de déni a été préféré à celui de tabou car on peut parler d'un tabou de l'inceste ou d'un tabou alimentaire, parce qu’il est possible de proscrire tel ou tel aliment, mais on ne peut proscrire la mort.
On ne peut donc pas parler de tabou stricto sensu mais plutôt d’une société qui dénie la mort. Malgré tout, certains deuils sont plus problématiques que d'autres et les choses évoluent.
La place prise par le deuil de l'enfant est intéressante à étudier, notre société est plus attentive à cette question du deuil périnatal, des fausses-couches, même précoces, alors qu’il y a quelques décennies, il était fréquent de perdre un bébé à la naissance. C'était « normal », et on redémarrait, les médecins comme l’entourage encourageaient un nouveau projet de grossesse. Aujourd’hui, le deuil périnatal est un vrai problème public. Pourquoi ? Parce que tout est tourné du côté de la vie, et de la vie qui vaut la peine d'être vécue, à partir d'un couple qui forge un désir d'enfant. Lorsque ce désir s'exprime et qu'il rencontre un projet, que l'enfant est conçu, il est très rapidement perçu comme un bébé, non comme un embryon. On détermine son sexe de plus en plus tôt, il porte un prénom et donc une identité avant même d’avoir une existence légale. Avant même de naître, l'enfant est tellement investi qu'il est déjà un individu en puissance. Si la grossesse s'arrête ou si l’enfant meurt à la naissance, cela crée une perte incommensurable.
Dominique Memmi, Directrice de recherche au CNRS, a fait des travaux en milieu hospitalier. Lorsque les parents, notamment les mères, perdent un bébé — qu’il s’agisse d’une interruption médicale de grossesse ou d’un bébé mort pendant l’accouchement —, les sages-femmes ont tendance à accompagner la mère pour qu’elle prenne le bébé dans ses bras, le touche, tout cela pour enclencher un processus de deuil. Il y a quelques années en arrière, quelques que soient les acteurs en présence, on voulait rendre tout cela invisible pour tout de suite penser à une grossesse ultérieure. Dans un contexte de mortalité infantile beaucoup plus élevée, c'était différent. Par ailleurs, la hausse des couples infertiles et des couples qui ont des projets de grossesse tardifs, rend la perte plus lourde.
Le rituel a un caractère itératif, c’est la répétition du geste et c’est cette répétition, conforme, immémoriale presque, qui lui confère son efficacité. Si l’un des piliers de la définition d’un rituel est ce caractère itératif, comme penser le changement du rituel. Je pense moins aux changements imperceptibles qui se font dans le temps qu’aux demandes faites aux religions de plier leur rituel au cadre laïc. Toute transformation n’est-elle pas dénaturation ?
Le caractère itératif du rituel va de soi, mais il ne faut pas non plus donner trop de place à un effet de placage où l’on ferait d’une certaine manière seulement parce que cela se fait comme cela. Il y a certes une forme de croyance mais qui n’est pas accordée les yeux fermés. L’anthropologue Albert Piette a travaillé sur cette question de l’adhésion au rite. Dans certaines sociétés, on ne croit pas forcément au rituel que l'on est en train de mettre en œuvre, mais on fait semblant d'y croire. Ce « faire comme si » est très efficace. Il faut donc que le rite s’inscrive dans une croyance, ou à minima que les acteurs fassent « comme si ». Mais le faire pour le faire, ne fonctionne absolument pas, cela n'a aucune efficacité.
Ceci étant, c'est vrai pour la mort comme pour la naissance, nos pratiques connaissent des évolutions fortes, alors que ces constructions rituelles reposaient sur un caractère pérenne et quasi-immuable. Du XVIème siècle aux années 1920, les rituels funéraires se transforment peu. Ensuite, les historiens décrivent des changements très rapides. La question du rituel pose donc, effectivement, la question de la pérennité dans le temps. A partir du moment où l’on rencontre une explosion de pratiques différentes, qui renvoient à une sorte de catalogue de prestations qui peuvent être proposées, on est sans doute moins dans une organisation de type rituel que dans un dispositif qui prend la forme d’une cérémonie. Ainsi, le temps fort de l’accompagnement se situe lors de l’inhumation ou de la crémation et se concentre désormais sur une période très courte. Ensuite, le processus de deuil concerne davantage les arrangements individuels et familiaux.
Pour ce qui concerne le transfert de l’efficacité d’un rituel religieux modifié pour qu’il entre dans le cadre laïc, je crois que là, il faut faire attention à ne pas confondre deux choses différentes : le fait religieux, le sacré et la tradition qui l’entoure.
Il est difficile de mesurer avec précision ce qui ressort du sacré stricto sensus. Dans les communautés villageoises, les paysans faisaient « porter le deuil » aux ruches ou aux étables. Est-ce du registre du sacré ou du profane ? Il y a aussi l'ancrage du local. Dans les pays alpins, les funérailles avaient une couleur locale, de même, en Bretagne, la perte des marins en mer a marqué durablement les cérémonies.
Certes mais n’altère-t-on pas l’efficacité du rituel musulman quand on leur demande, par exemple, d'enterrer leurs morts dans un cercueil plutôt qu'en pleine terre ou quand on leur dit qu'ils ne seront pas inhumés à perpétuité ?
Ici ne s’agit moins de laïciser des rituels religieux, que d’amener àrendre possible des arrangements. Cela renvoie plus largement à la question de la mort dans un contexte migratoire qui va toujours supposer des aménagements. Pas simplement pour la mort d’ailleurs. Dans un contexte migratoire, l’individu doit sans cesse s'adapter, reconstruire, etc.
Dans certaines familles, on assiste à des dilemmes. Pour les musulmans, le corps doit être enterré rapidement. Alors vaut-il mieux rapatrier le corps, ce qui prend du temps, ou l’enterrer en France ce qui revient à devoir s’adapter au cadre réglementaire ?
Ce sont des négociations qui se font avec les enfants et la famille. En France par exemple, effectivement, on ne peut pas être inhumé en pleine terre. Certains cimetières vont proposer une inhumation en caveau avec de la terre placée dans celui-ci.
C'est vrai que cette question des aménagements, entre ce qui est proscrit, possible ou négociable, est importante et qu’il y a des accommodements plus faciles à mettre en œuvre que d'autres. Par exemple, deux étudiantes que j’encadre se sont rendues compte que la présence du crématorium, et/ou du jardin du souvenir tout à côté du carré musulman pouvait poser un problème de « contamination des espaces », ce du point de vue des représentations.
Plus généralement, les chercheurs observent une certaine porosité et surtout une diversité des situations. Certaines tombes des carrés musulmans vont être fleuries, recueillir des photographies de défunts, d’autres vont être plus dépouillées. Aussi, les cimetières des pays d’origine, notamment ceux qui se situent dans les grandes métropoles, en Tunisie, en Algérie ou encore en Turquie voient également des transformations à l’œuvre : apparition des concessions payantes, identification des sépultures, arrivée d’objets, parfois de photographies, de fleurs, remblaiement des parcelles pour faire de la place, sans bien sûr qu’il y ait exhumation.
La crémation évoque-t-elle pour vous une déritualisation ? Une rupture avec les rituels traditionnels ?
Non. Certes les prémices de la crémation renvoient bien à une démarche laïque et républicaine. Ses premiers promoteurs s’inscrivaient en faux par rapport à la tradition et voulaient « rendre la terre aux vivants ». Mais aujourd'hui cela a beaucoup changé. Les crématistes sont croyants ou non, écolos ou non, vont vouloir que leurs cendres soient dispersées ou non, etc. Il n’y a pas de profil type et, de mon point de vue, inhumation et crémation sont en fait assez proches. Seul le sort réservé au corps change.
Souvent, c’est une question qui se discute dans les couples. Bérangère Véron, qui a récemment consacré sa thèse de doctorat à la prévoyance funéraire, montre que souvent un monsieur ou une dame qui prenant de l’âge ou s’étant trouvé confronté au décès d’un ami ou d’un parent, va signer une convention obsèques à l’occasion de laquelle il va discuter avec son conjoint pour régler cette question de ses funérailles, de leur financement, mais pas seulement, aussi de la crémation ou de l’inhumation.
Quel est le ressort du choix qui conduit à la crémation, s’il n'est plus déterminé par une conviction religieuse ni une convention ou une pression sociale ?
Pour certains, il s’agira de « faire simple ». On ne veut embêter personne, ne pas laisser de trace, etc. Elle traduit alors une volonté d’effacement, de ne pas faire de « bruits ». Pour d'autres, la crémation répond à une logique de maîtrise complète : « Je gére ma vie de A à Z et avec la crémation je sais qu’il n’arrivera rien à mon corps après ma mort ». Alors que si vous choisissez l'inhumation, votre corps pourra être sorti du caveau, mis à l'ossuaire ou même crématisé lorsque la sépulture arrivera au terme de la concession. D’autres encore, diront leur crainte du feu, exprimant la peur d’être « brûlé », quand leur voisin leur répondra qu’il a lui la « la trouille d'être bouffé par les vers », etc. Parfois, c’est parce qu’on pense que la crémation coûte moins cher alors qu’en réalité, c’est quasiment équivalent. Il faut aussi parler des gens qui changent d’avis. Ce n’est pas si anecdotique. Ils signent une convention obsèques, choisissent la crémation ou l'inhumation, en parlent dans leur famille, changent d'avis, etc. Certes, c'est à l'échelle de l'individu, mais les gens ne font pas forcément un choix définitif. On peut aussi évoquer la mobilité géographique qui fait que certains refusent l’inhumation car être localisé dans un lieu de vie qui n’a pas d’ancrage avec le passé n’a pas de sens.
L’obligation d’être inhumé dans la commune du lieu de décès ou d’habitation (à moins de posséder une concession de famille) est d’ailleurs un motif de surprise, bon nombre de nos concitoyens étant loin d’imaginer cette contrainte dans un monde où la mobilité est une constante. La crémation peut donc leur donner l’image d’une plus grande liberté.
On parle d’une hyper personnalisation des funérailles. Vous la constatez ?
Pas du tout. Qui meurt aujourd'hui ? Principalement des gens qui sont nés dans les années 1910, 1920, 1930, même si toutefois il existe des décès accidentels ou des suites d’une maladie. Ces personnes, si elles ont vu l’émergence de la société de consommation, n’ont pas grandi avec elle. De même, leur trajectoire, notamment leur entrée dans la vie adulte ne s’est pas faite sur des motifs identitaires ou conflictuels à l’usage des générations qui les ont précédées.
Ce sont eux qui meurent, mais leurs enfants ou leurs petits-enfants qui organisent les funérailles…
Par l’intermédiaire des conventions obsèques, il est possible d’anticiper ces obsèques, voire de tout prévoir à l'avance et dans ce cas, comme elles ont valeur testamentaire, les enfants ne peuvent rien y faire. A partir de récents travaux, on peut faire l'hypothèse qu'il n'y a quasiment aucune personnalisation dans le cérémonial, ce qui ne veut pas dire que çà et là on ne constate pas une innovation, un renvoi à une démarche très personnelle. En revanche, attendons le décès des baby boomers. Il est possible qu'il y ait des effets de génération et que, d'ici 20 à 30 ans, on ait des cérémonies totalement différentes. Nous verrons peut-être arriver, comme aux États-Unis, des cercueils « rose flashy », des cérémonies plus gaies et en musique. Dans le registre de la culture hip-hop, on peut imaginer un cercueil graffé, cela n’a rien d’illégal…
Pour les décès de jeunes gens, on voit apparaître d’autres formes de cérémonials, moins solennels, plus festifs et personnalisés. Ayant travaillé sur la perte d’un pair Martin Julier-Coste montre que fréquemment ces rassemblements s’organisent dans un autre temps que celui des funérailles proprement dites. Dans un autre espace également. Il arrive donc que les copains organisent des cérémonies en dehors de la cérémonie officielle, avec l’assentiment des parents ou pas. Avec ces dispositifs festifs, ces jeunes créent d'autres dispositifs, d’autres lieux de rencontre ou espace de parole, notamment en utilisant les réseaux sociaux.
Nous avons ouvert cet entretien avec la question de la crémation qui transformait les rituels sans qu’on ait de recul pour comprendre comment et vers quoi aller. Vous avez parlé également de nouveaux dispositifs, comme pour les morts du Sida, et maintenant de temps « parallèles » organisés par des proches de jeunes défunts. Y a-t-il une forme de bricolage rituel ?
Oui on est sans doute dans une société du bricolage. Parce qu'on n'a pas de substitut univoque et unifié aux rituels traditionnels. Mais n’en a-t-il pas été toujours ainsi, avec des organisations que l’on adaptait aux circonstances, à l’environnement, même si les prescriptions étaient très prégnantes ? Tout simplement parce qu’il faut bien vivre. Reste, qu’il est notable que les normes sont plus flottantes. De plus, avec les migrations, des situations de métissage se sont créées.
Il y a une vraie question : peut être que 70 à 80% des gens vont choisir des obsèques religieuses alors même qu'ils ne sont pas tous pratiquants. Cependant, ils ne voudront pas plaquer seulement du « religieux » sur cet événement-là. L’étayage de la tradition semble important, mais on repère le besoin, ou plutôt l’envie de créer d’autres supports. D’où un certain éclectisme (modernité/tradition, aspirations de type populaire/objet de distinction sociale, etc.) qui n’a rien de révolutionnaire, comme une somme de petits moments. D’où cet archétype de la diffusion d’une chanson de Johnny Hallyday lors d’une bénédiction à l’église. Ces demandes hétérogènes ne me surprennent pas parce qu'elles relèvent de l’appropriation de chacun, mais elles ne viennent pas non plus totalement renouveler les cérémonies. Quant à savoir comment penser le cérémonial lors d’une crémation, cela renvoie à la question du passage et de la séparation.
Lors d’une inhumation, c’est la descente du cercueil en terre qui marque la séparation définitive, ou la fermeture du caveau de famille. La cérémonie des obsèques ayant, le plus souvent, eu lieu dans un autre environnement que celui du cimetière.
Mais lors d’une crémation, que se passe-t-il ? La séparation se fait au moment de l'entrée dans le four ? Faut-il le montrer ? Jusqu'où doit-on aller dans le caractère performatif ? Doit-on montrer la flamme ? Le cercueil qui rentre, par le biais d’une caméra, en direct, etc. ? Nous ne savons pas bien quoi, ni comment montrer, car ces dispositifs sont assez nouveaux.
Les opérateurs funéraires, comme les associations, sont assez prescriptifs mais, en fait, ils calquent, le plus souvent, un modèle ancestral sur des situations présentes. Sur la situation présente, je confesse que je ne sais pas ce qu'il faut faire. Si une famille considère qu'il faut faire les choses de telle ou telle manière, pourquoi pas. Les nouvelles pratiques s’inventent depuis la société, les gens. Car, après tout, s’il y a des pratiques qui émergent, c’est qu’elles répondent à quelque chose. A leur échelle, les individus commencent à construire, ils ne sont pas bien armés, et certes ce n'est pas très construit… Mais ne vaut-il pas mieux laisser la place à cette imagination, même si elle est un peu défaillante, même si elle est éphémère, plutôt que d'être dans des injonctions ?
A ce titre, je mettrais juste en garde les professionnels du secteur funéraire de ne pas développer trop d’« injonctions paradoxales » ou de véhiculer un point de vue moral, qui consisterait à dire que toute action sortant d’un cadre établie serait nécessairement déviante.
Que signifie le succès grandissant des contrats obsèques ?
Le premier argument est celui de soulager les proches, de prévoir pour que le jour venu ils n’aient pas à se préoccuper des obsèques. Cependant, les familles se retrouvent ainsi privées de l’organisation et elles peuvent être placées dans une situation d’attente. Cela peut être confortable d’un certain point de vue, mais ce déficit d’action peut avoir pour conséquence un repli sur la psyché ou sur la somatisation. De plus, le passage de témoin ne se fait pas ou de manière partielle, puisque le défunt dirige encore et organise son départ, et cela pose la question de la confiance en ses proches, notamment ses enfants. Dans les faits, un contrat obsèques n’est pas synonyme de soulagement pour l’entourage, il est par contre un étayage financier incontestable.
Les cimetières urbains sont confrontés à un problème de saturation qui devrait s’amplifier dans les années 2020-2050 avec la vague des décès des baby-boomers. La crémation est-elle une réponse au problème de saturation ?
La crémation est effectivement dans l’air du temps, ce dans la très grande majorité des pays occidentaux. Il y a cinquante ans, elle était proscrite chez les catholiques, aujourd’hui elle est très facilement admise. Et, il n’est pas impossible que d’autres religions qui la proscrivent actuellement s’ouvrent à cette perspective.
En fait, on ne peut pas faire de la prospective, car à l’échelle de l’histoire il faut être très prudent et ouvert. Ainsi, jusqu’au IIIème siècle la crémation était la pratique la plus répandue sur le territoire qui est le nôtre aujourd’hui et dans toutes les aires géographiques les archéologues trouvent des sites cinéraires.
De fait, en France, il y a une réelle pression sur les espaces dévolus à la mort, notamment en termes d’urbanisme. Les pouvoirs publics adoptent des réponses de plusieurs types : créer des espaces cinéraires diversifiés (columbarium, cavurnes, jardin du souvenir, jardin des roses); réduire la durée des concessions en promouvant les concessions de courte et moyenne durée).
Comment l’évolution de notre relation à la mort impacte le cimetière en tant que lieu : celle-ci facilite t-elle une plus grande ouverture des cimetières sur la ville ou au contraire les confirme t-elle comme des espaces clos, des enclaves ?
Les cimetières n’ont jamais été aussi « loin des villes », au sens où les habitants ne les investissent pas. Au moyen âge, il y avait de la vie dans les cimetières, des commerces, c’était également des lieux de débauche... Aujourd’hui, les jeunes étudiants avec qui je travaille perçoivent les visites dans les cimetières comme des intrusions, comme un manque de respect. Comme s’il n’était pas légitime de franchir la porte d’un cimetière à d’autres fins que de se recueillir sur la tombe d’un proche. Il y a un enjeu car le besoin de garder des traces, d’identifier, de localiser s’est-il concentré en d’autres lieux (maison de famille, photographies, objets ayant appartenus au défunt)? Tend-il à disparaitre, corps et biens ? Les sociologues ont des pistes de réponse, Jean-Hugues Déchaux parlant d’une intimisation du rapport à la mort. Mais, quand bien même l’on assisterait à un transfert de la prise en charge de la mort, passant d’une réponse collective à une réponse intime, il reste que les institutions sont impliquées, et pas simplement d’un point de vue légal.
Dans un autre domaine, les tombes récentes sont moins massives et plus uniformes, souvent en granit « bien lisse, bien propre ». Cette uniformisation questionne la patrimonialisation des tombes et seuls les cimetières du XIXème siècle semblent intéressants à ouvrir au public, à visiter. L’initiative de la Ville de Lyon de vendre pour l’euro symbolique des sépultures abandonnées est en ce sens une solution pour éviter une trop grande uniformisation et conserver tout en les réappropriant des sépultures qui ont une valeur historique ou patrimoniale.
L’art funéraire ne mériterait-il pas d’être renouvelé ?
On achète ce qui se fabrique, c’est l’effet catalogue. On achète des tombes durables (non pas au sens du développement durable, mais au sens de leur stabilité dans le temps) qui s’érodent peu avec le temps, alors que les concessions sont de courte ou moyenne durée ! Faire appel à des artistes est une démarche intéressante. Elle peut relever d’une politique qui, certes a un coût, mais qui permettrait de faire vivre des artistes et des artisans et de valoriser des lieux par une plus grande diversité. De ce point de vue, l’histoire des monuments aux morts est intéressante.
Peut-on aujourd’hui imaginer de nouveaux usages des cimetières ?
Il est difficile d’apporter une réponse générale à cette question. En fait, tout dépend du lieu en question, sa situation dans l’espace urbain, son potentiel d’un point de vue culturel et touristique, son ouverture à l’inter-culturalité... Je pense que de nouveaux usages sont envisageables, mais qu’il ne faut pas tout verrouiller en amont.
Par contre, il ne faut pas se bercer d’illusions car nos représentations qui poussent à une séparation des lieux (espace des vivants, espaces dédiés aux morts) sont tenaces et je ne pense pas que l’on soit prêt à accepter une ouverture large des cimetières. Il est certain qu’une politique publique d’ouverture (fluidité des accès, horaires d’ouverture plus larges, visites guidées, lieux de repos) rendrait plus visible ces espaces et aurait un effet direct sur notre perception de la mort comme partie intégrante d’un cycle de vie. Ce serait effectivement intéressant de réfléchir à une démarche de ce type à l’échelle d’une agglomération.
Comment penser les nouveaux espaces funéraires ?
Cette question relève du marketing public, elle suppose de prendre en compte à la fois des éléments de politique publique, mais aussi de bien saisir les enjeux contemporains. Beaucoup de questions sont en suspens, lesquelles appellent une réponse globale.
Or, les pouvoirs publics, notamment les mairies ou les régies intercommunales ont tendance à produire des réponses ponctuelles et souvent techniques à des problèmes émergents. Faut-il prévoir un espace multiconfessionnel ou une salle pour chaque culte et une salle laïque sachant par exemple que les musulmans préfèrent un espace multiconfessionnel à un espace laïc ? Comment donner de la matière, un décorum, comme on trouve dans les églises de l’encens ou des tentures, qui convienne à tout le monde ? Les crematoriums doivent-ils être accolés aux cimetières ? Comment permettre le respect des lieux et dans un même temps les rendre plus vivants, voire attractifs ? etc.
Cela va se répercuter par des actions comme : la construction d’un centre funéraire avec des espaces modulables, l’ouverture de salons funéraires 24h/24h, la création d’un carré des enfants, l’aménagement d’un carré confessionnel, la conception d’un espace cinéraire de dispersion des cendres, la réduction de la durée des concessions ou encore l’accompagnement des indigents...
Pour avoir une réponse plus globale, il faudrait savoir pourquoi telle démarche est mise en œuvre et selon quels objectifs ? Car en créant des espaces et de nouveaux dispositifs, comme en répondant à des demandes nouvelles, les pouvoirs publics, comme les opérateurs funéraires participent à une refonte de notre rapport à la mort.