Veille M3 / Un jour, la ville sans Lune ni l’Autre ?

Article
La Lune, symbole d'une altérité radicale à notre monde ?
Interview de Léo COUTELLEC

<< L'éthique est tout simplement un outil de la pensée qui nous aide à poser les bonnes questions >>.
Entretien réalisé le 7 mars 2013 par Marianne Chouteau dans le cadre de la démarche Métropole des savoirs, dans laquelle le Grand Lyon se propose d'explorer les formes et les enjeux d'un développement du dialogue entre science et société.
Léo Coutellec est actuellement en post-doctorat à la faculté de philosophie de Lyon 3. Il travaille sur le renouvellement de la pensée en matière d'éthique. Il est spécialisé dans les questions liées aux poissons OGM.
Dans votre travail de doctorat, vous employez l'expression « relation démocratique entre la science et l'éthique », pouvez-vous nous expliquer ce qu'est ce concept et ce qu'il change sur la façon d'envisager science et éthique ?
Pour cela, il nous faut revenir un peu en arrière et refixer quelques définitions. Aujourd'hui, on confond souvent éthique et morale. En philosophie, il existe des distinctions classiques, mais qui reposent sur des malentendus. Il existe une morale de la science, c'est évident. Ce sont les codes de déontologie, les règles que les scientifiques se donnent. La morale vient fixer une limite. Elle vient mettre des bornes, et parfois interdire. Elle est de l'ordre de l'obligation. C'est très bien, c'est même nécessaire mais l'éthique ne peut s'y réduire. Avant de dire ce qu'est l'éthique par rapport à la morale, il faut expliquer pourquoi cette dernière n'est pas suffisante pour la science. La science n'est pas un objet qui nous est donné comme ça et sur lequel nous pouvons appliquer directement des règles ou des obligations. La science, c'est un processus en construction et les scientifiques ne sont plus seulement dans une posture d'analyse du réel mais ils créent aussi des objets nouveaux. Et là, nous constatons que la morale a peu de prise. Donc, il faut trouver autre chose. Progressivement, avec le développement croissant des sciences et des techniques, la société a pris conscience qu'il fallait trouver un autre outil de pensée et cela a pris la forme de l'éthique. De fait, l'éthique n'est pas une nouvelle morale, mais ce n'est pas non plus – ce qu'on a trop souvent voulu en faire – un outil d'accompagnement ou d'acceptabilité des sciences et des techniques ; c'est-à-dire quelque chose qui arriverait comme une justification a posteriori de la science et de la technique.
On utilise souvent l'éthique comme un qualificatif. On parle d'entreprise éthique, de consommation éthique, de marché éthique. Mais l'éthique comme qualificatif est subordonnée à la chose qu'elle qualifie en tant qu'instrument. Cette éthique instrumentalisée est très courante. Ainsi, nous avons d'un côté un rapport de subordination avec la morale, et d'un autre un rapport utilitaire et instrumentalisé avec l'éthique. Or, on se rend compte qu'aucun de ces positionnements ne peut fonctionner. Il faut donc envisager un espace qui ne soit pas le juste milieu de ces deux positions mais qui serait un troisième espace pour l'éthique. Ce dernier pourrait prendre en compte les deux aspects cités. C'est-à-dire qu'il ne s'oppose ni à la morale ni à l'éthique, mais qu’il devient un espace de pensée autonome. A mon avis, c'est à cette condition que l'on peut parler de « rapport démocratique entre science et éthique ».
Quelle pourrait être la forme de cet espace autonome de pensée qui autorise « un rapport démocratique entre science et éthique » ?
Si l'éthique n'est pas une morale et si l'éthique n'est pas un outil de justification, qu'est-ce que c'est ? Nous dirons que l'éthique est tout simplement un outil de la pensée qui nous aide à poser les bonnes questions. A propos des sciences et des techniques, qui relèvent de multiples dimensions très hétérogènes, comment peut-on faire pour se poser des questions qui soient pertinentes à la fois pour les scientifiques mais aussi pour la société ? Un certain positionnement en éthique peut permettre cela. Lorsque l'éthique est comprise comme un outil de questionnement critique. Nous utilisons ici le mot « critique » dans le sens d'une distance aux choses et non pas d'un point de vue négatif. L'éthique permet de prendre du recul mais pas en étant en surplomb mais plutôt en faisant un pas de côté.
Là, où ça devient plus complexe, c'est sur la forme que cet espace de pensée peut prendre. Comment mettre du concret là-dedans ? Il faut tout d'abord essayer de définir le mode d'intervention de l'éthique dans les sciences. Si ce n'est pas l'obligation ou la contrainte qui sont réservées à la morale, alors il faut trouver une autre voie qui fasse que l'éthique puisse quand même être dans la science. Car l'enjeu est que l'éthique n'arrive pas après la science pour juger, mais soit complètement intégrée dans le processus de connaissance. Mais tout en étant intégrée, il ne faut pas que l'éthique perde sa valeur critique. Cela rend le problème vraiment complexe et c'est pour cela qu'il y a tant de malentendus et d'ambiguïtés sur l'éthique.
Pour ma part, je crois que la question à se poser pour lever ces difficultés est la suivante : comment définir un mode d'intervention de l'éthique dans les sciences, qui soit « non-autoritaire » ? Une réponse peut être apportée lorsque l'éthique prend part à la discussion avec des scientifiques. Par exemple, dans un projet interdisciplinaire ou dans le cadre d'une évaluation, le savoir qu'elle va créer ne va pas se substituer à la science, mais au contraire va s'y ajouter. La logique sera cumulative, et pas substitutive. L'éthique devient une dimension de la science et des objets de la science.
Est-ce que cela veut dire que l'on va se servir de la production de ces connaissances pour prendre des décisions ou pour orienter des projets de recherche ?
C'est ça, mais au même titre que les autres dimensions.
Et quelles sont ces autres dimensions ?
Prenons un exemple : celui des OGMs. Quand on traite une question comme celle-là, on peut se dire que l'OGM est un ensemble de dimensions scientifiques et techniques. Donc, il y a un enjeu pluridisciplinaire de faire cohabiter la génétique avec la biologie des populations, l'écologie des paysages, l'économie, le droit parce que souvent il faut traiter la question des brevets, l'insertion de technologies sur des marchés, la sociologie lorsqu'on veut notamment regarder l'acceptabilité des risques ou l'insertion sur un marché de consommateurs. Mais très peu souvent, pour ne pas dire jamais, on met l'éthique. L'éthique arrive toujours après, comme une morale. L'idée est de faire en sorte que l'éthique intervienne ici au même titre que les autres disciplines. Qu'elle devienne une dimension à part entière au même titre que les autres. C'est ce que l'on peut appeler « une démocratie des disciplines » qui relève d'une logique de l'objet. C'est-à-dire qu'on sort de la logique disciplinaire où on réfléchit les problèmes par les disciplines, pour mettre l'objet au centre. Cet objet, on s'interdit de le définir trop vite pour ne pas réduire le champ des possibles. De fait, on va se demander quelle dimension et quel outil il faut mobiliser pour essayer de comprendre au mieux cet objet, en mobilisant tout autant des savoirs et des non-savoirs. C'est dans ce cadre-là que l'éthique a toute sa place au même titre que la sociologie, que la génétique, que l'informatique ou que toute autre discipline scientifique. C'est un mode d'intervention très proche de ce qu'on peut appeler l'interdisciplinarité. Mais l'interdisciplinarité dans le sens non pas de l'incantation habituelle, mais du vrai processus interdisciplinaire qui respecte une démocratie des disciplines. C'est-à-dire tout autre chose qu'une convocation d'une discipline par une autre où se jouent des phénomènes de capture.
Est-ce cela qui a été expérimenté dans le projet Dogmatis ?
Oui, c'est cela. Nous avons mis l'objet au centre mais un poisson génétiquement modifié, personne ne sait ce que c'est vraiment. Collectivement et progressivement, nous avons construit cet objet en essayant d'identifier le plus précisément possible ce que nous ne savions pas de celui-ci. Cela permet de mettre toutes les disciplines à égalité. Dans ce projet, l'éthique était une dimension parmi d'autres ainsi que la philosophie.
Est-ce qu'avec des objets aussi complexes que ceux issus des nanotechnologies ou de la biologie de synthèse par exemple, ce genre de posture devient essentielle voire indispensable ?
Oui, je le crois. D'autant plus qu'il y a une forme de prise de conscience aujourd'hui du fait que la science et la technique fonctionnent avec des valeurs et en produisent. Tout le processus scientifique et technique est immergé dans un ensemble de valeurs explicites mais souvent implicites. Les objets de la biologie de synthèse et de la génétique montrent cela de façon éclatante. Habituellement, cette question est traitée dans ce que l’on appelle les rapports science-société. Mais en fait c'est consubstantiel au processus scientifique quel qu'il soit, c'est juste que là, il y a une forme d'expansion de par la nature des objets qui sont plus sophistiqués, plus complexes, plus performatifs dans le sens où ils ont un impact plus grand dans la société. Les nanotechnologies, il peut y en avoir partout, la biologie synthèse requestionne le pouvoir même de la biologie qui crée et recompose. Mais c'est avant tout révélateur d'une chose : que la science et la technique ne sont pas neutres de valeurs. Et si la science et la technique ne sont pas neutres, alors nous avons besoin de l'éthique pour faire émerger ces valeurs, pour essayer de les comprendre, pour voir comment elles interfèrent avec le processus scientifique. L'éthique va avoir le rôle de poser les bonnes questions et d'ouvrir les « boîtes noires de la science et de la technique ». Tout ce qui est souvent dans l'ombre, dans les implicites. On se rapproche ici de ce que Gerald Holton appellait « l'imagination scientifique » ou les thematas. Avec ce dernier terme, Gerald Holton1 considèrait toutes les orientations thématiques et les valeurs liées à la science et à la technique. Il estime que ce sont des choses qu'il faut faire émerger et voir comment elles interfèrent avec tout le processus de création des connaissances et des objets. Ce ne sont pas seulement des choses qui sont à part, qu'on pourrait traiter comme superflues, des bruits qui gênent la science et la technique. Au contraire, elles sont constitutives du processus de production des connaissances scientifiques et techniques. C'est pour cela, que d'un point épistémologique, il faut aussi traiter ces dimensions-là et ce n'est pas anodin.
Est-ce que les biotechnologies et les biosciences en général rajoutent une « couche » de questionnements car elles touchent au vivant ?
En fait, cela rend plus forte une dimension qui est celle de la place de l'homme. Mais cela pourrait être une forme d'invariant pour toutes les technologies. Il est vrai que pour les technologies du vivant et pour tout ce qui touche au vivant, cela saute aux yeux. C'est évident que quand on a des techniques de manipulation du génome ou des techniques de diagnostic ou toutes les techniques de la médecine prédictive, régénératrice et améliorative, on touche directement à la conception de l'homme dans ses liens au vivant. Mais, en fait c'est le cas pour toutes les techniques. On prend n'importe quel objet technique, quand on fait un ordinateur ou une voiture, derrière on sous-entend une certaine conception de l'homme. Mais c'est plus difficile à comprendre. Dans les processus de conception, en ingénierie par exemple, il y a tout un marécage d'implicites sur l'homme, qui est souvent pris dans un contexte socio-politique non pensé. Actuellement c'est le contexte socio-politique de « l'homo consumericus », l'homme serait complètement « stupide », il ne pourrait qu'appuyer sur des boutons, et il ne faut surtout pas qu'il sache comment ça fonctionne, parce qu’il n'en a pas les capacités. Actuellement, on est baigné dans ce contexte mais on se rend compte qu'il y a certaines démarches de conception et d'ingénierie qui prennent du recul par rapport à cela, et qui fonctionnent différemment. C'est le cas, par exemple, de l'open conception. Cela veut dire que ce n'est pas une fatalité. Il n'y a pas de déterminisme là non plus.
Pour les biotechnologies, cela paraît beaucoup plus frontal ?
Voilà, c'est direct. Cela saute aux yeux. D'ailleurs, c'est souvent la porte d'entrée de l'éthique. C'est pour cela que l'éthique médicale et la bioéthique ont pris une ampleur importante. Cela a permis de créer un corpus théorique considérable ainsi que des méthodes qui aident pour tous les autres domaines même s'il nous faut les adapter et parfois s'en détacher complètement. Mais avec la bioéthique, on a un cas où l'éthique est complètement immergée dans le processus scientifique. On est dans un cadre très typique.
Ce qui voudrait dire que dans les recherches sur ces questions-là, l'éthique fait partie intégrante du processus, au même niveau que d'autres types de disciplines ?
Ce n'est pas toujours le cas parce que pendant longtemps on a raisonné en termes de comités d'éthique où l'éthique arrive après ou comme « condition de ». Les comités d'éthique sont très utiles pour émettre des avis d'experts. Dans ce cas, on n'est pas devant une recherche éthique mais devant une évaluation éthique. Toutefois, aujourd'hui, il y a effectivement une prise de conscience des chercheurs eux-mêmes de cette dimension éthique au moment de la recherche. Ils ne peuvent plus ignorer ces questions-là de par leur ampleur sociale et politique. Et au-delà de cette prise de conscience, ils sont aussi formés. Il y a des formations, des outils qui sont proposés pour que les chercheurs eux-mêmes puissent se poser ces questions-là. C'est assez rare mais des philosophes spécialistes cohabitent dans certains centres de recherche. Des comités d'éthique locaux sont créés, ce qui change aussi beaucoup de choses.
« Locaux », c'est-à-dire en région ou dans les établissements ?
Dans les établissements et ceci est obligatoire depuis février 2013 en France avec l'application de la directive 2010/63/UE. Ainsi, la réglementation en vigueur aujourd'hui en France demande à ce que « tout projet de recherche qui inclut le recours à l'expérimentation animale doit faire l'objet d'une évaluation éthique favorable délivrée par un comité d'éthique agréé ». Tout établissement utilisateur d’animaux destinés à être utilisés dans des procédures expérimentales doit créer ou être rattaché à un comité d'évaluation éthique. Les interactions entre ces comités d'éthique et les laboratoires de recherche vont se systématiser. L'éthique peut devenir une pratique courante dans certains domaines, comme celui de la santé, ou celui de l'expérimentation animale. Bien entendu, cela ne se fait pas sans problèmes, il est évident qu'il y a énormément de choses à faire pour clarifier le rôle de l'éthique dans ces processus. Mais nous observons un vrai changement de perspective.
Parce que dans ces cas-là, l'éthique est vraiment pensée comme un moyen de se poser des questions ou comme quelque chose qui surplombe, qui dicte des règles ?
L'éthique produit des questions mais elle n'est pas pensée comme un espace autonome. Dans ces comités locaux d'éthique sur l'expérimentation animale, elle intervient encore un peu à l'extérieur, un peu comme quelque chose qui juge et est parfois considérée comme une lourdeur administrative de plus. Ce n'est pas une morale, mais ce n'est pas non plus une éthique qui questionne. Il y a encore beaucoup de chemin à parcourir mais c'est tout nouveau. Ces réglements sont les symptômes d'une prise de conscience que l'éthique est une dimension à part entière de la recherche. Après, derrière ce symptôme, il faut aller plus loin, regarder comment ça se passe localement, concrètement. On s'aperçoit qu'il y a encore beaucoup de travail à faire pour que l'éthique devienne une pratique plus quotidienne. Une issue pourrait être d'intégrer ces disciplines – éthique, philosophie - en tant que disciplines autonomes dans les laboratoires de « sciences dites dures ». Par exemple, aujourd'hui, à l'INRA, des biologistes côtoient des éthiciens, des juristes, des économistes et des sociologues. Toutefois si l'éthique veut être autonome dans le cadre d'une démocratie des disciplines, il faut qu'elle soit robuste. Elle doit donc être rigoureuse dans son analyse, et développer des méthodologies pour assurer une sorte de transparence dans la façon dont elle a formé ce qu'elle dit et ce qu'elle avance. Il y a des méthodologies plutôt d'inspiration anglo-saxonnes ou des pays du Nord tels la Norvège, la Suède, les Pays-Bas, le Royaume-Uni qui sont très intéressantes et novatrices. La matrice éthique en est un exemple.
Pouvez-vous expliquer ce qu'est une matrice éthique ?
La matrice éthique est un outil qui aide à faire émerger des valeurs. C'est le premier objectif. On est face à un problème scientifique, technique, complexe et on se pose la question de savoir comment faire en sorte que des valeurs liées à ce problème émergent de façon quasi-exhaustive. C'est ambitieux mais avec cet outil, on y arrive et ce, de façon très pertinente. C'est un outil qui se base sur deux principes pluralistes. Le premier est le pluralisme des traditions morales. Prenons un exemple dans les sociétés occidentales. Nous sommes héritiers de traditions morales qui sont très fortes. L'éthique ne va pas s'opposer à la morale mais elle va l'intégrer. Nous sommes tous héritiers d'une tradition utilitariste selon laquelle nos actes doivent maximiser le bien-être du plus grand nombre. En même temps, nous sommes aussi les héritiers de la déontologie kantienne, très attentive à la dignité de l'homme, considérant l'homme comme une fin et jamais comme un moyen. C'est une autre tradition morale, très différente de l'utilitarisme, mais qu'il faut prendre en compte également. A cela, il y a un troisième principe qui a plutôt émergé au cours du XXe siècle, et qui a trait à la justice. Il s'agit du principe de justice et d'équité. La matrice éthique va donc prendre en compte ces trois grandes traditions avec le principe pluraliste selon lequel on n'a pas à choisir, a priori, une de ces traditions. On les prend toutes en compte.
Le deuxième principe est celui du pluralisme des acteurs. Ce principe dit que quand on est face à un problème ou une question ou un enjeu lié aux sciences et aux techniques, il faut essayer de prendre en compte tout le monde, et à égalité. Il s'agit d'élargir le spectre de la considération. Pour cela, on regarde qui est touché directement ou indirectement par la question qu'on pose. Par exemple, qui est touché directement ou indirectement par la question des nanotechnologies ? Il n'y a pas que l'industrie, il n'y a pas que les scientifiques, il n'y a pas que les ingénieurs. Il y a peut-être aussi les consommateurs, les citoyens, les générations futures, voire les animaux...
Comment faire se croiser à la fois la pluralité des traditions avec la pluralité des acteurs ?
Grâce à un dispositif en matrice où on va mettre les traditions morales en colonnes, les acteurs en lignes, et ensuite il y a un exercice de questionnements qui fait émerger des valeurs. On se pose la question de savoir quelle est la valeur qui représente pour tel acteur le principe de bien être ou le principe d'autonomie ou encore le principe de justice. Ça fait émerger les valeurs. Et donc quand, on a trois traditions morales et si on a au moins quatre acteurs, cela nous fait douze valeurs. Si on a cinq acteurs, ça fait quinze valeurs, etc. Le but est de n'exclure personne, c'est un exercice d'inclusion. Une forme d'éthique inclusive. On est là au premier stade de la réflexion.
Est-ce que l'on peut illustrer cela par un exemple concret ?
La question des OGMs nous pose des problèmes depuis vingt-cinq ans, et ce sont toujours les mêmes. Cela vient entre autres du fait que l'on a voulu aller trop vite vers le consensus et qu'on a exclu de nombreuses considérations. On ne savait pas comment traiter des dimensions considérées comme non scientifiques et qui ne rentraient pas directement dans le paradigme du risque. Le paradigme du risque implique d'emblée la probabilité, il est un appel à la quantification. Dès 1992, quand le problème des OGMs a éclaté publiquement en France, on a vu qu'il y avait des questions économiques, sociologiques, sociétales, éthiques, mais on ne savait qu'en faire, donc on ne les a pas considérées directement. De fait, on est parti bille en tête sur une évaluation des risques qui a exclu tous les autres éléments. Cela a créé un biais de départ dans la façon de considérer les questions liées aux OGMs. Si aujourd'hui il y a une opposition aussi frontale entre les pro et les anti OGMs, c'est entre autres parce que l'on n'a pas réussi à dire ce qu'est cet objet et quelles sont les valeurs, et toutes les dimensions qu'il faut prendre en compte.
Qui se charge de mettre en place ces matrices éthiques ? Est-ce que ce sont les industriels ? Est-ce que tout le monde participe à la construction de cette matrice ?
Le dispositif ainsi conçu peut fait intervenir tout le monde. Ce ne sont pas nécessairement des experts en éthique qui remplissent la matrice. Le mieux est que ça se passe dans un cadre collectif, dans un groupe hétérogène, parce qu'il faut qu'il y ait une pluralité de valeurs exprimées. Par exemple, une valeur qui représente le bien être pour un agriculteur ou pour un citoyen ou pour un consommateur ou pour un industriel. Il faut que le groupe soit d'accord pour l'expression de ces valeurs. C'est pour cela qu'elles sont discutées collectivement. C'est en Norvège que j'ai pu observer les modèles les plus aboutis. Les parties prenantes de la matrice éthique étaient invitées à formuler eux-mêmes les valeurs qui pour eux représentent les grands principes moraux. C'est vraiment l'approche « bottom-up » : ce sont les acteurs qui remplissent la matrice éthique. Il y a d'autres approches où la matrice éthique est remplie par des collectifs – un peu comme des comités d'éthique hétérogènes. Il y a vraiment une intelligence du dispositif et ce ne sont pas seulement un ou deux « sages » qui se prononcent et qui donnent un avis. Il y a un autre aspect de la matrice éthique qui est intéressant : c'est que l'on peut en construire plusieurs en parallèle. Sur un même sujet, on peut très bien faire travailler plusieurs groupes en même temps. Du coup, on obtient plusieurs modélisations éthiques du même sujet. On peut les confronter et mettre des avis en conséquence. Ce qui est intéressant est que cette matrice éthique simplifie l'éthique en multipliant les paramètres. C'est une forme de paradoxe car on pourrait penser que pour simplifier l'éthique, il faudrait simplifier les termes et les problèmes et réduire les acteurs. Bien entendu, il ne faut pas non plus s'imaginer qu'il s'agit là d'un outil miracle. Mais il a l'avantage d'être un outil très opérationnel pour cadrer la réflexion éthique et pour faire émerger des valeurs et ceci dans un cadre véritablement pluraliste.
Une fois que ces valeurs ont émergé, quelles sont les autres étapes ? Que fait-on de ces valeurs ?
La deuxième étape est d'essayer de construire la matrice des conséquences et/ou des impacts. Autant avec la matrice des valeurs, on pouvait rester sur un sujet très général : la biologie de synthèse, les OGMs, l'expérimentation animale ; autant à ce niveau là, il va falloir aller sur un cas très précis. De quoi parle-t-on ? Des OGMs, mais quels OGMs ? Le Mon810, le Mon610K ? On prend un exemple très concret. Et on se pose la question suivante : quel impact a cet objet sur chacune des valeurs de la matrice ? Il s'agit là d'un travail d'argumentation puisque bien sûr, il faut que les réponses soient documentées. Cette étape est plus pointue en termes d'expertise. Par exemple, si on dit que l'impact est positif sur telle valeur, il ne faut pas seulement le dire, il faut l'argumenter. Il faut le démontrer à partir d'études, d'enquêtes, etc. Idem si c'est négatif. Bien entendu, cet outil laisse toute sa place à l'incertitude et aux non-savoirs qui seront considérés comme tels. Si par exemple, une des valeurs qui émerge est la « sécurité sanitaire » et que cette valeur représente le principe de « bien être » pour les consommateurs. Alors, pour le Mon610k, répondre à la question, est-ce qu'il impacte positivement ou négativement la sécurité sanitaire devient impossible. On est face à une incertitude. Donc, cela permet de montrer quelles sont les zones de non-savoir. Avec les OGMs, cela a fait émerger beaucoup plus de zones d'incertitude qu'on ne le pensait au départ. Nous étions partis sur l'idée qu'il n'y avait que deux problèmes : l'impact environnemental et la sécurité sanitaire. Comme il n'y avait que ces deux problèmes – que l'on traite depuis vingt ans – on a voulu balayer les incertitudes ! On a tenté de faire croire que l'on maîtrisait les risques sur ces deux domaines. En fait, si on est honnête, on se rend compte qu'on ne maîtrise rien sur l'évaluation sanitaire des OGMs et ni même sur l'impact environnemental. Or, la matrice éthique déplace un peu le problème : on fait émerger les incertitudes, les zones de non-savoir mais aussi ce que l'on sait, ce que l'on maîtrise. On peut travailler sur les impacts, qu'ils soient positifs, négatifs ou neutres. Concrètement, dans la matrice des conséquences, on a quatre choix : incertitude, impact positif, impact négatif, impact neutre. Cela permet de faire émerger une nouvelle cartographie du problème. Cette étape est plus longue, plus fastidieuse et elle est, en général, élaborée par des « experts » qui ne sont d'ailleurs pas que des scientifiques.
Est-ce que cette deuxième étape n'est pas difficile à mettre en place en amont ? En effet, si l'OGM n'a pas encore été créé et qu'on n'a pas déjà des conséquences à observer, comment peut-on du coup faire émerger les impacts ? Est-ce que l'on ne se replace pas d'emblée dans une position où l'éthique vient surplomber le problème à traiter ?
La matrice des conséquences peut être utilisée après coup. Cela devient un outil d'évaluation éthique. Mais elle peut être aussi utilisée comme outil de la recherche dans une dynamique prospective. Par exemple, on se pose la question de la commercialisation d'animaux trans-géniques à des fins d'alimentation humaine. Là, on n'est pas dans un cas qui existe. Du coup, en quelque sorte, on fait des scénarios pour essayer d'évaluer l'impact de l'insertion d'un saumon transgénique par exemple sur un marché et dans un environnement. A ce moment, on peut utiliser la matrice des conséquences comme outil de la recherche prospective pour définir, par exemple, les paramètres de l'insertion de cet objet dans un marché et dans l'environnement et en faire émerger les valeurs. Cela veut dire que l'on construit des scénarios. Par exemple, on pourra dire que l'impact sera positif dans telles conditions ou négatif dans telles autres. Si on fait de l'aquaculture en pleine mer, l'impact pour la sécurité environnementale sera probablement négatif, parce que l'on sait qu'il y a énormément d'échappées. En revanche, si on fait de l'aquaculture en pleine terre, dans un milieu hermétique, en contrôlant les inputs d'eau et les outputs, alors là, on projette que l'impact sera neutre. Mais pour faire cela, il faut travailler avec des spécialistes de l'aquaculture, des spécialistes du développement aquacole, des généticiens sur la stérilisation ainsi que d'autres types d'experts. Dans ce cadre, on est vraiment dans le processus en amont de recherche. Mais ce genre d'outils fait aussi émerger des impossibles ou des contradictions irréductibles. Alors, les mettant en lumière, ce sera au législateur d'en prendre acte.
Dans ce qui est décrit ici, on imagine assez bien que les institutions publiques de recherche s'inscrivent dans ce genre de choses, parce que la connaissance qui est produite par les scientifiques, est aussi un « bien commun » ; mais comment fait-on lorsque l'on se retrouve dans des cas où ce sont les industriels qui possèdent le savoir ? Comment fait-on pour les inclure et pour qu'ils ne voient pas l'éthique comme quelque chose qui arrive après et qui bride leur créativité et leur capacité à innover ?
Dans le cadre d'une méthodologie comme celle-là, il est évident que les industriels et le monde économique sont inclus de facto. L'éthique ne va pas les pointer du doigt en les stigmatisant mais elle va intégrer leurs préoccupations comme une dimension du problème à résoudre. Dans le carde des matrices éthiques, on peut discuter des valeurs que les industriels veulent défendre. Ils sont inclus dans le processus. Après la question se pose de savoir comment les convaincre de participer et là non plus pas dans une optique de contrôle ou de surplomb. Il faut sans doute se tourner vers notre compréhension du processus d'innovation. Comment peut-on innover aujourd'hui sans prendre en compte l'ensemble des paramètres de l'objet en question ? C'est un facteur d'échec, c'est évident. D'un autre côté, les industriels et notamment ceux qui sont spécialistes de l'innovation ne savent que faire de ces réflexions en éthique. Souvent ils les utilisent comme arguments marketing. Ils se disent : notre positionnement éthique va nous servir à mieux vendre nos produits, à mieux les faire accepter. Mais, là aussi c'est un échec. En même temps, ces industriels voient bien qu'il y a des questions de valeurs qui se posent, ne serait-ce que par le fait qu'il y a des questions d'acceptabilité et de résistance. Il peut donc y avoir des frictions entre les valeurs sociales et celles de l'entreprise qui est consciente de cela. Je crois que c'est important de faire émerger ces frictions. Un outil comme la matrice éthique peut nous y aider.
Aux États-Unis, l'entreprise Aqua Bounty s'est lancée dans la recherche-développement autour des saumons transgéniques. Elle a investi des milliards de dollars pour essayer de commercialiser ce saumon transgénique. Son unique objectif était le profit, la valeur dominante de son action était l'économisme. Elle n'a donc pas pris soin de comprendre d'abord de quoi elle traitait : quelle était la nature de ce saumon transgénique ? Qu'est-ce que l'on est en train de produire ? La première demande de commercialisation remonte à 1996 et aujourd'hui, cela n'a toujours pas abouti. Depuis, cette entreprise a perdu des milliards de dollars. Ils ont failli déposer le bilan, ils ont été rachetés en bourse et sont aujourd'hui dans une situation très difficile.
Toutefois soyons clairs, cet exemple ne sert pas à dire qu'il faut instrumentaliser l'éthique pour que les objets produits en entreprise soient mieux acceptés. Il s'agit de mieux comprendre, et de voir ce qu'on peut faire avec ces objets. Est-ce que ça répond vraiment aux objectifs que l’on s'est fixés ? Quelles conséquences cela peut avoir sur la société ? Les industriels doivent rendre des comptes face à la société, face aux pouvoirs publics, face à leurs clients. Pour rendre des comptes, il faut qu'ils aient compris sur quels objets ils travaillent. Sinon cela n'est pas possible.
Avant tout, il faut clarifier le statut de l'éthique. Il faut clarifier le statut du processus épistémologique qui consiste à identifier les objets. Il existe de nombreuses théories en conception qui permettent aussi de faire cela. On n'est pas dans « un monde de bisounours », il y a tout un tas de contraintes qui font que ces processus ne peuvent pas être mis en œuvre, il faut en avoir conscience. Les pouvoirs publics peuvent aussi organiser la rencontre entre le privé et le public. Aux États-Unis, cela s'est fait. Les pouvoirs publics ont organisé le dialogue entre industriels, recherche publique, citoyens autour d'outils de ce type-là. C'est intéressant. Mais il faut être très vigilant sur le statut et le rôle de l'éthique, très vigilant sur la place de chacune des disciplines et sur la place des acteurs. Dans une matrice éthique, l'économie n'est plus au centre, c'est un paramètre parmi d'autres. Cela change quand même beaucoup de choses !
Les matrices éthiques ouvrent à ce propos de nombreuses voies d'expérimentation. Elles permettent de mettre en place une éthique générique, c'est-à-dire une éthique qui n'est subordonnée à aucune tradition morale ni à aucune discipline. Elles instaurent un dialogue et de nombreux exemples récents (OGM, biotechnologie, nanotechnologie) nous ont montrés combien celui-ci est nécessaire.
1 Gerald Holton est un philosophe et historien des sciences à l'Université d'Harvard.

Article
La Lune, symbole d'une altérité radicale à notre monde ?

Article
Dans un monde qui se réenchanterait pour mieux se réconcilier avec le non-humain, que nous dirait-il de nos anomies actuelles ?

Article
Synthèse du colloque organisé par Tempo Territorial et la Métropole de Lyon – Retour sur les interventions du jeudi 9/11/2023.

Article
Synthèse du colloque organisé par Tempo Territorial et la Métropole de Lyon – Retour sur les interventions du vendredi 10/11/2023.

Article
Aurianne Stroude, sociologue spécialiste de la transformation des modes de vie en lien avec les enjeux écologiques, décrypte le changement social qui opère au-delà des évolutions individuelles.

Article
S’appuyant sur une importante revue de littérature, cet article décrit la façon dont les modes de vie se structurent progressivement autour de trois variables.

Étude
Cette étude propose cinq monographies – Bogotá, Pontevedra, Milan, Zurich et Lahti – explorant le lien entre « massification » des changements de mode de vie et nouvelles manières de travailler au sein des collectivités publiques.
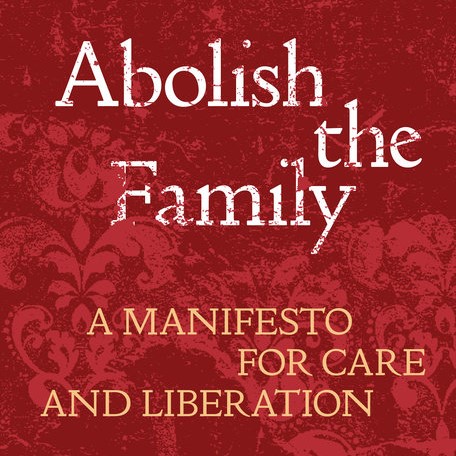
Article
La famille, considérée parfois comme valeur suprême est pourtant un important marqueur d’inégalités. Dès lors, qu’en faire ? Peut-on envisager l'abolition de la famille ?
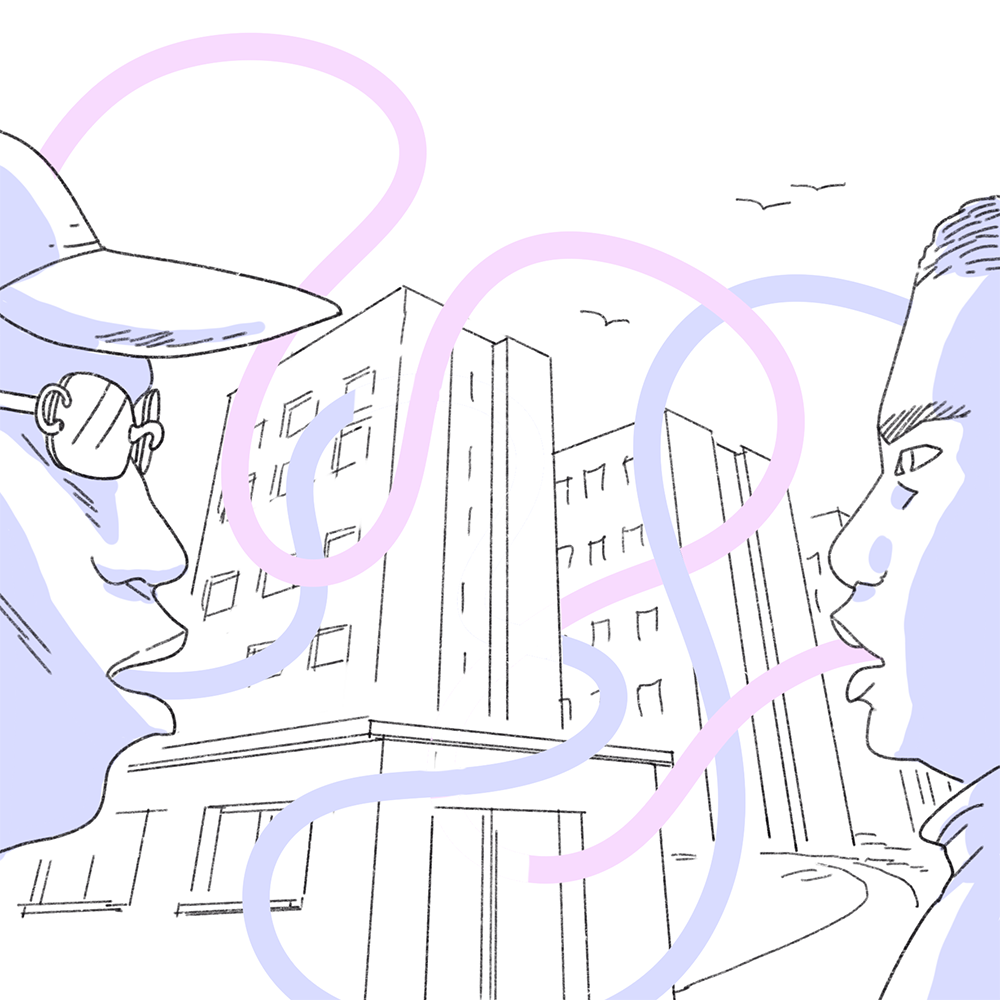
Article
A priori, pour le grand public, le Grand Lyon n’est pas une place forte du rap hexagonal. Pourtant, de nombreux acteurs ont solidement posé depuis 30 ans les fondations de la scène locale, à l’échelle d’une agglomération qui regorge de talents cachés.