Synthèse temporelles 2023 (1/2) : Quels temps pour vivre le collectif ?

Article
Synthèse du colloque organisé par Tempo Territorial et la Métropole de Lyon – Retour sur les interventions du jeudi 9/11/2023.
Interview de Marie Peze

<< Les nouvelles organisations du travail sont extrêmement sophistiquées et fabriquent comme des orfèvres une machinerie qui vient capturer toute la subjectivité du salarié pour qu'il s'investisse corps et âme dans la nouvelle tâche >>.
Texte augmenté de l'interview réalisée pour la revue M3 n°3 le 29 mai 2012 par Caroline Januel
Interview de Marie Pezé, Docteur en psychologie, psychanalyste, expert judiciaire, auteur de « Ils ne mourraient pas tous mais tous étaient frappés » (2008) et de « Travailler à armes égales » (2011)
Marie Pezé a créé en 1996 la première consultation « Souffrance et travail » au Centre d'Accueil et de Soins Hospitaliers de Nanterre. Il existe désormais 35 consultations hospitalières spécialisées dans la prise en charge de la souffrance au travail en France.
Présidente de l'association « Diffusion des connaissances sur le travail humain », elle est à l'origine du site internet www.souffrance-et-travail.com dédié aux difficultés que nous pouvons rencontrer dans le monde du travail et à leurs conséquences sur notre santé psychique et physique. Le site propose des réflexions sur le travail, mais aussi tous les outils nécessaires pour reconnaître les signes de souffrance et y faire face.
Il semble que notre époque vive une mutation radicale dans son rapport au temps. On parle d'accélération du temps, du culte de l'urgence, du règne de l'immédiateté... La fatigue, le stress, mais aussi des manifestations violentes, comme les suicides sur les lieux de travail, semblent aujourd'hui de plus en plus fréquents. Comment percevez-vous cette évolution et quelles en sont les caractéristiques les plus marquantes ?
Les premiers effets des mutations du travail se sont fait sentir dans les années 1980-85, par le type de pathologies des patients que nous rencontrions. Des salariés occupant des postes a priori sans charge lourde se mettaient à présenter des troubles musculo-squelettiques (les affections péri articulaires provoquées par certains gestes et postures de travail décrites dans le tableau 57 des maladies professionnelles comme les tendinites, les syndromes du canal carpien, les périarthrites de l’épaule). Ces troubles étaient soignés et opérés mais réapparaissaient quand ces personnes retrouvaient les mêmes postes et surtout le même rythme de travail. Après avoir tenté d'expliquer classiquement ces récidives par les psychologies individuelles, sans résultat probant, notre équipe s'est logiquement tournée vers l'organisation du travail. Ces patients, occupant des postes variés (femme de ménage en milieu industriel, manutentionnaire dans un grand magasin, assistante de direction en entreprise...) témoignaient tous d'une intensification de leur travail. On leur demandait de travailler plus vite, dans le même temps et souvent dans un contexte de pression managériale.
Pour intensifier la productivité de ces salariés, des modèles organisationnels du travail ont en effet été mis en place. Dans les récits des patients, cette transformation s'exprime clairement au travers de trois registres : l'intensification du travail (« on me donne plus à faire en moins de temps »), la densification des tâches (« on me donne trop de tâches », « je dois faire plusieurs choses en même temps »), et avec une perte de marge de manœuvre (« je ne peux rattraper les erreurs ou adapter les solutions à mon travail qui ne se présente jamais comme les procédures l'envisagent »). On demande aux salariés de travailler en suivant les prescriptions mais celles-ci ne rendent pas compte de toute la complexité du travail réel. L’écart entre le travail prescrit et le travail réel est immense. Les personnes doivent alors ruser, inventer pour répondre à l'exigence du travail tel qu’il se présente dans la vraie vie, insuffisamment pensé par les bureaux de méthodes. Car si le monde tourne, alors qu’il y a tant de chômeurs, c'est bien que ceux qui travaillent le font beaucoup plus que ce qu'on imagine ! Il ne faut pas oublier que les salariés français occupent la 3e position mondiale en termes de productivité horaire mais ils sont également les 1ers consommateurs de psychotropes.
Par ailleurs, les dirigeants d'entreprises ont logiquement cherché à augmenter la productivité, mais en s'appuyant sur une théorie du travail partielle. Gagner en productivité a consisté à imposer le « lean management » partout. Concrètement, les pauses cafés ont été supprimées car considérées comme des « temps morts », les déplacements optimisés, etc. Ces décisions paraissent rationnelles: rapprocher le stock de boulons de l'ouvrier pour limiter son déplacement semble une bonne solution, mais on le prive du même coup d'un temps de déambulation, des répits physiologiques indispensable au fonctionnement du corps humain. Certes, la productivité augmente mais les maladies professionnelles aussi. Le corps et le psychisme humains sont soumis au TTU que décrit Nicole Aubert (« très, très urgent »). Or l'organisme humain a des cycles, des alternances de veille et de sommeil, des pics de production de certaines hormones à certains moments... Si on soumet l'organisme à une intensification des tâches sur un temps trop prolongé, il fabrique des toxines, il doit mobiliser beaucoup de cortisol pour tenir, bref, il est comme en apnée en permanence ! Mais ce corps inoxydable, ou plutôt désiré comme tel, sans maladie, sans émotion, ce « corps machine » que veut l'organisation du travail n'existe pas. Faire travailler les salariés en éliminant tous les temps qu’on dit « morts » est méconnaître le fonctionnement du corps humain. Faute d'écouter les spécialistes, les ergonomes, les neurophysiologistes, les cliniciens du travail, on a privilégié une approche dite scientifique et chiffrée du travail : cadence, cycle de production, chronométrage en oubliant d’autres chiffres plus médicaux. Les salariés travaillent donc à leur rendement maximum comme des athlètes de la quantité et présentent rapidement des pathologies de surcharge.
Travailler à une telle vitesse a comme premier effet -voulu- d'empêcher de penser. Quand vous travaillez ainsi, vous ne pouvez plus faire un pas de côté pour réfléchir à votre travail. Et si on ne pense plus, il n'est plus possible d'organiser de collectif de riposte et d'imaginer une meilleure manière de travailler.
Que recouvre l'appellation « pathologies du surcharge » ?
Travailler à flux tendus enclenche chez le salarié une posture du « tenir » et tenir n'est pas qu'une métaphore. « Tenir » fait allusion à tout ce qui est convoqué pour parvenir à travailler de cette manière, c'est-à-dire mobiliser au maximum, toute la journée, sa musculature, sa posture, son taux de cortisol, son système cardio-vasculaire... Sur le versant psychique, on est dans une telle accélération des tâches, dans une telle instantanéité d'exécution, que le cerveau doit traiter une masse phénoménale d'informations. L'acronyme ASAP (as soon as possible) si utilisé dans les mails veut désormais dire maintenant. Or le cerveau ne fonctionne pas comme cela. Comme un ordinateur, il a une certaine quantité de mémoire et de capacités d'analyses et au-delà, il rame. C'est pourquoi on observe d'abord des troubles cognitifs, des troubles de concentration, de mémoire, de logique... Tous les salariés nous disent rentrer chez eux avec le sentiment de ne pas être à jour, donc de ne pas avoir su finir leur travail : bien travailler, terminer les tâches demandées... Le salarié reprend son travail le lendemain matin avec ses troubles cognitifs, mais aussi le sentiment de faute prescrite parce qu'il ne peut se permettre de remettre en cause l'organisation du travail et les objectifs demandés. Faute de temps, de moyens et d'effectifs, le salarié a le sentiment de ne pas bien faire son travail. Les conditions d'accomplissement de soi au travail sont alors compromises. Tout le temps où le cerveau traite les informations, les relie à d'autres, c'est-à-dire tout le travail de logique est court-circuité par cette urgence permanente et explique les troubles cognitifs.
Vient ensuite l'épuisement physique et moral. Ces « athlètes de la quantité » font des burn-out, ils craquent tout en se sentant fautifs de ne pas tenir. Cet état d'épuisement ou d'usure professionnelle entraîne un syndrome psychologique à trois dimensions : l'épuisement émotionnel (sentiment de fatigue), la dépersonnalisation (insensibilité et réactions impersonnelles vis-à-vis des usagers) et la réduction de l'accomplissement personnel (faible sentiment de compétence et de reconnaissance de l'effort accompli par le travail). Des études américaines menées par des cardiologues ont précisément repéré trois critères annonçant un accident cardio-vasculaire sur les personnes ayant survécu : un travail de plus de 70 heures par semaine, le sentiment d'impasse, c'est-à-dire le sentiment qu'on ne peut se sortir de cette situation, et le changement de tâche une vingtaine de minutes avant l'accident. Ce n'est pas tant une fragilité génétique ou des antécédents que l'on a mis au jour, mais ces trois critères là !
Au-delà des incidents sur le corps, il y a des incidents sur le comportement des salariés. A force d'être dans cet état d'urgence absolue, permanente, de multiplier les tâches, les salariés ont le sentiment d'être le dos au mur et se montrent agressifs, irritables... y compris dans la sphère privée. Il s'agit d'ailleurs d'un motif de consultation. Les femmes en particulier viennent consulter quand elles ne supportent plus leurs enfants ou commencent à les maltraiter. Elles sont épuisées et ne supportent plus d'être réveillées la nuit quand les enfants font parfois des cauchemars. C'est la terrible porosité entre le travail et la sphère privée qui poussent les personnes à consulter.
On voit aussi l'apparition de la violence : violence entre le salarié et l'usager (l'infirmière vis-à-vis de son patient, le vendeur vis-à-vis de son client, mais aussi les usagers qui ne font part d'aucune reconnaissance et peuvent se montrer violents), violence des salariés entre eux car ils manquent de temps et de moyens pour régler les problèmes (faire payer à quelqu'un son congé maladie à son retour parce qu'il a occasionné encore plus de travail par exemple). Cela déclenche une agressivité profonde dans le collectif de travail qui peut se répercuter contre l'outil de travail. Cela déclenche aussi tous ces comportements managériaux maltraitants qui se répercutent en chaîne jusqu'aux subordonnés.
Les suicides, en recrudescence sur les lieux de travail, sont-ils les ultimes pathologies de surcharge ?
L’accélération des cadences fait qu'on travaille tous au-dessus de nos moyens. L'augmentation de la cadence des tâches à accomplir et leur densification pulvérisent tous les seuils neurophysiologiques et psychologiques supportables. Les gens qui viennent nous voir en consultation nous disent « je n'en peux plus ». Ils décrivent un mécanisme qu'ils n'arrivent plus à arrêter et qui gagne leur vie personnelle. Ils mettent la pression sur leurs enfants, leur conjoint qui doivent suivre leur rythme effréné, passent l'aspirateur au petit matin car ils sont réveillés et n'arrivent pas à partir travailler sans faire le ménage, dorment tout habillés, etc. en d'autres termes, ils n'arrivent plus à appuyer sur le bouton off. Les personnes pensent à se suicider pour pouvoir se reposer, et non parce qu'elles ne veulent plus vivre ! C'est ce que l'on appelle les suicides blancs. Et c'est assez effrayant de les voir augmenter. Eric Hamraoui décrit le suicide comme une manière de rapatrier à l'intérieur de soi l'exécution du bourreau... On dit au cadre, vous avez fixé vos propres objectifs, vous êtes responsable de votre situation, etc. Pour arrêter cela, le salarié tue le patron qu'il est pour lui-même, se débarrasse de son persécuteur interne.
La prochaine étape sera sans doute les meurtres. On les annonce depuis longtemps et ils arrivent. J'ai été sollicité récemment par une magistrate au sujet d'une salarié ayant tué son patron. Après avoir retourné la violence contre eux, les salariés vont retourner la violence sur les dirigeants.
Ces pathologies de surcharge ne reposent-elles que sur des causes organisationnelles ?
Trente ans de chômage de masse et la peur de perdre son emploi ont engendré des postures de soumission et des conduites de domination propices à l'adhésion aux idéologies organisationnelles. Si on fait l'arbre des causes, on remonte toujours à des causes organisationnelles car pour mettre en place cette capture du corps et du psychisme humain par la vitesse, il faut une idéologie productiviste : une économie qui fonctionne non plus par l'amont mais par l'aval. Aujourd'hui, quand les gens désirent quelque chose, il faut agir vite pour y répondre les premiers et produire en conséquence. Il faut donc obtenir que les salariés changent leurs manières de faire, sans se plaindre, sans résister au changement. Or, c'est une négation de leurs compétences, de leurs investissements, de leurs savoir-faire. Pour parvenir à cela, il y a nécessairement des pressions morales. Le management fait redescendre la nécessité du changement avec « si vous n'êtes pas content, la porte est ouverte, il y en 200 qui sont prêts à prendre votre poste », « si vous ne pouvez pas atteindre vos objectifs, c'est que vous ne correspondez pas à l'entreprise », etc.
On voit bien combien les nouvelles organisations, bien décrites par Eric Hamraoui et Mohammed Sidi Barkat, sont extrêmement sophistiquées, et fabriquent comme des orfèvres une machinerie qui vient capturer toute la subjectivité du salarié pour qu'il s'investisse corps et âme dans la nouvelle tâche. Pendant longtemps, on a fait croire aux cadres supérieurs qu'ils étaient les seigneurs de l'entreprise en leur en donnant tous les signes : les gratifications, les primes, les voitures de fonction, etc. Mais on voit bien qu'au fil du temps, cette couche de cadres supérieurs a fini par être atteinte également. Les gratifications se sont faites plus rares et on les a beaucoup chargé avec des injonctions paradoxales : « mettez la pression sur votre équipe », « c'est la guerre économique »... On est venu solliciter ce qu'on appelle la posture héroïque du cadre supérieur : « je suis un cadre, j'ai plus de responsabilités que les autres, je dois prendre sur moi, travailler davantage, faire toujours plus, etc. » mais cela a déplacé le curseur de ce qu'il faut supporter tellement haut qu'ils sont devenus insensibles à leurs propres souffrances et à celles de leurs équipes. Examinez les suicides chez France Télécom : il s'agit pour beaucoup de suicides de cadres supérieurs, de Docteurs en mathématiques ou autres, qui craquent. Pourquoi n’a-t-on pas compris qu'en touchant aux postes, aux compétences, aux lieux d'exercice, on déracinait complètement les salariés et on volait leur vie ? J'ai reçu en consultation des cadres supérieurs mutés sur des plateaux téléphoniques à l'autre bout de la France auxquels on disait « vous acceptez cette mutation ou vous quittez la boîte » tout en sachant qu'en raison de leurs statuts, ils n'auraient aucune allocation s'ils démissionnaient !
Mais comment expliquer que des personnes développent de telles pathologies et que d'autres vivent ce rythme effréné comme un challenge permanent et parviennent à « triompher du temps »? En d'autres termes, existe-t-il des personnes plus vulnérables que d'autres à l'accélération du temps, des secteurs ou des professions plus touchés que d'autres ?
Il y a des cadres qui aiment être dans la compétition avec eux-mêmes mais cela ne dure pas toute une vie, ou rarement ! Ils ne résistent qu'un temps. Après avoir reçu les cadres, les cadres supérieurs, je reçois en ce moment les niveaux supérieurs. Les DAF (directeurs administratifs et financiers) craquent à leur tour parce qu'ils subissent la même organisation que les autres et qu'on leur demande « d'arranger » la comptabilité : les petits arrangements d'hier se transforment en actes délictueux aujourd'hui. Aucun niveau hiérarchique n'est épargné par la dégradation profonde du travail.
Aucun secteur n'est épargné non plus. J'ai reçu le patron d'une petite entreprise de 45 salariés qui ne comprenait pas pourquoi ceux-ci n'allaient pas bien. Au fil de la discussion, j'apprends qu'il a adopté les principes du « lean management ». Faute de temps justement, il a collé cette méthode à son entreprise et à ses salariés. Ainsi, il a peu à peu supprimé des pauses, optimisé les temps de déplacement, rapproché les postes, fait refaire la salle de repos mais en enlevant tous les posters et photos mis en place par les salariés... En exprimant tous ces changements, il s'est rapidement rendu compte qu'il faisait complètement fausse route. Je lui ai juste donné un espace et du temps pour réfléchir à l'organisation de son entreprise. Après il n'y a pas de miracle, mais il a su inverser la tendance en réintroduisant des pauses, en organisant des journées portes-ouvertes pour valoriser le travail de ses salariés, en les laissant décorer leur salle de repos comme ils le souhaitent, en embauchant la femme de ménage qui apportait des gâteaux et des fleurs et discutait avec chacun, etc. Il ne s'agit pas d'investissements pharaoniques, mais juste une autre manière d'appréhender l'organisation du travail.
Peut-on dire qu'avec de telles organisations de travail, on abîme le salarié autant que le travail ?
Absolument. Regardez par exemple la manière dont on dresse de manière récurrente le palmarès des hôpitaux. Il serait naturel et logique d'examiner la qualité des soins, la satisfaction et le suivi des patients. Or, aujourd'hui, les critères retenus sont le nombre de procédures réalisées (et en médecine, comme ailleurs, « plus » ne veut pas forcément dire « mieux »), l'importance du plateau technique ou encore le nombre d'infections nosocomiales. Le meilleur hôpital est-il réellement celui où l'organisation du travail vous infecte le moins ? Chacun sait que l'intensification du travail en milieu hospitalier et les 35 heures ont considérablement réduit les temps de transmission, les temps passés au chevet du patient, les temps où on se lave les mains... La publicité de la MACSF, la mutuelle des professionnels de santé, est aussi révélatrice : elle évoque très clairement l'intensification du travail des infirmiers, le risque d'erreur médicale et rappelle toutes les solutions qu'elle propose pour défendre et protéger contre les plaintes. On préfère judiciariser plutôt que de mener une réelle réflexion sur l'accélération et l'organisation du travail. Quand Toyota rappelle plus de 12 millions de voitures vendues à travers le monde, cela n'interroge pas davantage, personne ne fait le lien. Un massicoteur me le racontait récemment, mais les exemples existent dans absolument tous les domaines, on préfère faire partir des produits défectueux dans les délais, et laisser le service après-vente gérer la colère du client, plutôt que de prendre le temps de corriger ses erreurs.
Subir, s'adapter, résister ou ralentir... Des personnes parviennent-elles à s'opposer à l'accélération du temps, à l'organisation du travail et à leur propre désir de faire bien et dans les temps ?
Habituellement, les femmes s'en sortent mieux. Elles sont pourtant de plus en plus mal traitées dans l'organisation du travail puisqu'elles continuent à être moins payées que les hommes pour des emplois équivalents, à occuper des postes de subordonnées, etc. Mais les femmes acceptent cela parce qu'elles ont à côté la maternité pour combler l'épanouissement qui ne peut se faire dans le travail ou que partiellement. Rappelons que 80% des femmes françaises choisissent de travailler et de faire des enfants. Cela ne veut pas dire qu'elles ne sont pas épuisées de faire les deux. Mais mobiliser du temps pour quelque chose qui a du sens est moins pathogène que d'accomplir des tâches vides de sens.
Il y aussi les personnes qui développent des savoir-faire pour passer entre les gouttes. Ils s'investissent moins dans leur travail et parviennent à adopter un rythme plus tranquille, aux côtés des salariés investis qui travaillent à un rythme effréné.
Enfin, il y a toute la nouvelle génération qui n'investit pas le travail. Les jeunes se désengagent, avec les conséquences que l'on imagine sur la qualité du travail, et s'épanouissent ailleurs, dans d'autres domaines... Certains aiment leur travail, mais une fois la journée finie, parviennent à ne plus y penser du tout. D'autres envisagent de travailler beaucoup, pendant un temps, puis de se tourner totalement vers d'autres activités, fonder une famille, etc. Ils parviennent ainsi à se tenir à distance de l'accélération du temps. C'est une défense que l'on n'aurait pas cru possible il y a encore quelques années. Encore une fois, ceci est lourd de conséquences : le génie français va se perdre avec un tel désengagement du travail.
Pourquoi le travail peut-il autant faire souffrir ?
Si le travail peut faire souffrir, c’est d’abord parce qu’il est porteur de nombreuses promesses : montrer ses savoir-faire, gagner sa vie, apprendre à vivre ensemble, à coopérer. C'est un domaine extraordinairement passionnant car il se situe à l'interface de la construction identitaire personnelle et de l'organisation même d'une société. Il convoque à la fois le corps biologique et le corps identitaire, subjectif. Il convoque bien évidemment l'éthique d'une société, ce qu'elle a envie de produire et de laisser dans l'histoire de l'humanité.
Qu'en est-il ailleurs ? Des pays échappent-ils à cette intensification et cette densification du travail que vous décrivez ?
L'évolution est générale, les organisations du travail sont les mêmes partout. En revanche, la valeur travail est différente. Aux États-Unis par exemple, le travail est davantage valorisé, aussi bien oralement que financièrement. Bien sur, il faut travailler beaucoup mais les efforts sont remarqués et récompensés. En France, on n'est pas rétribué. Le management entretient la déstabilisation de ses salariés de peur qu'ils ne se reposent sur leurs lauriers. Le salarié est vu comme un ennemi de l'intérieur alors que l'activité de l'entreprise dépend de lui. C'est un quiproquo tragique.
Percevez-vous des signaux de changement ? Par exemple, le mouvement slow, des entreprises qui semblent prendre en compte le mal-être de leurs salariés et installent des espaces de repos... ou bien ne s'agit-il que de symptômes, ou encore de moyens d'assurer la productivité ?
Proposer des massages aux salariés, des caissons de repos, etc. n'est que du gadget. Tant que les chefs d'entreprise n'auront pas compris que sur le plan biologique et cognitif, les pauses ne sont pas des temps perdus mais des moments de réflexion, de détente, de convivialité, il n'y aura pas de changement profond. Le travail ne peut être une activité constante : faire autre chose, dialoguer puis rependre le travail permet bien souvent de trouver la solution. Ces temps élémentaires ont disparu. Les gadgets supposés améliorer le bien-être des salariés sont bien souvent mis en place pour tenter d'augmenter encore la productivité. On ne s'attaque pas au vrai problème. Je pense par exemple, à une ouvrière qui doit visser 27 bouchons par minute et adapter son geste quand le flacon change, parce que cela coûte cher de faire venir un régleur pour adapter la machine au produit en cours de conditionnement. Ce n'est pas un massage qui la soulagera. On ne peut avoir une réponse simple à ce problème.
Des indicateurs objectifs de la souffrance au travail existent et sont mesurés depuis de nombreuses années. Que pouvons-nous faire pour contrer l'évolution que vous nous décrivez ?
Comprendre le fonctionnement du corps humain et les pathologies de surcharge est la seule piste intéressante pour faire connaître les enjeux, sinon on va rester dans le traditionnel débat sur la lutte des classes : le dirigeant « bourreau » et le salarié « victime ». Dans les deux camps, les salariés comme les dirigeants, règne une méconnaissance du corps au travail, corps organique comme corps identitaire.
Mais il faut aussi arrêter d’attendre de nos élites, de nos cadres, de nos politiques qu'ils apportent la solution. Ces personnes sont prises dans un monde où on n'a pas le temps de penser. Mais tous, individuellement, nous pouvons faire quelque chose. C'est notre monde, notre économie, il faut arrêter de penser qu'on ne peut rien changer et laisser les gens dans un sentiment d'impuissance. Chacun de nous peut se mobiliser pour revenir à des critères plus logiques et pragmatiques d'exécution du travail. Je pense que les femmes sont un peu plus douées que les hommes pour cela et pourraient contribuer à faire évoluer les choses..
Enfin, tous les acteurs impliqués doivent pouvoir travailler ensemble dans des réseaux pluridisciplinaires afin de se saisir de la question de l'organisation du travail et de traverser le territoire du travail. Quand nous formons des cadres, nous essayons de leur expliquer à quel point leur posture héroïque les met en situation d'aller toujours plus vite, d'en faire toujours plus, de ne jamais mettre de limites et nous leur expliquons aussi l'obligation de sécurité et de résultats qui pèse désormais sur l’employeur. La loi oblige le chef d'entreprise à préserver la sécurité et la santé physique et mentale de ses salariés. Obligation de résultats et pas seulement de moyens ! La santé au travail est l’affaire de l’entreprise. Si on ne fait pas de prévention primaire, on se dirigera vers une judiciarisation de ces questions et une recrudescence des condamnations. Encore une fois le corps humain a des limites précises. Nous ne pouvons pas plier notre poignet 27 fois par minute parce qu'il ne tiendra pas. On ne peut pas maintenir notre taux de cortisol au sommet en permanence. Un coureur du 100 mètres est, entraîné, préparé, accompagné par un nutritionniste, un kinésithérapeute... Les athlètes de la quantité n'ont rien de cela et pourtant, on leur demande d'être au maximum tout le temps. Quand la 1ère ligne s'effondre, une autre vient la remplacer, etc. C’est le cynisme du système. Il est urgent de retrouver des espaces de pensée pour réfléchir à toutes ces questions, et pour cela, il faut prendre le temps.

Article
Synthèse du colloque organisé par Tempo Territorial et la Métropole de Lyon – Retour sur les interventions du jeudi 9/11/2023.

Article
Synthèse du colloque organisé par Tempo Territorial et la Métropole de Lyon – Retour sur les interventions du vendredi 10/11/2023.

Interview de Anca Boboc
Sociologue du travail et des organisations, spécialiste des usages du numériques en entreprise
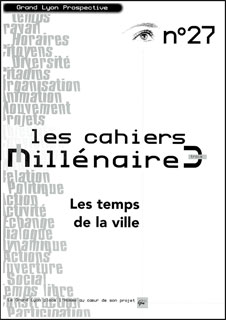
Étude
Le plan de mandat 2001/2007 du Grand Lyon met à l’ordre du jour une réflexion sur les temps de la ville.

Interview de Arnaud STIMEC
Professeur de gestion à l'université de Reims

Interview de Nicole AUBERT
Hommes et Organisation du campus Paris d'ESCP Europe.
Interview de Michel WEILL
ARAVIS
Texte de Jean-Yves BOULIN

Les métiers du prendre soin souffrent d'un fort turnover. Pourtant, les facteurs d'engagement dans ces métiers très humains ne manquent pas. Alors, que se passe-t-il ?