LES RÉVOLUTIONS DE LA MÉMOIRE À L'ÈRE DU NUMÉRIQUE
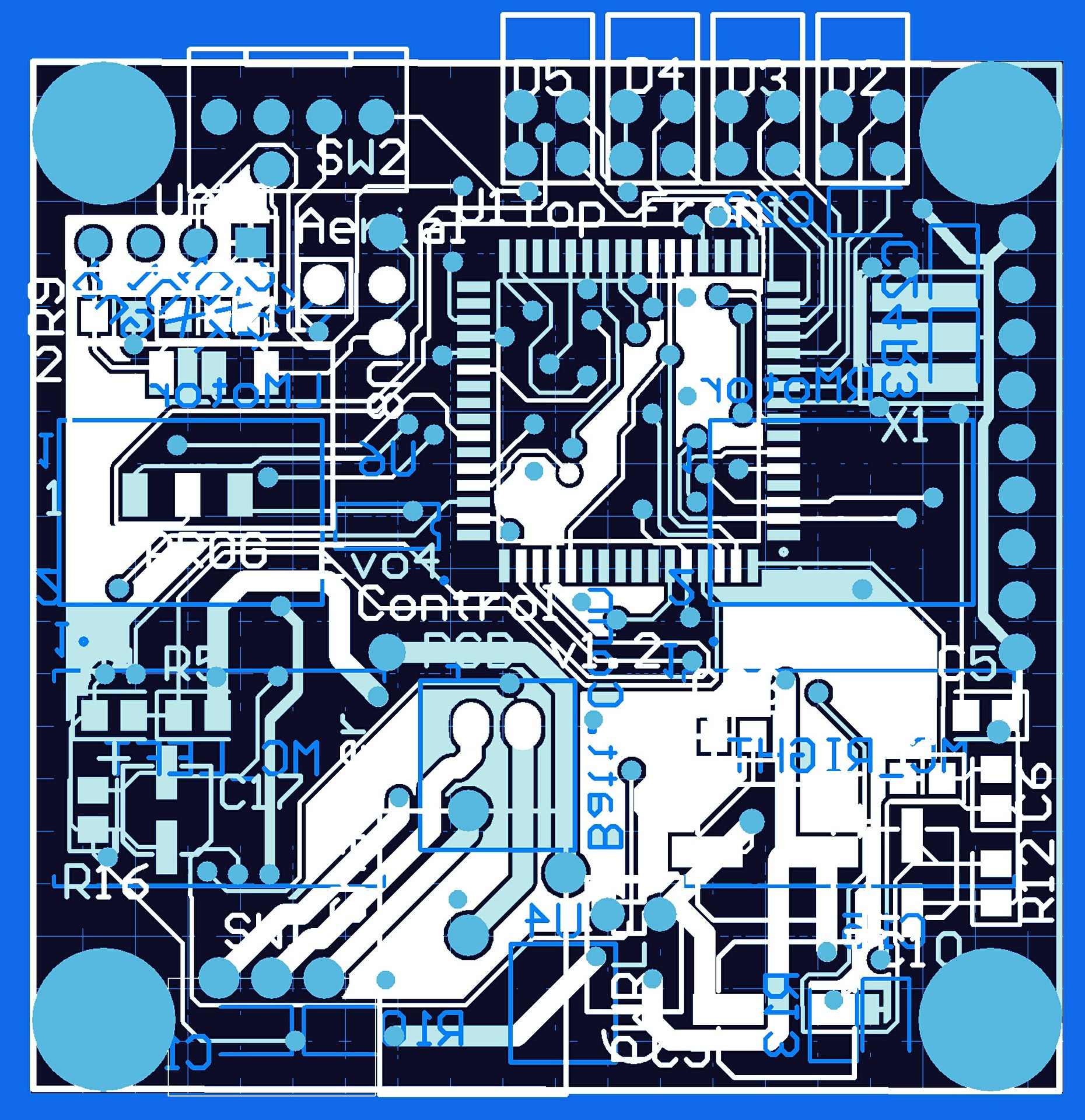
Comment les acteurs de la mémoire appréhendent-ils le passage d’une mémoire culturelle classique à une mémoire numérique ?
Interview de Ghislaine Chartron

<< Il nous faut rapidement mettre en place une vraie politique nationale en matière d’édition numérique sans détruire les systèmes éditoriaux existants, du moins ceux qui ont prouvé leur efficience >>.
@rchivSIC est une archive dédiée aux recherches en sciences de l’Information et de la communication.
C'est l’une des premières archives ouvertes créées en France. Elle a été mise en place en 2002 sous l’impulsion de chercheurs en sciences de l’information et de la communication en mars 2002. Elle se place dans le mouvement mondial des archives ouvertes initiée par Paul Ginsparg. Cette archive ouverte est dédiée aux Sciences de l’Information et de la Communication. Ce champ interdisciplinaire, souvent éclaté, trouve dans cette archive un outil d’aide à la mise en visibilité, au rassemblement et à l’’accessibilité des travaux. @rchivSIC est régie par le principe de l’autoarchivage : c’est l’auteur même de l’article qui le dépose et l’indexe.
Quel est aujourd’hui votre domaine de recherche ?
Je travaille essentiellement sur les questions relatives à l’édition scientifique numérique en comparant parfois avec d’autres secteurs de l’édition. J’ai été impliquée dans différents projets pionniers d’édition numérique en France. C’est à la fois la conception, l’expérimentation et l’analyse de tels projets qui animent ma motivation dans ce domaine. Ces dernières années, j’ai investi plus particulièrement les champs des SHS en particulier les caractéristiques propres des modalités d’open access ainsi que les modèles économiques qui pourraient y être associés. Plus globalement, ce sont aussi les différences d’appropriation de l’information numérique et des outils numériques qui m’intéressent.
Concernant l’innovation de dispositifs, j’ai contribué à la naissance de la revue électronique Solaris (1998) avec Jean-Max Noyer, Gabriel Gallezot et Sylvie Fayet-Scribe, puis au développement de l’archive ouverte @rchiveSic en 2002 avec les mêmes collègues et l’appui du Centre de Communication Scientifique Directe de Lyon.
Depuis quelques temps, je travaille également sur l’impact du web 2.0 sur la communication scientifique avec Evelyne Broudoux. L’objectif est de bien analyser les évolutions en cours dans la communication scientifique, les motivations et les freins des chercheurs confrontés, comme toute la société, à ce mouvement participatif élargi des modes de communication.
La création d’@rchiveSIC répondait-elle à un besoin particulier émanant de la communauté de recherche ?
On ne peut pas dire exactement ça. Dans le début des années 2000, j’ai suivi ce qui se passait dans les pays anglophones et j’étais persuadée que ces outils représentaient l’avenir en matière de circulations des idées et des écrits au-delà des revues qui sont très nombreuses et ce, surtout en sciences de l’information et de la communication, champ interdisciplinaire. Il est très difficile de suivre l’actualité de ces revues ; qui sont, qui plus est, des domaines très variés. Lorsqu’on travaille dans l’interdisciplinarité, on est sensible à ces questions de croisement des idées, de circulation des savoirs. L’idée de concevoir un outil transversal et ouvert a été en grande partie motivée par ce projet de décloisonnement, au-delà du territoire de chaque revue.
Lorsque vous avez créé ces outils dans les années 2000, avez-vous ressenti des freins importants de la part de la communauté de chercheurs ?
Oui, évidement. Il y a beaucoup de freins de la part des chercheurs et des institutions. A l’époque, nous étions vraiment considérés comme des « électrons libres». Nous avons, certes, été aidés par la sous-direction des bibliothèques universitaires au Ministère (Clarisse Marandin), c’est-à-dire par des personnes sensibilisées aux problématiques de la transmission des savoirs. En revanche, la communauté scientifique de l’époque a été très réticente.
Les freins ont été et sont encore multiples. Tout d’abord, les chercheurs en SHS sont très impliqués dans leurs revues pour la simple et bonne raison que souvent, ils sont à la fois chercheur et éditeur. La priorité est donc de ne pas fragiliser la revue qu’ils ont créée ou qu’ils défendent. Il existe un grand nombre de revues ; ce qui d’ailleurs, ne facilite pas la concurrence des idées…
L’économie de l’édition en SHS est atomisée et fragile. C’est sans doute une des raisons qui fait que le libre accès ne se développe pas si facilement. En sciences dures, nous ne sommes pas du tout dans le même cas de figure : il y a de grosses maisons d’édition anglophones telles Springer, Wiley, APS, Elsevier, etc. qui déploient leurs ventes sur le marché international. Dans le cas des SHS francophones, ce sont davantage des petites maisons d’édition à diffusion nationale et à tirage réduit.
Les accords entre les éditeurs SHS et les archives ouvertes ne sont pas encore très aboutis. Pour les raisons évoquées précédemment, les éditeurs n’ont pas encore totalement éclairci avec leurs auteurs la politique en matière de dépôt des articles dans les archives ouvertes.
Sinon, concernant les freins des chercheurs, il y a aussi et toujours l’idée sous-jacente selon laquelle les publications en libre accès sur Internet ne seraient pas évaluées ou seraient de moindre valeur… Or il n’en est rien, un article dans une archive ouverte est dans la majorité des cas un article qui a déjà été évalué… C’est une méconnaissance du système mis en place.
Il est important de trouver un « éco-système » où les éditeurs ne se sentent pas fragilisés, où le travail qu’ils font soit reconnu et rétribué à sa juste valeur mais où parallèlement, la circulation des textes soit facilitée par des outils numériques entre autres.
N’y aurait il pas aussi un souci en terme de volonté de transmission ?
C’est possible. Cela peut être aussi un frein. Il est vrai qu’en déposant son article en ligne, on s’expose au plagiat, à la reprise des idées. Mais c’est un mauvais calcul, car les retombées sont aussi importantes : on est plus visible, plus lu, plus cité et on élargit son champ « d’influence ».
Le phénomène de partage via les outils numériques n’est pas aussi massif en SHS que dans les sciences dures. Il s’agit là aussi de pratiques et de traditions disciplinaires différentes. Les chercheurs de sciences dures construisent ensemble leur savoir : ils publient, font des expériences, vont aux mêmes colloques internationaux. Ils travaillent collectivement au laboratoire. Ils ont une véritable « tradition » de travail en collaboration. En SHS, les recherches sont majoritairement plus solitaires. Le travail d’équipe est moins fréquent qu’en sciences dures. La communauté de chercheurs est plus éclatée et dans un certain sens, il y a peu de paradigmes unificateurs. Ce constat conduit a fortiori au fait que les chercheurs en SHS partagent peu leur système de diffusion de l’information. Il y a pourtant un enjeu autour de ces problématiques : il faut que les informations et le savoir soient visibles, qu’ils circulent et soient mis en interconnexion au niveau international. Cet enjeu traverse tous les champs et disciplines scientifiques. Reste à savoir maintenant si tous les chercheurs partagent cet enjeu et veulent l’intégrer dans leurs pratiques professionnelles. On peut se dire que c’est un mouvement en marche ne serait-ce que parce la recherche publique n’est plus financée de la même façon. On incite les chercheurs à répondre à des appels d’offre (ANR) à s’inscrire dans des projets (PCRD) et à leur donner une dimension internationale.
Il y a aussi des formes d’incitation pour que les chercheurs déposent leurs articles en ligne ?
Oui, c’est exact. Mais il n’y a pas d’obligation sauf dans quelques universités ou institutions de recherche. Il y a des universités aux Etats-Unis, en Belgique où le dépôt en ligne est obligatoire. En France, ce n’est pas le cas. L’AERES incite les chercheurs à déposer sur une archive en ligne de leur choix mais il n’y a pas de vérification à notre connaissance. Il y a des domaines, comme la médecine, où les chercheurs le font plus aisément toute simplement parce qu’ils s’alignent sur les pratiques dominantes des Etats-Unis.
Toutefois, je suis persuadée qu’il nous faut rapidement mettre en place une vraie politique nationale en matière d’édition numérique sans détruire les systèmes éditoriaux existants, du moins ceux qui ont prouvé leur efficience à ce jour. C’est aussi une question de qualité de la recherche, de qualité de sa diffusion et de sa transmission.
A l’heure actuelle, au sein du GFII (Groupement Français des Industries de l’Information) sont réunis des éditeurs et des représentants de la recherche afin d’envisager des modalités partagées par l’ensemble des parties.
Dans ce cadre, en terme d’usages, pensez-vous que les pratiques professionnelles des chercheurs en matière de recherche d’informations, de documentation et de publication ont changé ?
Il faut déjà se dire que lorsque l’on parle de sciences humaines et sociales, on englobe des disciplines très différentes qui auront des pratiques variées. Le sociologue travaille différemment du philosophe qui lui travaille différemment du géographe ou de l’historien, etc. C’est un champ vaste avec des méthodologies diverses. Ceci étant dit, globalement, on observe des mouvements de fond.
L’accès aux ressources a fortement évolué. De plus en plus, les chercheurs se tournent vers l’international. Ce mouvement est dû en partie au numérique. Par exemple, dans les bibliothèques universitaires, on achète des licences d’accès à des corpus internationaux et on s’abonne à des revues internationales disponibles par tous sur les campus.
Autre constat récent qui n’est pas uniquement lié au numérique : une des doctorantes de mon équipe a travaillé sur une comparaison des pratiques documentaires de chercheurs en science de l’éducation entre le Royaume-Uni et la France. Elle a mis en évidence que pour le Royaume-Uni, l’article est bien plus utilisé que l’ouvrage alors qu’en France, on est dans le cas contraire.
Qu’est-ce qui provoque ce basculement ? Tout d’abord, l’article est de plus en plus important dans l’évaluation du chercheur (poids du classement des revues) ; c’est aussi un moyen de confrontation aux autres. Par ailleurs, la recherche en SHS se tourne de plus en plus vers une recherche sous mode projet ou en réponse à des appels d’offres et dans ces circonstances, l’article et le rapport de recherche jouent un rôle majeur pour la restitution des résultats. Un autre facteur important est le temps. Tous les chercheurs vivent une accélération dans la conduite de leurs travaux, cadrés par des calendriers de plus en plus serrés… Les livres en SHS ne sont pour autant pas morts. En revanche, ils sont de plus en plus collectifs.
Ces changements de pratiques sont-ils représentatifs d’un changement du monde de la recherche ?
Oui, cela me paraît évident. En tant que directrice d’équipe, je peux dire que la dotation financière minimale d’une équipe est restreinte. Si l’on veut se déplacer dans des colloques, explorer des terrains nouveaux, acheter du matériel et organiser des séminaires et/ou des colloques, il faut vraiment que nos recherches soient cadrées dans des appels d’offre. Il est vrai que ce système conduit à articuler la recherche aux demandes des acteurs socio-économiques et de la société civile. C’est un changement pour les SHS qui n’est pas forcément négatif. Cette nouvelle économie de la recherche influe en tout cas sur les modes de publication et d’édition.
Vous avez été responsable de la cellule veille scientifique et technologique de l'Institut national de recherche pédagogique (INRP) et enseignante à l’Ecole nationale des sciences de l’information et des bibliothèques (enssib) à Lyon de 2003 à 2006, pensez-vous que la région Rhône-Alpes soit une région active en matière de développement d’outils numériques ?
Beaucoup de projets sont nés à Lyon et plus largement dans la région Rhône-Alpes. Pour ne citer qu’eux, il y a eu le Centre de Communication Scientifique Directe (CCSD) et Hal-Archives-ouvertes, Persée à Lyon 2, l’OAPEN avec les Presses Universitaires de Lyon , les travaux de l’Institut des Sciences de l’Homme (ISH), les travaux de numérisation entrepris par l’ENS-LSH ainsi que ceux de l’Institut National de Recherche Pédagogique (INRP).
La région Rhône-Alpes semble tournée vers le développement du numérique. Au-delà de suivre ce mouvement, elle a même été novatrice et pionnière. La création de l’Institut des Sciences du Numérique (ISDN) dans les années 2000 en a été également une preuve.
Toutefois, il faut distinguer l’engouement des militants qui a abouti à la création d’un certain nombre de projets et l’adhésion des chercheurs élargis. Il est très dur de savoir si les acteurs de la recherche en Rhône-Alpes sont plus actifs ou non dans l’utilisation de ces outils – aussi bien en terme de dépôt qu’en terme de recherche d’informations. Il faudrait pour cela créer un observatoire des pratiques qui serait très utile pour la suite.
Comment une collectivité territoriale telle que le Grand Lyon peut-elle aider au développement ce type d’outils ?
Il est vrai que le monde de la recherche et celui des collectivités sont deux mondes différents avec des impératifs et des modes de fonctionnement leur étant propres. Les collectivités territoriales telles que les Conseils généraux interagissent avec la recherche via les clusters par exemple. Il ne faut pas développer des outils et des projets sans prendre en compte les contraintes des chercheurs. Si de nouveaux projets se créent, il faut que cela ait un sens pour le chercheur. L’enseignant-chercheur est déjà submergé par les contraintes qui lui sont imposées et notamment celles de la publication.
Une collectivité territoriale peut aider au développement et/ou à la création de projets innovants en les subventionnant par exemple.
Il serait envisageable qu’une collectivité crée un site global de communication scientifique dans sa région dédié aux actualités, aux appels d’offre, etc. Mais cela demanderait une implication de chercheurs ou alors de médiateurs (documentalistes) proches des chercheurs.
Une autre idée serait que la collectivité en partenariat avec des acteurs du numérique comme Centre de Communication Scientifique Directe (CCSD), Doc-Forum, et d’autres partenaires crée une archive ouverte «territorialisée » en recensant les productions des chercheurs de ses universités et en créant, par ailleurs, des partenariats avec des entreprises de la région ou non. Si le Grand Lyon ou la région se lançait dans cette initiative, ils seraient les premiers en France à le faire. Ce serait probablement utile car cela donnerait de la visibilité à la recherche régionale et cela susciterait probablement à terme des partenariats entre différents acteurs de la région, contribuant à une dynamique territoriale régionale.
• Depuis 2006 : Professeur au Cnam et Titulaire de la chaire d’ingénierie documentaire. Directrice de l’Institut national des sciences et Techniques de la Documentation (INTD), depuis Juin 2007.
• 2003/2006 : Professeur des Universités, responsable de la cellule veille scientifique et technologique de l'Institut national de recherche pédagogique, Lyon. Enseignante à l’Ecole nationale des sciences de l’information et des bibliothèques
• 2003 : Maître de Conférences à l'URFIST de Paris (Unité régionale de formation à l'information scientifique et technique)/ Ecole Nationale des Chartes. Responsable de formation pour la documentation médicale et pour les sciences de la nature.
• 2003 : Prix du livre i-expo Chartron G. (sous la direction de), Les chercheurs et la documentation numérique, nouveaux services et usages, Editions du Cercle de la Librairie, Collection Bibliothèques, juillet 2002, 268p
• 2002 : Création d’@rchivsic. Archive ouverte spécialisée en sciences de l’information et de la communication
• Evelyne Broudoux, Ghislaine Chartron (2009), La communication scientifique face au web 2.0. Premiers constats et analyse. archivesic.ccsd.cnrs.fr/sic_00424826/fr/
• Ghislaine Chartron (2008), « Une offre en pleine expansion. Documentaliste. Sciences de l’information, vol 45. n°2, p. 28-34
• Ghislaine Chartron (2007), « Evolutions de l’Edition scientifique 15 ans après », Colloque international EUTIC 2007, Université d’Athènes, 7-10 nov. 2007. http://archivesic.ccsd.cnrs.fr/sic_00186675/fr/
• Marc Minon et Ghislaine Chartron (2005), Etats des lieux comparatifs de l’offre de revues SHS. France-Espagne-Italie. Etude réalisée pour le Ministère de l’Education nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, juin 2005. https://archivesic.ccsd.cnrs.fr/sic_00001561/fr/
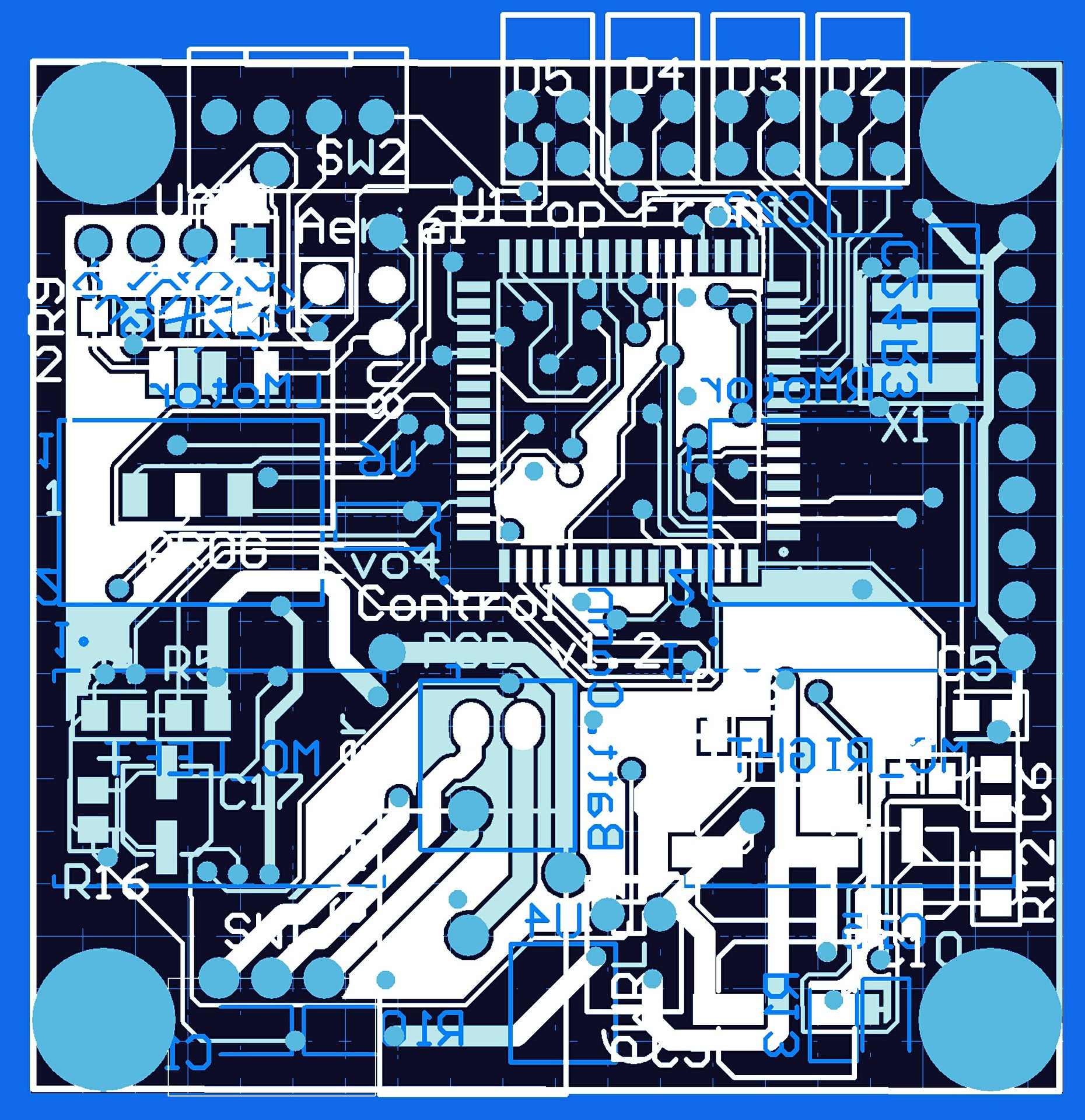
Comment les acteurs de la mémoire appréhendent-ils le passage d’une mémoire culturelle classique à une mémoire numérique ?

Quel avenir pour nous avec les robots ? La question se pose alors que les robots ne sont plus l'apanage du monde industriel.

Que sont les digital humanities et comment contribuent-elles à ancrer les sciences sociales dans la société, à renforcer leur «utilité sociale» et dans une certaine mesure aussi, à les re-légitimer ?

Interview de CHRISTIAN WOLF
Maître de conférences

Interview de Gérard BAILLY et Nicolas MARCHAND
"Il faut profiter de l’effet de levier du projet Robotex pour créer un pôle robotique régional au niveau de la recherche académique".

Interview de Fabien SOLER
Directeur du Cluster EDIT
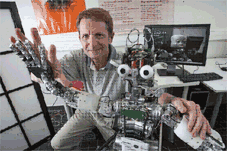
Interview de Peter FORD
Directeur de recherche en neurosciences et robotique (ICSC-CNRS) à l'INSERM de Bron

Interview de Anne-Catherine Marin et Tristan Vuillet
Anne-Catherine Marin est directrice des Archives municipales de Lyon en 2010 et Tristan Vuillet est chargé des recherches

Interview de Christine BERTHAUD
Responsable du Service d'Ingénierie Documentaire de l'ISH de Lyon