Modélisation urbaine et simulation sociale
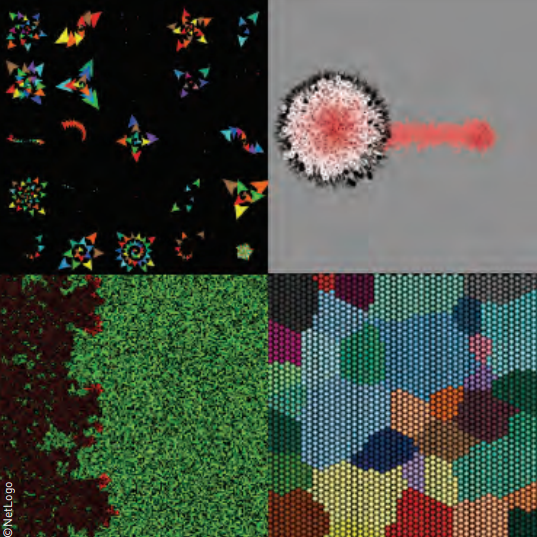
Étude
S’appuyant sur des exemples, des entretiens avec des chercheurs et la littérature académique, ce document donne un éclairage sur les principaux outils utilisés.
< Retour au sommaire du dossier

Interview de Lise Bourdeau-Lepage
<< Si on arrivait à déterminer les éléments constitutifs du bien-être de l’individu relatifs à l’espace, alors on devrait pouvoir mieux aménager nos villes ou nos villages >>.
Si le bien-être des habitants est évidemment le Graal de toute collectivité, il semble aujourd’hui difficile d’en proposer une mesure objectivable. La chercheuse Lise Bourdeau-Lepage, professeur de géographie à l'Université Lyon 3 et membre du Laboratoire d’Excellence Intelligence des Mondes Urbains (IMU), en propose une lecture novatrice croisant les approches héritées d’Amartya Sen et de l’économie territoriale.
Sa recherche, résolument théorique et appliquée, nourrit ainsi les réflexions méthodologiques relatives à l’aménagement des territoires urbains et à leurs aménités. Elle a comme fil rouge une focale sur les inégalités sous-jacentes à tout projet urbain, y compris dans les projets perçus comme forcément positifs pour les populations locales, à l’image de la végétalisation urbaine. Ce travail permet ainsi de comprendre comment la mesure du bien-être pourrait permettre non seulement de mieux aménager les villes, mais plus généralement d’intégrer les « impensés » des politiques publiques au sein même de leur formulation.
Comment en êtes-vous venue à travailler sur la mesure du bien-être en ville ? Dans quelle mesure votre parcours disciplinaire a-t-il influencé votre perception du sujet, et la manière dont vous l’abordez ?
C’est un cheminement qui vient de loin. Je suis arrivée à l’urbain à la suite de ma thèse en économie, dont les conclusions m’ont amenée à travailler sur les villes des pays d’Europe de l’Est, pour voir comment elles s’étaient transformées d’un point de vue purement économique depuis la chute du mur de Berlin. Puis, à partir de 2002, je me suis intéressée à quelques villes particulières, connues sous le terme de métropoles. C’était un travail conceptuel, définir la métropole et ses formes particulières à travers l’histoire. J’ai ensuite étudié les activités de d’innovation et de R&D et le mode de gouvernance dans une métropole globale en étant Chargée de mission pour la Région Île-de-France.
Ainsi en 2007, j’avais l’impression d’avoir creusé assez profondément les tenants et aboutissants de l’activité économique de ces villes. Sauf que derrière ces activités économiques, il y a des humains. Comment vivent-ils ? Que produit-on dans une métropole globale ? Quelles sont les inégalités que ces activités métropolitaines peuvent générer ? Est-il tenable de vivre dans ces villes pour toutes les catégories d’individus ? Je pouvais revenir à mes premières amours en matière de recherche : l’étude des inégalités socio-spatiales qui est le fil rouge de mes travaux . Et finalement, cela m’a amenée à travailler sur le bien-être ! Est-ce que les individus vivant dans ces métropoles, ont une qualité de vie différenciée ? Comme ce fût le cas à partir de 2001 dans ma collaboration sur l’urbain avec Jean-Marie Huriot, la suite a été le fruit de rencontres, en particulier avec Antoine Bailly sur la nature et le bien-être.
Quelle est votre approche sur la question du bien-être des individus ? Comment le définiriez-vous ?
J’ai d’abord commencé à travailler sur l’approche des “capabilités”, telle que formulée par Amartya Sen, en essayant d’étalonner le bien-être. Dans la définition classique des économistes, la proxy du niveau de bien-être est le niveau de revenu. Le prisme est donc l’utilité et l’approche est quelque peu réductrice . Ce qui est intéressant avec l’approche de Sen, c’est qu’elle est multidimensionnelle, prenant en compte le bien-être comme liberté, la liberté de choix et les réalisations effectives : le vécu. Cela m’a logiquement amenée à travailler sur une mesure objective du bien-être. Aujourd’hui, je dirais toujours que le bien-être est multidimensionnel. L’adaptation de l’individu à son environnement compte effectivement mais à la différence de l’approche de Sen, je crois que sa relation aux autres est importante et que la dimension spatiale de son existence a une influence sur son bien-être et ses préférences.
Vous aborder cette question dans une approche territoriale. Quels liens faites-vous entre le bien-être des individus et le territoire ? Quelle est la finalité de cette approche ?
Ce qui me paraissait vraiment intéressant c’était de travailler sur la relation-humain et la relation-espace. C’est là que j’ai basculé vers le bien-être, non plus dans une approche objective, mais dans une approche multidimensionnelle qui allait prendre en compte à la fois des éléments objectifs et des éléments subjectifs.
Les travaux que je produis aujourd’hui vont dans ce sens : quels sont les éléments constitutifs du bien-être des individus, ceux qui sont liés au territoire. C’est le but ultime : si on arrivait à déterminer les éléments constitutifs du bien-être de l’individu relatifs à l’espace, alors on devrait pouvoir mieux aménager nos villes ou nos villages. Déterminer quelles sont les préférences des individus face à ces éléments constitutifs de leur bien-être permet de faire un diagnostic du territoire, de voir si ces éléments y sont présents ou non, de savoir s’ils sont considérés comme importants ou non...
S’ils ne sont pas présents, on peut alors se poser la question suivante : Est-il par exemple possible de les introduire comme critères d’aménagement ? Mais cela permet aussi deux choses :
- Premièrement, d’envisager des aménagements amènes en prenant en compte dès le début de leur conception les attentes des individus ;
- Deuxièmement, d’arbitrer entre plusieurs projets d’aménagement envisagés en se fondant sur les désirs des individus. Mais au-delà de cette prise en compte, il est évidemment nécessaire de regarder quel impact ces scénarios d’aménagement peuvent avoir sur les inégalités.
Dans cette perspective, comment faites-vous pour mesurer les attentes des habitants concernant la qualité de vie au sein d’un environnement donné ?
J’essaie d’élaborer une mesure multi-critères du bien-être qui lie la subjectivité de l’individu et les éléments objectifs du territoire (en particulier : les aménités). Cela va concerner :
- tous les critères pris en compte dans le choix de résidence des individus (il s’agit notamment de certains facteurs d’attractivité d’un territoire) ;
- mais aussi les éléments de l’approche objective du bien-être (reprise de Sen notamment)
- et tous les facteurs qui font consensus dans les études sur les éléments favorisant le bien-être.
De cette manière, on dispose d’un nombre d’éléments constitutifs du bien-être. J’en ai collecté une petite trentaine jusqu’à maintenant mais je continue à y réfléchir. Ensuite, il s’agit avec mes collègues d’aller enquêter auprès des habitants de lieux différents. Ainsi, à partir d’un protocole d’enquête établi, au sein d’un projet de recherche nommé BE IN que je dirige à l’Université Lyon 3, nous demandons aux gens, de déterminer quels sont les 10 plus importants éléments pour la constitution de leur niveau de bien-être, parmi cet éventail de 30 éléments. Par la suite, nous leur demandons de hiérarchiser et de donner un poids à chacun des 10 premiers éléments qu’ils ont retenus. Nous évitons ainsi d’introduire de la subjectivité dans ces éléments...
Pour résumer : ce qui m’intéresse ce n’est pas de savoir quels sont les éléments constitutifs du bien-être (ce n’est qu’une partie de l’observation), mais bien de savoir si ces éléments sont présents sur le territoire et s’ils sont importants pour les habitants !
Dès lors, comment passe-t-on d’une étude sur le désir des habitants à la mise en place d’aménagements urbanistiques ?
D’abord, chacun des éléments ressortant de cette analyse qualitative est ensuite quantifiés car à chaque élément constitutif du bien-être correspond un indicateur/une donnée géolocalisé(e), cela permet de savoir si sur un territoire, l’élément est absent ou présent et de quelle manière. En utilisant les pondérations accordées à chacun des 10 éléments retenus, on obtient une petite équation de bien-être (faite des 10 éléments retenus par l’individu avec leur pondération) dont le calcul donne un niveau de bien-être pour chaque individu sur un territoire donné. Donc si un individu me dit “ce qui est important c’est le niveau d’emploi, c’est le fait que je puisse habiter dans une maison, que je puisse avoir un accès rapide à un parc, ou qu’il y ait beaucoup d’associations avec une vie de quartier importante…”, je peux étalonner la présence/l’absence de chaque donnée (élément) sur le territoire où habite l’individu, et comparer par exemple avec une commune voisine et voir si cette autre commune correspond mieux à ses attentes. Globalement ça revient à faire le travail suivant pour chaque individu : “Dites-moi vos préférences, et je vous dirai où aller habiter pour avoir le niveau de bien-être le plus élevé .”
Ensuite, le second aspect se positionne sur la fabrique de la ville : si je le conduis mes enquêtes auprès d’un grande nombre d’individus, je peux avoir un individu moyen sur l’ensemble d’une commune que je peux présenter aux acteurs locaux ; on fait ensuite le diagnostic sur le territoire. Pour une grande ville comme Lyon, il peut en effet y avoir des manques de certains éléments constitutifs du bien-être des individus dans certains quartiers ou arrondissements. Ça peut donc permettre aux acteurs locaux de réfléchir autrement. Cela peut également permettre d’aider à arbitrer entre différents projets qui sont en compétition selon la présence ou l’absence de certains équipements que souhaitent les habitants par exemple.
Aujourd’hui, l’idée est d’aller un peu plus loin, et on en vient à la question de la participation citoyenne : on se demande alors comment faire participer l’individu à la prise de décision. Une fois qu’on a ce diagnostic sur le territoire, on peut le présenter à notre échantillon d’individus enquêtés - et même à un public plus étendu, incluant les acteurs locaux ou non - pour connaître leur avis et leurs observations sur les résultats de l’étude. On voit ainsi ce qui peut ressortir de ces groupes de discussion, quels sont les possibles que l’on peut mettre en place à partir de cette analyse. Je travaille donc en ce moment sur cet aspect avec Pauline Texeira, une collègue de Lyon 3 qui travaille sur la question des risques et de la vulnérabilité. L’idée est donc de se dire qu’à travers cet échantillon, à travers cette participation citoyenne, on peut proposer des choses nouvelles aux acteurs locaux. Mais c’est un projet qui débute.
Vous l’avez évoqué, vos travaux peuvent aider à mesurer l’impact de différents projets urbains sur les inégalités d’un territoire. Comment intégrez-vous cette problématique dans vos travaux de recherche ?
Cet aspect est très important pour moi. Il y a des effets pervers (les impensés) dans l’aménagement, on a tendance à toujours voir les bons côtés d’un aménagement mais il y a des effets impensés qui peuvent amener à faire croître les inégalités. Prenons l’exemple de la nature en ville. Dans mes enquêtes, j’ai pu observer que les individus désirent effectivement en voir davantage dans les lieux qu’ils fréquentent au quotidien... Qu’est-ce qu’on met en place pour y répondre ? Parfois des jardins partagés. Mais cela produit des effets qui n’étaient pas prévus au départ. Qui a accès à ces jardins ? En réalité, toute une partie de la population n’y a pas accès1.
Un autre exemple un peu provocateur concerne l’aménagement des berges de la Seine, à Paris. Sur ces berges aménagées, le coût des boissons est extrêmement élevé, dans les petites cabanes disposées le long de la promenade. On peut comprendre la logique car ce sont des concessions privées, mais cela exclut une partie de la population. Alors qu’une solution simple pourrait être mise en place : ouvrir des concessions municipales, avec un prix régulé. Les bénéfices pourraient même être reversés : par exemple pour mettre en place des activités pour les enfants qui appartiennent aux familles peu favorisées, ou alors pour continuer à aménager, et du coup avoir un déploiement beaucoup plus vaste de ces aménagements. Il y a là une manne financière qui peut éviter l’exclusion. Il y a forcément des moyens d’en tirer parti. Il faudrait juste y penser.
Si je devais parler en tant qu’économiste, je parlerais des effets pervers des politiques publiques. Tout est parti de mon observation sur la nature en ville2, notamment en région parisienne, où le discours était et est plutôt positif sur la nature (“ça rend les gens heureux”, “ça crée du lien social”, etc.) où il y a même eu un mouvement de marketing urbain végétalisé. Cet aspect m’a interpellé, j’étais étonnée de voir cet élan positif dominant, et je me suis demandée qui avait accès à cette nature en ville... En effet, qui peut acheter le miel du Jardin du Luxembourg ? Est-ce que tout le monde est capable de devenir membre d’une association ? Qui peut payer une somme pour adhérer à une association ? Qui peut s’inscrire sur la liste d’attente d’une association ? Qui a le temps de penser à tout cela ? Il est clair que tout le monde ne le peut pas.
Aussi, suite au colloque “Nature urbaine en projets”, en décembre 2014, j’ai émis l’idée selon laquelle il y avait des impensés inhérents aux projets de végétalisation des villes, produisant des inégalités. Il suffisait de regarder 1) où se trouvaient les jardins partagés, à savoir dans des endroits souvent à la frontière de zones en processus de gentrification et 2) quelles étaient les personnes qui avaient accès à ces lieux, la plupart du temps des personnes plutôt aisées. Les personnes qui participent aux jardins partagés sont des retraités, des individus issus des classes moyenne et haute, etc. J’ai donc fini par me dire qu’il y avait là un impensé, autour de l’appropriation d’une partie de l’espace public par certaines catégories de population2. Cette question des impensés est née à ce moment-là dans mes travaux, puis, je suis revenue sur la question des inégalités, qui était celle qui m’avait fait travailler sur le bien-être au départ !
Quelles sont les pistes d’action ou les méthodes à mettre en place pour tenter concrètement de contourner ces impensés, et limiter ainsi les inégalités sociales qui se développent au cœur de certains projets urbains ?
« La Ferme du Rail », projet lauréat de l’appel “Réinventer Paris”, en est un bon exemple. Je fais partie de l’équipe en tant que chercheur. Elle est localisée à Jaurès-Ourcq. C’est un projet de logements sociaux avec réinsertion dont le point de départ est plutôt architectural, mais avec la mobilisation de relations associatives très fortes. Lorsque Clara Simay est venue me demander de participer, j’étais plutôt réticente car le projet - une ferme urbaine ! – risquait de porter en lui tous les impensés de la nature en ville. Mais les membres de l’équipe naissante du projet voulaient justement éviter cela et ils cherchaient une vision plus globale. Ils ne voulaient surtout pas ignorer la question des impensés.
En fait, leur idée n’était pas d’avoir simplement des flux entrants, mais aussi d’avoir des flux sortants. De fait, il fallait penser entrée/sortie, au niveau social et spatial. Au-delà du fait de pouvoir prendre des cours de cuisine, de faire du compostage, d’avoir un petit restaurant, de former des gens à des nouveaux métiers etc., l’idée était d’avoir la possibilité de loger des gens en réinsertion, et de mélanger ces personnes avec des étudiants. Donc faire de ce nouveau lieu un support de liens, un pôle d’attraction pour que les gens viennent avec quelque chose et en ressortent avec autre chose : faire venir des compétences, qui ne soient pas forcément liées à l’objet de base, qui est la ferme urbaine. Si des gens viennent manger, pourquoi ne pas en profiter pour qu’ils aident les personnes en réinsertion, par exemple à remplir des papiers administratifs. Le tout était surtout de ne pas centrer les activités seulement sur la question verte…
Le projet est donc parti de ce point de vue-là. Si on veut éviter qu’un lieu soit fréquenté uniquement par des personnes qui s’investissent dans la ferme, il faut nécessairement l’ouvrir - à la fois physiquement et symboliquement -, essayer d’aller toucher des publics différenciés. D’où l’idée d’intégrer une dimension d’apprentissage, avec des compétences diversifiées pour faire venir des personnes “vulnérables”. Pour moi, c’était essentiel que le projet mobilise ce concept d’entrées/sorties, car les résultats montrent que les jardins partagés ne renforcent que très peu les liens à l’échelle du quartier. Ça crée une petite bulle, et il faut à tout prix chercher à éviter ce phénomène d’oasis puisqu’il est excluant selon moi !
Comment se passe le dialogue avec les acteurs locaux pour ce type de projets ? Comment travaillez-vous avec eux ? Comment s’inscrit votre démarche par rapport aux démarches existantes, par exemple en termes d’évaluation ou de concertation ?
Je parle de “diagnostic”, alors que les acteurs locaux parlent “d’évaluation”. Ce qui me dérange dans l’évaluation, c’est qu’elle doit être pensée ex ante. Or, la plupart du temps en France, elle n’est pas pensée : on ne dispose que très rarement des indicateurs pour évaluer, ou des méthodes... Et on ne pense que rarement en amont des aménagements, la possibilité de les évaluer ! Donc je rejette un peu ce terme d’évaluation car je considère qu’en France l’évaluation n’existe pas vraiment… C’est un vrai problème : on ne peut pas réellement parler d’évaluation des politiques publiques. C’est pourquoi je parle plutôt de diagnostic, pour dégager des solutions. Ça me met un peu en porte-à-faux avec les acteurs locaux lorsqu’ils me demandent une évaluation car je suis amenée à leur répondre que je n’en fais pas. Difficile ensuite de poursuivre le dialogue.
Grâce aux échanges au sein d’IMU, j’ai compris comment les méthodes que j’emploie peuvent est utiles aux acteurs locaux. Je suis capable de leur expliquer comment je peux intervenir, par rapport aux questions qu’ils se posent. Ma méthode se fonde sur ce que les individus attendent d’un territoire, n’oublions pas que l’objectif principal des politiques publiques, doit être d’améliorer le bien-être des individus. Les acteurs locaux ont souvent une autre vision de la chose plutôt technique. Je me situe souvent en amont de leurs préoccupations, donc il y a une différence d’échelles.
Ce que l’on pourrait souhaiter faire avec les acteurs locaux, ce sont des tests. Mais ils ne se rendent pas compte que, d’une part le temps de la recherche est beaucoup plus long, et d’autre part que notre temps n’est pas extensible, et que nous avons très peu de moyens financiers. On est souvent confronté à cela malheureusement...
Pensez-vous que ces problématiques “disciplinaires” sont en voie de changer, d’être fluidifiées ? Notamment avec des collaborations comme cette dernière ?
Vous savez, je me définis comme chercheur militant, une chercheuse qui lutte pour apporter les savoirs dans la sphère publique. La recherche ne sert à rien si on ne diffuse pas les résultats aux personnes qui font la politique publique, typiquement sur ce sujet-là. On a un rôle social à remplir en tant que chercheur : enseigner aux plus jeunes évidemment, et diffuser les résultats de notre recherche pour aller - dans le cas présent - vers des politiques publiques qui correspondent aux besoins et aux désirs de la population8 .
1 “Bien-être en Île-de-France : derrière une hausse générale, des disparités territoriales croissantes”, par Lise Bourdeau-Lepage et Élisabeth Tovar, 2 mai 2011 http://www.metropolitiques.eu/Bien-etre-en-Ile-de-France.html
2 Jean-Marie Huriot et Lise Bourdeau-Lepage ont notamment co-écrit “Économie des villes contemporaines”, paru en 2009 http://www.lgdj.fr/economie-des-villes-contemporaines-9782717856941.html
3 “Selon A. Sen, comme pour Martha Nussbaum, la « capabilité » désigne la possibilité pour les individus de faire des choix parmi les biens qu’ils jugent estimables et de les atteindre effectivement. Les « capabilités » sont, pour ces auteurs, les enjeux véritables de la justice sociale et du bonheur humain. Elles se distinguent d’autres conceptions plus formelles, comme celles des « biens premiers » de John Rawls, en faisant le constat que les individus n’ont pas les mêmes besoins pour être en mesure d’accomplir le même acte : un hémiplégique n’a aucune chance de prendre le bus si celui-ci n’est pas équipé spécialement ». Nicolas Journet, Sciences Humaines, 7 septembre 2012 http://www.scienceshumaines.com/capabilites_fr_29433.html
4 “Tell me your preferences and I’ll tell you where to live”, par L. Bourdeau-Lepage et H. Carré 62nd Annual North American Meeting of the Regional Science Association International, 11-14 November, Portland, http://www.narsc.org/newsite/wp-content/uploads/2009/03/finalprogram41.pdf
5 “Nature en ville : attentes citadines et actons publiques” par Lise Bourdeau-Lepage et Roland Vidal, 2014, http://www.editopics.com/livre/series/nature-en-ville-attentes-citadines-et-actions-publiques/1
“Quand l’agriculture s’installe en ville… Désir de nature ou contraintes économiques ?”, par André Torre et Lise Bourdeau-Lepage, 6 février 2013 http://www.metropolitiques.eu/Quand-l-agriculture-s-installe-en.html
6 “Nature(s) en ville”, par Lise Bourdeau-Lepage, 21 février 2013, http://www.metropolitiques.eu/Nature-s-en-ville.html
7 “Nature en ville : désir et controverse”, par Lise Bourdeau-Lepage, 2016 ouvrage à paraître, Librairie du territoire, http://www.lires.org/la-librairie-des-territoires/catalogue/
8 “Pour une géographie engagée, à l’écoute des populations : entretien avec Antoine Bailly”, par Antoine Bailly & Lise Bourdeau-Lepage, 28 mars 2012 http://www.metropolitiques.eu/Pour-une-geographie-engagee-a-l.html
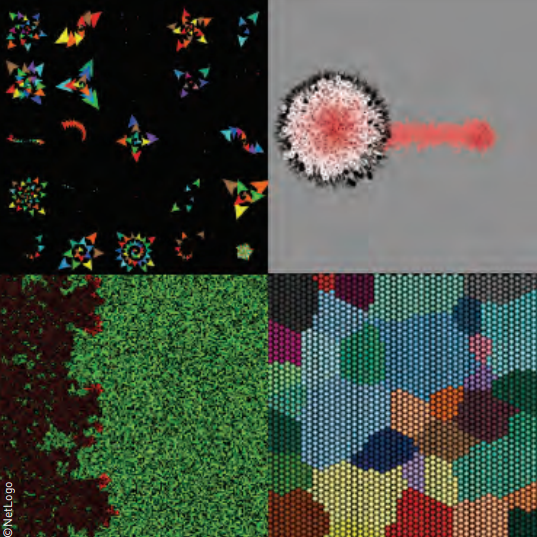
Étude
S’appuyant sur des exemples, des entretiens avec des chercheurs et la littérature académique, ce document donne un éclairage sur les principaux outils utilisés.

Interview de Arthur Lefèvre
Chercheur en informatique et sciences sociales

Étude
L’objet de cette étude est d’identifier quelques pistes permettant de modéliser les effets de l’aménagement d’un quartier sur le bien-être des habitants.

Interview de Maxime Frémond
Consultant indépendant

Interview de Frédéric Amblard
Maître de conférences à l'Université Toulouse 1 Capitole

Interview de Lise Bourdeau-Lepage
Professeure de géographie à l'Université Lyon 3 et membre du Laboratoire d’Excellence Intelligence des Mondes Urbains (IMU)

Étude
Revue de littérature des modalités de quantification de la cohésion sociale

Étude
Tour d’horizon des méthodes de quantification du bien-être afin de conceptualiser cette notion.

Article
Le croisement des cultures émergentes à Lyon devient-il un symbole du territoire ?

Interview de Jean-Christophe Vincent
Président du club de football de La Duchère

Étude
Dans ce numéro : un dossier consacré aux rapports entre l’espace, la vie, la ville.
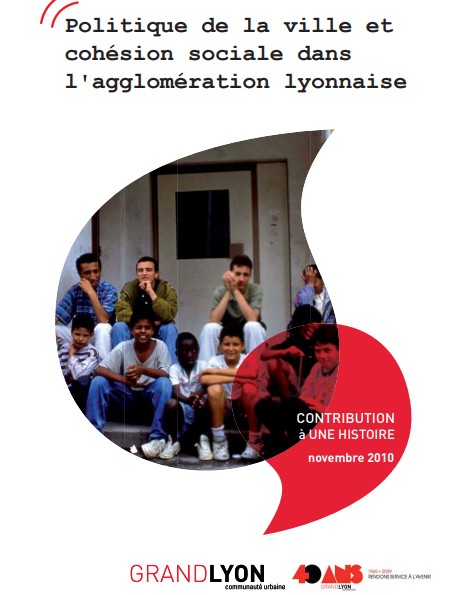
Étude
A travers ce qui sera appelé « politique de la ville » à la fin des années 80, de multiples enjeux se croisent, d’urbanisme, de peuplement, de mixité sociale, de transports, de diversité, etc.

Étude
Compte-rendu du premier débat rétro-prospectifs du cycle de conférences qui a donné l’occasion à la communauté des agents, élus et partenaires de se mobiliser ensemble sur les enjeux d’avenir de l’agglomération.

Étude
À partir d’une enquête documentaire et d’entretiens, cette étude propose une compilation de scénarios prospectifs sous la forme d’images commentées qui mettent en scène des trajectoires potentielles pour les rues de la métropole lyonnaise.

Étude
En déployant les tendances issues de la littérature et de benchmark nationaux et étrangers, cette étude interroge la cohabitation des mobilités dans une rue qui demeure un espace contraint.

Article
Quand le temps devient un outil d’aménagement de l’espace

De l’occupation de bâtiments à l’aménagement d’espaces ouverts, ces projets qui donnent du sens à l’éphémère