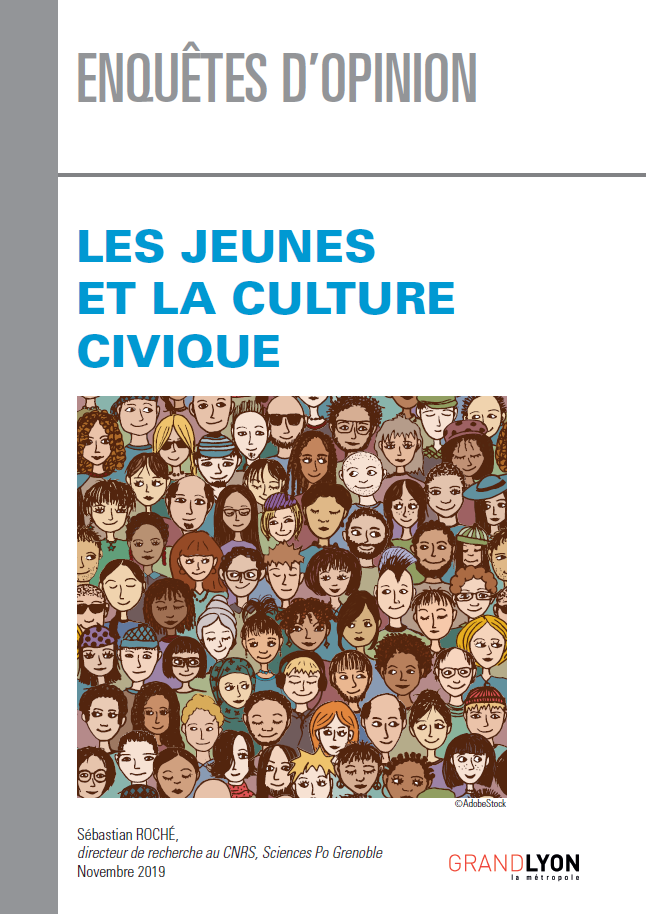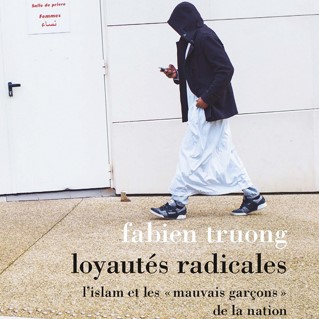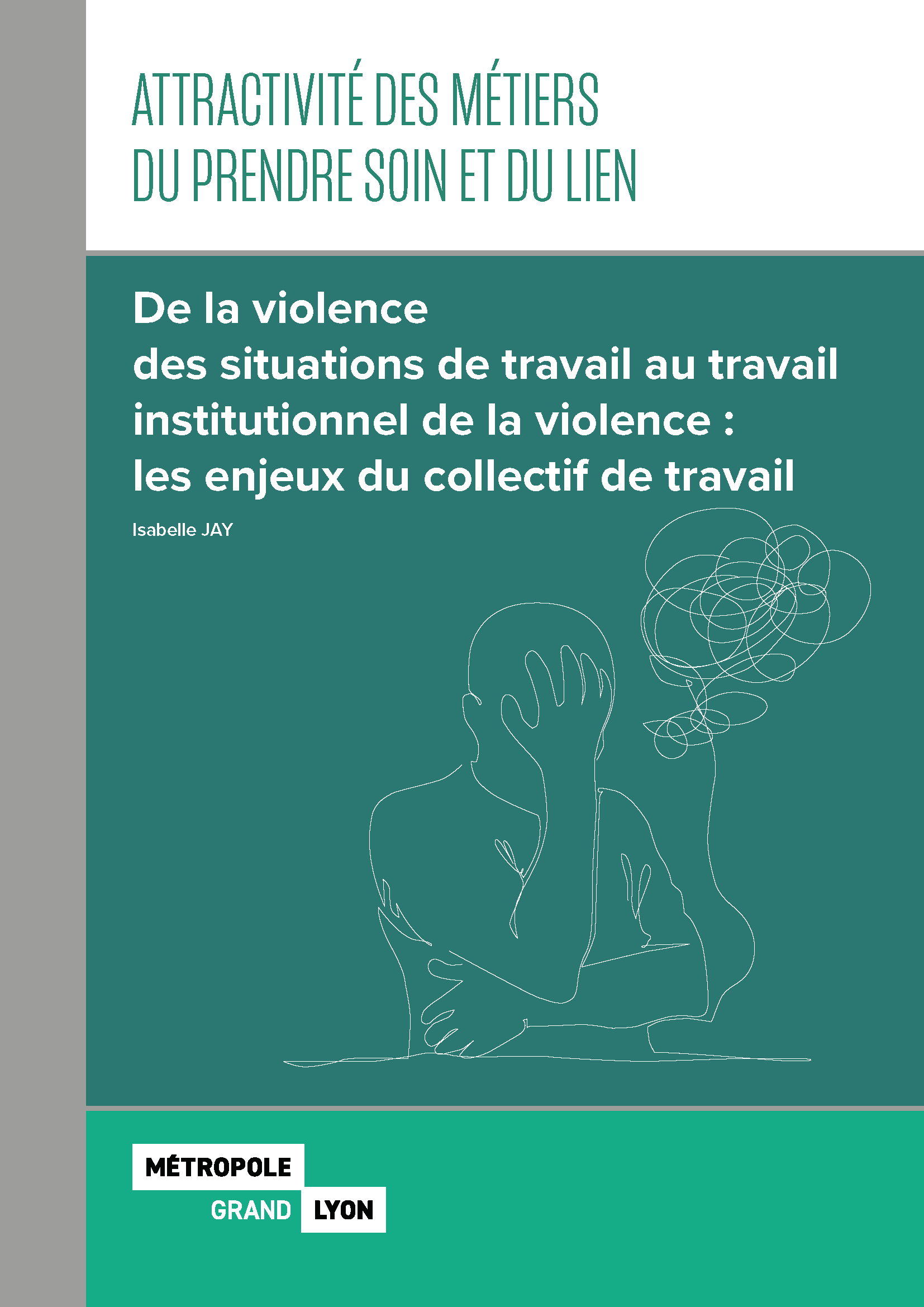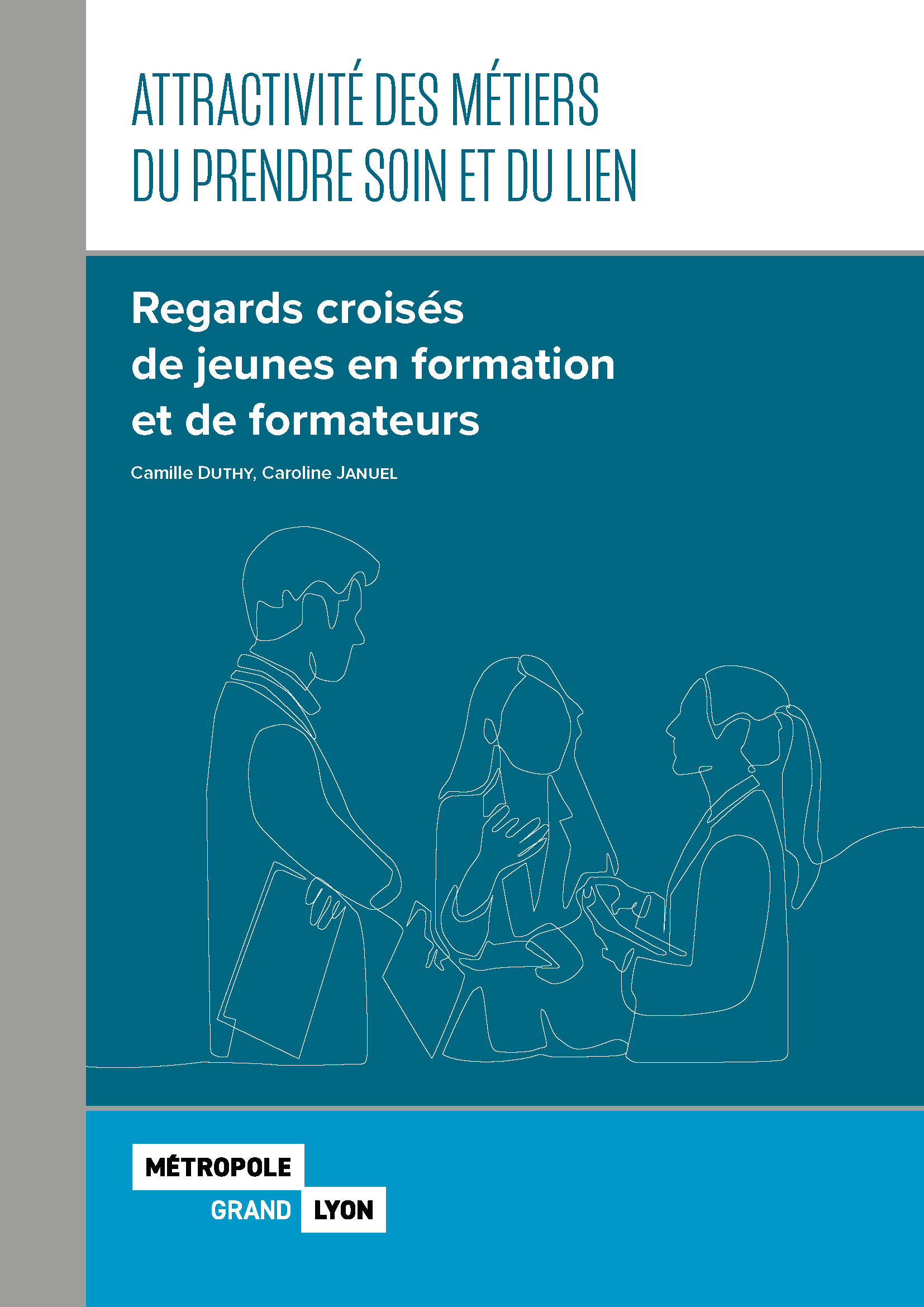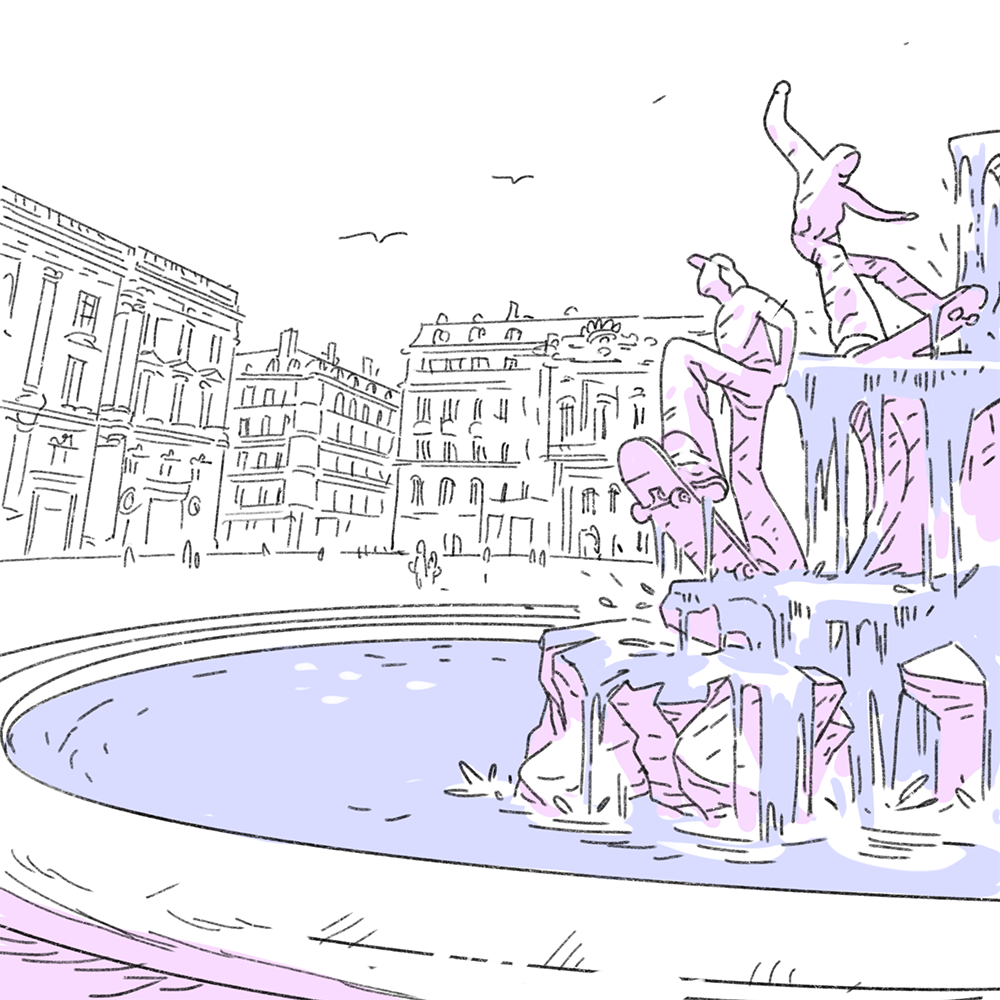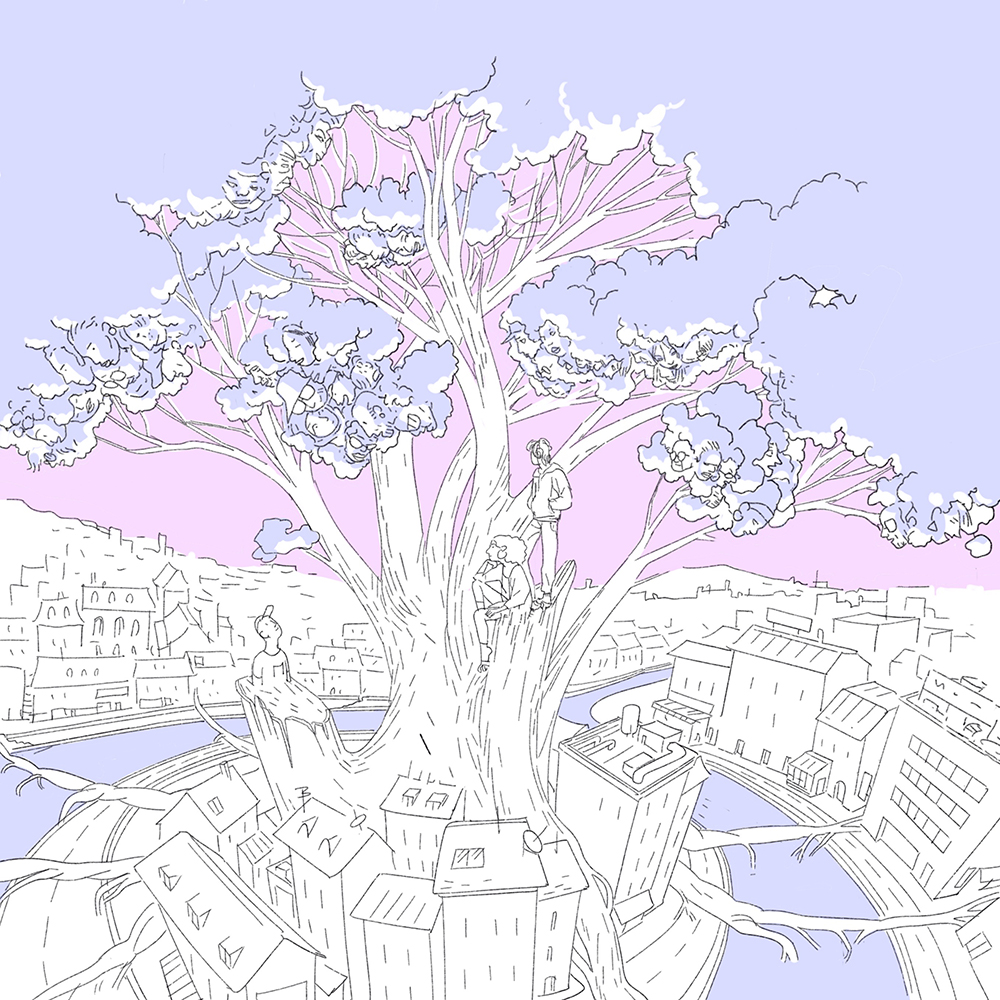Un homme en djellaba dont le visage disparaît sous sa capuche, smartphone à la main, chaussé de baskets, une porte d’entrée de salle de prière pour femmes accompagnée d’inscriptions en arabe, une dalle de béton, les termes « islam », « nation », « radical ». La couverture de l’ouvrage de Fabien Truong regorge de symboles renvoyant à une actualité brulante. À première vue, l’on pourrait penser qu’il s’agit d’un livre de plus sacrifiant les sciences sociales sur l’autel du bruit médiatique. Or, s’il est indéniable que la temporalité de la publication intervient dans un moment où les projecteurs sont braqués sur cet objet de recherche, l’ethnographie manquait à l’appel.
Sous une plume aussi précise qu’inventive qui réconcilie les sciences sociales avec la littérature, Fabien Truong réussit le pari de s’emparer d’un sujet à la fois complexe et clivant : les rapports à l’islam de jeunes hommes descendants d’immigrés, habitants d’un quartier relégué et passés par la « seconde zone »[1] à travers différentes figures, celle de l’ancien élève, celle du chef d’entreprise, de l’ancien prisonnier, de l’éducateur, du businessman ou du « terroriste-maison ».
L’auteur choisit de n’étudier que des hommes car ce sont « eux », jeunes hommes musulmans, habitants de banlieues et descendants de l’immigration postcoloniale, qui sont construits comme les nouvelles figures de la dangerosité. En plus d’incarner un problème public, par leur engagement dans la religion musulmane leurs destins sont reliés : les parcours des uns renseignent sur ceux des autres et permettent de saisir le sens des variations et des écarts. Plus prosaïquement, l’enquête permet de comprendre pourquoi ces enquêtés, aux profils sociaux très semblables, empruntent des chemins différents.
Cet ouvrage présente l’intérêt de montrer comment ces personnes ont trouvé, à un moment donné, dans la reconversion religieuse à l’islam des réponses que ne pouvaient leur apporter d’autres instances socialisatrices. Afin de pouvoir rentrer dans le détail de l’analyse sociologique, six cas sont étudiés, brièvement présentés ici :
Trois « petits » d’environ 25 ans : Tarik, né en Algérie, qui a émigré pour soigner son handicap, avec son père, alors que le reste de la famille (trois frères et une sœur) est resté avec la mère en Algérie. Il a œuvré dans le « business »[2] avant de s’en éloigner plus récemment. Ce dernier est un ancien élève de l’auteur, tout comme Radouane. Fils unique dont les parents vivent de « petits boulots », il est celui qui a le moins évolué dans la délinquance, et après deux années de « galère » il réussit à décrocher un contrat en alternance dans une école de commerce. Quant au troisième « petit », Marley, il alterne les séjours en prison, survit du business et a grandi dans une famille monoparentale avec sa mère, ses deux frères et sa sœur.
Deux « grands », qui ont dépassé la trentaine et vécu leur adolescence dans les années 1990. Adama et Amédy[3] ont rapidement basculé de la petite délinquance à la criminalité, puis en prison. Si leurs profils sociologiques sont assez semblables, leurs parcours sont extrêmement différents puisque Adama est aujourd’hui animateur de jeunesse complètement désengagé de toute activité délinquante alors qu’Amédy a répété les séjours en prison et a fini par participer aux attentats de janvier 2015, avant d’être tué par la police.
Enfin, un « ancien », Hassan arrivé en France à l’âge de huit ans. Il a fui les persécutions du FLN. Ses parents glorifiaient l’école comme voie de salut et ont légué à la fratrie (une sœur et deux frères) un appétit intellectuel et une culture politique rares dans le quartier. Hassan a pendant un temps été éducateur puis a ouvert son entreprise d’informatique.
Ce compte rendu d’ouvrage ne se présentera pas sous une forme traditionnelle. Il est plutôt l’occasion d’aborder trois points développés par Fabien Truong, qui paraissent particulièrement éclairants pour saisir débats actuels sur l’engagement religieux dans les quartiers populaires en y ajoutant une teneur sociologique. On présentera, pour commencer, la position de l’auteur qui opère un pas de côté par rapport à certains « théoriciens de l’islam » et choisi de rompre avec la notion trop abstraite de « radicalisation ». Ensuite, on exposera la thèse principale de l’auteur, concernant la reconversion religieuse, envisagée comme un parcours ou un processus qui se construit sur la durée. Celui-ci est marqué par différentes phases qui peuvent s’entrecouper, s’alterner, se dépasser et qui croisent d’autres parcours (professionnel, social, familial, carcéral…) et espaces sociaux (le logement, l’école, le quartier, la prison, l’entreprise, la salle de sport...). En dernier lieu, on reviendra sur un pari scientifique de l’auteur, celui de comprendre les ressorts de l’engagement radical, notamment des « terroristes maisons » à travers la reconstitution post-mortem du parcours d’Amédy Coulibaly, raconté par ses proches.
La radicalisation : un concept inapproprié à l’analyse sociologique
Dès l’introduction de l’ouvrage, le contexte est grave. L’auteur raconte sa journée du 13 novembre 2015, les liens qui unissent les divers protagonistes de l’enquête autour de cet évènement et finalement, le drame : la perte de proches et la fragmentation d’une société sur le modèle binaire du « nous » et du « eux ». Lorsqu’un tel sujet est abordé dans l’espace public, les causes sociales du terrorisme sont transformées en « conversations culturelles » et le terme de « radicalisation » ne met généralement pas longtemps à surgir. Fabien Truong choisit de le laisser tomber, et ce faisant, il brise sa coquille et met au jour le vide qui l’habite. La « radicalisation » est devenue une catégorie d’analyse journalistique, politique, policière, intellectuelle qui permet de désigner un changement de paradigme sans l’expliquer. L’ennemi n’est plus extérieur, il est dorénavant intérieur : ce sont les jeunes que la société a produit qui viennent la frapper dans une quête ultime de salut. Le « radicalisé » est devenu l’« autre », celui que « nous » ne sommes pas, qui par un mouvement de bascule (la radicalisation) fait partie d’un autre collectif (« eux ») et qui « nous » désigne de l’extérieur. La « radicalisation » est également une catégorie pratique, qui permet de donner du sens aux expériences et s’incarne notamment dans l’action publique (des programmes de « déradicalsiation » sont par exemple mis en place). C’est finalement un tiroir, dans lequel l’on peut ranger « tout ce qui se passe avant que la bombe n’explose ».
Mais le réel est parfois transcendant et dépasse les catégorisations. Alors le terme lui court après et se décline en « radicalisation expresse », « préradicalisation », « autoradicalisation », etc. La posture méthodologique de l’auteur est claire :
Il me semble plus sage de l’abandonner [le concept de radicalisation] pour observer ce qu’il cherche à expliquer : le pouvoir de séduction de l’idéologie du ‘‘martyr’’ et l’attrait de l’islam chez toute une frange de la jeunesse. L’explication par l’idéologie est, au mieux, tautologique : il est évident qu’un jeune prêt à mourir pour la gloire du prophète adhère au plus profond de son être à un solide système de croyances et de convictions. Mais une revendication politique ou une justification morale est au moins autant une conséquence qu’une cause. […] La radicalisation par l’idéologie fonctionne comme un mythe (p. 15).
Il opère un pas de côté avec les spécialistes de l’islam qui s’affrontent à travers des notions de « radicalisation de l’islam » (Gilles Kepel) ou d’« islamisation de la radicalité » (Olivier Roy) dont les postures, aussi vraies soient-elles, lui semblent éloignées de la réalité sociologique des quartiers populaires. Le premier renvoie à un durcissement de l’interprétation des textes arabes et à une nouvelle idéologie qui s’adresserait aux « djihadistes de la troisième génération » issus des marges sociales des sociétés occidentales. Or, les jeunes « radicalisés » ne maîtrisent généralement que très peu les textes religieux et l’arabe. Le second constate que les conditions d’existence de plus en plus difficiles pour une partie reléguée de la jeunesse française conjointes à la perte d’horizons politiques capables d’offrir l’espoir d’un avenir meilleur mènent à la naissance d’une « génération nihiliste » gagnée par l’attrait d’un islam radical. Ce point semble très discutable, dès lors que l’observation ethnographique montre au contraire que les jeunes des banlieues ségréguées sont inscrits dans des relations sociales, ont des aspirations pour leur futur et sont capables d’intellectualiser la contradiction.
Processus de reconversion religieuse
Durant les années 1990, l’islam s’implante dans les quartiers populaires et transforme durablement la vie sociale. Cette nouvelle offre politique et symbolique prend racine sur le dépérissement des quartiers populaires et l’appauvrissement des conditions de vie. Le retrait progressif des relais éducatifs, la désillusion quant aux possibilités d’ascension sociale et professionnelle, l’impossibilité à occuper des postes à responsabilité politique pour les descendants d’immigrés, le sentiment d’injustice grandissant à mesure que les inégalités sociales et ethno-raciales se renforcent par les effets de discriminations, et enfin, le contexte géopolitique de persécution des musulmans accroissent un sentiment de rejet.
Alors que les expériences du business ont pu pousser certains jeunes à commettre des actes immoraux et à côtoyer la prison, amputant l’espoir d’un avenir stable, la religion peut apparaître comme une voie de sortie de la délinquance. Plus encore, la peur de la mort (et de l’enfer), plus présente qu’ailleurs dans les quartiers populaires, poussent vers la voie de la rédemption. De nombreux jeunes trouvent dans l’islam un médium pour regagner une forme de dignité et redonner sens et cohérence à leur vécu.
La force de l’analyse de Fabien Truong est de penser la reconversion à l’islam, de ces jeunes hommes, comme un processus marqué par des grandes phases. La reconversion se fait sur le temps long, elle est une période de réajustement, de réordonnancement, de reclassement de son passé. Cette étape de la reconversion est précédée d’un temps de mise en scène de la rupture, de « volte-face » par laquelle l’individu va affirmer ostentatoirement, parfois de manière trébuchante, maladroite, excessive et bruyante sa nouvelle identité. Ce geste est une forme d’empowerment individuel, une manière de se reprendre en main, d’affirmer la rupture avec le passé, de magnifier le déclic et le changement de trajectoire tout en témoignant son appartenance à une communauté religieuse. La « volte-face » et le « spectacle de la rupture » sont également des moyens de réaffirmer une loyauté familiale par la reconnaissance des dettes envers les parents (la souffrance, l’humiliation et le parcours migratoire pouvant parfois être douloureux transmettant aux enfants le poids de la culpabilité). Pour certains, qui connaissent une moindre réussite sociale que leurs frères et sœurs, c’est aussi une manière de compenser l’échec par la réaffirmation d’une supériorité morale et d’une dignité personnelle. Se conformer aux normes religieuses c’est appartenir à un groupe social, accéder à une identité et à la reconnaissance.
De ce fait, le renouveau religieux dans les quartiers de banlieue ne saurait se comprendre sans penser l’islam comme une catégorie politique qui s’imbrique dans un contexte « désintégrateur ». Lorsque les pratiques intimes se manifestent dans la sphère publique, la volte-face devient politique. Les gestes individuels qui se répètent et trouvent leur signification dans « l’excès » révèlent une lutte politique pour laquelle « l’islam donne un nom à une cause collective éprouvée mais non identifiée » (p. 117).
Après le temps de l’ostentation et de la rigueur, qui passe par l’officialisation et l’affirmation de son appartenance religieuse, vient très souvent le temps de la pacification intérieure et du réajustement par la négociation permanente entre les divers « conflits de loyauté ». Rester dans la rupture, la contradiction et l’opposition n’est pas tenable à terme et peut engendrer une forme « d’extinction de soi »[4]. D’ailleurs la rupture n’est qu’une façade, car la logique de la « reconversion » est plutôt de fabriquer de la continuité : on recycle, construit sur ses fautes commises, repart avec ses ressources disponibles. L’enjeu, une fois que le temps s’écoule, est alors la « perpétuation de l’acte d’officialisation », c’est-à-dire la capacité à rester soi-même et à ne pas trahir ses valeurs notamment lorsque l’on vit une expérience répétée de stigmatisation, tout en faisant preuve de tolérance. C’est dans des moments de « frottement social » où la moralité est mise à l’épreuve que les valeurs s’éprouvent et adviennent à soi-même. Fabien Truong définit la tolérance ainsi :
Ce que l’on appelle "la tolérance" se décline dans un continuum de variations, faite d’une série d’options, de possibles et de limites qui renvoient moins à des grands principes supérieurs qu’aux conditions historiques et sociales permettant toute "coexistence pacifique" (p.142).
In fine, la reconversion religieuse est un processus de reconstruction biographique et de réorientation de sa destinée, et non pas de rupture (même si l’acte d’officialisation et la volteface tendent à la mettre en spectacle). En bâtissant sur le passé, la foi du converti devient un médium d’expression (de ses protestations, sa liberté, son jugement, son authenticité, sa singularité) et une révélation à soi qui mène au sentiment d’émancipation, au droit de choisir son propre chemin. C’est également l’expression d’un systématisme dans un monde désenchanté et relatif (affaiblissement des certitudes) où il faut s’affirmer et se réinventer en permanence.
Expliquer l’engagement radical des « terroristes maisons »
Dans ce dernier point, revenons sur un des grands paris de ce livre : comprendre comment « Amédy » a pu devenir « Amédy Coulibaly », le « terroriste maison » des attentats de janvier 2015 ? Et parallèlement, comment se fait-il que d’autres ne passent pas à l’acte ?
Fabien Truong rappelle à maintes reprises l’importance de distinguer les « terroristes maison » des « candidats au départ » : Le départ, notamment vers la Syrie, se vit sur le mode de la libération et du soulagement. Il est une synthèse entre l’évasion heureuse (tourisme) et la sécession dangereuse (vagabondage) [5], permettant de sortir du conformisme social et nécessitant peu de dispositions particulières (de l’envie et de la débrouillardise). Cette fugue a un objectif : affronter le danger pour fonder une société plus juste.
À l’origine du départ, il y a une excitation composite : l’aventure touristique, l’utopie politique, l’émancipation familiale et l’appel au combat (p. 173).
Le djihadiste est avant tout un moraliste, qui accepte de se donner la mort comme un moyen d’aller au paradis, mais en aucun cas comme une fin en soi[6]. Ainsi, il ne s’agit absolument pas d’une « génération de nihilistes » comme l’affirme Olivier Roy. Le départ est plutôt l’occasion de se reconstruire et non de mourir au combat. C’est un fantasme, celui de transcender des particularismes en faisant advenir l’universalité de la communauté et en vivant une utopie concrète, sur le terrain. C’est une forme d’affiliation à une communauté imaginaire (l’Umma), qui rencontre une opportunité physique et une proposition géopolitique (conflit syrien).
Amédy, « terroriste maison » est persuadé que son vécu dans une cité l’aurait de toute manière amené en prison, il est fataliste et résigné : seuls la voie du business et des allers-retours en prison s’offraient à lui. Il ressent un profond sentiment d’injustice et de persécution, renforcé par les expériences humiliantes du traitement pénitencier (refus d’assister à l’enterrement de son père, traitements inégaux), judiciaire (condamnations à répétition, remises de peine inexistantes alors même qu’il fait preuve d’une bonne conduite) et policier (meurtre d’un ami d’enfance, sous ses yeux, par un policier) qui lui donnent la sensation fataliste d’être dans l’impasse. Fabien Truong nomme ce processus, l’impasse du cercle, puisqu’il révèle la tautologie de certains parcours englués dans les allers-retours en prison et l’enfermement progressif dans la « seconde zone ». Le futur n’est pas envisagé, seul l’instantanéité et l’incertitude du présent rythment les vies. Les traces des expériences successives de l’échec (scolaire, sentimental, professionnel, etc.) entachent les parcours de manière indélébile et recouvrent les pages vierges de l’avenir. L’incertitude laisse peu à peu place à la certitude, celle de voir ses scarifications grandir et déterminer la suite de l’histoire.
Ainsi, le comportement d’Amédy se routinise et se systématise, laissant peu à peu place à l’action plus qu’à la réflexion introspective. La religion apparaît comme une opportunité de cohésion intérieure, permettant de se prémunir face à l’hostilité du monde extérieur, à ses injustices et de se réassurer par des gestes maîtrisés :
Djamel Beghal [djihadiste rencontré en prison] ne fait que mettre des mots sur les choses. À vingt-deux ans, l’islam fournit déjà à Amédy une grille de lecture cohérente entre demande de reconnaissance, réparation de l’injustice, appartenance à un groupe de braves et promesse d’une vie réglée comme une "montre" (p. 189).
Ses dispositions de combattant et de businessman sont ainsi réorientées, pour panser les plaies de son injustice et du sentiment de persécution. Ce n’est pas un renversement (même s’il tend à être mis en scène par Amédy lui-même), mais une continuité : il active ses filières dignes de confiance du business pour la logistique de son attentat et fait jouer l’économie morale des dettes et de loyautés tout en gardant secret son « coup ». De même qu’il a développé cette capacité à agir en automate dans des situations très violentes.
Conclusion :
Habiter en cité expose à plusieurs obstacles ponctuant les parcours sociaux: ce sont à la fois la disparition des cadres intégrateurs et récits mobilisateurs (communisme, culture ouvrière) l’augmentation des inégalités et de la ségrégation urbaine accompagnées de la désertification de certains services sociaux, de même que la fin de la mixité sociale qui banalisent le stigmate [7] et la honte au travers de plusieurs canaux (adresse, couleur de peau, classe sociale, religion, lieu de naissance) malgré la diversité des destins sociaux :
« Si, parmi les "banlieusards" ou les "musulmans", il existe une forte hétérogénéité des destins sociaux, l’obligation d’affronter le stigmate reste un dénominateur commun. Les jeunes diplômés du supérieur comme les résidents de la seconde zone ; les familles quittant les cités d’habitat social comme celles qui sont condamnées à y demeurer ; les musulmans conciliant piété et attachement à la République comme ceux qui jugent leur foi incompatible avec les lois françaises ; tous partagent une commune épreuve, à la fois intime et politique, de diffamation sociale » (p. 160).
Pour ces jeunes hommes, il s’agit alors de trouver leur place entre des socialisations contradictoires et de se déterminer face au monde. La première des conditions est la « sécurité » d’évoluer dans un monde prévisible et stable afin de pouvoir se représenter l’avenir et de s’y projeter, passant notamment par le fait d’avoir un emploi, un logement et un couple stable. La deuxième condition sine qua non, consiste à pacifier son rapport au monde et à ses origines, pour ne pas vivre en permanence avec le sentiment de trahir son entourage. C’est également la capacité à traverser les mondes sociaux, à se mouvoir sous des facettes sociales différentes dans des espaces sociaux différents. Ces petits trajets sociaux requièrent et produisent à la fois de la confiance et de la considération ainsi qu’un sentiment de cohérence dans son identité (liée à la capacité à se présenter et à représenter).
La reconversion religieuse à l’islam permet à certains d’accéder à une « paix intérieure ». Pour se transformer en action, la croyance doit s’articuler avec un ensemble d’attentes, de besoins, de pratiques, d’institutions, sur un fond d’expériences et de schèmes sociaux incorporés. Ainsi, la pratique de l’islam prend racine dans des parcours de vie, fruits d’expériences ancrées dans un enchevêtrement des contextes sociaux, résidentiels, familiaux, institutionnels, politiques, idéologiques. Dans son ouvrage, Fabien Truong restaure les causes sociales de l’engagement religieux sous les dimensions complexes et contradictoires de la socialisation. La force de son analyse est d’articuler les effets de contextes dans leurs dimensions à la fois individuelles, spatiales et temporelles, en conjuguant les parcours sociaux et spirituels.
S’il est un point qui aurait pu davantage être exploré, il s’agit du type de généralisation ou d’analogies possibles. Comment peut-on et doit-on passer de l’analyse microsociologique profuse et regorgeant de détails qui forgent les différences de parcours à une analyse d’ordre macrosociologique, plus systématique ? Autrement-dit que nous apprennent ces six cas sur le groupe social des « jeunes de cités » qui habitent dans d’autres quartiers, avec d’autres contextes sociaux, locaux, familiaux, générationnels. De même que l’appareillage conceptuel de la « reconversion » religieuse, peut-il s’avérer utile pour d’autres formes de socialisation, notamment politique ?
Cette lecture nous pousse à oser un parallèle, qu’il conviendrait de creuser davantage, entre les processus de l’engagement religieux et ceux de l’engagement politique. Et pour grossir sciemment le trait, les « candidats au départ » pour la Syrie d’aujourd’hui ne peuvent-ils pas être comparés, sur certains points, aux militants communistes et anarchistes qui ont rejoint les rangs républicains durant la guerre d’Espagne de 1936 ? [8].
Notes :
[1] Voici la définition très étayée qu’en propose l’auteur :
la seconde zone est « un espace de relations et de représentations qui sanctionnent le fait de vivre à l’écart – dans et par l’illégalité. Elle consacre son appartenance à un groupe d’individus qui se sait à part. Le sens du jeu qui les réunit impose une coupure avec celles et ceux qui n’en sont pas. [...] L’action y remplace l’introspection, seul moyen de substituer à la déchéance morale l’excellence de son intelligence ou de sa compétence. C’est une façon de s’accommoder, par l’oubli, du "sale" et de la morale restreinte. Dans cet espace sont reconnus une application, des qualités et des engagements qui restent, ailleurs, honteux. En décrivant la "banalité du mal", Hannah Arendt remarque que le "refus de penser" permet de se détacher de toute intention morale en survalorisant le savoir-faire, dans une attitude tenant plus de la médiocrité et de la routine que de la méchanceté. Il y a, dans la seconde zone, quelque chose de l’ordre de cet automatisme pratique et de ce systématisme en acte. Il est motivé par le profit économique, repose sur un idéal contemporain : être à soi-même son propre principe » (p. 85).
[2] Ce terme renvoie aux travaux sur la sociologie de la déviance juvénile et il est employé comme un synonyme « d’économie informelle ».
[3] Il s’agit d’une enquête post-mortem, d’Amédy Coulibaly, tristement célèbre pour avoir participé aux attentats de janvier 2015 en France.
[4] « Rester dans la rupture permanente est extrêmement coûteux, quasiment intenable. Le monopole d’une telle posture se solde inévitablement par une forme d’extinction de soi, comme le sacrifice ou la mort. […] L’épreuve du temps oblige, par conséquent, à dépasser la mise en scène et le slogan, à les mettre de côté pour en faire quelque chose » p. 138.
[5] Ian Hacking, Les Fous voyageurs, Les empêcheurs de penser en rond, 2002.
[6] Blom A., 2011, « Les «martyrs» jihadistes veulent-ils forcément mourir? », Revue française de science politique, 61, 5, p. 867‑891.
[7] Dans Grandir en Banlieue, Emmanuelle Santelli avait également montré que l’expérience de la stigmatisation et des discriminations sociales, résidentielles et ethno-raciales était commune à tous les enquêtés, toutes trajectoires confondues (personnes ayant entre 20 et 30 ans en 2003, ayant grandi dans un quartier de la banlieue lyonnaise, et descendants d’immigrés maghrébins).
[8] Comparaison à laquelle le sociologue Laurent Bonelli s’est essayé dans un article du Monde diplomatique : BONELLI Laurent, « Des brigadistes aux djihadistes, combattre à l’étranger », Le Monde diplomatique, N° 737, no 8, 7 octobre 2015, p. 22-23.