Performance et solidarité(s) : les principes de la LOLF

Interview de Damien Catteau
Maître de conférences en droit public, Directeur du Master 2 Droit public - Parcours Carrières publiques - Université Jean Moulin Lyon3.
Interview de Marc Leroy

<< Une approche démocratique des choix politiques et financiers permettrait de réconcilier le sentiment de justice avec l’approche objective du système fiscal. >>.
Depuis plus de 25 ans, Marc Leroy s’attache à développer une branche méconnue de la sociologie qui s’intéresse aux finances publiques, en incluant la fiscalité, aux dimensions sociales du fait financier. Il s’inscrit dans la lignée des fondateurs de la sociologie financière, issue de l’école autrichienne et de l’école italienne de la science des finances, et a permis d’instituer cette discipline en France, où seuls existaient les travaux de Gabriel Ardant sur l’histoire et la sociologie de l’impôt ou de Jean Duberger sur la psychologie sociale du contribuable. Ses recherches portent sur l’administration et le contrôle fiscal, les politiques européennes et internationales, les services publics et les financements des politiques publiques, l’action publique territoriale, etc. Ces dernières années ont été plus particulièrement consacrées aux enjeux de justice fiscale, à la sociologie du contribuable et aux comportements de déviance fiscale, à la crise financière et ses impacts notamment sur les décisions financières des collectivités territoriales. Il a publié une quinzaine d’ouvrages, une soixantaine d’articles, 35 chapitres, avec aussi une centaine de communications et conférences en France et dans d’autres pays. Parmi ses ouvrages, on peut citer : La logique financière de l’action publique conventionnelle dans le contrat de plan État- Région, Paris, L’Harmattan, 2000. La sociologie fiscale, Paris, PUF, 2002. La sociologie des finances publiques, Paris, La Découverte, 2007. L’impôt, l’État et la Société, Paris, Economica, 2010. Le financement des politiques publiques (en direction avec G. Orsoni), Bruxelles, Bruylant 2014. L’autonomie financière des collectivités territoriales (direction), Paris, Economica, 2017.
Pression des multinationales, crise économique, idéologie néolibérale, technicisation à outrance de la fiscalité, etc. les raisons sont nombreuses qui ont conduit à une perte du sens social de l’impôt, à l’accroissement du sentiment d’injustice et la banalisation des pratiques d’optimisation, d’évitement et d’évasion fiscale. Mais l’impôt n’est-il pas un outil de cohésion et de justice sociale ? Comment reconstruire cette fonction sociale, rendre à la fiscalité sa légitimité ? Pour répondre à ces questions, Marc Leroy rappelle le lien endémique entre Etat moderne et fiscalité, l’évolution des arbitrages entre les différentes fonctions de la fiscalité et comment ces compromis socio-fiscaux témoignent de l’idéologie d’une société et des priorités qu’elle reconnait. Il alerte sur les évolutions récentes et leurs conséquences délétères sur le rapport social à l’impôt et plus largement sur la soutenabilité des finances publiques. Discutant les injonctions à la rigueur budgétaire adressées notamment aux collectivités locales, il partage les résultats de ses récents travaux sur les modalités de prise de la décision budgétaire en leur sein et plaide pour une approche démocratique des choix financiers, seule à même de refonder le lien entre société et fiscalité
Cet entretien fait partie d’une série d’entretiens et de textes d’auteurs consacrés aux relations entre finances publiques, fiscalité et solidarité.
Qu’apporte une approche sociologique des finances publiques ?
La sociologie des finances publiques propose une lecture financière de l’action publique en s’intéressant aux relations entre les phénomènes financiers, l’État et les autres entités publiques et la société : décisions financières, politique fiscale et budgétaire, dette, subventions, etc. Historiquement, elle est issue d’une école autrichienne qui questionnait la soutenabilité de l’État fiscal en crise après la première guerre mondiale et d’une école italienne qui s’intéressait à l’usage des finances publiques par les élites fin 19ème -début 20ème siècle. Ainsi, s’intéresser aux finances publiques, c’est s’intéresser aux dimensions économiques, juridiques, politiques et sociales de l’action publique. La sociologie fiscale interroge plus particulièrement la légitimité de l’impôt, la notion de justice sociale, la catégorisation de la société par l’impôt… Elle permet de replacer et théoriser les données empiriques dans des problématiques générales de société. Par exemple, de mettre en relation réforme fiscale et changements sociaux, acception sociale de l’impôt et légitimité de l’action publique, politique fiscale et justice sociale, fraude fiscale et sociologie de la déviance…
Une lecture historique de la fiscalité permet ainsi de mieux comprendre comment la manière d’appréhender la solidarité ou l’intérêt général a évolué ?
En effet. La fiscalité est constitutive de la genèse et de l’évolution de l’État moderne, au sens historique du terme. Quatre périodes se distinguent schématiquement. La première démarre au 12ème siècle, lorsque le domaine féodal ne suffit plus à financer la guerre. L’instauration d’une fiscalité royale, en modifiant la structure politique et sociale de la féodalité, est à l’origine de la constitution de l’État moderne. L’impôt en devenant permanent remplit une fonction de financement, à l’origine en relation avec les dépenses de guerre, puis selon une dynamique qui se réclame de l’intérêt général. Dès l’origine, la recherche du consentement à l’impôt est tourmentée par la tension entre l’obligation à l’autorité souveraine et la contribution légitimement consentie aux politiques publiques, à l’intérêt général. La fiscalité traduit aussi les rapports de pouvoir entre les groupes, notamment entre le roi, les seigneurs et les villes. Cette évolution est propre à l’Europe occidentale de par la spécificité de son organisation politique.
Le deuxième période est celle du grand 19ème siècle, avec l’apogée de l’État libéral dans le cadre institutionnel de la démocratie parlementaire qui met en œuvre un droit budgétaire pour mieux contrôler l’exécutif. En France, le droit budgétaire devient ainsi effectif sous le régime monarchique de la Restauration, illustrant ce parallèle historique entre le développement politique des pouvoirs des assemblées (parlementarisme) et le renforcement technique du droit budgétaire, une logique qui reste présente aujourd’hui, même si le cadre juridique a évolué. Cette conception libérale classique apparut incapable de résoudre la question sociale, comme le releva la critique marxiste basée sur la démocratie réelle.
Le troisième moment débute à la fin du XIXe siècle, avec l’instauration progressive d’un contrat démocratique socio-financier qui conduira à l’extension des droits sociaux financés par la fiscalité de masse. Se développant après la seconde guerre mondiale, l’État-providence keynésien instaure des compromis socio-fiscaux ayant un contenu social et une portée démocratique. Il représente le « modèle social européen » présent dans les pays d’Europe occidentale avec des variantes notamment concernant la structure des finances publiques : les choix de fiscalité et de dépenses reflètent des compromis plus ou moins orientés vers le social ou le marché. À ce moment-là, nos sociétés avaient réussi à instaurer un modèle d’action publique, celui du Welfare State keynésien, qui concrétisait les grandes fonctions de la fiscalité, avec des choix sociaux validés démocratiquement ou faisant l’objet d’un consensus.
Enfin, depuis les années 70, la diffusion d’une idéologie néolibérale mettant en avant les contraintes du marché, puis l’intensification de la mondialisation dans les années 90, a contribué à miner les fondements solidaires de l’action publique interventionniste. L’idée prévaut que cette nouvelle donne économique implique nécessairement une réduction des dépenses sociales et une baisse de la fiscalité sur les grandes entreprises multinationales et sur les plus riches. Or, ce déterminisme du marché globalisé n’est pas vérifié par les travaux empiriques internationaux sur l’impact de la globalisation économique au regard des dépenses publiques ou de la fiscalité des affaires. La surgénéralisation de la théorie de « l’efficience du marché » constitue ainsi une idéologie qui s’est diffusée auprès des décideurs politiques.
Quelles sont ces grandes fonctions de la fiscalité qui avaient réussi à faire consensus ?
Classiquement, trois grandes fonctions de nature économique sont utilisées en référence aux travaux de l’économiste américain Richard Musgrave (1910-2007) : une fonction financière par l’apport de recettes fiscales pour financer les dépenses publiques, une fonction de régulation économique, et une fonction de redistribution des revenus pour agir sur les inégalités (par exemple via un impôt progressif). Dans mes travaux, j’ai élargi ces fonctions pour tenir compte de la dimension socio-économique des finances publiques. Dans cette perspective, six fonctions sont à distinguer.
- La fonction financière, telle qu’elle est définie habituellement.
- La fonction de régulation économique que je reprends aussi.
- la fonction sociale qui contient la fonction de redistribution financière pour diminuer les inégalités mais ajoute aussi une fonction de catégorisation fiscale de la société. De fait, la fiscalité découpe et classe le social dans ces catégories que le droit formalise : par exemple, la fiscalité de la famille ne correspond pas forcément à la définition sociologique de la famille, qui aujourd’hui admet une acception pluraliste. Or, les finances publiques constituent un moyen, pour certains groupes sociaux, de voir reconnaître leur importance et leur participation légitime à la société. Ainsi, à côté des enjeux classiques de redistribution, des enjeux de reconnaissance sociale, devenus particulièrement sensibles depuis la fin du 20ème siècle, sont en cause.
- La fonction territoriale est particulièrement importante dans le contexte de la mondialisation et de la crise internationale qui s’est propagées aux finances publiques de nombreux pays. Cette fonction, qui part de la compétence géographique du pouvoir d’imposer, permet d’enrichir doublement l’approche des territoires : sous l’angle des inégalités générées par la fiscalité et sous celui du développement (exonérations fiscales, incitations fiscales à des fins de compétitivité et d’attractivité, etc.).
- La fonction environnementale ou écologique qui vise à préserver l’environnement : écotaxes, dépenses fiscales avec des finalités écologiques…
- La fonction politique qui se définit comme la contribution du citoyen au financement des services publics, des institutions et des politiques publiques. On retrouve l’enjeu constitutif de l’État au regard de la légitimité politique de l’impôt, du civisme fiscal, de la démocratie financière par le consentement direct et indirect.
La notion de justice fiscale se confond-elle avec celle de justice ou d’équité sociale ?
La sociologie fiscale distingue le sentiment de justice, tel qu’il est ressenti par une société, des groupes sociaux ou les citoyens, de l’instauration objective d’une justice sociale par la fiscalité. La justice questionne à la fois la dimension objective et le sentiment dans l’opinion publique. C’est une notion sociologique plus complexe, plus riche, que l’équité qui relève davantage d’une approche économique. L’équité horizontale vise à traiter de manière égale ceux placés dans une situation similaire, l’équité verticale vise à mieux répartir les richesses, à diminuer les inégalités entre les plus aisés et les catégories les moins favorisées par des prélèvements obligatoires. La justice fiscale inclut une dimension démocratique de consentement (réel) aux choix fiscaux.
La justice sociale n’est pas une notion universelle que ce soit sur le plan géographique ou historique. Pourtant, contrairement au relativisme des valeurs, dans un contexte socio-historique donné, des principes généraux du juste peuvent être définis. Cette définition dépend d’abord du positionnement épistémologique et politique du problème. Il s’agit de déterminer le périmètre de l’investigation scientifique et du débat démocratique préalable à la décision politique. Par exemple, pour décider du juste impôt sur le revenu, doit-on considérer le seul impôt sur le revenu, qui exclut la moitié des ménages en France, ou la taxation de tous les revenus, qui inclut les impôts sociaux comme la Csg et la Crds ; faut-il tenir compte des interdépendances avec les autres impôts, avec l’ensemble des prélèvements obligatoires, avec les transferts sociaux, avec toutes les dépenses publiques… Scientifiquement, l’élargissement de l’équation de la justice fiscale apparaît souvent justifié ; politiquement, le traitement du problème public est rarement aussi radical, sauf dans de rares périodes.
La fiscalité est de plus en plus contestée. Cela traduit-il un délitement des liens sociaux ou du sentiment d’appartenance à un même collectif ?
En se complexifiant et en se technicisant, la politique fiscale s’est fragmentée dans des particularismes qui abaissent sa valeur sociale. Même si des blocs de cohérence subsistent, le sens des grandes fonctions du système fiscal se perd. Chaque année, plus de 200 nouveaux articles de loi sont adoptés en matière fiscale… Il devient alors de plus en plus difficile d’identifier clairement les enjeux de société reconnus comme prioritaires. Par exemple, la reconnaissance de la famille n’est ni parfaite ni égalitaire : il existe des différences selon le type de familles, selon les impôts (l’impôt sur la fortune traite différemment les personnes vivant maritalement, contrairement à l’impôt sur le revenu), l’objet imposé (transmission d’entreprise…). Autre exemple, celui des niches fiscales : leur nombre est passé de 320 en 1981 à 430 en 2016, soit une perte de recettes publiques de plus de 80 milliards (Mds) €. Elles minent largement la redistribution en profitant davantage aux plus aisés et contribuent à diluer le rapport à des valeurs de la société.
Les finalités sociales de l’impôt sont-elles en train de disparaître au profit de la dimension économique ?
La redistribution est effective et permet un resserrement des écarts de revenus. Cela dit, cette effectivité résulte plutôt des transferts sociaux que de la fiscalité. Mais les inégalités de revenus et de patrimoine se sont creusées notamment du fait du très fort enrichissement des hauts revenus. Toute la difficulté est de taxer ces revenus qui bénéficient d’un côté d’exonérations fiscales, et de l’autre, ont des pratiques répandues de déviance sous la forme de la fraude ou de l’optimisation/évasion (usage du droit ou de ses lacunes pour minimiser l’impôt à payer). En conséquence, les ménages les plus riches contribuent insuffisamment et leurs efforts sont moins élevés que les ménages moins riches. De plus, la crise exacerbe le mécontentement de l’opinion public face aux privilèges économiques de certaines élites. La légitimité de l’impôt s’est dégradée et le système fiscal, perçu comme injuste, est rejeté. Par exemple, selon un sondage Ipsos du 7-10/13 pour Le Monde et Fondafip, 43 % ne pensent pas que payer l’impôt est un acte citoyen. Un chiffre qui atteint 56 % selon une enquête par sondage aussi d’Opinionway en novembre 2014 pour Finsquare. En conséquence, les comportements d’évasion et de fraude se banalisent. La priorité serait donc de rétablir un impôt équitable pour diminuer les privilèges des plus riches.
Le sentiment de justice sociale dépend de la justification des différences (visibles) entre les classes de revenus. Dans le cadre de sa fonction sociale, l’impôt progressif doit mettre fin aux privilèges croissants de la classe des hauts revenus en réduisant, par la redistribution, les inégalités. Il convient aussi d’équilibrer le traitement fiscal des classes populaire et moyenne en fonction de leurs capacités contributives, mais en conservant une distance raisonnable entre les revenus après impôts (et transferts sociaux) pour encourager la mobilité sociale. Il s’agit de ne pas trop prélever pour éviter d’instituer un impôt-tribut et de maintenir des différences en évitant les inégalités. Le sentiment de justice concerne aussi, comme on l’a dit, la reconnaissance par la fiscalité et/ou dépenses d’enjeux de société comme la santé, l’éducation, la dépendance, la famille sentimentale, le logement, l’écologie, etc. Or, aujourd’hui, l’équité du système fiscal est instrumentalisée dans des configurations sociales éclatées, comme l’atteste les traitements particuliers permis par les dépenses fiscales (incitations). Afin de sortir de cette fiscalité dérogatoire qui mine le rendement budgétaire et la redistribution, un principe de justice consisterait à sélectionner démocratiquement une liste limitée d’enjeux de société qui méritent une reconnaissance par les dépenses fiscales.
Rétablir une égalité de traitement dans l’imposition permettrait-il de reposer les termes du débat autour de la soutenabilité de notre système social et financier ?
Nous sommes actuellement face à un vrai problème de soutenabilité sociale du système financier. L’ensemble des dérogations fiscales sous forme d’exonérations, abattements, réductions etc., ce que l’on appelle les niches fiscales, s’élève comme on l’a vu à plus de 80 Mds, un chiffre à rapporter au déficit public estimé à plus de 70 Milliards (Mds) d’euros (€) en 2015, soit 3,5 % du PIB ! Même s’il y a consensus dans le monde académique pour dire que le volume des dépenses fiscales (niches) est intenable, le réduire ne sera pas suffisant pour reconstituer la fonction sociale de l’impôt. Il faut agir sur la banalisation de la déviance fiscale qui se traduit directement par un manque de recettes pour financer l’action sociale et plus largement les dépenses publiques. La fraude fiscale est évaluée de 60 à 80 Mds par an. Les scandales du Luxleaks, du Swissleaks et des Panama Papers ont montré que les paradis fiscaux abritent des profits d’entreprises multinationales et des fortunes de particuliers élevés. Selon l’économiste Gabriel Zucman, 8 % du patrimoine financier des ménages du monde sont dissimulés dans les paradis fiscaux, 12 % pour l’Union Européenne (UE), 350 Mds € pour la France, dont la moitié en Suisse. Cette déviance est une cause structurelle de la crise internationale, devenue une crise des finances publiques dans de nombreux pays.
Comment expliquer cette montée du rejet de l’impôt et l’explosion de la fraude fiscale ?
Les causes sont plurielles. Premièrement, la diffusion d’une idéologie néolibérale antifiscale dont l’objectif est d’obtenir la baisse des impôts des multinationales ainsi que la limitation drastique des dépenses sociales. Deuxièmement, la complexification du droit fiscal favorisant les montages de fraude tout en compliquant l’obligation des plus pauvres. Troisièmement, un défaut de régulation publique : la concurrence fiscale entre États facilite les montages complexes d’évasion et cette concurrence touche les territoires nationaux comme infranationaux. Le droit international a privilégié des mécanismes de régulation basé sur le soft law, le droit informel. Dans les années 90, la lutte contre la concurrence fiscale s’appuyait sur des négociations entre États, avec notamment l’adoption d’un code de bonne conduite. Mais cela s’est avéré largement insuffisant face aux coûts générés par cette concurrence et à la crise qu’elle a favorisée. Même les modèles de conventions fiscales internationales proposés par l’OCDE n’ont pas permis d’unifier le droit international, sans compter le manque de coopération entre administrations… Quatrièmement, l’influence du New Public Management au niveau international. Ce mouvement œuvre en faveur d’une régulation administrative plus accommodante envers les grandes entreprises qui sont traitées à part. Les multinationales et les plus riches ont les moyens de détourner ou contourner les règles à leurs avantages par des montages complexes. Actuellement, il y a bien un mouvement politique au sein du G20 pour lutter contre la déviance fiscale en Europe, pour des raisons budgétaires, mais il doit faire face à une contre-offensive des élites qui tentent de dépolitiser le débat et de revenir sur un terrain technique en arguant de la sécurité juridique des affaires et des montages économiques, les besoins d’organes de négociation et d’arbitrage propres aux entreprises…
En quoi la fraude fiscale est-elle une déviance ?
La notion de déviance renvoie à la question des normes juridiques, sociales, politiques, morales transgressées et aux finalités de la société. Il y a d’abord un enjeu de labellisation par l’autorité publique de ce qui relève de la fraude fiscale ou non, sachant que les grandes entreprises multinationales et les particuliers les plus riches déplacent la frontière entre le légal et l’illégal, en utilisant habilement les textes ou leurs lacunes. Jusqu’ici, seule l’infraction à la loi, la fraude, était condamnable tandis que l’optimisation fiscale était jugée normale. Du côté des normes sociales, on constate qu’au-delà de quelques scandales, la condamnation morale est relativement faible en France et ailleurs. Seulement un peu plus de 50 % des français estiment que la fraude n’est jamais justifiable. On revient à la question de la légitimité : les impôts sont légitimes quand les institutions politiques sont légitimes. Or chez nous les institutions font l’objet d’une certaine défiance. D’après les enquêtes du Centre de recherches politiques de Sciences Po (CEVIPOF), plus de 80 % des Français pensent que les responsables politiques ne se préoccupent pas de leur avis. La confiance dans les institutions locales est un peu meilleure mais reste faible. Nous sommes face à un biais cognitif : les Français déplorent une fiscalité trop lourde mais condamnent peu la fraude et encore moins l’optimisation ! L’opinion publique ne fait pas le lien entre cette déviance et la crise des finances publiques. Or, si la déviance ne transgresse pas des normes claires, elle n’en constitue pas moins un affaiblissement de l’égalité devant l’impôt et délégitime l’impôt-contribution du citoyen aux politiques publiques : elle porte atteinte aux finalités sociales de la fiscalité.
Comment redonner du sens au système fiscal ?
Il est important de sortir le débat des mains des élites économiques, des groupes de pression et des experts afin d’établir collectivement quels sont les choix politiques à exercer démocratiquement sur les grands enjeux de la fiscalité. Il s’agit de dépasser ainsi le prétexte de la technicité de la fiscalité. Tout citoyen est à même de se prononcer sur ce qu’il considère comme un enjeu prioritaire : la dépendance, le développement, etc. Ces questions doivent faire l’objet d’un débat politique démocratique en se limitant à de grands enjeux correspondant aux 6 fonctions de l’impôt que j’ai décrites. Un compromis entre la fonction sociale, environnementale et économique doit être notamment trouvé. Incite-t-on au développement économique malgré un fort coût écologique ou développe-t-on la fonction environnementale de la fiscalité ? La taxe carbone implique des changements de comportements dans la manière de consommer, les choix de mobilité… Ces choix ont des implications fortes pour l’ensemble des citoyens. Une approche démocratique des choix politiques et financiers permettrait de réconcilier le sentiment de justice avec l’approche objective du système fiscal.
Quelles sont les marges d’action des collectivités dans ce contexte global de crise ?
La crise budgétaire et les traités européens ont conduit à la baisse des dotations aux collectivités, elles-mêmes poussées à la rigueur. Au niveau européen et international, un paradoxe est apparu dans le contexte de la crise. D’un côté, l’instauration rapide d’un gouvernement européen par la rigueur, avec un recul de la souveraineté des États, en accord avec les élites politiques ayant signé la règle d’or de l’équilibre structurel des budgets publics (Traité sur la Stabilité, la Coordination et la Gouvernance du 2 mars 2012). De l’autre côté, une régulation de la déviance fiscale globalisée, qui malgré des progrès importants, reste lente et incomplète, avec des politiques fiscales qui s’appliquent aux contribuables nationaux ordinaires sur le territoire national. Quel est le sens de cette territorialisation ? Les créanciers de la dette publique sont largement étrangers. La rigueur s’applique sur la masse des contribuables ne pouvant pas échapper à l’impôt puisque la fraude et l’évasion extraterritoriales sont réservées aux plus riches et aux multinationales. La hausse de la TVA touche ainsi les plus démunis. Par ailleurs, au niveau infranational, les inégalités entre territoires sont accentuées par la crise. Ainsi, les inégalités de situation entre grandes métropoles dynamiques économiquement et les territoires les plus fragiles se sont accentuées etc.
Comment expliquer la hausse continuelle des dépenses publiques alors que le credo dominant depuis deux décennies enjoint de les réduire ?
Historiquement, par-delà la diversité des causes de la hausse des dépenses publiques, deux explications générales existent : Alexis de Tocqueville dans De la démocratie en Amérique montre que, dans une démocratie, les dépenses publiques augmentent suivant une loi tendancielle dépendant de plusieurs facteurs. La démocratie fait naitre de nouveaux besoins en matière d’éducation, sociaux… qui entraînent la hausse des dépenses. L’économiste autrichien Wagner, toujours au XIXème siècle, démontre que la hausse est due à des facteurs économiques, comme les besoins d’infrastructures publiques accompagnant l’industrialisation et l’urbanisation. La croissance économique permet d’engendrer de nouvelles recettes fiscales. Aujourd’hui, les explications courantes tournent autour de trois grands facteurs, appelés les « 3I » : l’influence des idées et des doctrines, les intérêts en jeu et les institutions (entendues tant comme celles qui décident des dépenses que l’influence des majorités, des partis, etc.). Contrairement à ce qu’on pourrait penser, le clivage gauche – droite n’influence pas beaucoup les choix politiques par rapport aux dépenses et recettes sauf dans des périodes plus idéologiques (par exemple, la résistance des collectivités locales aux réformes fiscales de Madame Thatcher en Grande-Bretagne…). Toutefois, les processus internes de la décision budgétaire ont en réalité plus de conséquences.
De quelle manière les processus décisionnels au sein des collectivités impactent-ils les choix budgétaires ?
Je me suis précisément intéressé à la manière dont les collectivités ont réagi face à cette rigueur européenne et à l’engagement français de maîtrise des dépenses publiques qui a suivi. J’ai conduit de nombreux entretiens auprès de directeurs financiers pour savoir comment était prise la décision budgétaire. Il existe en France une culture de la dépense locale pour financer des investissements locaux ou d’autres dépenses, et qui passe par une hausse de la fiscalité locale. Il n’y a pas d’idéologie, au niveau local, de la rigueur qui se concrétiserait en une doctrine de la discipline de la gestion des finances locales. L’objectif est plutôt d’améliorer les services publics locaux et de défendre une action publique résolument interventionniste en matière sociale, économique et culturelle. L’idée est de maintenir les investissements locaux. Le jeu des subventions et des co-financements permettait aussi aux communes de trouver assez facilement des ressources pour leurs investissements. Par ailleurs, la maîtrise des dépenses de fonctionnement est davantage perçue comme un moyen de dégager des capacités d’autofinancement pour l’investissement, que de faire des économies.
Le contexte financier (réduction des dotations, impact de la crise) et l’injonction de l’État vont sans doute contraindre les collectivités à changer de paradigme. On constate déjà une gestion plus prudente avec parfois des innovations radicales, mais l’évolution est lente et complexe pour plusieurs raisons. Tout d’abord, du fait de la rigidité de certaines dépenses comme les dépenses sociales, de personnel, les investissements réalisés… Ensuite, du fait de facteurs socio-politiques tels que la résistance des services au changement, des catégories de dépenses difficiles à diminuer politiquement comme certaines subventions... Il y a bien une prise de conscience, notamment des services financiers et parfois de certains chefs de l’exécutif, de la nécessité de changer. À la suite de cette enquête, j’ai établi une typologie des modèles de décision financière que je résume ici :
- Un modèle élitaire dans lequel la décision financière est aux mains de l’exécutif ;
- Un modèle de l’expertise dans lequel la décision est fortement technicisée et dépendante des directeurs financiers ;
- Un modèle systémique, répandu,qui combine les deux premiers modèles dans un équilibre politico-administratif entre l’exécutif local et l’expertise financière ;
- Un modèle démocratique, qui donne une portée forte à la démocratie (implication de tous les élus, transparence, association de l’opposition, rôle des commissions etc.), mais est encore peu répandu. Les modèles les plus démocratiques intègrent des expériences de budgets participatifs ou l’implication des commissions, de l’opposition qui invitent à approfondir le débat démocratique. Il est fondamental de partager la connaissance fine du système notamment en discutant et publiant les outils importants comme le Plan Pluriannuel d’Investissements. Cela permettrait de repenser une démocratie interventionniste au niveau local par une meilleure transparence sur l’information financière en suscitant de véritables débats sur les choix politiques à traduire dans les budgets etc.

Interview de Damien Catteau
Maître de conférences en droit public, Directeur du Master 2 Droit public - Parcours Carrières publiques - Université Jean Moulin Lyon3.

Interview de Olivier Landel
Délégué général de France urbaine et Directeur général de l'Agence France Locale

Texte de Victor Chomentowski
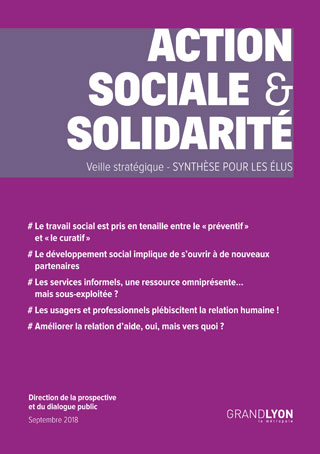
Étude
Veille stratégique - synthèse pour les élus.

Interview de Jacky DARNE
Vice-président du Grand Lyon chargé des finances
Texte de Gilles PINSON, Deborah GALIMBERTI et Rémi DORMOIS

Texte de Camille GUEZENNEC et Guillaume MALOCHET

Étude
Avec la question de la solidarité, on est au cœur du processus de construction de la Métropole.

Interview de Sonia PATY
Professeur de sciences économiques à l'université de Lyon 2