La psycho-ethnologie d'entreprises pour des projets psycho-friendly

Texte de Delphine SCIARRINO et Ludivine SCIARRINO
Interview de Jacques-Hervé LEVY
<< On part en général du produit et pas de l’entreprise : mais le meilleur produit du monde, s’il ne rencontre pas son marché, il ne sert à rien >>.
Propos recueillis par Ludovic Viévard, 22 juillet 2006.La recherche et le développement ( R&D ) est la mission essentielle confiée aux centres techniques industriels ( CTI ) créés spécialement afin que les entreprise mettent leurs moyens en commun dans ce sens. Cette R&D investit aujourd'hui dans l'innovation. Dans un contexte de chômage, l'innovation devient un facteur essentiel pour la création d'emplois et c'est pourquoi la puissance publique doit soutenir l'innovation.
_________________________________________________________Qu’est-ce qu’un centre technique et dans quel contexte ont-ils vu le jour ?
Les centres techniques industriels (CTI) datent de la loi de 1948. Après-guerre, les entreprises n’avaient pas les moyens de faire de la R&D et l’État a souhaité donner les moyens aux groupements professionnels de mutualiser des outils facilitant les transferts d’innovation industrielle. Pour assurer le financement, les CTI ont eu la capacité de lever des taxes parafiscales, sortes d’impôts « volontaires » au départ, assurés par les groupements des secteurs concernés — le textile en l’occurrence —, taxes qui sont ensuite devenues systématiques. Mais, dès 1978, le textile a connu la crise et, en 1996, ce mode de fonctionnement a été renégocié, le secteur du textile n’ayant plus les capacités d’assumer cette charge. L’IFTH a été créé en 2000 par fusion de deux autres centres techniques ITF (Institut textile de France) et le CETIH (Centre Technique des Industries de l’Habillement). Aujourd’hui, notre part de financement public est assurée par une dotation budgétaire de l’État, selon un contrat d’objectifs et de moyens précis (rayonnement international, transfert de l’innovation, animation du réseau, etc.). C’est un financement qui n’a pas bougé depuis la création — et qui est donc en baisse du fait de l’inflation — mais qui est complété par une part privée qui se monte environ à 60 % du budget. Ces recettes privées ont des origines variées puisque, comme toutes les sociétés de conseil, nous nous adressons autant à des entreprises privées qu’à des collectivités publiques. Quel est votre « métier » ?
Notre métier de base est le transfert de R&D dans les entreprises, y compris les petites. Notre système s’appuie sur de la veille, pour assurer la sensibilisation des entreprises, jusqu’au transfert de technologie, ce qui concerne une centaine d’entreprises chaque année pour un chiffre d’affaire de 24 millions d’Euros.
Il est intéressant de voir la différence qui touche les modes de transferts des technologies dans les industries qui ont des CTI et les autres. Les secteurs qui disposent de CTI sont beaucoup plus réactifs parce que nous avons un rôle de veille et nous assurons une interface qui nous permet d’être efficace dès qu’il y a un coup d’accélérateur. Un exemple. Le secteur des micro et nanotechnologies n’a pas d’industrie ancienne ni d’outil constitué comme les CTI. On a pu constater des difficultés dans le transfert technologique parce qu’ils ont dû reconstituer des outils or cela n’a pas laissé de place aux petites entreprises. Le transfert de R&D est l’une des taches la plus complexe et la plus mal définie. Tout le monde en parle, les pôles de compétitivité, et avant les technopôles. Nous y réfléchissons depuis 1948 et, en 2006, on s’interroge encore sur la façon dont la puissance publique peut aider au transfert de technologie. Mais ce qui a changé, c’est le discours, parce qu’on sait maintenant que la survie de l’emploi industriel passe par l’innovation. Comment définissez-vous l’innovation ?
Il y a innovation à partir du moment où il y a un progrès, une amélioration dans n’importe quel processus ou produit. Intégrer un ISO 9001 dans une boîte qui n’en n’a jamais fait, c’est de l’innovation. Gérer les ressources humaines, c’est déjà un processus innovant pour qui ne le faisait pas, etc. Aujourd’hui, ce qui est innovant pour moi ne l’est pas forcément pour vous. Il est important de contextualiser : ce n’est pas nécessairement un nouveau procédé, c’est un nouveau procédé là où il faisait défaut. Il n’y a pas que l’innovation produit et, pour nous, la première réponse est que l’innovation n’est pas d’abord technologique. Mais il est vrai qu’à Lyon où depuis un siècle on fait du textile en capitalisant sur ce qu’on appelle la « haute nouveauté lyonnaise », on a du mal à accepter cela. Il y a pourtant bien d’autres choses et notamment tout ce qui touche aux grands processus de l’entreprise : conception / création, production, marketing / vente, administration générale.Ce que vous dites peut paraître surprenant, qui plus est venant d’un centre technique…
L’innovation est nécessaire, mais ne commence pas par de l’innovation technologique ou de nouveaux produits. Il faut comprendre les problématiques spécifiques de la filière. Les sociétés textiles ont perdu la capacité de faire de la valeur ajoutée. Historiquement, le textilien créait de la valeur ajoutée sur chacun des processus de la chaîne. Il créait ses dessins et les vendait. Il créait des tissus et les vendait et ce jusque dans les boutiques, etc. Mais on a été les premiers à structurer la distribution via les hard discount ce qui a déstructuré les industriels et a diminué la valeur ajoutée sur la vente.
Il leur restait la production et la conception/création. Mais ils ont rapidement perdu la première avec l’arrivée sur le marché de la Chine et du reste de l’Asie.
Demeure aujourd’hui la conception/création, simplement parce que
« l’air du temps » ne se délocalise pas et que, pour l’heure, le pouvoir d’achat étant à proximité cela leur permet de concevoir les bons produits au bon moment. Il s’agit donc bien, quand même, de nouveaux produits…
On peut avoir le meilleur produit, si on ne sait pas le vendre… Ici, on a travaillé sur les technologies de greffage sous faisceau d’électrons avec un laboratoire de l’École Centrale. On avait trente ans d’avance mais on n’a pas réussi à vendre cette technologie. Pourtant, aujourd’hui, elle est diffusée dans l’industrie et les produits arrivent sur le marché. Pourquoi ? Parce qu’on ne s’était pas posé la question de ce que voulait le marché. Cela fait trente ans qu’on dit qu’il faut écouter le marché pour savoir ce qu’il veut avant de développer un produit. Certes, il existe aussi un marketing de l’offre mais on répond à des besoins qui existent même s’ils ne sont pas exprimés. Mais nous sommes dans une industrie qui a été tirée et dirigée par la technologie depuis 100 ans. C’est pourquoi, à des gens qui ne pensent que technologie, je leur parle de marché pour leur dire que l’innovation n’est pas que technologique. La technologie est au service de l’innovation, c’est toute la différence.
Donc il faut comprendre les business processus des entreprises clientes pour pouvoir les aider à être meilleures. On part en général du produit et pas de l’entreprise : mais le meilleur produit du monde, s’il ne rencontre pas son marché, ne sert à rien. C’est un travail de fond, fondamentalement spécialisé, et qui n’est pas celui du CNRS ou de l’université. Le transfert de l’innovation n’est pas un problème technique, cela engage beaucoup d’autres choses qui sont liées à l’entreprise. Si on veut vraiment que les chercheurs créent de la valeur ajoutée il faut leur donner un outil de vente et d’accès au marché.Quelle est la part de la représentation et du rêve, puisqu’on se dit généralement que l’avenir des textiles passe par l’innovation technologique… On fantasme la filière en mettant en avant les nouveaux produits, les nouveaux tissages, etc. ?
D’une certaine manière oui, parce qu’on ne pense pas suffisamment matériaux / textiles et trop tissus / habillement. On sait tous que le textile sert à faire des vêtements : on a un lien intime avec ce qu’on porte sur le corps et un rapport culturel fort. C’est un gros avantage. Mais le textile n’est pas que cela. Aujourd’hui, on roule en textile, on vole en textile. Le textile est partout. L’Oréal met des fibres de soies dans ses shampoings, Michelin est le premier textilien de France. En matière d’aviation également. Certes, Boing a trente ans d’avance sur Airbus parce que les textiliens n’ont pas travaillé sur le secteur, mais on tricote le nez de l’airbus.
Toute la difficulté est que nos savoir-faire se sont sclérosés dans un marché dont on savait pourtant que la loi des nombres nous rendrait perdant — à part les entreprises du luxe qui ont très bien marché à Lyon, mais qui ne représentent pas une solution de masse. On a voulu transmettre un message positif en disant que si les secteurs traditionnels fermaient, il y avait cependant d’autres secteurs qui utilisaient des TUT ( textiles à usages techniques ). Mais on a fait une grosse erreur de communication, personne ne sait vraiment ce que sont les TUT. Il fallait expliquer à quoi ça servait. Or le textile est une industrie intermédiaire qui fabrique un matériau qui sert à beaucoup de choses, que nous n’avons d’ailleurs pas fini de découvrir. Certains textiliens vont voir des grandes entreprises, comme par exemple Lafarge, leader mondial de la plaque de plâtre, et font évoluer leur métier ; ce qui était du plâtre renforcé avec des déchets textiles est en train de devenir des structures de textile remplies avec du plâtre. Les textiliens ont compris qu’à partir du moment où leurs matériaux avaient une valeur ajoutée pouvant être valorisée sur d’autres marchés et amener des solutions aux clients, ils pouvaient passer de sous-traitants à équipementiers. Ce type de démarches montre que ce n’est pas le produit qui est moteur, c’est le circuit de distribution, la capacité à arriver sur un marché, qui permet de valoriser l’innovation. Toute la difficulté est de transgresser le discours officiel qui est de dire qu’on va sauver l’emploi en France grâce à l’innovation. Ce discours tient, certes, mais si on ne met pas la charrue avant les bœufs. Or il y a beaucoup de cabinets de conseil qui encouragent l’innovation à tout prix et certaines entreprises engloutissent leurs dernières forces financières dedans. C’est une erreur de renvoyer ce discours aux chefs d’entreprise. Nous ne sommes une solution que si l’entreprise est structurée.On ne parle plus d’innovation mais de mutation d’entreprise qui s’adapte à des marchés en évolution.
Je ne peux pas imaginer que l’innovation soit détachée de cela.
On a une vision trop centrée sur la technologie. Je viens de l’industrie et du marché. Ma responsabilité vis-à-vis de mes clients n’est pas que technologique et mon intérêt est que mon client aille bien et soit pérenne pour nouer des relations durables avec lui.Cela signifie que l’entreprise est d’abord ce sur quoi il faut travailler ?
Il y a deux approches classiques.
Selon la première, pour prendre des parts de marché, il faut que je propose des produits nouveaux. Il faut donc mettre l’accent sur l’innovation produit. Mais on sait aujourd’hui que les nouveaux produits sont immédiatement copiés et qu’en choisissant cette voie on entre dans une course perpétuelle à l’innovation. Ce n’est pas forcément une mauvaise stratégie, mais il faut un budget de R&D important et cela contraint à se renouveler en permanence. C’est le processus classique sur lequel on a vécu durant ces dernières années et il touche ses limites dans le textile habillement car le temps de montrer le tissu, il est déjà copié. En gros, vous assurez la R&D des autres… Ce business modèle-là est perdant.
Le second modèle joue sur le prix et la diminution des coûts. Je rappelle au passage que c’est nous qui avons inventé la délocalisation. Elle a démarré avec les anciens compagnons qui en avaient assez que certains fassent fabriquer dans les campagnes à bas prix et ramènent ensuite les produits dans les villes, raison pour laquelle ils ont institué des octrois à l’entrée des villes. Aujourd’hui le prix n’est pas un avantage pour nous. Coproduction, partenariat, délocalisation, etc., ce n’est pas une solution durable. Bien sûr, c’est un des outils et cela fait partie de l’environnement concurrentiel, mais ce n’est pas là-dessus que nos entreprises peuvent réellement se distinguer.
Il faut donc trouver un autre levier d’action. On travaille plus sur le domaine création/conception. Sur ce processus, notre valeur ajoutée avait disparu. On était devenu les sous-traitants des passeurs d’ordre du nord de la France, de Paris, voire d’Italie ou d’Allemagne. Aujourd’hui, notre travail est de redonner aux entreprises locales de la valeur ajoutée à la fonction de création. Et rien que le fait d’intégrer un processus de création est innovant pour ces sociétés là. Mais pour cela, il faut intégrer d’autres processus de structuration, comme la définition des savoir-faire de l’entreprise, le knowledge management. Aujourd’hui, il y a un vrai déficit de ce point de vue. Le réflexe est de penser que la solution est à l’extérieur et les chefs d’entreprise ont oublié de capitaliser sur leur savoir-faire. Le vrai travail de fond est de mettre les entreprises en capacités d’intégrer des processus de création en consolidant les bases et en prenant conscience de qui elles sont et de leurs savoir-faire. L’innovation réside dans leur aptitude à « marketer » et à vendre leurs produits.Comment mettre en œuvre cette double dimension innovation / organisation de l’entreprise ?
L’ IFTH est une fusée à plusieurs étages.
Dans un premier temps, on débroussaille des technologies et des concepts et, selon les enjeux, cela se passe au niveau local, national, européen, ou international. Le risque est maximal. Le propulseur est ici l’argent public et les modes d’action collectifs puisque nous travaillons dans des acquisitions de savoir-faire à travers des consortiums, la participation à des programmes de recherche, etc.
La seconde étape est celle du test et de l’application. On a besoin d’avoir des référents et de tester les choses pour savoir comment fonctionne la technologie et comment l’intégrer. Lorsqu’on s’est lancé dans les plasmas, il a fallu valider les capacités de cette technologie pour le textile, comprendre vers quelle industrie on se dirigeait, etc. Par ailleurs, il faut mettre la prise de risque en corrélation avec la capacité financière des entreprises, qui n’est pas énorme. On essaie donc de les faire innover en réseau, en mutualisant les technologies transférées.
La dernière phase est le transfert industriel à proprement parler. L’IFTH accompagne l’entreprise jusqu’à la porte de l’atelier, sachant que nous nous refusons à leur servir de béquilles et que nous ne faisons pas le transfert. Ce sont elles qui le font. On peut amener l’entreprise vers des décisions, mais c’est à elle de les prendre.Accueillez-vous également des chercheurs qui souhaitent valoriser leur travail ?
Peu, mais oui, on a aussi des chercheurs qui viennent nous voir pour développer leurs projets jusqu’à l’industrialisation. On sert également d’incubateur de projets à l’intérieur d’équipes mixtes associant nos chercheurs et des chercheurs de grandes entreprises. On arrive ainsi à croiser les compétences. L’innovation est souvent dans les rencontres et les limites de compétences. Mixer les compétences nous amène au plus près de l’innovation.C’est le principe des pôles de compétitivité, Techtera pour le textile. Qu’est-ce que ça va changer puisque vous travaillez déjà en réseau ?
Le premier impact des pôles a été de réveiller les projets dormants d’entrepreneurs qui ont amené des idées parce qu’il y avait des financements. Il y a des projets bien avancés, d’autres sur lesquels il y a plus de travail. L’IFTH participe à 9 pôles directement, 12 avec les participations. Notre technologie est transversale.
Pour ce qui est du travail en réseau, l’arrivée des pôles nous a effectivement obligé à nous regrouper entre outils collectifs et ressources technologiques. On se connaissait, on se respectait, mais c’est vrai que souvent, il est plus facile d’aller chercher un partenaire italien, belge ou polonais que de descendre à la Doua pour trouver le bon labo au CNRS. La R&D ce sont des relations de confiance et de personnes, on travaille avec des personnes que l’ont connaît bien. Les pôles nous ont obligé à nous poser collégialement la question du choix de nos partenaires. Au lieu de nous dire que nous allions travailler avec des gens que l’on connaît déjà, on est amené à mieux regarder l’environnement local des compétences. Cela resserre les liens locaux.

Texte de Delphine SCIARRINO et Ludivine SCIARRINO

Interview de Jean-Francis SPINDLER
Directeur R&D Europe de Rhodia-Solvay

Interview de Nadia KAMAL
Directrice de Créalys
Interview de Michel LACROIX et Michèle GRANGER
Institut de recherches sur la catalyse et l'environnement de Lyon ou IRCELYON
Interview de Olfa HOOFT
Directrice de la Fondation Franco-Suisse pour la Recherche et la Technologie
Interview de Alain MERIEUX
Président de bioMérieux
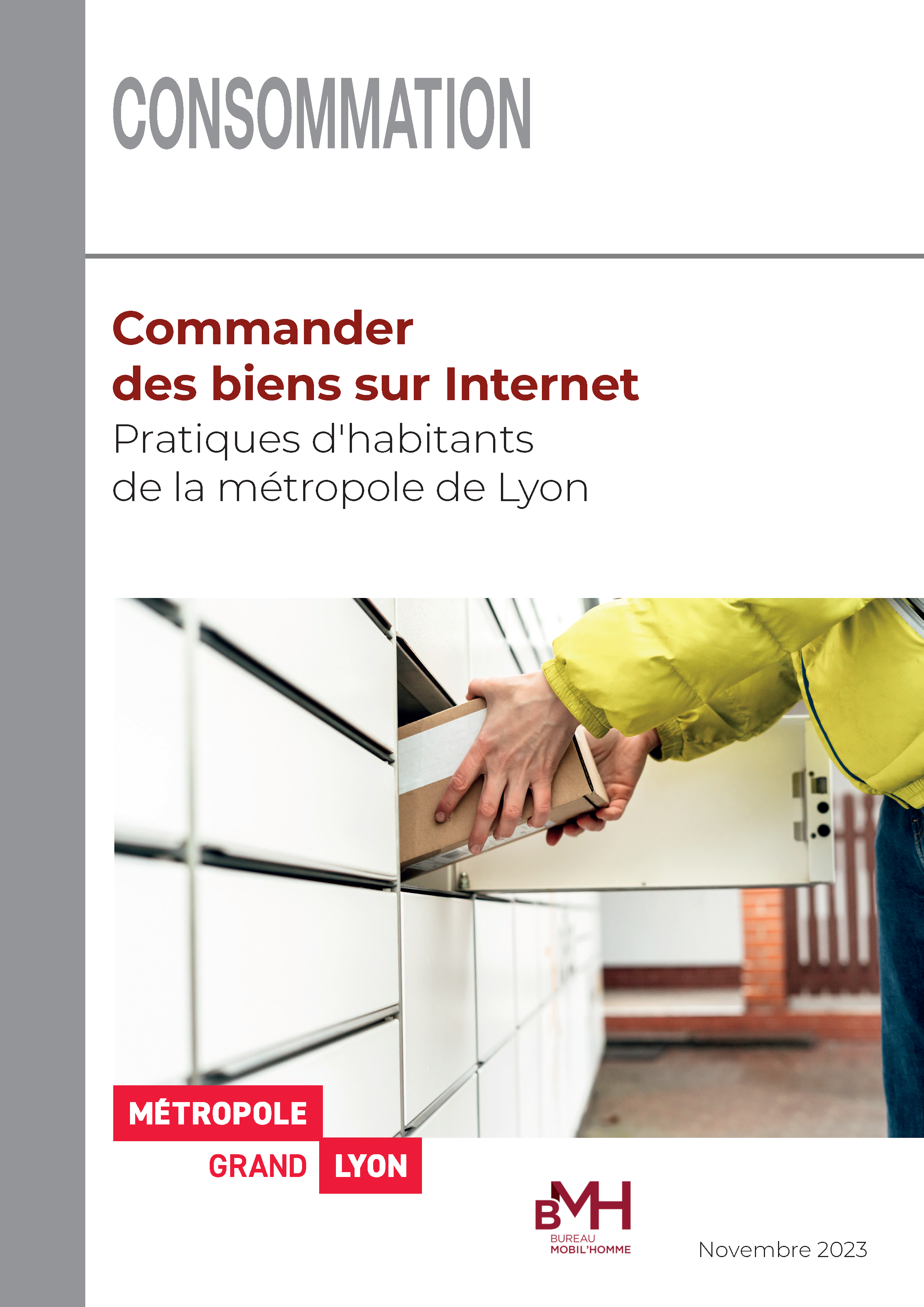
Étude
Pourquoi acheter en ligne ? Quelles préférences entre se faire livrer à domicile, en point-relai ou en drive ? Une douzaine d’habitants témoignent.

Étude
Comment les commerces de proximité s’adaptent à la vente en ligne ? Cette étude donne la parole à une dizaine de commerçants indépendants du territoire.