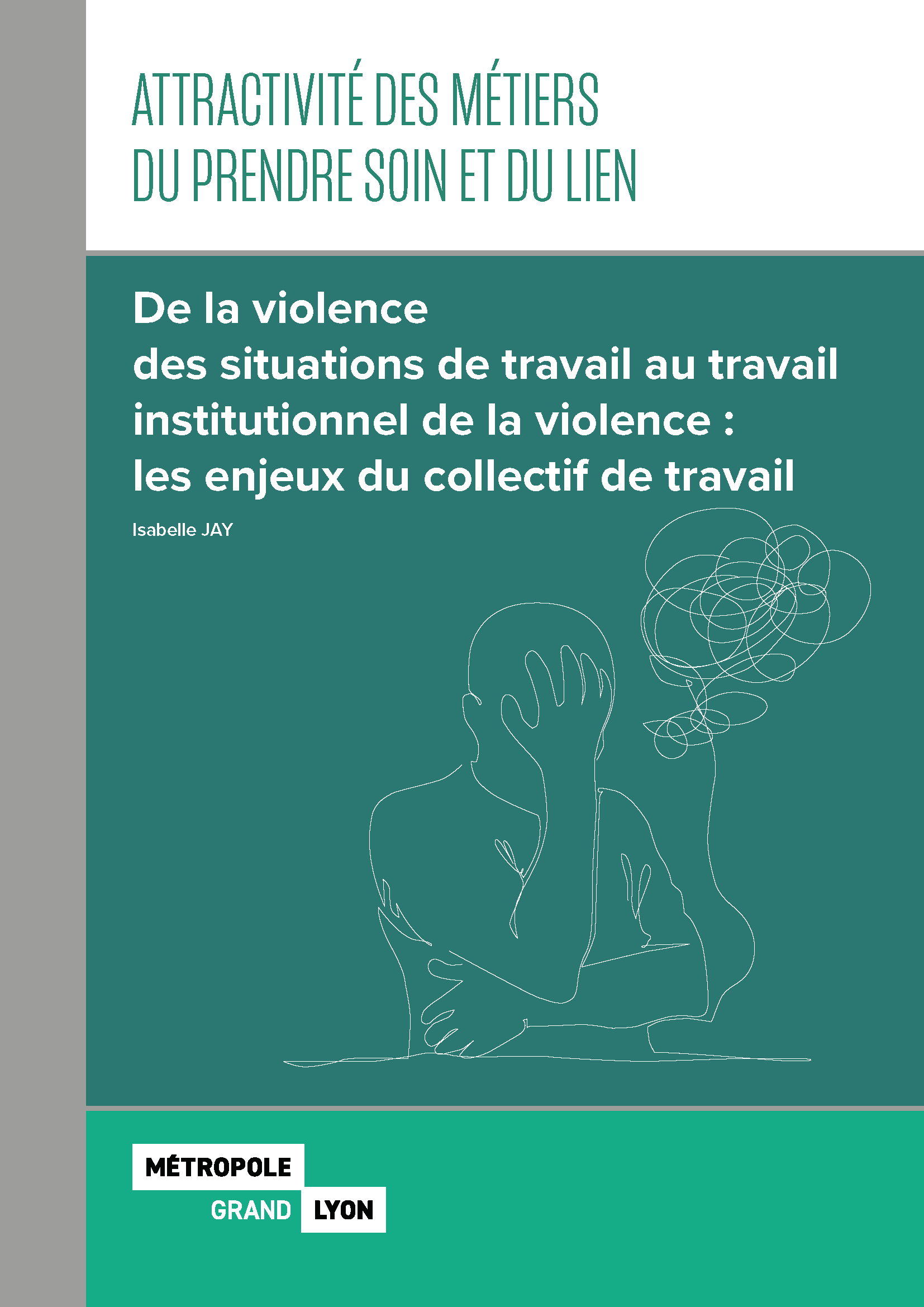Lorsqu’il était en fonctionnement, quels rapports entretenait le centre Thomas More avec les différents échelons des collectivités locales ?
Les relations avec les collectivités locales ont été excellentes et quasiment sans ombres. On a toujours eu un soutien très cordial de la commune d’Eveux, même si le couvent est souvent présenté comme étant situé à L’Arbresle ! Nous entretenions de bonnes relations avec François Baraduc, maire de Fleurieux-sur-l’Arbresle. Michel Mercier, en tant que président du Conseil général du Rhône, a beaucoup soutenu le centre Thomas More, il venait de temps en temps.
Nous avons constamment eu de bonnes relations avec le Conseil régional, en particulier Jacques Oudot, vice-président chargé de la culture au début des années 1990 puis Anne-Marie Comparini. Le Conseil régional nous a commandé une étude sur l’architecture contemporaine. Ceci nous a permis d’organiser « Les assises régionales de l’architecture ». Notre rapport final « Faire aimer le XXe siècle » avait une ambition pédagogique : comment rendre plus lisible et populaire l’architecture du XXe siècle en Rhône-Alpes. La réflexion a été menée en interne par les dominicains. Nous avions présenté une cinquantaine de notices, classant les ouvrages majeurs par thèmes. Ce travail a été un peu perdu, sa sortie coïncidant avec « l’affaire Million ».
Nous n’avions pas de relations directes avec le Grand Lyon du fait de notre situation géographique mais nous avons reçu plusieurs adjoints à la culture de Lyon comme Patrice Beghain, entre autres.
Dès sa création, les rencontres du Centre Thomas More se sont construites avec les meilleurs intellectuels français et non pas forcément avec les forces intellectuelles locales…
Le centre a effectivement reçu les plus éminents intellectuels de leurs disciplines comme Jacques Le Goff, Jean-Pierre Vernant. Dans les premiers temps, on était peut-être un peu fasciné par Paris. On voulait être crédible au plus haut niveau. Nous étions fiers quand une personnalité reconnue se déplaçait jusqu’au couvent. Cette volonté est née sous l’impulsion d’Henri Desroche, ancien dominicain. Il avait créé le Groupe de sociologie des religions dans les années 1950 au CNRS. Cet établissement était en relation avec l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales. Il y a eu, au début des activités du centre Thomas More, une focalisation vers cette école prestigieuse.
Cependant, il y a eu d’emblée des Lyonnais dans le coup ! Le centre n’était pas forcément élitiste car nous n’avons heureusement pas fait venir que des « vedettes » ! J’ai d’ailleurs contribué à ce que le centre soit plus attentif aux activités intellectuelles des Lyonnais. Ce ne fut pas au détriment des intervenants parisiens car, avec jusqu’à 25 sessions par an, nous avions largement de la place pour tout le monde.
Quel est le rôle de la laïcité dans le déroulement des rencontres ?
La laïcité était une condition sine qua non pour permettre la réussite des rencontres. Il fallait jouer la carte du laïc…dans un cadre religieux ! Dans les années 70, certains membres du centre Thomas More voulaient presque faire oublier que les participants se trouvaient dans un couvent ! Nous étions atypique puisque dans un des textes donnant une définition d’un centre culturel de rencontres était écrit « lieu d’une communauté disparue ! » C’était particulièrement original de créer un Centre culturel de rencontres dans un lieu religieux et habité. Cette position nous permettait une totale liberté. Nous avons par exemple organisé une séance sur la théologie en France mais avec l’approche des sciences humaines.
En quoi le centre Thomas More était précurseur ?
C’était avant tout une question de style dans les débats. Il n’y a pas beaucoup de lieux en France où un professeur d’université se trouve assis à côté – et non en face – d’un étudiant. Les participants pouvaient échanger avec des intellectuels de haut niveau dans des débats croisant plusieurs disciplines. C’était donc très différent des colloques universitaires traditionnels où les actes se résument à un alignement consensuel de communications ! Nous avions instauré un principe : le temps de débats devait être aussi long que le temps de parole des intervenants à la tribune. Enfin, il fallait « en vouloir » pour venir 48h le week-end en pleine campagne…d’autant plus qu’il fallait payer ! Les rencontres demandaient une implication assidue, très différente d’une conférence où le public reste passif pendant une heure et demi !
Est ce que la qualité de l’architecture du couvent a donné lieu à des rencontres sur ce thème ?
Oui. Nous avons organisé des débats sur l’architecture avec des experts et des passionnés. Inversement, nous faisions découvrir les singularités du lieux à des intervenants ne connaissant pas du tout le couvent et l’architecture du Corbusier. Il fallait permettre aux visiteurs initiés ou non de vivre 48 h à la Tourette ! Il y a des visiteurs qui découvraient avec enthousiasme, d’autres qui se recroquevillaient… Après le déjeuner du samedi, nous organisions de manière rituelle la visite du couvent et nous en profitions pour expliquer l’ordre des Dominicains.
Nous n’avons pas eu besoin de faire de la communication pour attirer les écoles d’architecture. Le couvent a connu un succès grandissant, nous obligeant à assurer un accueil crédible. Le nombre de visites d’architecture a été en croissance constante jusqu’à des problèmes internes et des défauts de communications vers 2000. La réputation du bâtiment est très bonne, c’est l’un des bâtiments les plus emblématiques construit par Le Corbusier. Etant donné que l’œuvre de l’architecte est enseignée dans le monde entier, en Europe, aux Etats-Unis, en Australie ou au Japon, la source de visiteurs est intarissable. Nous avions créé Les cafés d’architectures au Café Bartholdi, place des Terreaux à Lyon. La série de conférences a tenu au moins trois ans. Elles permettaient une diffusion des réflexions menées à la Tourette.
Quelles ont été les relations avec l'université lyonnaise ? Comment celle-ci voyait vos activités ? Y a t'il eu rejet, collaboration, évolution de vos rapports ?
Nous avions des relations nourries avec un certain nombre d’universitaires Lyonnais comme Philippe Dujardin, Etienne Fouilloux, Guy Avanzini, Jean-Michel Servet, André Julliard, Bernard Lecomte, à l’origine du musée de la résistance. En revanche, nous n’avions pas de contacts institutionnels. Le centre Thomas More n’a pas été créé pour être reconnu de manière universitaire. Nous étions hors des clans, ce qui ne nous empêchait pas d’avoir des liens amicaux avec certains Lyonnais ! Ils ont donc eu leur part dans les rencontres Thomas More, aussi bien les universitaires de l’université publique que certains professeurs de l’université catholique. Nous avions des relations avec cette dernière car des dominicains y enseignaient. Inversement, l’Université de Lyon n’a jamais cherché à s’investir officiellement dans les échanges du centre Thomas More. Elle a marqué une indifférence polie vis-à-vis de nos activités. C’est un peu normal, nous étions tellement différents ! Ce n’était ni un rejet, ni une collaboration. Il y avait un peu de participation, surtout avec des étudiants.
Il y a eu toutefois un petit événement avec le monde universitaire. La première année où j’étais responsable du centre, la conférence des présidents d’université s’est réunie à la Tourette. Globalement, ça s’est bien passé mais il y a eu tout de même deux ou trois présidents d’université communistes qui ont dénoncé la tenue d’une pareille réunion dans un couvent !
De quoi êtes-vous le plus fier de votre activité de directeur du centre Thomas More ? Y-a-t-il eu une ou plusieurs rencontres qui vous ont plus particulièrement marqué et pourquoi ?
Je peux citer deux exemples. Lors d’un colloque sur la notion de prévention, nous avons fait se rencontrer Christian Gérondeau, à l’époque M. sécurité routière » depuis le gouvernement Chaban Delmas jusqu’à la fin des années 1990 et Jean-Pierre Deschamps, professeur de santé publique à Nancy, spécialiste de la prévention de la santé des enfants. Ces deux messieurs s’ignoraient complètement alors qu’ils travaillaient sur les mêmes thématiques. La rencontre a même permis de découvrir qu’ils avient les mêmes méthodes de travail ! En l’occurrence, la prévention n’est pas une pratique démocratique, il faut imposer les choses pour avoir des résultats. Les giratoires ont sauvé 2000 vies par an en France sans que le Parlement n’ait été consulté. Cette rencontre a été rendue possible par le Centre Thomas More. Elle ne se serait certainement passée nulle part ailleurs. Ces deux experts avaient beaucoup de choses en commun mais allaient mener leur vie sans jamais se rencontrer !
Nous avons organisé un extraordinaire colloque sur Pasolini : « Pasolini et le sens du sacré ». Nous avons pu faire intervenir Ninetto Davoli, le compagnon de la fin de vie du réalisateur. Ce dernier a évoqué des choses extraordinaires…qu’il n’avait jamais eu l’occasion de dire en Italie, étant exclu de la fondation Pasolini. Nous avons pu organiser le colloque sans demander l’avis de la fondation.
La liberté d’action du centre était totale. Nous étions une petite bande inventant ce que bon nous semblait sans aucune pesanteur d’institution…C’était très léger en comparaison du monde universitaire où la moindre réunion peut être difficile à organiser !
Inversement, avez-vous des regrets, des actions inachevées ?
Absorbé par le travail quotidien, nous n’avons presque pas produit de compte-rendu écrit des différentes rencontres. Il y avait bien une revue qui donnait des échos de certains colloques mais elle juxtaposait des sujets si hétérogènes qu’elle était totalement illisible. Il valait mieux publier un article dans une revue spécialisée.
Il y a eu cependant quelques filières » qui ont produit des articles sur des sujets bien cadrés. Nous avions créé l’observatoire des changements du catholicisme français. Nous avons fait des rencontres de spécialistes de l’islam et du christianisme, sur la figure du saint et la mort du saint. Un livre est sorti « Histoires des hommes de Dieu dans l’Islam et le Christianisme ». Une autre filière a concerné la matérialité du livre dans les différentes religions et a engendré quatre ou cinq colloques qui pouvaient s’étaler sur plusieurs années.
On a eu tout de même quelques cas de censure puisque lors de l’organisation d’un colloque sur la santé des personnes âgées, l’organisateur voulait titrer « L’interminable bonne santé des vieux ! ». Le titre fut jugé un peu provoquant ! Le colloque traitait du sens d’être maintenu en bonne santé jusqu’à 90-95 ans…parfois contre son gré.
Certaines opérations se sont-elle révélées impossibles à monter ?
On a subi quelques échecs. En moyenne, sur 25 colloques par an, deux à trois ne marchaient pas, ne trouvant pas leur public. Par exemple, je voulais faire venir le très intéressant philosophe Jean-Pierre Dupuy mais il n’y a eu que quatre ou cinq inscrits ! On a préféré annuler la rencontre.
Aussi, des idées n’ont pas réussi à se concrétiser totalement. Par exemple, la rencontre sur « la modestie en architecture » On a fait venir Alvaro Siza, Giancarlo De Carlo et Shigeru Ban, l’architecte du Beaubourg de Metz, qui a aussi travaillé sur des projets plus modestes comme l’architecture d’urgence. Henri Ciriani, le plus corbuséen des architectes Français m’a dit « Tu es fou ! L’architecte n’a pas à être modeste » ! Il n’a pas voulu venir défendre sa thèse dans le débat !
Le terrain dominicain a-t’il facilité le dialogue en s’affranchissant de querelles « de chapelles » ?
Non quand les chapelles sont très fortes… En psychanalyse, il n’a pas été possible de faire se rencontrer des Lacaniens et des Freudiens ! Plus étonnant, en archéologie, dans les années 1990, il y avait des clans nous empêchant d’organiser le colloque « L’archéologie et les collectivités locales ». Le blocage est venu des universitaires et non des collectivités, malgré tous les efforts de Jacques Lasfargues, à l’époque directeur du musée Gallo-romain de Fourvière. Notre liberté totale se heurtait donc parfois à des clans insurmontables.
En quoi une organisation mixte laïque-religieux est-elle plus riche pour des rencontres intellectuelles qu'une organisation purement laïque ?
Les religieux avaient une sorte de liberté : tout en jouant un jeu laïque, ils disposaient d’un bâtiment intéressant et des moyens de relations crédibles. Les dominicains présents au conseil scientifique l’étaient non pas en qualité de religieux mais en tant que spécialistes d’un domaine précis. Concernant la liberté et la religion… l’Eglise peut paraître comme une grosse machine oppressive, ce qu’elle peut parfois être, mais aussi être un lieu de très grande liberté.
Est ce que l'implantation géographique du couvent - en région lyonnaise - a permis au milieu intellectuel national de découvrir la région ?
En général, les participants, souvent parisiens, prenaient la correspondance de trains à Perrache. Nous allions les chercher à la gare de L’Arbresle…et ils repartaient le dimanche dans l’après midi. Les gens invités ne profitaient donc pas du pays, même si ce n’était pas fait pour cela. Les échanges étaient assez denses. De Lyon, les intervenants ou participants voyaient surtout la gare !
Le colloque « Théorie et pratique de la gastronomie » a permis aux participants de découvrir la cuisine lyonnaise pendant deux jours. Il s’est tenu à guichet fermé, nous étions une soixantaine. Nous avions invité Philippe Chavent, alors chef de la Tour Rose, un sociologue du vin et un neurobiologiste qui décrivent les mécanismes cérébraux de la dégustation. Ce fut un moment jouissif exceptionnel.
L’architecture du couvent a-elle facilité la venue d’intellectuels ou d’artistes ?
Des architectes, des psychologues nous disaient : « après un débat chez vous, je repars avec des idées nouvelles » Le samedi, on continuait parfois de discuter minuit passé…pourtant La Tourette n’a pas été conçu pour être un lieu convivial !
Des artistes sont venus dans le couvent, des photographes ont souvent exposé. Il est toujours délicat d’installer des œuvres d’art dans un lieu qui est lui-même œuvre d’art.
Bill T. Jones, chorégraphe New-Yorkais, a été séduit par le lieu. Arte a réalisé un documentaire sur l’artiste. Jones a choisi le couvent de la Tourette comme fil conducteur du reportage. Je pense que de ce lieu émane une grande force spirituelle.
Nous avons organisé un concours grâce à la DRAC pour la création d’une chaise pour le réfectoire. Trois designers ont été mis en compétition. Le lauréat, Morrisson, a passé deux nuits dans le couvent et s’en est inspiré. Il m’a dit : « Autant quand je vais dans un hôtel banal, je ne suis pas inspiré…dès que j’arrive au couvent, j’ai des idées !»
Aujourd’hui, avec la profusion des moyens d’échanges et de production d’informations numériques – profusion qui peut brouiller le message et le contredire – pensez-vous que des scènes de rencontres « réelles » soient toujours pertinentes ?
Je crois que les rencontres réelles sont toujours pertinentes. Un critique d’art parle de la présence réelle des œuvres. On va dans un musée, on va voir une église, une pièce de théâtre. Il y a un contact que n’importe quelle représentation ne fera qu’approcher. Voir une photo d’une statue de Giacometti ou être à côté est une expérience très différente. La réalité des rencontres est très importante. Par rapport au numérique, je suis convaincu que le livre de papier résistera ou accompagnera toutes les autres formes. Je crois en la pertinence et l’avenir de rencontres d’hommes qui prennent le temps de s’écouter, de discuter et de réfléchir ensemble.