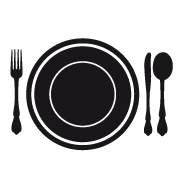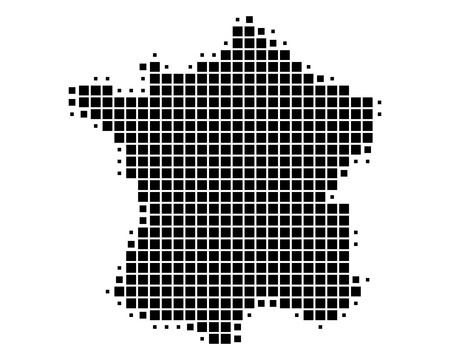Je pense qu'il y a un travail à entreprendre du côté des institutions, qu’elles soient locales ou nationales, qui dépasse la question des quartiers populaires. Elles auraient tout à gagner à accepter le conflit, l’interpellation, le désaccord et plus généralement la critique. On demeure quand même en France dans un modèle politique très centralisé, où on a interdit les corporations avec la loi Le Chapelier en 1793. Pendant un siècle, le droit de l'association n'était pas reconnu. Il demeure cette idée que les élus incarnent le monopole de l'intérêt général et que tout autre acteur serait, d'une certaine façon, un acteur séditieux ou qui aurait une perspective corporatiste, séparatiste, par rapport à l'intérêt général représenté par les élus. Or, quand on a 20 % de participation aux élections municipales, voire 5% à 6% de participation dans certains quartiers de Roubaix, ce discours ne tient plus.
Il est compliqué pour les élus locaux de revendiquer l'intérêt général et la légitimité démocratique d’une décision prise de façon unilatérale. Au regard de la désaffection de la démocratie représentative, et eu égard aux formes de colère sociale ordinaire qui existent dans les quartiers, il me semble que si participation il y a, il est probable qu'elle passe par des formes relativement conflictuelles ou critiques. Les institutions doivent être en capacité de l'entendre. Il y a un travail à mener, et il existe déjà. Je dresse un tableau un peu noir, et il faut évidemment y mettre des nuances selon les localités, mais les élus locaux gagneraient à se tourner vers une autre culture politique, plus réceptive aux formes d'interpellations et de critiques, quand bien même elles peuvent être dérangeantes.
Pour aller plus loin :
1. Sur les discriminations :
Talpin J., Balazard H., Carrel M., Hadj Belgacem S., Sümbül K., Purenne A., Roux G., 2021, L’épreuve de la discrimination : enquête dans les quartiers populaires, Paris, PUF (Collection « Le lien social »), 398 p.
Se référer au comte-rendu : https://www.cairn.info/revue-cahiers-de-la-lcd-lutte-contre-les-discriminations-2020-2-page-146.htm
Réécouter l’émission de la suite dans les idées : https://www.franceculture.fr/emissions/la-suite-dans-les-idees/de-la-discrimination-dans-les-quartiers-populaires
2. Sur la Table de quartier à Roubaix :
Talpin J., 2016, « Une répression à bas bruit. Comment les élus étouffent les mobilisations dans les quartiers populaires », Métropolitiques.
Lien vers l’article : https://metropolitiques.eu/Une-repression-a-bas-bruit-Comment-les-elus-etouffent-les-mobilisations-dans.html
Paula Cossart, Julien Talpin, Lutte urbaine. Participation et démocratie d’interpellation à l’Alma-Gare, Vulaines-sur-Seine, Éditions du Croquant, coll. « Sociopo », 2015.
Se référer au compte-rendu : https://journals.openedition.org/quaderni/1088
3. Sur le Community organizing :
Julien Talpin, Community organizing. De l'émeute à l'alliance des classes populaires aux Etats-Unis, Paris, Raisons d'agir, coll. « Cours et travaux », 2016, 320 p.
Se référer au compte-rendu : https://journals.openedition.org/lectures/20944
4. Sur le « communautarisme » :
Mohammed M., Talpin J., 2018, Communautarisme ?, Paris, Presses universitaires de France.
Présentation de l’ouvrage : https://laviedesidees.fr/Communautarisme-4176.html
→ Réalisée dans le cadre de la thèse « Grandir en banlieue : parcours, construction identitaire et positions sociales. Le devenir d’une cohorte » de Benjamin Lippens, retrouvez la première partie de l'interview de Julien Talpin ici !