Jeunesse, culture & numérique : les six grands constats qui concernent déjà la génération Z
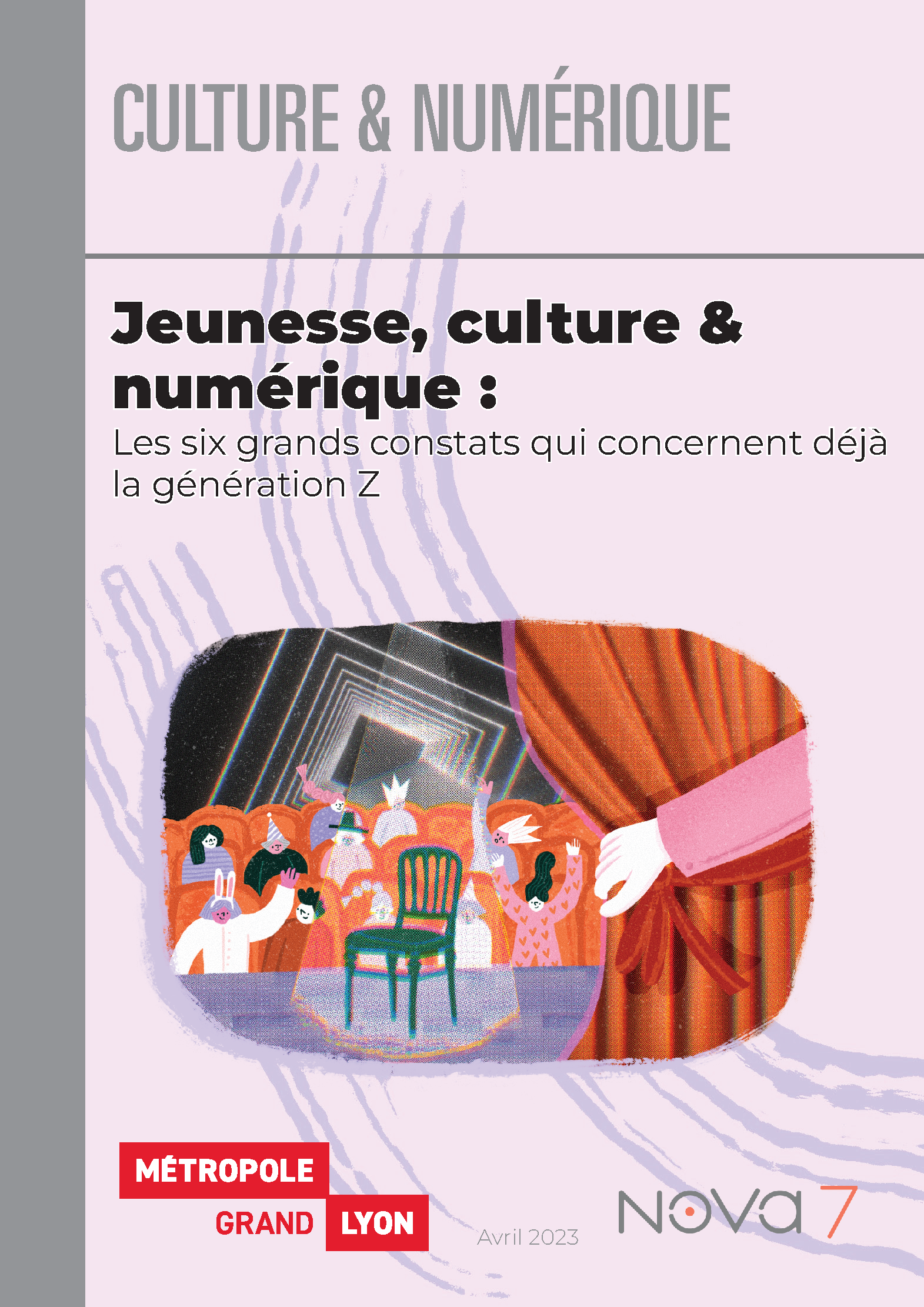
Article
Pour mieux imaginer l’offre culturelle proposée demain aux jeunes publics, acter les grandes transformations qui changent la donne dès aujourd’hui
Interview de Pierre FOURNERET

<< J'ai pu voir une enfant de 3 ans se balader littéralement sur une tablette numérique. C'était bluffant ! >>.
Quels sont les moyens d’augmenter l’intelligence ?
On peut viser une augmentation rapide — et le plus souvent transitoire — de processus comme la vigilance, l’attention, la mémorisation, voire la vitesse de traitement de l’information. Elle peut être provoquée par certains produits alimentaires (les oméga-3, la caféine, le thé, le gingembre), des recommandations d’hygiène de vie (les activités sportives, la qualité du sommeil) mais surtout, par certains psychotropes comme les amphétamines, dont l’usage est réglementé. S’il s’agit en revanche de faciliter la mémorisation ou l’utilisation des connaissances dans des tâches comme la résolution de problèmes, la démarche est plus lente et coûteuse — au sens de l’effort à fournir. Dans ce domaine, un ensemble de logiciels (comme les serious games) arrivent sur le marché pour stimuler telle ou telle fonction mentale. Les médecines dites « alternatives » ont également pour projet un mieux-être du sujet dans son environnement. Elles visent donc une meilleure efficience des aptitudes par des techniques de relaxation et de méditation ou qui passent par le jeûne. Malgré tout, défi nir l’intelligence reste une question largement «ouverte » dans la communauté scientifique. On peut mesurer les effets de l’intelligence — via certains tests —, mais l’intelligence n’est pas une habileté globale et donnée […][…] une fois pour toute. Ce serait la faculté de comprendre, de donner du sens à nos expériences de vie et qui nous permettrait d’agir efficacement dans un environnement donné.
Quelles sont les limites de ces techniques d’amélioration des capacités cognitives ?
Officiellement, et malgré les réserves éthiques, aucune !Officiellement, et malgré les réserves éthiques, aucune ! Les capacités de notre cerveau, comme celles d’un ordinateur, peuvent augmenter de façon linéaire si on stimule l’attention ou la mémoire vive de notre « système » avec des processus de calcul. Mais la prise de décision est un processus non linéaire, complexe, tributaire de nombreux facteurs comme les croyances, les désirs ou les émotions, l’histoire et la personnalité, qui ne peut se résumer à une amélioration de performance. Certains vont même jusqu’à envisager, avec la révolution des nanotechnologies, des puces hybrides biotechnologiques que nous pourrions, à terme, greffer sur notre cerveau. Une intelligence à la carte que nous pourrions modeler à loisir selon nos envies ou nos besoins. La question est de savoir qui décide, qui commence et surtout, où s’arrêter. . Mais la prise de décision est un processus non linéaire, complexe, tributaire de nombreux facteurs comme les croyances, les désirs ou les émotions, l’histoire et la personnalité, qui ne peut se résumer à une amélioration de performance. Certains vont même jusqu’à envisager, avec la révolution des nanotechnologies, des puces hybrides biotechnologiques que nous pourrions, à terme, greffer sur notre cerveau. Une intelligence à la carte que nous pourrions modeler à loisir selon nos envies ou nos besoins. La question est de savoir qui décide, qui commence et surtout, où s’arrêter.
Quels sont, selon vous, les risques réels dans ces pratiques ?
En ajoutant des prothèses artificielles, on ne laisse plus à l’individu la liberté de penser qu’il n’est pas obligé d’être performant. On peut créer les conditions de nouvelles dépendances à des produits ou à des techniques. Et finalement, on participe à réduire l’humain à une logique purement mécaniciste et utilitariste. La question est bien trop complexe et sérieuse pour être laissée à quelques scientifiques. La recherche fondamentale doit être bordée par une réflexion soutenue en sciences humaines. Aujourd’hui, on peut manipuler l’individu — comme le fait par exemple le neuro-marketing —, le cerveau étant l’organe le plus facilement « dupable ».
Vous prescrivez des psychostimulants à des enfants qui souffrent de défi cit de l’attention et de narcolepsie. Quels effets ont ces produits sur leur santé ?
Chez certains de ces enfants, les effets sont bénéfiques : en soutenant leur attention, on favorise leur mémorisation et plus globalement, leurs conditions d’apprentissage, ce qui évite le risque de décrochage scolaire et de marginalisation. Comme ils ne sont plus distraits, ils sont capables d’être plus performants dans le traitement de leurs devoirs scolaires. Les tensions avec les parents diminuent. La durée de prescription est sans cesse remise en cause pour éviter de faire croire que c’est une sorte de potion magique. Quelles améliorations de « l’intelligence » observez-vous ? J’ai pu voir une enfant de 3 ans se balader littéralement sur une tablette numérique. C’était bluffant ! Les premières études en IRM fonctionnelle comparent les cerveaux geek et non geek : les premiers gagnent en vitesse de traitement des informations simultanées mais sembleraient moins performants dans des tâches d’analyse en profondeur. On peut imaginer que l’usage de ces outils de plus en plus tôt au cours de notre développement puisse accélérer la transformation de notre « appareil mental ». Cependant, avant que ces nouveaux outils modifient notre fonctionnement cognitif, il risque de se passer du temps. Le cerveau ayant de remarquables capacités d’adaptation, il a horreur de se précipiter.
Les scores des sujets aux tests dits « d’intelligence » — je pense à l’épreuve de Weschler —, ont progressé régulièrement aux cours des trente dernières années. Pour autant, sommes-nous devenus plus intelligents, au sens d’une meilleure capacité à vivre ensemble et en harmonie avec notre environnement ? J’en doute !
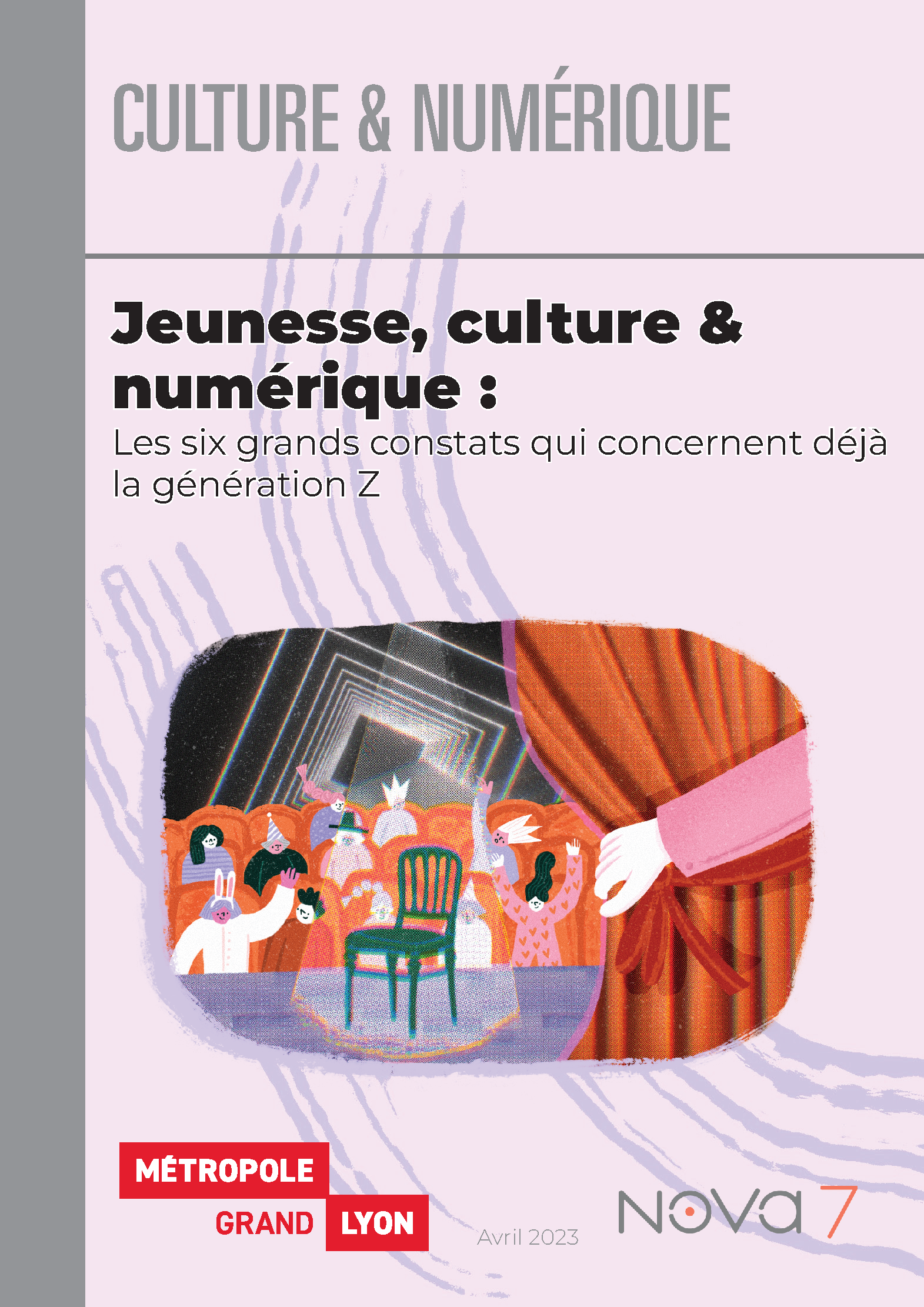
Article
Pour mieux imaginer l’offre culturelle proposée demain aux jeunes publics, acter les grandes transformations qui changent la donne dès aujourd’hui

Article
Un grand fou rire dans la ville jusqu’à l’aurore, une résidence citoyenne accueillie par l’Émeute de Lyon, « Carmen » hacké par nos ados. C’est à Lyon, en 2040.

Article
Et si demain le spectacle vivant se déroulait dans le métavers ?
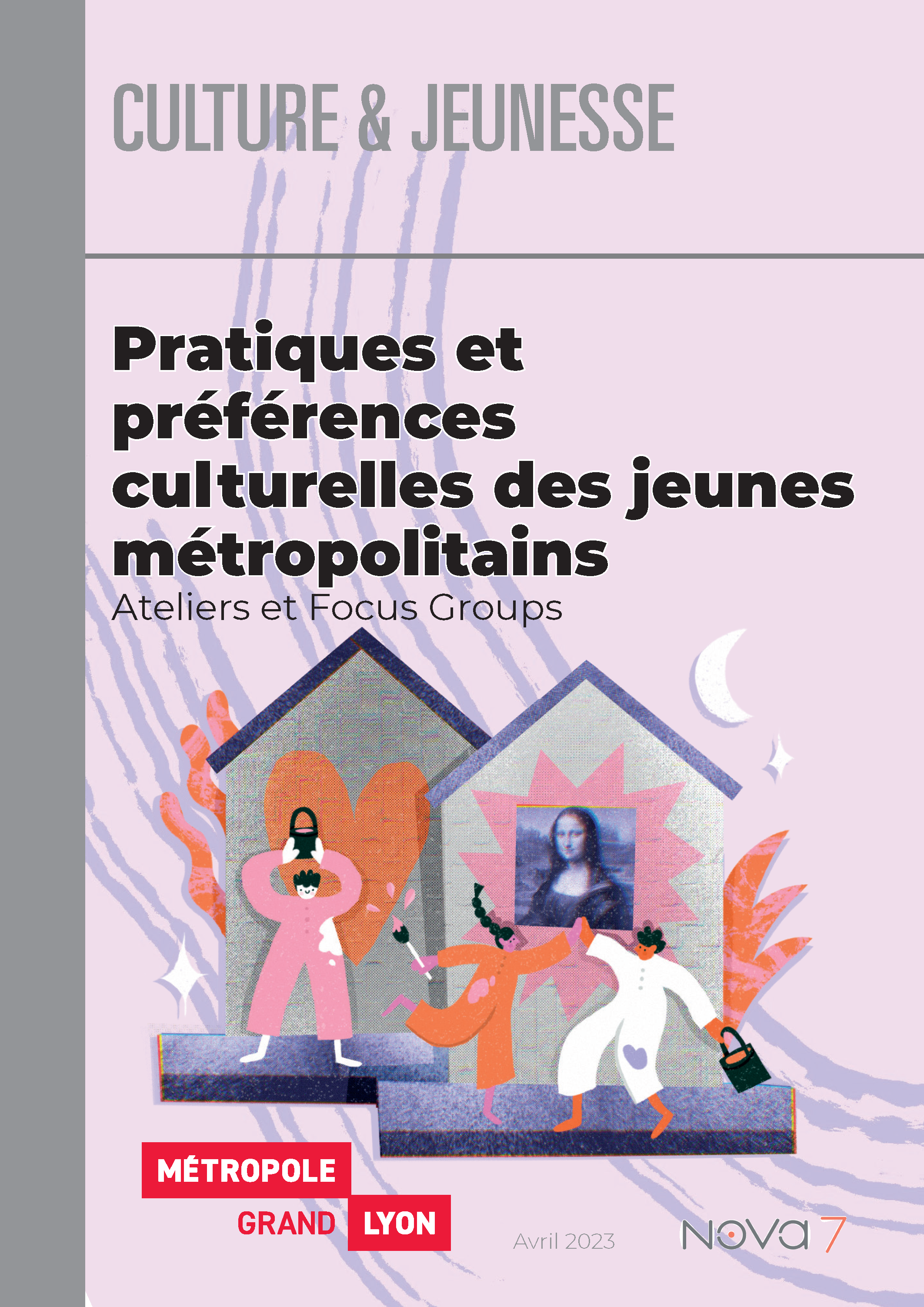
Article
Quand les pratiques on line et URL se complètent et s’entremêlent.
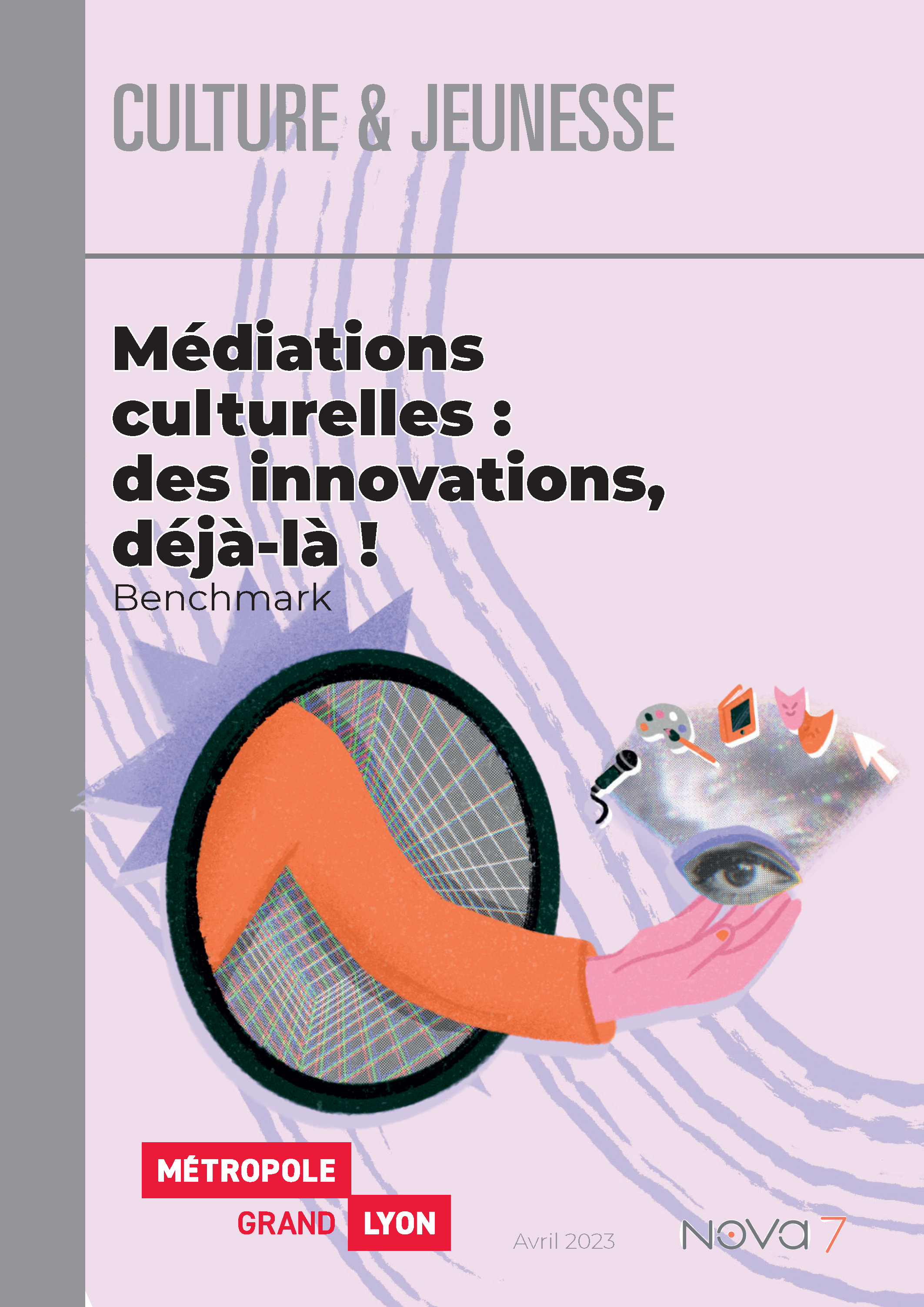
Article
Une douzaine d’initiatives inspirantes de médiations culturelles. Pour en imaginer d’autres…
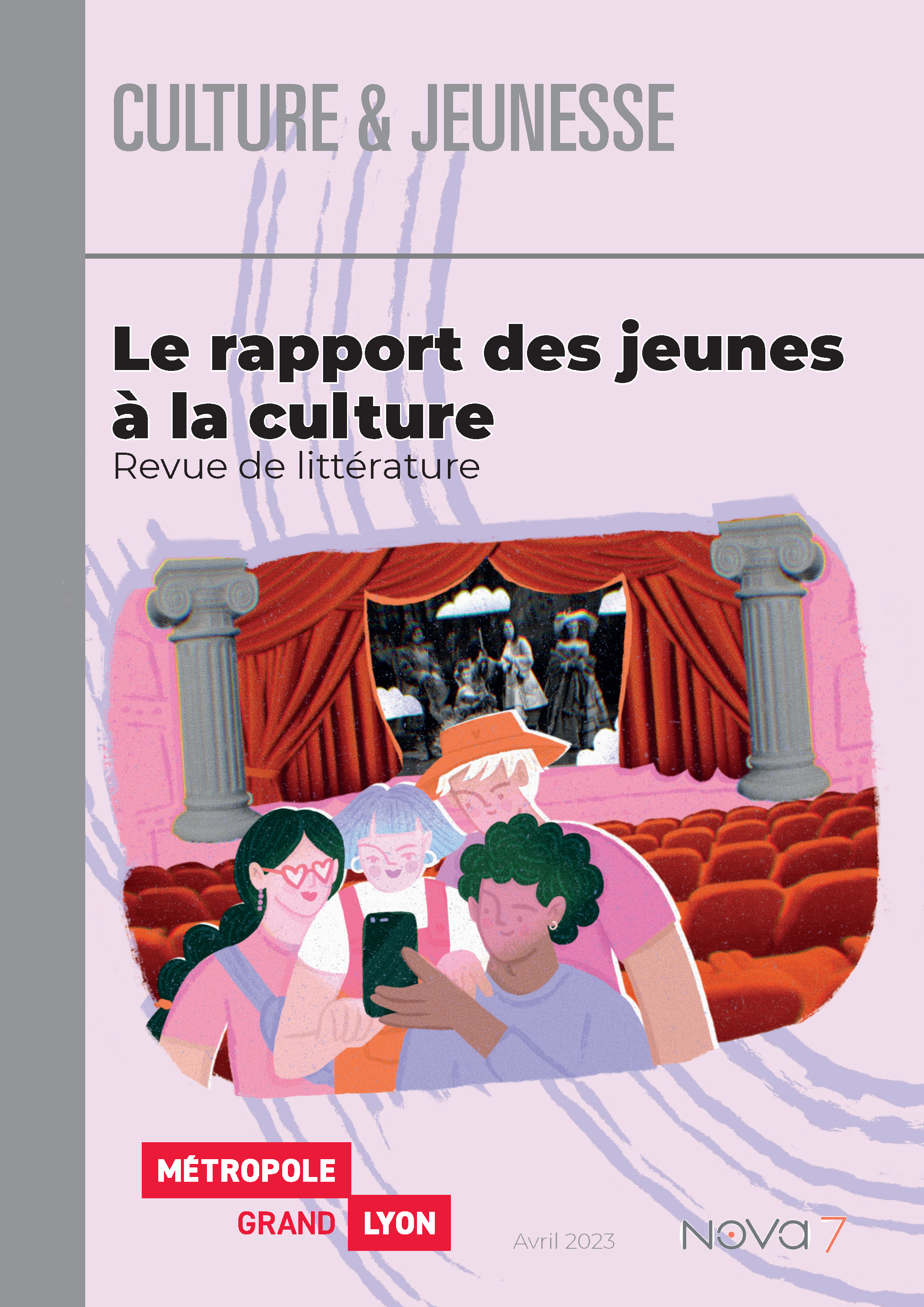
Article
De la « culture de la chambre » aux pratiques IRL, comment se construisent les pratiques culturelles et l’identité des jeunes aujourd’hui.

Retrouver dans ce dossier les fruits d’une démarche d’étude et d’enquête de plus d’un an, consacrée aux évolutions des relations entre jeunes publics, arts vivants et numérique.

Interview de Laurent Chicoineau
Directeur Quai des Savoirs

Étude
Quatre grandes tendances qui caractérisent les liens de la jeunesse avec l'espace public.