Prendre soin des métiers du prendre soin

Les métiers du prendre soin souffrent d'un fort turnover. Pourtant, les facteurs d'engagement dans ces métiers très humains ne manquent pas. Alors, que se passe-t-il ?
Interview de Paul BOINO

<< La solidarité est constitutive du Grand Lyon. Comme la société en générale, sinon plus encore, les villes donnent lieu à multiples interdépendances >>.
Propos recueillis le 18 décembre 2012 par Cédric Polère
Paul Boino est professeur des universités en urbanisme et aménagement, directeur de l’Institut d’Urbanisme de Lyon (Université Lumière Lyon 2) et chercheur à l’UMR 5206 Triangle. Spécialiste de l’intercommunalité, des stratégies métropolitaines et des modes de production des villes occidentales, nous l’interrogeons aujourd’hui sur les enjeux de solidarité pour le Grand Lyon.
Que recouvre pour vous l'idée de solidarité, si on se place dans la perspective d’une communauté urbaine comme celle de Lyon ?
Si la solidarité est le fait d’aider des personnes ou des groupes sociaux en difficulté, la Communauté urbaine est relativement étrangère à ce champ d’action publique. C’était hier une compétence d’Etat. C’est aujourd’hui une compétence essentiellement partagée par l’Etat et les Départements.
Ce n’est pas là toutefois la seule acception du mot solidarité. On peut également l’appréhender au sens d’Émile Durkheim. Il s’agit alors d’une forme de relations sociales permettant la vie collective malgré la prégnance des intérêts particuliers. Nos sociétés modernes sont travaillées par un processus d’individualisation qui nous rend de plus en plus différents les uns des autres. Il nous rend aussi de plus en plus interdépendants. Plus nous sommes individualisés plus notre rôle social est spécialisé et plus nous avons besoin des autres pour nous vêtir, pour nous soigner, pour manger, pour habiter, pour vivre tout simplement. C’est la division sociale du travail au sens strict. Mais le processus d’individualisation ne s’arrête pas à cela. Il tend également à nous rendre de plus en plus étranger les uns aux autres dans nos expériences et nos modes de vie, dans nos manières de voir, de comprendre et d’agir ; de là selon Durkheim la montée en puissance des logiques singulières et des intérêts particuliers. Tout le problème au final est de savoir, toujours selon lui, si nous arrivons à répondre aux nécessités posées par ces interdépendances fonctionnelles, c’est ce qu’il appelle la solidarité organique, ou si nous sommes emportés par la prégnances de nos logiques singulières et de nos intérêts particuliers : c’est ce qu’il désigne sous le terme d’anomie.
Dans cette acception du terme, la solidarité est constitutive du Grand Lyon. Comme la société en générale, sinon plus encore, les villes donnent lieu à multiples interdépendances. Sans architectes, sans maçons ni grutiers il n’y a plus d’appartements dans lesquels habiter. Sans logistique et sans chauffeurs routiers mais aussi sans personne pour poser le goudron de nos rues, et il n’y a plus de magasins achalandés dans lesquels acheter de quoi se nourrir et se vêtir. Sans système de traitement des eaux usés strictement séparé de l’adduction de l’eau potable, et donc sans professionnels des égouts, ni du traitement de l’eau, et c’est le retour du choléra.
On voit à travers ces quelques exemples, que le processus d’individualisation qui organise nos sociétés modernes ne nous rend pas seulement dépendants de quelques professions particulièrement remarquables, de quelques secteurs d’activités particulièrement stratégiques, ou encore de quelques personnalités indispensables. Que nous soyons riches ou pauvres, que nos situations soient valorisées ou non, nous sommes tous et toutes liés dans un système d’interdépendances au sein duquel nous avons à être solidaires sans nécessairement avoir besoin de nous connaître et a fortiori de nous apprécier. On voit également, que ces interdépendances sont prises en charge pour partie seulement par le jeu des acteurs privés : le secteur marchand mais aussi le milieu associatif. Pour autre partie, elles relèvent de différentes institutions publiques : l’État, les communes, les départements, les régions, mais aussi les intercommunalités : le Grand Lyon par exemple.
Nous sommes loin ici d’une solidarité synonyme de redistribution, d’aides sociales…
Oui, dans cette perspective, être solidaire ne se réduit pas à des riches qui aident les pauvres. Cela ne se résume pas non plus à des politiques de redistribution en direction de classes ou des groupes défavorisés, même si ces politiques sont nécessaires d’autant plus dans le contexte actuel. La solidarité dont je parle ici, est un changement de perspective qui conduit à s’interroger d’abord sur les besoins sociaux, ensuite sur ce que prennent en charge les rapports privés qu’ils soient marchands ou non et enfin à ajuster en regard l’action de la puissance publique.
Cette perspective rejoint au fond celle de John Maynard Keynes pour qui la fonction de la puissance publique n’est pas de garantir le fonctionnement illusoirement autorégulé du marché et de s’occuper à l’occasion des plus pauvres. Elle est de réguler les dysfonctionnements inhérents au système capitaliste : prévenir les crises cycliques générées par les calculs à court terme des acteurs économiques mais aussi intervenir dans les secteurs et les territoires insuffisamment investis car considérés comme non rentables. C’est dans cette compréhension des choses que furent menées au cours des trente glorieuses, les politiques de déconcentration industrielles ou encore des métropoles d’équilibre. Il s’agissait de lutter contre ce qu’on appelait la macrocéphalie parisienne et le risque de désert français. C’est à ce titre également que la puissance publique est intervenue tout au long de ces mêmes années pour produire massivement du logement face à une croissance démographique à laquelle le marché immobilier privé ne parvenait pas à répondre. Les investisseurs privés préféraient placer leur argent dans un secteur industriel en pleine croissance.
Peu avant 1969, quand l’État a contraint 56 communes à adhérer à la Communauté urbaine de Lyon, c’est bien parce qu’elles étaient en situation de dépendance réciproque et qu’il semblait opportun qu’une seule instance gère les grands services urbains… Si je suis votre raisonnement, cette interdépendance a placé la Communauté urbaine dans le registre de la solidarité ?
Effectivement. Tout au long du XIXème et du XXème siècle, la ville de Lyon en tant qu’ensemble d’individus et d’activités liés dans un même fonctionnement quotidien, n’a cessé de croître débordant tout d’abord sur la rive gauche du Rhône et le plateau de la Croix-Rousse, puis sur Villeurbanne, Pierre Bénite ou encore Saint Fons, et ensuite de plus en plus loin encore. En regard, le périmètre administratif de la commune de Lyon n’a guère changé. Au milieu du XIXème siècle, un décret impérial a intégré de force les communes de Vaise, de la Guillotière et de la Croix-Rousse. Par la suite, les autres tentatives d’extension du périmètre municipal ont échoué à l’exception d’une seule pour une fois voulue par les deux municipalités concernées : l’intégration de Saint-Rambert L’ile-Barbe au début des années 1960. Pour le reste, rien. Dans les années 1920 par exemple, Lyon avait proposé d’absorber Villeurbanne mais cette dernière s’y était fermement opposée. Ceci ne l’empêcha pas, la décennie suivante, de proposer à son tour de fusionner avec Lyon. Villeurbanne en effet, s’était engagée dans la construction des Grattes ciels mais se trouvait en posture difficile avec l’irruption de la grande crise des années 1930. Ce fut alors la commune de Lyon qui refusa. Édouard Herriot eut cette phrase fameuse : « vous avez des dettes et vous demandez aux lyonnais de les acquitter ».
Au final, la trame communale est restée relativement inchangée alors que la ville a continué se développer. Cet écart croissant entre la réalité territoriale de Lyon et sa transcription administrative a posé des problèmes de plus en plus difficiles de gestion des réseaux et des services urbains ou encore de financement des équipements d’agglomération utilisés par tous mais financés par les seuls habitants de la ville-centre. Rajoutons à cela les problèmes de planification, de maîtrise foncière ou encore de politique du logement et l’on comprend aisément les difficultés engendrées par cet émiettement municipal.
C’est face à ce problème qu’a été inventée la « solution » intercommunale. Elle a démarré dès la fin du XIXème siècle avec la création des syndicats intercommunaux à vocation unique puis s’est étoffée dans les années 1930 avec les syndicats mixtes et enfin à la fin des années 1950 avec les syndicats intercommunaux à vocation multiple. Portées par les communes, ces structures ont permis le développement des services urbains de base (eau, électricité, transports collectifs, etc.) sans remettre en cause l’autonomie municipale : les décisions étaient prises à l’unanimité et leur financement dépendait des subventions qu’acceptaient de leur allouer les communes.
Au tournant des années 1960, l’Etat a tenté toutefois d’impulser une intercommunalité plus intégrée : autonomie budgétaire vis-à-vis des communes via l’instauration d‘une fiscalité propre, compétences élargies, prise de décision à la majorité, etc. Il s’agissait même d’instaurer, à moyen terme, un nouveau rang de collectivités locales avec élection au suffrage universel direct de son personnel politique. Le préfet du Rhône a ainsi cherché à imposer la création d’un district urbain mais cette tentative s’est soldée par un échec. Pour y échapper, les élus locaux ont constitué un simple syndicat à vocation multiple. Il a donc fallu attendre la loi de 1966 pour qu’une structure de coopération intercommunale intégrée soit purement et simplement imposée par le législateur (et non pas le seul préfet) : ce fut la Communauté urbaine.
Pouvez-vous préciser comment la Communauté urbaine concevait son rôle et si les choses ont changé depuis ?
Quoi que plus intégrée qu’un simple SIVOM et a fortiori qu’un SIVU, il est commun de considérer que la Communauté urbaine était alors une intercommunalité de gestion et qu’elle le resta tout au long des années 1970-80. Sa fonction centrale était d’assurer la reproduction sociale : en soi la lutte contre les incendies, le logement social, l’eau, les grands équipements et les infrastructures de transport, etc., en d’autres termes l’essentiel des fonctions qui assurent le fonctionnement sans doute banal mais néanmoins vital de la ville. Cette fonction était politiquement assumée par la plupart des élus, des techniciens et de la population sans que cela fasse grand débat : ça allait de soi.
La bascule s’est opérée au tournant des années 1980. Elle procède pour partie de la promulgation d’un nouveau cadre juridique (loi ATR de 1992, puis loi Chevènement de 1999), pour autre partie de l’action même des élus locaux. La Communauté urbaine a été en l’occurrence, de plus en plus positionnée en intercommunalité de projet en opposition explicite avec l’ancienne intercommunalité qualifiée de gestion.
Contrairement à ce que ce changement de qualificatif suggère, le rôle qui lui a été assigné, n’a pas été tant de refonder l’action communautaire sur un projet de territoire collectif, transversal et pour tout dire politique. Il a été aussi, si ce n’est surtout, d’œuvrer pour accroître la richesse d’ensemble du territoire par la captation d’activités et de ménages mobiles. Le tropisme du développement économique exogène, de l’attractivité, du positionnement international était lancé. Les objectifs de voir figurer la ville dans le top ten ou le top quinze des villes européennes, de développer le marketing territorial, de favoriser l’innovation et l’accueil d’entreprises de hautes technologies se sont rapidement imposés. En corolaire, la figure de l’édile gestionnaire s’est effacée au profit de celle de l’édile entrepreneur. Ce changement de posture s’est formalisé avec l’élection de Michel Noir en 1989. Elle est depuis globalement assumée aussi bien par la sphère des élus que par celle des techniciens ou du moins de leur haut encadrement mais aussi par une bonne part de la population : cette nouvelle doxa va de soi comme hier allait de soi le référentiel keynésien.
Sur le plan des réalisations, comment ce tournant s’est-il traduit ?
Inconnues dans la période précédente (les premiers services de développement économique municipaux ne se développent en France qu’à la fin des années 1970), des politiques de développement économique de plus en plus étoffées ont été mises en place. Au cours des 1990-2000, un effort substantiel a été consacré à accroître la capacité d’accueil économique de la ville : Cité internationale, extension d’Eurexpo, parc technologique de Gerland, Vaise industrie, sans oublier la reprise du développement de la Part Dieu. Des actions ont aussi été menées sur les infrastructures de transport dans le but de faciliter les déplacements locaux mais aussi, et toujours très explicitement, pour renforcer l’accessibilité de Lyon et son intégration au système-monde : ouverture d’une gare TGV, extension de l’aéroport de Saint Exupéry, etc. À cela sont à rajouter des investissements importants pour améliorer l’environnement qualitatif des entreprises (le lycée international de Lyon par exemple) ainsi que les relations entre les institutions publiques et le monde économique (schéma de développement économique sous Raymond Barre, Grand Lyon l’Esprit d’Entreprise sous Gérard Collomb, plan technopôle puis Lyon métropole innovante, …).
En parallèle de multiples actions ont été conduites pour mettre en valeur la ville. Il s’est agi d’améliorer le cadre de vie des habitants mais aussi et à nouveau très explicitement de renforcer l’attractivité de la cité : plan bleu, plan vert, plan lumière, plan presqu’île, palette des couleurs, réfections des espaces publics ou encore des entrées de ville (à Gerland ou à Mermoz par exemple), requalification des quartiers dégradés d’abord anciens (Presqu’île, pentes de la Croix-Rousse, Confluence, etc.) et désormais contemporains (rénovation des quartiers d’habitat social), mise en valeur du patrimoine architecturale et urbain (Tony Garnier, Gratte-ciel, périmètre UNESCO), etc. Il s’est agit enfin de tout un ensemble d’actions visant à agir sur l’animation de la ville pour la qualité de vie de ses habitants sans doute mais aussi, encore et toujours, pour améliorer la notoriété de la cité, la fréquentation touristique et l’attractivité globale de la ville : biennales de la danse et de l’art contemporain, fête des lumières, festival Lumière, ...
En définitive, ce repositionnement a conduit non pas à l’abandon des anciennes missions de la Communauté urbaine mais à une nouvelle hiérarchisation des priorités. Désormais ce qui a été mis en avant c’est la place de Lyon dans la compétition internationale et le développement économique et non plus la gestion technique de l’agglomération. À un autre niveau, ce nouveau positionnement a généré aussi quelques déclarations tendant à reconsidérer la répartition des tâches entre les différents niveaux de collectivités locales. Pour faire simple, le développement économique c’est avant tout le rôle de la Communauté urbaine et non pas celui de la Région ; le développement social, c’est-à-dire le caritatif, c’est le Département.
Quels sont les soubassements théoriques de ces conceptions axées sur le développement économique et la compétition internationale des territoires ?
Plusieurs modèles structurent cette pensée. On peut citer la théorie des avantages comparatifs de David Ricardo : dans une économie ouverte, les territoires ont intérêt à se spécialiser dans les domaines où ils détiennent les avantages comparatifs les plus significatifs. Ils doivent les améliorer afin de renforcer leurs échanges avec l’extérieur et ainsi conforter leur situation relative. Le deuxième modèle est celui de Homer Hoyt : seules les activités exportatrices, c’est-à-dire générant un échange monétaire avec l’extérieur (industrie, tourisme, services aux entreprises, etc.) sont en capacité de faire varier la richesse d’un territoire donné. Les activités fondées sur des échanges internes au territoire (le commerce de proximité par exemple) sont par nature un jeu à somme nulle pour le dit territoire. Il faut donc augmenter les activités exportatrices si l’on veut augmenter la richesse globale du territoire et incidemment aussi accroître les ressources des collectivités locales, via la fiscalité locale. Le troisième modèle est la trickle down theory : à travers la consommation et les salaires, la richesse captée par un territoire se redistribue à l’ensemble du corps social sur un principe de ruissellement ou de propagation. Le quatrième modèle est la théorie du cycle de vie du produit de Raymond Vernon : les activités innovantes naissent et se développent dans les métropoles car ces territoires sont dotés de main d’œuvre certes chères mais qualifiées, de biens collectifs de haut niveau, etc. Ces activités se standardisent toutefois avec le temps et tendent alors à se délocaliser vers des territoires dotés d’une main d’œuvre moins qualifiée mais aussi moins chère. Les villes comme Lyon doivent donc raisonnablement se centrer sur l’innovation et les activités complexes. Le dernier modèle enfin, que l’on peut citer, est celui de Joseph Schumpeter et sa théorie de la destruction créatrice d’emplois : les villes sont constamment soumises à un processus de destruction d’emplois car les anciennes activités se délocalisent mais aussi par un processus de création de nouveaux emplois grâce au développement de nouvelles activités. En conséquence, il est inévitable de perdre certains types d’activité. Il vaut mieux consacrer son énergie (et l’argent public) à en développer de nouvelles.
La grille d’analyse qui résulte de ces grands modèles théoriques a nourri l’idée selon laquelle l’avenir d’un pays comme la France est nécessairement le tertiaire et qu’il ne servait à rien de se battre pour maintenir de l’industrie. Dans les villes, elle a également alimenté la conviction selon laquelle la puissance publique locale doit agir pour renforcer les capacités d’innovations locales, attirer à elles des activités à haute teneur technologique comme les NTIC et les biotechnologies ou encore ces hypothétiques classes créatives, mais aussi développer le tourisme à commencer par le tourisme d’affaire.
Comment ces théories deviennent-elles de l’action publique ?
C’est une question plus complexe qu’il n’y paraît. Peut être devrait-on inverser la proposition : comme cette action publique génère-t-elle ces théories ? La question que vous posez renvoie en effet au vieux débat du XIXème siècle sur les rapports entre pensée et action : les idées déterminent-elles les conduites comme le prétendait Hegel par exemple, ou leur donnent elles un sens plus ou moins fondé, plus ou moins factice, comme le soutenait Marx ou Bakounine notamment ?
Sans prétendre épuiser le débat, disons qu’il me semble pour ma part que la concomitance entre mondialisation, décentralisation et montée en puissance de ces théories n’est pas fortuite. Depuis les lois Defferre, ce sont essentiellement les collectivités locales qui ont à administrer les territoires or il faut pour cela de l’argent, beaucoup d’argent. Dans un contexte où les transferts d’État sont insuffisants, la solution qui s’impose est d’attirer des entreprises et des ménages qui contribueront via la fiscalité locale à accroître les ressources budgétaires des dites institutions locales. Se construit ainsi un marché concurrentiel des territoires structuré non pas seulement par la conduite des entreprises et des ménages mais aussi par les pratiques des institutions publiques qui ont en charge ces territoires. Les modèles dont je parlais, donnent avant tout un sens logique, rationnel à ces conduites. Je ne suis pas certain qu’elles les déterminent nécessairement à l’avance. Nul n’est besoin d’être un libéral convaincu pour développer ce type de stratégie effectivement libérale : nécessité fait loi.
Vous défendez l’idée que le tropisme économique est désormais très important. Est-ce à dire que la priorité n’est plus celle de servir les habitants ?
Non, cette mission fondatrice de la Communauté urbaine comme de l’ensemble des administrations publiques est toujours là. Ce tropisme économique désigne simplement cette volonté constatable, et assumée du reste, de soutenir toujours et encore l’attractivité de la ville, son internationalisation au sens d’améliorer sa position dans la compétition des territoires non pas seulement mais notamment pour accroître les rentrées fiscales. En principe, il s’agit là d’un moyen pour être en mesure justement de continuer à mettre en œuvre les politiques dont les habitants ont besoin. Pour autant, ce tropisme économique n’est pas qu’un mode de faire vide de conséquence, un passage certes obligé mais accessoire. Il a des effets substantiels sur les institutions publiques et les politiques qu’elles conduisent.
Il est à même de créer des tensions. Valorisant l’internationalisation, l’économique et les services qui s’en chargent, il tend à considérer les services urbains et de fait ceux qui les gèrent comme une forme un peu surannée d’intercommunalité – « intercommunalités de tuyaux », « intercommunalité de moyens », les qualificatifs plus ou moins péjoratifs ne manquent pas – de la même manière que dans certaines entreprises sont mises en avant les commerciaux par rapport aux services de production en oubliant un peu vite que sans la production les commerciaux n’auraient strictement rien à vendre. Les conséquences inévitables sont la sensation pour les employés de la collectivité qui gèrent ces services, ces équipements, ces infrastructures sans doute basiques mais qui assurent néanmoins le fonctionnement quotidien de la métropole, de subir une perte d’intérêt de leurs élus et du haut encadrement ou à tout le moins d’être désormais « pris de haut ». Ce tropisme économique peut également générer une certaine incompréhension dans les populations. Elles peuvent à l’occasion avoir l’impression que l’on se soucie davantage des grandes entreprises et du patronat, que de leurs besoins de proximité quotidiens : ces éternelles plaques d’égouts mal calées et autres propreté des trottoirs que les habitants ne manquent pas d’évoquer à chaque réunion publique et que l’on peut avoir tendance à dénigrer un peu vite face aux enjeux forcément plus importants du développement économique international.
Ce tropisme économique est-il susceptible de provoquer dans certains cas une réorientation de l’action publique ?
Oui, les politiques universitaires en constituent un bon exemple. En la matière, le Grand Lyon n’a aucune obligation légale. C’est au titre de la clause générale de compétences que les communes (comme la Région et le Département du reste) peuvent s’en saisir quitte à la déléguer ou à associer ensuite leur intercommunalité. Historiquement, c’est ce qui s’est passé. La commune de Lyon a soutenu les universités depuis leur création. C’est elle qui a construit les premiers bâtiments de l’Université de Lyon sur les berges du Rhône à la fin du XIXème siècle. Sur la période récente, la ville de Lyon a également permis l’installation de structures universitaires sur le Carré Berthelot (IEP, ISH et IUL). Le Grand Lyon de son côté a joué un rôle majeur dans la réhabilitation de la Manufacture des Tabacs dévolue à Lyon 3 ou encore la construction de l’ENS LSH à Gerland. Au cours des années 1990-2000, la puissance publique locale (commune de Lyon et communauté urbaine) s’autorisait ainsi à soutenir l’ensemble des activités universitaires : la formation, les bibliothèques, le logement étudiant, les bâtiments de recherche, parfois l’une ou l’autre de ces activités, parfois la totalité. Depuis quelques années, les choses ont changé. La commune de Lyon tout comme la communauté précisent désormais que leur compétence en la matière se limite au rayonnement international et à la recherche. En parallèle, les personnels communautaires qui s’occupent des universités ne sont plus rattachés à la direction générale du développement urbain, mais à la direction générale du développement économique et international. C’est le droit le plus strict de ces institutions de réorienter leur politique. Il n’en demeure pas moins qu’on ne peut être plus éloquent en matière de tropisme économique.
Ce tropisme peut-il aussi avoir pour effet de conduire à une certaine reformulation de l’action publique ?
C’est le cas de figure le plus courant. On le voit par exemple avec la politique des espaces publics. Issue du développement social des quartiers, elle a démarré dans les années 1980 comme un droit pour l’ensemble des habitants de la communauté à disposer d’espaces publics de qualité et cela qu’ils habitent dans le centre ou en banlieue. Ce premier objectif très local n’a pas été abandonné par la suite, mais la décennie suivante on a assigné un second objectif à cette politique : la mise en valeur de la ville afin d’en changer l’image et de la rendre plus attractive. Cet horizon économique fut explicitement énoncé par Michel Noir lors du lancement de son plan Presqu’île. On pourrait prendre également en exemple la politique touristique qui a démarré globalement sous Raymond Barre avec comme clientèle visée le monde professionnel, d’où les efforts pour développer l’hôtellerie de luxe, les salles de congrès mais aussi un casino à la Cité internationale. Le tourisme d’agrément n’est arrivé qu’ensuite en complément de ce tourisme d’affaire : il faut bien remplir les hôtels le weekend. On pourrait encore prendre en exemple les politiques culturelles. S’il s’agissait uniquement de répondre aux demandes locales les plus massives, on aurait soutenu le rock et le rap pour les jeunes, sans doute aussi un festival d’opérettes pour les plus âgés mais assurément pas la danse contemporaine ou l’art contemporain. À nouveau, il ne s’agit pas de dire ici que le Grand Lyon n’a pas le droit ou la légitimité ou bien encore tort de faire ces choix. Ces exemples soulignent simplement que les visées économiques ne sont désormais jamais bien loin, même si ce ne sont pas les seuls objectifs poursuivis.
La conception selon laquelle il faut avant toute chose accroitre les avantages comparatifs de la ville est-elle partagée par tous les élus ?
Il y a forcément des différences entre élus comme entre techniciens ou habitants d’ailleurs. Si tout le monde est soumis à la contrainte de maintenir et même d’accroitre les ressources fiscales, certains la mettent plus en avant que d’autres, au risque de transformer ce qui devrait rester une quête de moyens, en finalité en soi ; au risque également, je pense, de commettre parfois certaines erreurs de raisonnement.
Pourriez-vous expliciter ce que peuvent être ces erreurs de raisonnement ?
Elles découlent globalement d’une lecture un peu scolaire des modèles dont j’ai parlé précédemment. Ces théories sont des réductions forcément biaisées du réel : c’est inévitable. Elles ont été aussi maintes fois remises en cause tant au plan théorique qu’au niveau empirique, ce qui est moins pris en considération et de fait dommageable. Pour ne prendre qu’un exemple, celui de la Trickle down theory, ce modèle semble aller de soi, sauf que tout dépend du degré de polarisation des richesses à diffuser et donc du type d’activités qui les produisent et de la structure d’emplois qui les sous-tendent. Pour aller à l’essentiel, si vous avez réussi à attirer un million d’euros en un mois sur votre territoire mais que ce million est détenu par une seule personne, alors le degré de percolation dans l’ensemble de l’économie locale sera faible : la personne en question consommera localement une part marginale de cette somme, elle placera le reste et ce reste sera investi ailleurs. Conclusion : la richesse captée par le territoire est sans doute d’un million, mais sa diffusion dans le corps social est largement moindre. Si vous prenez maintenant cette même somme, mais en la répartissant sur un million d’individus la situation est radicalement différente. Chacun ne disposera que d’un euro supplémentaire ce qui lui permettra d’acheter par exemple une baguette de pain. C’est peu au niveau des individus mais cela signifie à l’échelle du territoire que ce million d’euro aura été entièrement consommé localement : il sera entièrement diffusé dans le territoire.
Auriez-vous un exemple concret ?
On peut reprendre les politiques universitaires. Si l’on se fie aux théories économiques précédentes, il convient en toute logique de focaliser l’action publique sur la recherche et plus globalement le rayonnement international des universités. Cela conduit toutefois à minorer l’importance des étudiants et de l’ensemble des personnels universitaires dans l’économie locale (logement, consommation, etc.). L’université de Strasbourg est par exemple le troisième employeur de cette agglomération ; combien l’université de Lyon est-elle ? Cela conduit également à ne pas comprendre correctement sur quoi se fonde le dynamisme des universités. Pour faire simple, sans étudiants, plus de postes d’enseignant-chercheur et donc plus de recherche. Or les étudiants sont de plus en plus mobiles et ils choisissent leur université en fonction de la qualité des formations mais aussi du cadre de vie mis à leur disposition. Or les enseignants-chercheurs sont mobiles également et ils choisissent leur université en fonction de la qualité de leur centre de recherche, c’est certain, mais aussi du niveau des étudiants à qui ils auront à enseigner et de leur environnement de travail plus global : centre ville ou banlieue, facilité d’accès ou lignes de transport saturées, locaux agréables ou préfabriqués plantés sur un parking, logement hors de prix ou abordable, … Il n’y a qu’à voir les difficultés sensibles de recrutement dont se plaignent certains établissements de la région parisienne, du moins ceux qui ne sont pas en situation de monopole (type l’ENS de la rue d’ULM ou l’École des Ponts). Travailler en grande périphérie dans un environnement plus ou moins baroque ou en centre ville dans des locaux plus ou moins inadaptés, plus ou moins délabrés, payer dans tous les cas un surcoût de loyer substantiel et voir de plus son temps de déplacement quotidien multiplié par deux en moyenne n’est pas forcément très attractif d’autant plus avec un salaire qui reste quant à lui identique au reste de la France. À l’inverse, il n’y a qu’à visiter les sites internet des plus grandes universités mondiales, Oxford, Yale, Stanford, Harvard, … pour constater combien ces établissements mettent en avant la qualité de leur recherche mais aussi de leurs formations et plus encore de leur environnement urbain (il est généralement présenté dès leur page d’accueil) pour attirer les étudiants et les enseignants-chercheurs. En conclusion, il ne s’agit pas de dire que la recherche ne doit pas être soutenue par les pouvoirs publics locaux et a fortiori qu’elle ne constitue pas un élément essentiel des universités mais que l’opposer ou le faire au détriment de la formation et de l’environnement global des universités ne peut conduire qu’à une impasse.
Quels sont les enjeux de solidarité pour le Grand Lyon demain ?
Ils perpétuent pour partie les défis qu’il a fallu relever hier : la solidarité entre le centre qui assume l’essentiel des charges d’agglomération et la périphérie. La ville en tant qu’ensemble de populations et d’activités continue à s’étendre alors que le périmètre du Grand Lyon reste globalement stable. Dès lors, comment déployer les réseaux, les équipements et les infrastructures nécessaires ? Pour ne prendre qu’un exemple celui des transports en commun, faut-il étendre le réseau mais comment financer le coût que cela représente ? Doit-on mettre en place des conventions qui permettraient que les nouveaux territoires desservis payent le service auxquels ils ont désormais accès, mais que fait-on des territoires qui ont besoin de ces transports collectifs tout en étant trop pauvres pour financer le service rendu par des conventions et donc à son prix réel ? Doit-on plutôt élargir le Grand Lyon, ce qui permettrait que tout le monde ait accès aux transports en commun mais en les finançant, via la fiscalité, et donc à la mesure des moyens dont chacun dispose ? Comment faire cependant quand les collectivités voisines, notamment les plus riches, refusent cette extension ? Doit-on par ailleurs accepter une extension à la carte, qui pour les transports, qui en matière d’adductions d’eau ou plutôt promouvoir des extensions intégrées (c’est l’entrée dans la Communauté urbaine ou rien) ? La double question du financement des services et des équipements d’agglomération et de leur déploiement à l’échelle où l’on en a besoin reste ainsi clairement d’actualité.
Pour autre partie, il s’agit d’enjeux plus contemporains.
Comment les formuleriez vous ?
Au plan territorial notamment, comment allouer les moyens là où se trouvent les besoins ? Historiquement, ceci ne posait pas beaucoup de difficultés. Les territoires budgétairement riches étaient aussi les territoires socialement pauvres. Industriels et ouvriers, ils disposaient de ressources plus importantes mais devaient supporter des charges plus fortes du fait des besoins en services publics et en services sociaux de leurs administrés. À l’inverse, d’autres territoires plus résidentiels étaient sans doute riches socialement mais ils étaient pauvres budgétairement, car ils n’accueillaient pas beaucoup d’entreprises. Là aussi, il n’y avait pas de problème en soi : les inégalités territoriales généraient de la justice sociale ; les moyens se situaient là où étaient les besoins. La situation actuelle est sensiblement différente. Certains territoires se retrouvent tout à la fois socialement et budgétairement pauvres tandis que d’autres sont simultanément riches de leur population et de leurs entreprises. Dans ce schéma général, le Grand Lyon est en situation médiane. Au plan budgétaire, la Communauté urbaine ne s’en sort pas trop mal tandis que sa population reste relativement variée. Si on change d’échelle, la situation est cependant tout autre comme le montre par exemple la situation du Sud Loire. Se pose ici un problème de solidarité financière entre territoires riches et territoires pauvres qui ne se résout pas par la mise en place du pôle métropolitain. En l’état, la seule solution est l’extension du Grand Lyon comme cela s’est fait avec Givors et Grigny mais pour qu’elle soit viable, il faut évidemment que ce ne soit pas seulement les territoires pauvres qui entrent dans la Communauté urbaine.
Un autre défi de taille me semble être le droit à la ville, que menace clairement la montée des prix immobiliers tant à la location, qu’à l’achat. Elle pénalise de plus en plus durement les moins riches. Elle a aussi et plus globalement un effet délétère au plan économique en détournant de la consommation (et donc de l’économie productive) une part substantielle du budget des ménages au profit d’une rente foncière qui ne produit rien et n’emploie personne. Elle alimente enfin la périurbanisation et son cortège de mitage foncier, d’artificialisation des sols et de déplacements automobiles inévitablement polluants, vis-à-vis de laquelle on essaie vainement de lutter depuis vingt ans et plus. Face à cette inflation qui n’est pas le propre de Lyon mais qui est en revanche relativement spécifique à la France, le Grand Lyon, comme d’autres institutions locales mène une politique de production de logement social. Le budget que la Communauté est en mesure d’allouer à cette politique, quelques dizaines de millions d’euro, est cependant insuffisant pour enrayer ce cercle vicieux. Peut-elle faire plus ? Sans doute un peu plus, toujours un peu plus, mais cela restera insuffisant pour changer substantiellement la donne. Il y a là un défi auquel est clairement confrontée la Communauté urbaine, mais dont les clés lui échappent en bonne part. Elles sont dans les mains des pouvoirs publics nationaux car le problème découle avant tout de politiques publiques nationales.
Un dernier grand défi pour conclure, et non des moindres, est à mon sens celui de la démocratie locale.
Vous voulez parler de la légitimité politique de la Communauté urbaine et de ses actions ?
Pas seulement. Le fait que cette institution ne soit pas élue au suffrage universel direct pose assurément un problème de fond : la règle en vigueur dans les démocraties est que toute institution qui prélève l’impôt se doit d’être soumise au suffrage des électeurs afin que les citoyens puissent exercer leur contrôle et déléguer en connaissance de cause leur souveraineté. Les intercommunalités françaises à fiscalité propre dérogent à cette règle ce qui, disons-le, ne constitue pas une avancée du moins si l’on considère la démocratisation comme un progrès.
Le défi démocratique dont je parle est aussi celui de la capacité d’arbitrage et donc de régulation de la Communauté : un enjeu que ne résoudra pas à mon sens la future réforme, du moins telle qu’elle est annoncée à ce jour. Le simple fléchage des conseillers communautaires lors des élections municipales ne fait que légaliser ce qui se pratique déjà : les têtes de liste aux élections municipales sont destinées à siéger au conseil communautaire. Cela ne changera pas le problème fondamental auxquels sont confrontés les conseillers communautaires : celui de représenter et de défendre les intérêts de leur commune (ce sont les municipalités qui les nomment au conseil communautaire) et dans le même temps de penser, d’agir et de défendre les intérêts de la communauté. Parfois les deux logiques vont de pair, parfois non. Malheureusement les conflits d’intérêts portent bien souvent sur les sujets brûlants comme l’accueil du logement social ou des infrastructures dont tout le monde à besoin mais que personne ne veut chez soi. Ces sujets nécessitent des arbitrages : une capacité que les communautés n’ont pas entièrement et dans tous les cas insuffisamment.
La dernière facette du défi démocratique attente enfin à l’efficience des politiques publiques locales. Elle a trait à la délibération contradictoire des choix publics.
Quel est le lien entre délibération et efficience de l’action publique ?
La Communauté urbaine, comme du reste la plupart des intercommunalités françaises, fonde son fonctionnement sur un mode essentiellement consensuel : exécutif regroupant des élus de gauche et de droite, prise de décision à des majorités très élevées voire à la quasi unanimité (voire à ce propos les scores obtenus lors de l’élection des vice-présidents). De prime abord, ceci peut être considéré comme un signe de maturité politique, qui contraste heureusement avec ce que l’on peut voir au niveau national et son jeu d’affrontement systématique entre opposition et majorité. Pour caricatural qu’il soit parfois, cet affrontement partisan a cependant des vertus : il permet une plus grande délibération des choix publics et en cela améliore la conception des politiques publiques. Le rôle social de l’opposition est en effet de surveiller en continu ce que fait la majorité, de la critiquer avec le risque toutefois de perdre en crédibilité si la critique est infondée et d’informer, voire d’alerter tout aussi continuellement l’opinion publique, ce qui lui permet a minima d’exister. À défaut de jouer efficacement ce rôle d’opposant elle ne peut guère espérer gagner les élections. En regard, la majorité ne peut pas ignorer les arguments de l’opposition. Sous le regard de l’opinion publique, titillée par des médias qui se nourrissent de ces polémiques, elle doit justifier ses décisions non pas tous les six ans au moment des élections mais en continu.
Ce système partisan pour pénible et désespérant qu’il puisse paraître a finalement un effet sur les politiques publiques : il produit des arènes de controverses dans lesquels les choix publics sont discutés de manière contradictoire. Au mieux, ils sont modifiés car telle ou telle question ou aspect du problème auquel la majorité n’a pas pensé, a été énoncé, argumenté et retenu au final comme étant pertinent (au plan social, économique, territorial, de santé publique …). Au pire, l’opinion publique est informée et peut le moment venu exercer son contrôle en réélisant ou non l’ancienne majorité. Ce véritable mécanisme social n’implique aucunement que les acteurs en jeu se défassent de leurs logiques, de leurs sensibilités, de leurs finalités propres. Il s’en nourrit au contraire. C’est en cela aussi que le pluralisme démocratique supplante l’apparente simplicité du pouvoir d’un seul : il est non seulement plus respectueux des individus, de leurs besoins, de leurs idées, de leurs situations ; il n’oppose pas mais au contraire concilie individus et société mais il est aussi beaucoup plus efficace dans le temps.
De fait, nos intercommunalités (le Grand Lyon comme les autres) manquent de telles arènes de controverse au sein desquelles une délibération contradictoire des choix publics peut se déployer. Ceci a des conséquences inévitables sur la qualité des choix publics : leur pertinence (la solution choisie est-elle la plus adaptée pour régler le problème visé ou correspond-elle à ce que l’institution sait déjà faire ?), leur pondération (le meilleur des techniciens ou le plus engagé des élus est-il en mesure à lui seul d’apprécier correctement la totalité des conséquences produites par ses décisions ou sa rationalité est-elle nécessairement limitée ?), leur hiérarchisation (qu’est-ce qui est prioritaire ?) et pour tout dire sur leur efficience. Cela a aussi des effets sur le rapport que les uns et les autres, habitants mais aussi communes, entretiennent avec la Communauté urbaine. Elle tend à être perçue comme un prestataire de service sommé de répondre aux attentes singulières de chacun plutôt que comme un espace pluraliste au sein duquel une collectivité définit ses priorités, les met en œuvre et en d’autres termes s’institue en société.
À l’échelle lyonnaise, ces mécanismes ne sont-ils pas assurés par d’autres biais comme les différents dispositifs de concertation et de débat public qui ont été mis en place ces dernières années ?
Non. Ces dispositifs nombreux (conseil de développement, conseils de quartier, concertation autour des projets d’aménagement, etc.) ont leur utilité propre, notamment celui d’améliorer substantiellement le degré d’information de la population. Mais ils reposent sur des mécanismes très différents : la diffusion d’une information préparée par l’institution et donc essentiellement univoque, le dépassement des logiques singulières de chacun des participants et l’obtention in fine d’un relatif consensus. Une bonne réunion de concertation comme une bonne séance de conseil de quartier, c’est quand le débat se passe calmement et donc sans que le topo initial présenté par les institutionnels ne soit trop attaqué, que les habitants présents veulent bien arrêter de parler de leur plaque d’égout et fassent l’effort de raisonner comme les institutionnels et qu’à la fin tout le monde tombe d’accord. Non ? Dans tous les cas, ceci ne remplace pas, ni ne compense ce que sont et ce que produisent les arènes de controverses.

Les métiers du prendre soin souffrent d'un fort turnover. Pourtant, les facteurs d'engagement dans ces métiers très humains ne manquent pas. Alors, que se passe-t-il ?
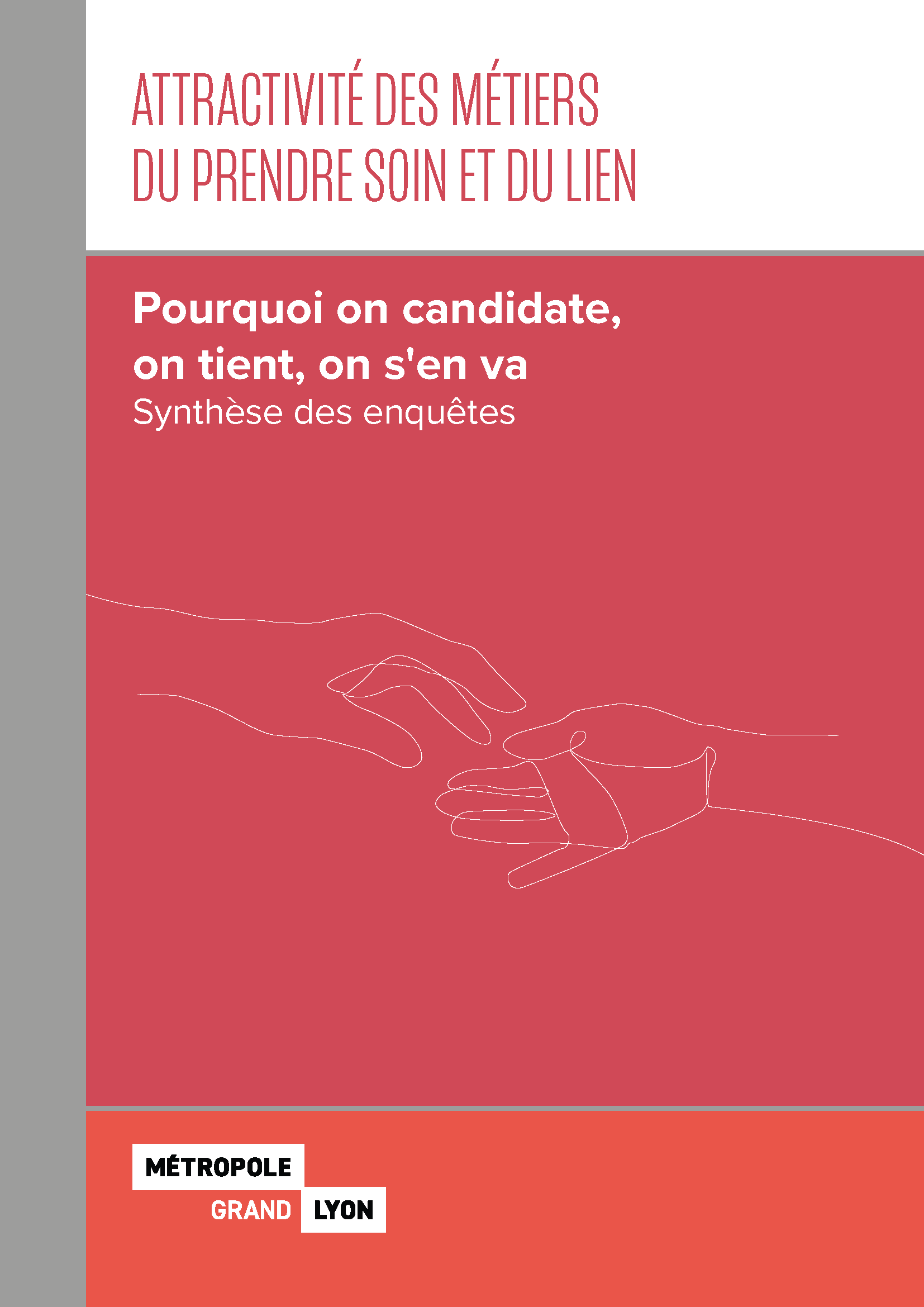
Étude
Comment expliquer le manque d'attractivité des métiers du prendre soin ? pourquoi on candidate, on tient, on s’en va ? Retrouvez la synthèse des enseignements des différentes enquêtes conduites sur ces questions.

Article
Cheminer vers la sobriété : L’altruisme est-il le balancier nécessaire à cette démarche de funambule ? « Pas si simple », répond la mathématicienne Ariadna Fossas Tenas

Article
En 2022, la loi bioéthique ouvrait le don du sang aux homosexuels dans les mêmes conditions aux hétérosexuels. En matière de sentiment d’appartenance à une catégorie sociale, que nous apprennent les controverses qui ont abouti à cette évolution ?

Interview de Elies Ben Azib
Directeur du Centre social La Garde à Marseille
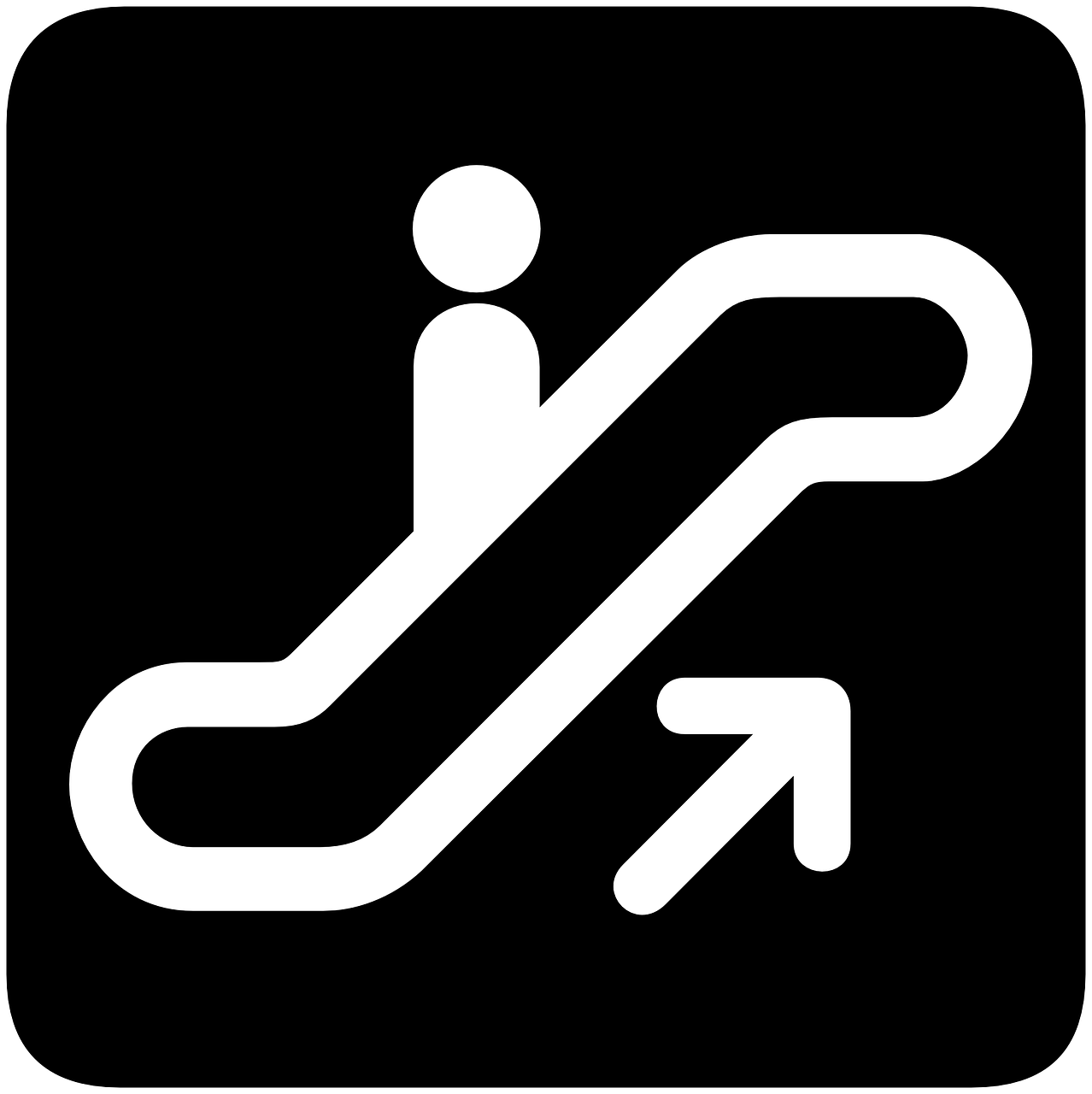
Texte d'Emmanuelle Santelli
Dans le cadre d’une étude effectuée par le Groupe de Recherche sur la Socialisation, (UMR 5040 CNRS, Lyon II), Emmanuelle Santelli étudie les parcours des populations d’origine maghrébine dans une perspective intergénérationnelle : comment se construisent les trajectoires professionnelles en référence aux parcours des parents.
Ce texte s’appuie sur une enquête effectuée sur les descendants d’immigrés algériens qui ont eu des parcours réussis.
Texte de Patrice RAYMOND
Un point de vue critique du système de péréquation redistributive des recettes des collectivités.

Interview de Diane Dupré La Tour
Co-fondatrice des Petites Cantines

Article
Investigations théoriques et pratiques sur l'exclusion dans la ville, par le laboratoire de recherche et création LALCA.