Veille M3 / À la nuit tombée, qui seront les vampires de l’Anthropocène ?

Article
Dans un monde qui se réenchanterait pour mieux se réconcilier avec le non-humain, que nous dirait-il de nos anomies actuelles ?
Interview de Michel SERRES

<< Cette société doit changer. [?] Elle a connu une bataille formidable entre la ville et la campagne et il faut que, là aussi, ce soit la paix >>.
Michel Serres est né en 1930 à Agen (Lot-et-Garonne). En 1952, après 3 années à l’École navale de Brest, il entre à l’École normale supérieure de la rue d’Ulm, à Paris. Agrégé de philosophie, il soutient sa thèse de doctorat sur Leibniz (Le système de Leibniz et ses modèles mathématiques, PUF, Paris, 1968), puis enseigne la philosophie à Paris I et Stanford University. Philosophe des sciences, Michel Serres creuse avec constance le sillon d’une prise de conscience planétaire en alertant sur les mutations inédites que connaît notre monde.
Repenser les rapports de l’homme à son monde, c’est tenir compte de la transformation d’au moins deux ordres de relations : le premier avec notre environnement, le second avec la connaissance.
Environnement : comme si nous étions au centre et premiers, et la nature autour et seconde. Ainsi rappelle Michel Serres, le mot lui-même dit beaucoup du biais qui fausse le lien que nous entretenons avec le monde. Repenser le rapport de l’homme à la nature nécessite de revoir notre place vis-à-vis d’elle. C’est rompre avec le projet cartésien qui affirme et promeut la toute-puissance du sujet sur l’objet, c’est, après le Contrat social, fonder un Contrat naturel qui installerait la nature comme partenaire et l’instaurerait comme sujet de droit.
Une transformation en profondeur à laquelle nous appelle Michel Serres. Maintenant. Le second ordre de relations à prendre en compte pour repenser notre rapport au monde est celui de la puissance qu’offre le savoir. Il s’agit alors de décrypter, comprendre et s’adapter aux bouleversements technologiques qui vont croissant depuis le début du XXe siècle. En penseur de la science, Michel Serres rappelle la nécessité de l’éthique pour éviter que cette science ne se transforme en un outil d’asservissement, voire de mort. Avec l’histoire de Petite Poucette, fille des technologies numériques, Michel Serres nous invite à mesurer toute l’étendue du changement qui s’ouvre aux nouvelles générations. Maintenant, « maintenant » le monde, Petite Poucette annonce une ère nouvelle qui ne pourra certainement pas aller sans transformations morales et politiques. Que ce soit dans notre rapport à la nature ou notre rapport au monde, Michel Serres nous invite ici à plus de sagesse, cet état de la pensée où se conjuguent savoir et philosophie.
En 1990 paraissait Le contrat naturel (François Bourin, Paris). Il représente une contribution majeure au renouvellement de la manière de penser les relations de l’homme à la nature. Dans cet essai vous décriviez des relations très violentes entre l’homme et la Terre, usant du vocabulaire de la guerre et appelant à un contrat d’armistice. 22 ans après, quel constat faites-vous ? L’armistice est-il signé ?
Bien sûr que non. L’écologie est devenue le plus souvent une publicité, une image que se donnent des entreprises, un logo. Il est très rare que les gens fassent vraiment du développement durable. On en parle, c’est devenu un sujet de conversation, mais c’est loin d’être réalisé.
Pouvez-vous revenir sur la notion de « contrat naturel » qui était au cœur de l’ouvrage ? Faut-il le comprendre comme une fiction, un « contrat virtuel », à l’image du « contrat social » auquel les contractualistes du 18e siècle faisaient remonter la sortie de l’état de nature, ou faut-il lui accorder un sens plus littéral et juridique ?
Je crois les deux. C’est un concept philosophique, d’abord, comme l’était celui de Rousseau. Personne n’a jamais signé véritablement de contrat social, mais il est la condition de possibilité d’une société plus juste. Le contrat naturel possède cette dimension tout en ayant également un aspect plus littéral et juridique. C’est même un livre de droit. Au début de ma réflexion, je m’étais d’ailleurs posé la question de l’histoire de l’évolution des personnes qui sont devenues des sujets de droit. Si l’on prend cette question avec assez de recul, on constate des transformations importantes. Qui était sujet de droit dans la haute antiquité ? Les adultes mâles. Pas les femmes, ni les enfants ou les étrangers, et encore moins les esclaves. A prendre l’histoire très lente de qui devient sujet de droit, on s’aperçoit que peu à peu, jusqu’à la Déclaration universelle des droits de l’homme, tout homme quels que soient son sexe et sa nationalité, devient sujet de droit. Par conséquent, entre le Ve siècle avant JC et les années 1945/47, il y a une longue histoire dans laquelle des personnes humaines accèdent progressivement au statut de sujet de droit. Mais seulement des personnes humaines. Pourquoi–? Certains monocellulaires sont considérés comme étant de la même espèce que d’autres dont ils ne partagent que 70% des gènes alors que nous, nous nous considérons d’une autre espèce que le chimpanzé alors que l’on a seulement 2% de gènes différents ! Toute la question est donc de savoir si l’on peut penser l’ensemble de la nature ou de ses habitants comme des sujets de droit, comme nous. C’est là qu’intervient la critique que je fais de la notion d’environnement qui sous-entend que l’homme est au centre, environné du reste du monde. Non, nous sommes plongés dans le monde, comme les autres habitants de ce monde. C’est pour cela que je pense que l’on peut faire accéder au statut de sujet de droit l’ensemble des habitants de cette planète. Telle est l’idée et c’est un effet un livre plus juridique qu’écologique.
Cette révision du droit est-elle en, marche ?
Non, pas vraiment. Cette idée que la nature peut être un sujet est une utopie. Mais ce sont les utopies qui font avancer l’histoire et cela viendra, j’en suis convaincu. Les habitudes sont tellement ancrées, l’histoire est tellement lourde, les intérêts en jeux tellement puissants, qu’avant d’arriver à cette conclusion là, il faudra du temps. Il y a toujours une inertie sociale dont il faut tenir compte.
Quelle forme ce contrat naturel peut-il prendre ? Vous aviez évoqué l’idée d’une institution de la WAFEL (Water/eau, Air, Fire/feu, Earth/terre, Living/vivants). Est-ce que vous parvenez à là faire entendre ?
C’est une idée qui m’est venue à l’occasion d’une discussion avec Boutros Boutros-Ghali, ancien directeur de l’ONU. Il m’a dit quelque chose qui m’a beaucoup frappé : « Nous ne parlerons jamais ni de l’eau ni des poissons pour la bonne raison que les gens qui sont à l’ONU, dans des discussions internationales, sont des fonctionnaires qui sont là pour défendre les intérêts de leur gouvernement ». Il faut donc faire une différence entre les institutions internationales et les institutions mondiales. Pour l’heure, il n’y a pas d’institution mondiale, seulement des institutions où chacun défend ses intérêts. Si l’on prend l’exemple de la pêche, on se rend bien compte que les intérêts de l’Espagne ne sont pas les mêmes que ceux de la France, que ceux des pays Occidentaux ne sont pas ceux des nations émergeantes, etc. Aujourd’hui personne ne défend l’intérêt des poissons ; la WAFEL parle de l’intérêt des poissons.
Cela signifie-t-il que tant que l’on n’agira pas à l’échelon mondial cette question n’avancera pas ?
En tout cas peu. Mais il me semble que l’on peut noter une avancée en ce sens lors de la Conférence de Copenhague sur le climat, en 2009. Le climat n’est pas sujet de droit, mais il y a eu des négociations entre le GIEC, le Groupement international d’étude du climat, et les 60 états présents à Copenhague. C’est une négociation intéressante où le climat est entré en jeu et, d’une certaine manière, le GIEC représentait les intérêts du climat. On est déjà, ici, dans du contrat naturel et dans l’esprit de la WAFEL. Malgré les échecs, les hésitations, etc., il y eu là une avancée très nette.
On parlait tout à l’heure d’évacuer la conception de nature-objet pour aller vers celle de nature-sujet. Mais pour penser sereinement la relation de l’homme à la nature, ne faudrait-il pas évacuer l’idée d’objet comme celle de sujet. Le « pécher originel » de la Modernité telle qu’elle s’institue avec Descartes ne serait-il pas le dualisme qui a opposé l’esprit à la matière, le sujet à l’objet, l’homme à la nature… ?
Je suis d’accord ce que vous dites concernant la dualité. Poser un objet c’est déjà une décision non seulement de connaissance mais aussi juridique. Mais cette idée remonte à plus loin que Descartes, elle est déjà présente au Moyen-Âge. Certes, avec Spinoza, par exemple, qui associe la nature à Dieu, on ne trace pas la même opposition entre homme et nature. Les animistes, les totémistes, c'est-à-dire beaucoup de sociétés primitives ont d’une certaine manière une théorie de la connaissance, pas très élaborée mais bien solide, où effectivement la distinction sujet/objet qui est si caractéristique de l’Occident n’a pas lieu. De ce point de vue, on a beaucoup à apprendre des sociétés dites « primitives ».
Comment traduire ces questions spéculatives en questions éthiques ? Autrement-dit, par quelles valeurs se traduit cette volonté de transformation de notre rapport à la Nature, de la révocation de l’idée d’une nature-objet ?
La morale ne s’édicte pas. Je veux dire par-là qu’elle est toujours formée à part et un peu après. Si on regarde comment évolue la manière de penser des générations, on voit très bien que la génération de ma Petite Poucette [Le Pommier, Paris, 2012], qui n’a pas encore 35 ans, ne réagit plus par rapport à la nature comme la génération de ses grands-parents. Un exemple, amusant. Dernièrement la télévision diffusait un film comique avec Louis de Funès. A un moment, une bande de joyeux drilles en panne de voiture se trouve devant la mer. Ils démontent le moteur, se disent qu’il faut le changer et le jettent à la mer. Au moment de la sortie du film, cela a pu faire rire, non pas parce que c’était drôle de jeter un moteur à la mer mais parce que le moteur était une chose chère. Mais mes petits enfants, qui ont autour de 20 ans, n’ont pas vu cela. Ils ont éteint la télévision, choqués, et en tout cas ne trouvant rien de drôle là. Entre deux générations les choses avaient changé car jeter un moteur à la mer est devenu moralement condamnable. Cette morale n’est pas établie mais elle fait son chemin.
Quelles sont les valeurs en jeu ? La frugalité ? La modération ?
Elles sont multiples et elles apparaîtront peu à peu. Il faut toujours compter avec l’inertie sociale. Si vous étiez PDG d’une grosse entreprise, vous verriez qu’elle se conduit comme l’officier de quart dirige un gros paquebot. Cet officier sait parfaitement que lorsqu’il dit « à gauche 25 », le paquebot ne viendra à gauche 25 que dans un mille ou deux. Il y a une inertie du gros bateau qui fait qu’avant qu’il vire à gauche ou à droite, il se passe du temps. Il en est de même pour les sociétés. Elles ont une grande inertie. Ca peut sembler condamnable mais ce n’est peut-être pas plus mal ; si les choses changent trop vite, on peut ne plus savoir ce qu’on fait.
Vous aviez dit dans le Nouvel Observateur (29 mars 1990) que Le contrat naturel venait clore cette période de la Modernité qui commence avec Descartes. C’est vers la suppression de cette dualité que vous souhaitez tendre ?
Oui, toute ma philosophie est fondée en grande partie sur le fait qu’il n’y a pas cette dualité. Dans les livres que j’ai écrits dès 58, il y a déjà ça. Je crois qu’il y a là une chose qui touche profondément la science. D’une certaine manière, pour l’Occident, pendant très longtemps et jusqu’à nos jours, la science de base était la physique qui s’occupait des objets en formulant des théorèmes concernant leur mode d’existence. Peu à peu, je crois qu’on s’oriente vers un centrage des sciences qui serait autour des sciences de la vie et de la terre (SVT). Or dans les SVT, il n’y est pas vraiment question de séparation du sujet et de l’objet parce qu’elle parle de réseaux extrêmement complexes de relations entre l’homme et l’environnement, entre les animaux et l’environnement, entre l’homme et les animaux, etc. Dès le moment où vous centrez la connaissance sur les SVT plutôt que sur les sciences dites « dures », vous trouvez des chercheurs qui dans la pratique et même dans leur théorie ne posent plus de séparation entre sujet et objet. La réponse est dans les SVT.
Est-ce le retour des philosophies pratiques, comme le sont les philosophies orientales, ou allons-nous même vers des pensées plus globalisantes en faisant retour aux pensées des peuples premiers ?
Ces pensées sont aussi spéculatives que les nôtres ! Vous n’échapperez jamais à la spéculation sans laquelle il n’est pas possible de diriger sa vie. Ce n’est pas ici la spéculation qu’il faut récuser. Ce qu’il faut interroger, c’est le type même des philosophies occidentales qui doivent bifurquer de façon assez importante et en particulier concernant la théorie de la connaissance. J’ai été très tôt convaincu de cela car je suis un enfant d’Hiroshima. Ce n’est pas la pollution qui m’a d’abord inquiété. J’étais un scientifique et je suis devenu philosophe à cause d’Hiroshima. Qu’est-ce que cet événement voulait dire ? Que dès lors qu’aujourd’hui on faisait de la physique, alors se posaient des problèmes moraux. Les questions de morale et de déontologie scientifique commencent à émerger dans le projet Manhattan. C’est le problème d’Oppenheimer et des autres savants impliqués dans ce programme : ils ne sont pas sûrs de ce qu’ils vont faire et certains sont très inquiets. J’avais écrit un article intitulé « La thanatocratie » [dans Hermès III, la traduction, Éditions de Minuit, Paris, 1974] pour attirer l’attention sur cette question. Mes professeurs d’épistémologie n’avaient aucune idée de ce que la science pouvait poser des problèmes moraux alors que dès 1945, ils étaient posés. Ce n’est donc pas si récent que ça, et même beaucoup plus ancien qu’on le croit. C’est pourquoi j’avais écrit Le serment du scientifique [Monde de l’éducation, 267, 7, 1999], en me référent à Hippocrate qui, déjà, avait remarqué qu’en médecine les problèmes de morale se posent en même temps que les problèmes théoriques.
En termes de valeurs toujours, il me semble que dans votre pensée la figure du savant aurait tendance à être écartée au profit de celle du sage, qui parle au nom des choses. Cela suppose un rapport différent à la connaissance, moins instrumentalisé et davantage tourné vers la manière dont elle peut nous aider à vivre une vie bonne.
Il y a ici deux choses. La première c’est que pour devenir ce sage dont vous parlez, il faut que le philosophe connaisse les sciences. Or ce n’est souvent pas le cas, et il leur est donc difficile d’acquérir cette sagesse relative à la connaissance. Mais la seconde, c’est que les savants, eux, commencent à avoir cette conscience-là. Je fréquente beaucoup mes collègues de l’Académie des sciences. Ce ne sont pas tous des philosophes, et de très loin, et pas non plus des moralistes, mais ils ont désormais cette conscience des problèmes que pose la science par rapport à la nature. L’Académie des sciences ne savait pas cela dans les années 50/60. Le sage en question n’est donc pas forcément un philosophe — parce qu’il ne sait pas de science —, mais peut-être plus le savant qui commence à apprendre un peu de philosophie.
Cette manière différente d’être au monde et de contracter avec lui change-t-il notre manière de faire société ?
Oui, bien sûr. Dans Le contrat social de Rousseau, de façon paradoxale puisqu’il parle toujours de la nature, on dirait que tout ce passe et se joue en ville, qu’il n’y a pas du tout de campagne. Aujourd’hui, vous voyez fleurir dans la tête des urbanistes des choses étonnantes tels ces toits plein de verdure ! Une anecdote. Il y a aujourd’hui des concours annuels de miel et des goûteurs se sont récemment accordés sur un miel extraordinairement complexe à qui ils ont attribué la médaille d’or. D’où venait ce miel ? De la Porte de Montreuil à Paris ! Les abeilles allaient butiner les fleurs des fenêtres et avaient retrouvé la biodiversité qui avait disparu des campagnes. Le faire société est en train de changer.
La nature entre comme un sujet dans la ville ?
Cette société doit changer. Je l’ai écrit dans mon livre Habiter [le Pommier, Paris, 2011] : notre société a connu une bataille formidable entre la ville et la campagne et il faut, que là aussi, ce soit la paix.
Qu’est-ce que l’arrivée de nouvel entrant change dans le contrat que nous avons entre-nous, individus ?
C’est qu’il s’agit désormais d’un contrat à trois. D’ailleurs, je le dis au début du Contrat naturel en évoquant le tableau de Goya [Hommes se battant avec des bâtons, Musée du Prado, Madrid]. Les deux hommes ne se battent pas que tous les deux, ils s’enfoncent dans un sable mouvant. Donc le contrat est à trois. Ce n’est plus vous et moi, seulement, qui sommes concernés, il y a un tiers qui entre dans notre rapport et notre rapport doit tenir compte de ce qu’on est assis sur des sables mouvants. L’image qui ouvre Le contrat naturel explicite cette idée que ce n’est plus un contrat à deux mais à trois. C’est un mariage à trois !
Est-ce que la notion de biens communs peut nous aider dans cette relation à trois ?
Absolument. Encore faut-il la définir, ce qui est difficile. C’est pour cela que j’ai écrit Le mal propre [Polluer pour s'approprier ?, Le Pommier, coll. « Manifestes », Paris, 2008]. L’antonyme du mal propre est le bien commun. J’ai essayé de voir ce que signifiait polluer. Si vous m’invitez à dîner mais que je crache dans le plat, vous ne le mangerez pas. Je me l’approprie. Quand je salis, je m’approprie. De la même manière, si vous salissez les draps de mon lit, je n’y dormirais pas. Polluer, c’est s’approprier. Par conséquent la pollution et le bien commun touchent aux fondements du droit de propriété. En langue française il y a un lien étymologique entre propriété et propreté. Le mal propre, c’est ce qu’on s’approprie, ce qui est personnel, mais c’est aussi de la saleté. Ainsi le sale, c’est le propre, ce que je m’approprie.
Vous avez toujours œuvré pour une diffusion large de vos idées de sorte qu’elles ne restent pas confinées au cercle des spécialistes. Qu’attendez-vous de démarches, comme celle des Entretiens de la cité, qui mêlent chercheurs et grand public autour de disciplines très différentes ?
Tout ce qui permet de mettre en contact des experts et le public est le bienvenu. Ici, je parle au public à travers vous, à travers un média. Et d’ailleurs, si j’ai une requête à formuler, c’est que les médias parlent davantage de sciences. Aujourd’hui la plupart des gens, y compris les journalistes connaissent bien mieux les chanteurs que les sept derniers prix Nobel français. Or, il y a 50 ans, Maire Curie était une héroïne nationale, beaucoup plus connue que n’importe qui d’autre. Il faut que les médias soient de bons messagers entre des experts qui n’ont pas souvent la parole et le public. Un exemple du contraire. Dans les médias, on n’entend ou on lit que l’éducation nationale est déplorable en France, que la recherche est minable, etc. Mais, en France, si on rapporte le nombre de prix Nobel au nombre d’habitants, on est les premiers dans le monde ! Qui le dit ? Personne. C’est pour cela que je fais ces entretiens, pour essayer de trouver un bon média entre les experts et le public.
Vous avez développé l’idée que l’Internet a conduit à une externalisation de notre cerveau et que notre société est désormais une société du « tous ». Cette relation nouvelle au savoir nous impose-t-elle de devenir inventif, ingénieux ?
Ce qui a le plus changé, c’est que Petite Poucette est née avec les nouvelles technologies. Ma génération travaille avec ces nouvelles technologies, la sienne vit dedans. Petite Poucette m’a appris le sens profond du mot « maintenant ». Pour nous « maintenant » évoque ce qui se passe dans le présent. Non. Maintenant veut dire « tenant en main ». Main tenant son téléphone portable. « Maintenant, tenant en main le monde », telle est la devise de Petite Poucette qui accède à tous les lieux du monde par le GPS, à toute l’information imaginable par Wikipédia et autres moteurs de recherche, etc. Avant Petite Poucette, qui pouvait dire « maintenant, tenant en main le monde » ? Auguste, empereur romain ? Un richissime ? Aujourd’hui, les Petite Poucette sont 3,750 milliards. Vous ne pensez pas que ça annonce une nouvelle politique !
Laquelle ?
Certainement une démocratie toute à fait nouvelle et pour l’instant difficile à concevoir. Mais on perçoit au fond du tunnel une lumière très extraordinaire. Aujourd’hui, n’importe quel livre de n’importe quel expert compte une citation par paragraphe avec des renvois aux dires d’Untel ou d’Untel, des index, etc. Tout cela n’est plus utile désormais car l’information est disponible. On n’a plus besoin de ce type d’expertise. De la même façon que Montaigne disait « Je préfère une tête bien faite à une tête bien pleine », à la Renaissance quand on invente l’imprimerie, aujourd’hui, où l’on accède à toutes les informations, on a besoin d’une autre tête. La tête experte, celle qui a des informations, je l’ai en face de moi, sur Internet. Nous sommes donc condamnés à devenir intelligent. Cela change aussi de nombreuses relations comme celles entre l’enseignant et l’élève, le médecin et son patient, les élus et le peuple… Autrefois, il y avait une présomption d’incompétence qui touchait les élèves, des patients ou le peuple, aujourd’hui s’y est substituée une présomption de compétence. Cette présomption transforme ces relations.
Pour aller plus loin avec Michel Serres :

Article
Dans un monde qui se réenchanterait pour mieux se réconcilier avec le non-humain, que nous dirait-il de nos anomies actuelles ?

Article
Synthèse du colloque organisé par Tempo Territorial et la Métropole de Lyon – Retour sur les interventions du jeudi 9/11/2023.

Article
Synthèse du colloque organisé par Tempo Territorial et la Métropole de Lyon – Retour sur les interventions du vendredi 10/11/2023.

Article
Aurianne Stroude, sociologue spécialiste de la transformation des modes de vie en lien avec les enjeux écologiques, décrypte le changement social qui opère au-delà des évolutions individuelles.

Article
S’appuyant sur une importante revue de littérature, cet article décrit la façon dont les modes de vie se structurent progressivement autour de trois variables.

Étude
Cette étude propose cinq monographies – Bogotá, Pontevedra, Milan, Zurich et Lahti – explorant le lien entre « massification » des changements de mode de vie et nouvelles manières de travailler au sein des collectivités publiques.
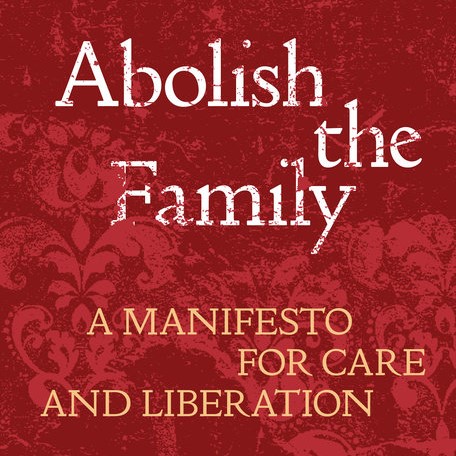
Article
La famille, considérée parfois comme valeur suprême est pourtant un important marqueur d’inégalités. Dès lors, qu’en faire ? Peut-on envisager l'abolition de la famille ?
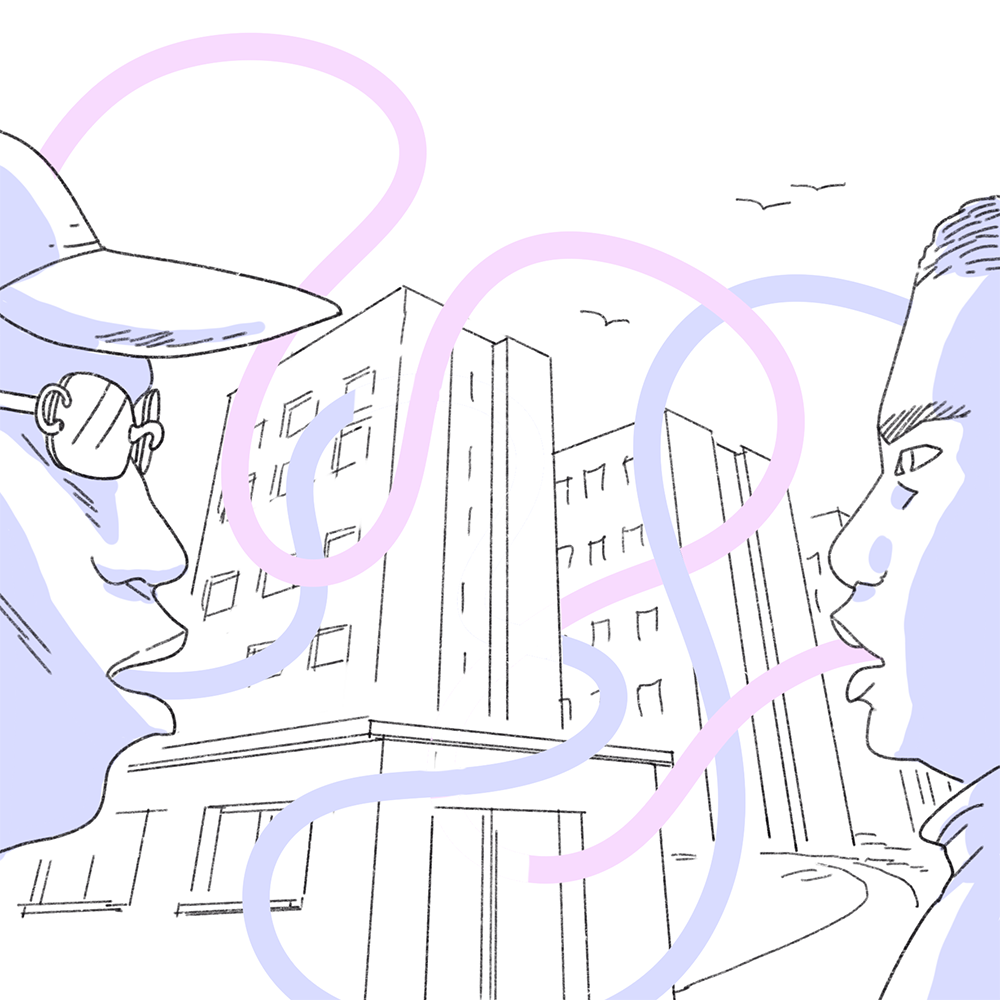
Article
A priori, pour le grand public, le Grand Lyon n’est pas une place forte du rap hexagonal. Pourtant, de nombreux acteurs ont solidement posé depuis 30 ans les fondations de la scène locale, à l’échelle d’une agglomération qui regorge de talents cachés.
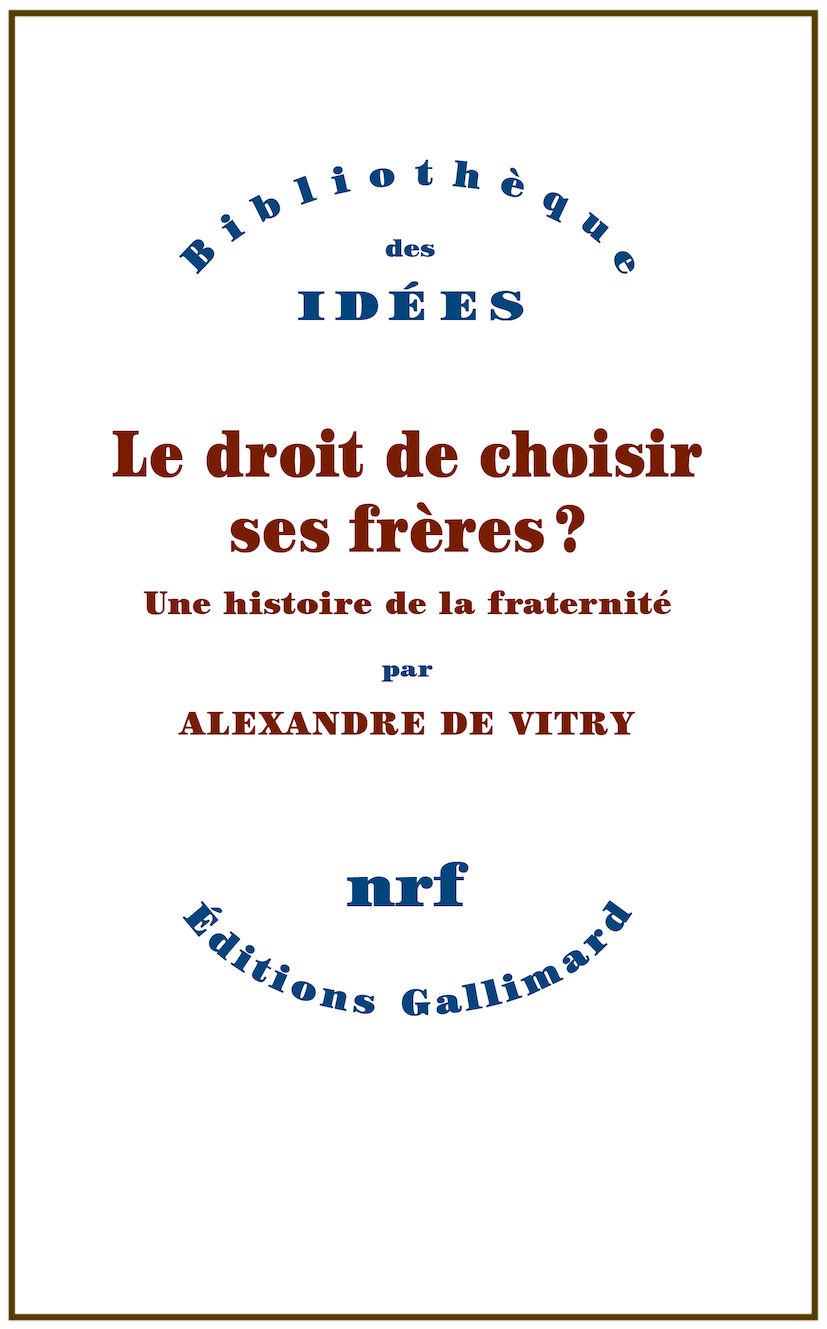
Article
La Fraternité, troisième pilier de la devise républicaine et représentation symbolique de la relation entre « famille » et « nation ». Mais demain, est-ce encore de ce lien dont nous aurons besoin ?