Mobilité quotidienne et ancrage local

Interview de Eric CHARMES
Directeur du laboratoire RIVES
Interview de Bruno FAIVRE

<< la refonte des structures tarifaires est à mon avis l’un des grands chantiers des années à venir pour le transport public, afin d’assurer son financement >>.
Propos recueillis le 30 mars et le 23 novembre 2012 par Cédric Polère
Bruno Faivre d’Arcier mène au sein du LET, à Lyon, des recherches sur la compréhension des politiques locales de déplacements : actuellement sur l'évaluation des politiques de transport, l'observation des comportements individuels de déplacements, ainsi que la mesure de la performance des transports publics. Nous l’interrogeons sur la prise en compte des questions de solidarité et d’équité dans les transports en commun.
Des villes mettent aujourd’hui en place des systèmes de tarification solidaire pour les transports en commun. Mais comment les préoccupations sociales, de solidarité, d’équité sont-elles apparues dans le champ des transports publics urbains ?
Il faut bien voir que les transports publics ont plusieurs rôles à jouer dans la ville. Historiquement, leur première mission est sociale. Dans les années 60, le modèle économique français s’appuyait sur quelques grandes industries, dont l’industrie automobile. On pensait alors que tous les ménages auraient progressivement leur voiture et l’utiliseraient pour se déplacer, partout et tout le temps. C’était le modèle du « tout automobile ». Sauf qu’une bonne partie de la population n’ayant pas encore accès à la voiture, elle se déplaçait en transports collectifs, assurés alors par des entreprises privées au prix du marché. Or, l’apparition de la concurrence automobile avait fait perdre progressivement leur clientèle à ces entreprises, puis avait conduit à la fermeture de lignes dès lors qu’elles n’étaient plus rentables. Pour éviter une discrimination sociale, les autorités ont tenu le raisonnement suivant : une bonne partie des gens n’ayant pas (encore) accès à la voiture, il faut leur permettre d’accéder à la ville depuis leur domicile. C’était l’époque de l’exode rural, de la crise du logement, du lancement des ZUP en banlieue. Si on logeait de plus en plus en banlieue, l’emploi restait en centre-ville. On a donc créé des lignes radiales de bus partant de ces ZUP pour aller au centre. À l’époque, on parlait des captifs des transports en commun, parce qu’ils n’avaient pas d’autres choix de déplacement, même s’il y avait la fameuse mobylette. Ces captifs étaient les jeunes qui n’avaient pas encore l’âge pour accéder à la voiture, les vieux qui étaient trop vieux pour se mettre à l’automobile, et les femmes puisqu’à l’époque elles étaient peu nombreuses à posséder le permis et si un ménage arrivait à s’acheter une voiture, il n’en aurait sûrement pas deux, et s’il y avait deux actifs, l’homme prenait la voiture.
Aujourd’hui, cette situation a bien changé…
Oui, mais les plus jeunes (scolaires) n’ont toujours pas accès à l’automobile, et les jeunes en âge de conduire font des études plus longues, ont un accès précaire au marché du travail, et par conséquent ils ont du mal à emprunter pour acheter une voiture. Les vieux sont en revanche devenus les meilleurs clients des industries automobiles, puisqu’ils sont solvables et peuvent acheter des voitures neuves. L’âge moyen de l’acheteur d’une voiture neuve en France est de 54 ans ! Du côté des femmes, comme l’accès au permis s’est diversifié, comme il y a beaucoup de ménages bimotorisés, et même s’il reste toujours le problème du partage de la voiture unique, elles forment moins qu’avant un public captif. Mais on a toujours plus de femmes que d’hommes dans les transports en commun.
Revenons si vous le voulez bien aux années 1960 : comment la vocation sociale des transports en commun a-t-elle été concrétisée ?
Le raisonnement a été le suivant : il faut assurer la mobilité aux exclus du marché automobile. Mais comme les transports en commun perdaient en clientèle et donc en rentabilité, les pouvoirs publics ont créé des autorités organisatrices des transports (AOT) et autorisé les collectivités locales à financer le déficit des lignes de transport en commun pour maintenir le niveau de service. Sachant que les ménages qui n’avaient pas accès à l’automobile étaient pour beaucoup des revenus modestes, on a donné aux transports en commun ce rôle social, d’où à l’époque la déconnection entre le prix du billet et le coût réel de production du service. Le rôle social des transports en commun reste aujourd’hui important : dans les villes de moins de 50 000 habitants, 80% de la clientèle est une clientèle captive.
Les années 70 marquent un tournant, avec l’apparition d’un rôle nouveau pour les transports publics urbains.
C’est l’effet de la crise pétrolière ?
C’est surtout l’effet de la crise de congestion des centres-villes. On s’est rendu compte que la généralisation du trafic automobile en ville conduisait à une impasse, tant il aurait fallu construire d’infrastructures routières pour satisfaire la demande. En 1968 la ville de Leeds en Angleterre avait commandé une étude sur ses besoins en infrastructures afin d’assurer la fluidité du trafic. Elle montrait qu’il fallait raser la moitié du centre-ville pour laisser la place aux nouvelles voiries, c’était absurde ! On a pris conscience que l’automobile ne résoudrait pas le problème de mobilité, en tous cas dans le contexte européen, car aux Etats-Unis des choix urbanistiques différents ont conduit à étaler la ville pour éviter la congestion, ce qui est cohérent vu l’absence de contraintes fortes sur l’espace. Pour revenir à la France, il a été décidé de relancer les transports en commun pour capter la demande excessive de déplacement qui génère la congestion, de manière à maintenir la fluidité pour un maximum de gens. Les transports publics en France se sont redéveloppés dans cette période. Le lancement des métros à Lyon, Lille ou Marseille s’inscrit dans cette logique.
On a développé les transports en commun pour capter la demande excessive, ce qui signifie que le véritable objectif était de permettre au maximum de gens de continuer à rouler en voiture ?
Exactement, d’autant que le métro libère de la surface et permet de faire passer plus de voitures. Le principal rôle des transports en commun consistait alors à réduire la congestion. C’est leur deuxième fonction historique.
Quel est alors le troisième rôle des transports publics ?
À partir des années 1980-90, l’étalement urbain provoque une crise de centralité. Les communes centres voient leur population diminuer, les activités commencent à partir vers la périphérie pour des raisons de coût foncier, c’est l’époque des grandes surfaces périphériques, de l’urbanisation qui s’étale. Les villes qui ont peur de perdre leur pouvoir cherchent alors à revaloriser leur centre, avec des politiques de logement pour faire revenir la population. L’inflexion est manifeste dans les années 1990 : pour revaloriser le centre, il faut rendre l’espace urbain plus agréable, donc on chasse en partie la voiture. La meilleure façon de réaliser cette requalification urbaine a été le tramway. Nantes ou Grenoble ont été précurseurs en piétonnisant le centre-ville à l’occasion de la réalisation des lignes de tram. Cela a été un deal entre la commune centre et les communes périphériques : nous créons une ligne de tram qui sera l’occasion de rénover le centre ville et renforcera son attractivité ; mais comme le tram est financé par l’ensemble de l’agglomération, il desservira quelques communes périphériques. Ces opérations ont contribué à faire financer sur le budget transport une bonne partie de la rénovation des centres-villes. Ainsi de la ligne C à Grenoble, où il y avait quasiment des autoponts autoroutiers sur les grands boulevards : toute la requalification jusqu’aux pas de portes a été payée sur le budget transport. C’est le troisième rôle des transports, leur contribution à l’aménagement urbain, notamment des centres-villes, leur contribution au retour de l’urbanité dans la ville.
J’imagine que ce type de compromis se retrouve dans le tracé des tramways à Lyon ?
Oui, si vous prenez la ligne T2 qui s’enfile avenue Berthelot, vous observerez qu’elle fait un petit détour pour desservir le centre de Bron. Cela a été génial pour les habitants de la ville de Bron, moins pour les étudiants dont les résidences ne sont pas desservies, mais à l’époque on avait tendance à penser que la clientèle étudiante n’était pas prioritaire, certains disant (à tort) que les étudiants ne sont présents que six mois dans l’année… Donc évidemment, le tracé a été l’objet d’un compromis. Le tram a servi à revaloriser l’offre foncière du centre de Bron et à recréer une dynamique de centre-ville. Cette fonction de support à l’urbanisation est donc un arbitrage, et indique que contrairement à ce que l’on pourrait croire, on ne privilégie pas forcément la fonction transport quand une nouvelle ligne est créée…
Aujourd’hui on recherche néanmoins une cohérence entre transports et urbanisme : c’est ce qu’on appelle les contrats d’axes, où s’établit un partenariat entre l’AOT et les municipalités dans le but très précis de coordonner les actions : en même temps que la ligne est réalisée, les communes densifient l’urbanisation autour des stations. Dans un contrat d’axe, par exemple à Grenoble dans le projet de la ligne E du tramway, un véritable observatoire foncier a été mis en place pour que la collectivité puisse préempter un terrain dès qu’il se libère, et donc densifier la ville, favoriser l’implantation d’équipements autour des stations… Ces contrats traduisent l’engagement des partenaires à agir ensemble de manière coordonnée pour assurer une densification le long des axes de transport.
Quel est le quatrième rôle des transports en commun ?
Il apparaît aujourd’hui autour de la question environnementale. L’objectif premier d’un Plan de Déplacements Urbains (PDU) est de réduire le trafic automobile afin de contribuer notamment à la lutte contre les gaz à effet de serre. Nous avons déjà des exemples : le dernier PDU de Montpellier a été attaqué en justice par des associations au motif qu’il n’apportait pas la démonstration qu’il allait réduire le trafic automobile. Montpellier a du refaire son PDU, pour vice de fond ! Comme depuis la loi SRU il y a une obligation de compatibilité entre le SCOT, le PDU, le PLU, le PLH, et comme la loi impose que le PDU réduise le trafic automobile, il devient nécessaire d’apporter cette démonstration. À Lyon il y a des débats sur ce qu’il conviendrait d’appeler l’ « anneau des sciences », ou « TOP » : s’il induit du trafic, il est contraire au PDU. Or, on sait bien que chaque fois qu’une infrastructure est créée, on augmente le trafic. Si vous diminuez le coût généralisé du déplacement, vous augmentez la fréquentation, ce qui signifie que le TOP peut poser problème, sauf s’il s’inscrit dans une politique multimodale offrant des alternatives à l’usage de la voiture, et que le prix du péage qui sera demandé garantit cette non augmentation du trafic automobile.
Pouvez-vous expliquer à quoi sert le Versement Transport ?
Ce versement joue en effet un rôle fondamental. Il a été créé en 1971 dans la région Ile-de-France, au départ pour inciter les entreprises à se délocaliser vers les villes nouvelles. Motif invoqué : il est normal que les entreprises payent, puisque les réseaux de transport publics transportent leurs salariés. Cette raison initiale n’est pas tout à fait en rapport avec le dispositif mis en place, car le Versement Transport est une taxe fondée sur la localisation d’une entreprise dès lors qu’elle est située dans le Périmètre des Transports Urbains, et ceci même si elle n’est pas desservie : ce n’est pas une redevance ou une prestation de service, mais un impôt lié à la localisation. La vraie justification du Versement Transport est à mon avis l’avantage indirect que retire l’entreprise de la réduction de la congestion (qui pénalise les échanges sociaux et économiques) suscitée par le développement des transports en commun. Cette année 1971, une notion très importante a été introduite, celle de bénéficiaire indirect. L’entreprise bénéficie indirectement du réseau de transport puisqu’il réduit la congestion. Il est alors normal qu’elle contribue à son financement.
Ce Versement Transport qui est une spécificité française a énormément d’avantages et quelques limites : c’est un impôt sur toutes les entreprises de plus de neuf salariés, privées ou publiques, fondé sur la masse salariale, ce qui est logique puisqu’il est lié au transport des salariés. L’inconvénient est qu’il fait augmenter le coût du travail. Une start-up ne paiera presque rien même si elle réalise un gros chiffre d’affaires, alors qu’une entreprise de main d’œuvre sera très pénalisée. Cette taxe a généré énormément d’argent (actuellement environ trois milliards chaque année pour la région Ile-de-France et trois milliards pour le reste de la France) qui a permis le financement des transports en commun en site propre, notamment les tramways, les métros et maintenant les bus à haut niveau de service, qui sont la tendance actuelle car c’est le moins coûteux en investissement.
Le Versement Transport donne-t-il toute latitude aux collectivités territoriales pour décider leur politique de transports en commun ?
C’est effectivement un dispositif qui va dans le sens de la décentralisation puisque c’est une ressource locale qui donne aux collectivités le moyen de financer leurs propres politiques. On peut l’interpréter comme un transfert fiscal. Autrefois les villes étaient dépendantes des subventions de l’État pour investir dans leur système de transport. Aujourd’hui, l’État se concentre sur les infrastructures interurbaines, TGV, autoroutes, etc. et apporte relativement peu de subventions aux transports collectifs urbains
Le Versement Transport couvre aujourd’hui la moitié du coût complet des réseaux de transport collectifs en France, en tout cas en dehors de l’Ile-de-France qui fonctionne selon un système différent. Les usagers ne payent que 20% et les collectivités mettent les 30% restant. Mais on est quand même confronté à un problème de financement du réseau.
D’où viennent ces problèmes de financement ?
Les élus, prompts à investir, oublient facilement qu’une dépense d’investissement génère des dépenses de fonctionnement. Or les coûts d’exploitation explosent, augmentent d’année en année. Le ratio recettes commerciales sur dépenses d’exploitation (R/D), hors investissement, est en chute libre depuis des années. Il est seulement de 30% aujourd’hui en France, ce qui signifie que les usagers ne couvrent que 30% du fonctionnement des réseaux.
Comme les transports en commun étaient initialement un service social, le prix payé par l’usager est déconnecté du coût réel du service, avec un prix du ticket qui n’a guère bougé alors que les réseaux se sont étendus. En plus de faire ce prix là, censé être social, on accorde des réductions tarifaires sociales, donc on fait de la double réduction. C’est assez aberrant, et surtout dangereux pour la pérennité du financement des transports collectifs, qui doivent continuer à se développer.
Au regard de cette situation, quelle est la situation lyonnaise ?
Le réseau lyonnais est un peu particulier, car avec un peu plus de 50%, c’est en France l’un de ceux qui a le meilleur ratio R/D. Cela s’explique parce que le SYTRAL pratique des augmentations annuelles de ses tarifs et que Lyon est une grande ville où la clientèle du réseau n’est plus majoritairement sociale. Ces gens nombreux qui pourraient prendre une voiture mais choisissent de prendre les transports en commun, sont la conséquence des politiques faites en matière de PDU. Historiquement, on observe que tous les efforts réalisés pour développer les réseaux de transport en commun, très coûteux, n’ont pas augmenté la fréquentation. Pour accroître la fréquentation, il faut en parallèle entraver l’usage de la voiture. Ceci est arrivé avec les nouveaux PDU, après la loi LAURE en 1996. On s’est aperçu qu’en entravant l’usage de la voiture surtout dans les grandes villes, on faisait augmenter la fréquentation des réseaux de transport en commun. Deux autres phénomènes ont joué : la hausse du prix de l’essence ces dernières années, et sans doute des phénomènes démographiques de vieillissement de la population qui favorisent des modes de déplacement différents.
Face aux difficultés de financement des réseaux de transports en commun, quelles sont les pistes étudiées ?
La manne considérable apportée par le Versement Transport a permis de financer énormément de réalisations, qui ont ensuite fait exploser les dépenses d’exploitation. Actuellement, nous allons dans le mur. Ce versement est en grande partie consommé pour financer les déficits d’exploitation. Il a permis de maintenir des tarifs assez bas des transports en commun ce qui n’est pas forcément la bonne solution : pour demain gagner en clientèle, il faudra conquérir des automobilistes et par conséquent apporter de la qualité, ce qui se répercutera sur les tarifs. Par ailleurs, l’irruption du développement durable a complètement modifié la donne, ce qui devrait susciter un changement de business model.
Les gens ne se rendent pas compte du prix des transports en commun. Jean-Pierre Orfeuil a montré à partir d’un travail sur les données des Comptes Transport de la Nation que la mobilité quotidienne génère des transferts de l’ordre de 20 milliards d’euros publics, soit par exemple bien plus que les dotations de l’Etat aux universités. 1,75% de la masse salariale de toutes les entreprises du Grand Lyon est versée chaque année au SYTRAL, ce qui représente environ 250 millions d’euros.
J’ajouterais que le mode de financement doit être cohérent avec les objectifs poursuivis. Si les transports en commun ont un rôle social, il est normal que l’impôt les paye. Si leur rôle est de lutter contre la congestion, il convient de les faire payer par le Versement Transport et les automobilistes ; si l’on entend préserver l’environnement, il peut être logique d’instaurer une écotaxe. Selon les objectifs poursuivis on ne favorise pas non plus les mêmes modes de déplacements. Le problème aujourd’hui est que le système de coût n’est pas cohérent. Il faudrait arriver à une certaine vérité des prix pour réorienter correctement la demande. Et sur l’aspect social, donner aux politiques plus de cohérence.
Vous avez parlé de la création des Autorités Organisatrices des Transports : permettent-elles aux collectivités territoriales de maîtriser le développement des transports en commun ?
Le principe des Autorités Organisatrices est apparu avec la loi TPIL (Transports Publics d’Intérêt Local) de 1979 quand on a voulu créer des réseaux de transport public urbain. Le mot réseau apparaît avec cette loi, alors qu’auparavant des transporteurs indépendants exploitaient des lignes historiques créées en réponse au marché, fixaient les prix, les horaires… Chaque fois qu’un réseau de transports publics urbains a été créé, on l’a associé à un monopole d’exploitation : l’organisation du réseau est confiée à une entreprise unique, privée ou régie. En échange de ce monopole et de l’obligation d’assurer des services non rentables, la collectivité pouvait financer, alors qu’auparavant il n’y avait aucune raison qu’une collectivité aide des entreprises privées de transport. C’est une bascule : avec le principe d’un réseau public, la collectivité publique est en situation de décider. On a alors assisté, petit à petit, à la création d’une autorité publique et politique, l’AOT (Autorité Organisatrice des Transports) qui est devenue propriétaire du réseau, décide du niveau de service, en donne l’exploitation à une entreprise pour un coût déterminé lors d’un appel d’offre, et s’engage à compenser le déficit pour assurer le service. À Lyon, le Syndicat Mixte des Transports pour le Rhône et l’Agglomération Lyonnaise ou SYTRAL est l’autorité organisatrice des transports urbains. Propriétaire de la marque TCL, il confie l’exploitation du réseau à une entreprise par appel d’offre selon le modèle de la délégation de service public. Mais on assiste à des évolutions puisqu’on en vient le plus souvent à des contrats de type net cost, où l’entreprise exploitante s’engage sur un niveau de recettes et sur un niveau de dépenses, ce qui permet à la collectivité de s’engager sur un déficit à payer sur les six années du contrat. Mais c’est l’AOT qui définit le service.
La Communauté urbaine de Lyon peut-elle décider de la politique tarifaire des transports en commun dans l’agglomération lyonnaise, par le biais du SYTRAL ?
Le SYTRAL est un cas particulier de syndicat mixte puisque sont présents à la fois le Conseil Général du Rhône et le Grand Lyon. Pour autant, la compétence du transport collectif en tant que service public appartient au Grand Lyon, qui a décidé de déléguer cette compétence au SYTRAL. Au sein du SYTRAL, le Grand Lyon est devenu majoritaire depuis le mandat de Raymond Barre (1995-2001). À noter que le SYTRAL décide la politique tous modes. C’est un système un peu bizarre, puisque le syndicat décide de la place de la voiture en ville, alors même qu’il est en charge des transports collectifs ! Donc la réponse à votre question est oui, mais via le SYTRAL.
Que pensez-vous de la solution de la gratuité pour les transports en commun ? Selon ses partisans, elle pourrait limiter l’usage de la voiture et permettre à tous de se déplacer…
Le débat sur la gratuité est affligeant, il porte une vision complètement erronée de la mobilité. La gratuité complète des réseaux existe dans une vingtaine de villes françaises petites ou moyennes, où il n’y a pas de problème de congestion (seule Aubagne a plus de 100 000 habitants et pratique la gratuité). Dans ces situations, les usagers sont très largement ceux qui n’ont pas accès à la voiture.
À gauche, les Verts par exemple sont très favorables à la gratuité des réseaux, considérant que cela va favoriser le transfert de la voiture vers les transports en commun. D’autres considèrent le droit au transport et veulent un service accessible à tous librement, ce qui signifie que le financement des transports collectifs doit se faire par l’impôt seulement. Or force est de constater que la gratuité profitera à tous, donc aussi aux plus riches, qui ont pourtant la capacité de payer leur transport ! Par ailleurs, la gratuité pose de multiples problèmes : si le transport en commun est gratuit, on le prend même pour faire 100 mètres, ce qui provoque la saturation des bus, nécessite de mettre plus de véhicules, donc augmente le coût à payer sur les impôts… Et si l’on rend les transports ferroviaires gratuits ou presque, on s’inscrit à l’encontre de l’objectif de la ville dense. Le TER à un euro serait la meilleure façon de faire exploser l’étalement urbain. Il convient donc d’envoyer un signal prix qui soit cohérent avec les enjeux que l’on identifie et les objectifs que l’on se donne.
Plutôt que la gratuité, la grande révolution à mon avis est la tarification solidaire qui passe d’une réduction liée au statut (étudiant, retraité, chômeur…), assez injuste parce qu’au sein d’un même statut les écarts de ressources peuvent être importants, à une réduction liée aux revenus réels. En prenant en compte le niveau de ressources de chacun, le tarif solidaire repose sur un principe de solidarité à l’égard des plus modestes, et sur l’équité entre usagers.
Avez-vous des exemples de tarification solidaire ?
Les agglomérations de Dunkerque puis Grenoble par exemple se sont engagées dans ce type de solution. À Grenoble, une femme seule avec enfant qui touche le SMIC paiera en 2012 son abonnement mensuel 2,40 euros, alors qu’un cadre le paiera 48,20 euros. La tarification est fonction du quotient familial. Si chacun paie selon son revenu, on maximise l’usage des transports en commun, on maximise les recettes, tout en respectant un principe de justice sociale. Cette solution de tarification basée sur le consentement à payer est consensuelle au niveau de la population, et apprécié par les plus modestes (même titre de transport que les autres). À Lyon, le SYTRAL s’interroge sur cette tarification solidaire, qui reste assez lourde à mettre en œuvre dans une très grande agglomération et présente quelques limites (tout le monde n’est pas à la CAF). Plus généralement, le GART (Groupement des Autorités Organisatrices de Transport) s’interroge même sur le principe des tarifications sociales : est-ce aux réseaux de transport de prendre en charge ces politiques sociales ? On peut ainsi observer que cela est rare à l’étranger : en Allemagne, il n’y a pas de tarification sociale. Ce sont les organismes sociaux qui achètent des abonnements plein tarif qu’ils revendent à tarif réduit à des personnes à faibles ressources. Dans ce modèle, on estime que ce n’est pas aux transports de faire une politique sociale.
Votre point de vue sur la tarification à la distance en matière de transports en commun, qui consiste à faire varier le prix du ticket de bus en fonction des kilomètres parcourus ?
La tarification à la distance (zonale, voire kilométrique) est le modèle le plus répandu dans le monde, notamment dans les grandes agglomérations. En France, la volonté de faciliter l’usage des transports en commun, mais aussi les difficultés de contrôle face à la fraude ont conduit à sa suppression progressive. Certains disent également que c’est la double peine pour ceux qui sont allés toujours plus loin pour se loger dans le périurbain, avec un temps de transport plus long, et un coût plus cher. Je pense que cette suppression est une erreur (il y a aussi des pauvres dans le centre et des riches en périphérie) et que le tarif unique pratiqué aujourd’hui génère des transferts entre usagers, tout en cachant la réalité des coûts. Ainsi par exemple, la suppression des zones en Ile-de-France va conduire à augmenter le prix de base et pénaliser des ménages modestes habitant dans la première couronne. La refonte des structures tarifaires est à mon avis l’un des grands chantiers des années à venir pour le transport public, afin d’assurer son financement. Mais il faudra aussi traiter un problème qui se posera de plus en plus, celui des « captifs de la voiture », ces ménages qui sont allés s’installer loin, dans le périurbain et que l’on n’ira pas chercher en transports en commun parce que cela est trop couteux, et qui vont prendre de plein fouet la hausse du prix de l’essence.

Interview de Eric CHARMES
Directeur du laboratoire RIVES

Interview de Michèle VULLIEN
maire de Dardilly

Texte de Cécile FÉRÉ

Les métiers du prendre soin souffrent d'un fort turnover. Pourtant, les facteurs d'engagement dans ces métiers très humains ne manquent pas. Alors, que se passe-t-il ?
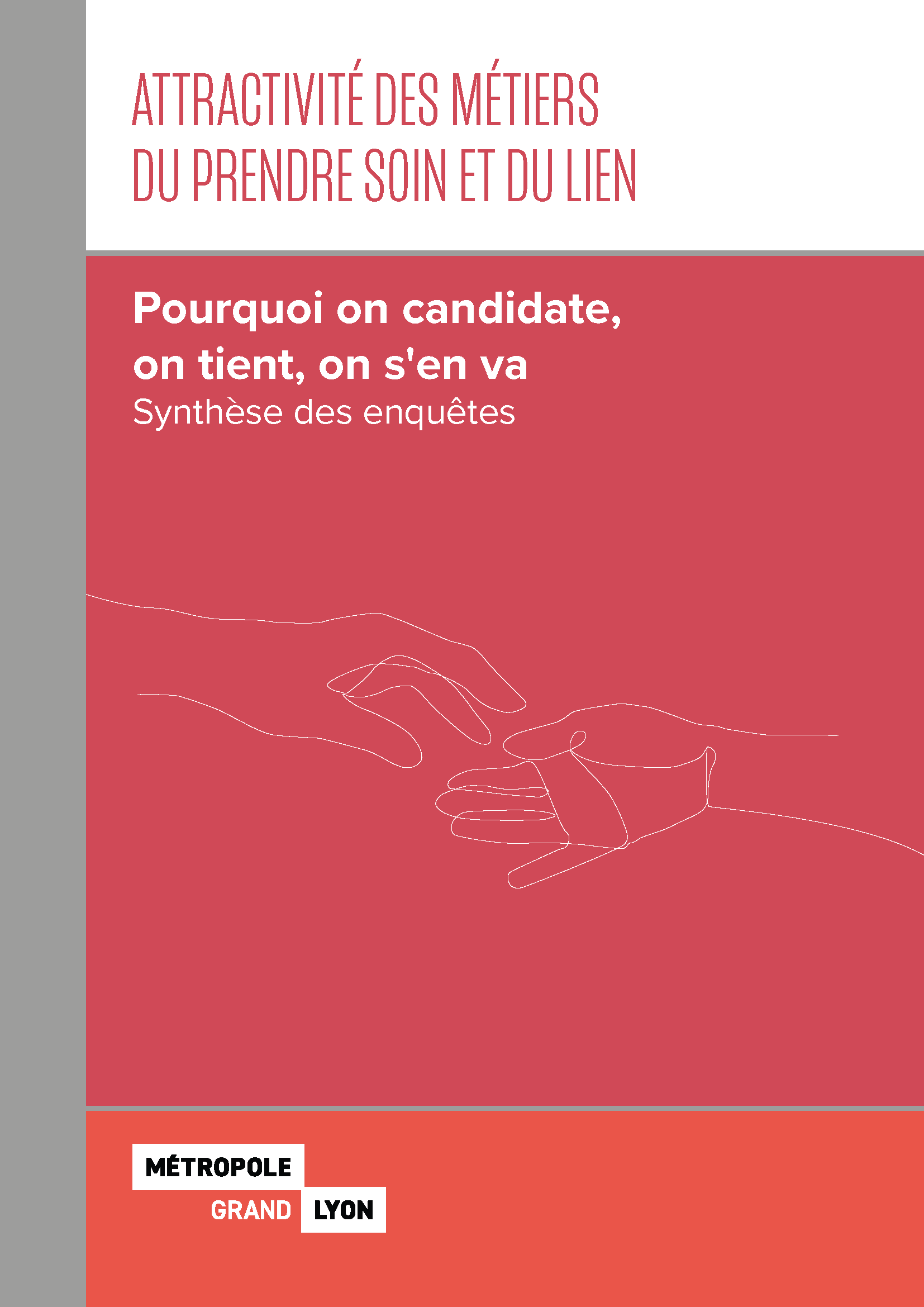
Étude
Comment expliquer le manque d'attractivité des métiers du prendre soin ? pourquoi on candidate, on tient, on s’en va ? Retrouvez la synthèse des enseignements des différentes enquêtes conduites sur ces questions.

Article
Cheminer vers la sobriété : L’altruisme est-il le balancier nécessaire à cette démarche de funambule ? « Pas si simple », répond la mathématicienne Ariadna Fossas Tenas

Article
La mobilité est un enjeu politique de premier ordre, reflet de différentes visions des mécanismes au cœur du fonctionnement et du changement de l’ordre social.

Article
Si la transition écologique doit s’envisager comme une réorientation globale et transversale de nos modes de vie, les enjeux de mobilité devront être saisis comme l’un des dénominateurs communs aux différents secteurs d’activité à transformer.

Ce dossier traite de la mobilité dans l’espace géographique, de l’idée de mouvement au cœur des imaginaires de notre société et des manières d'en décoder le fonctionnement social.