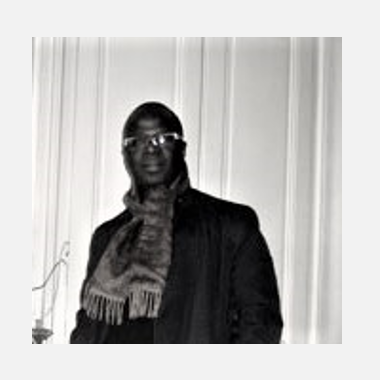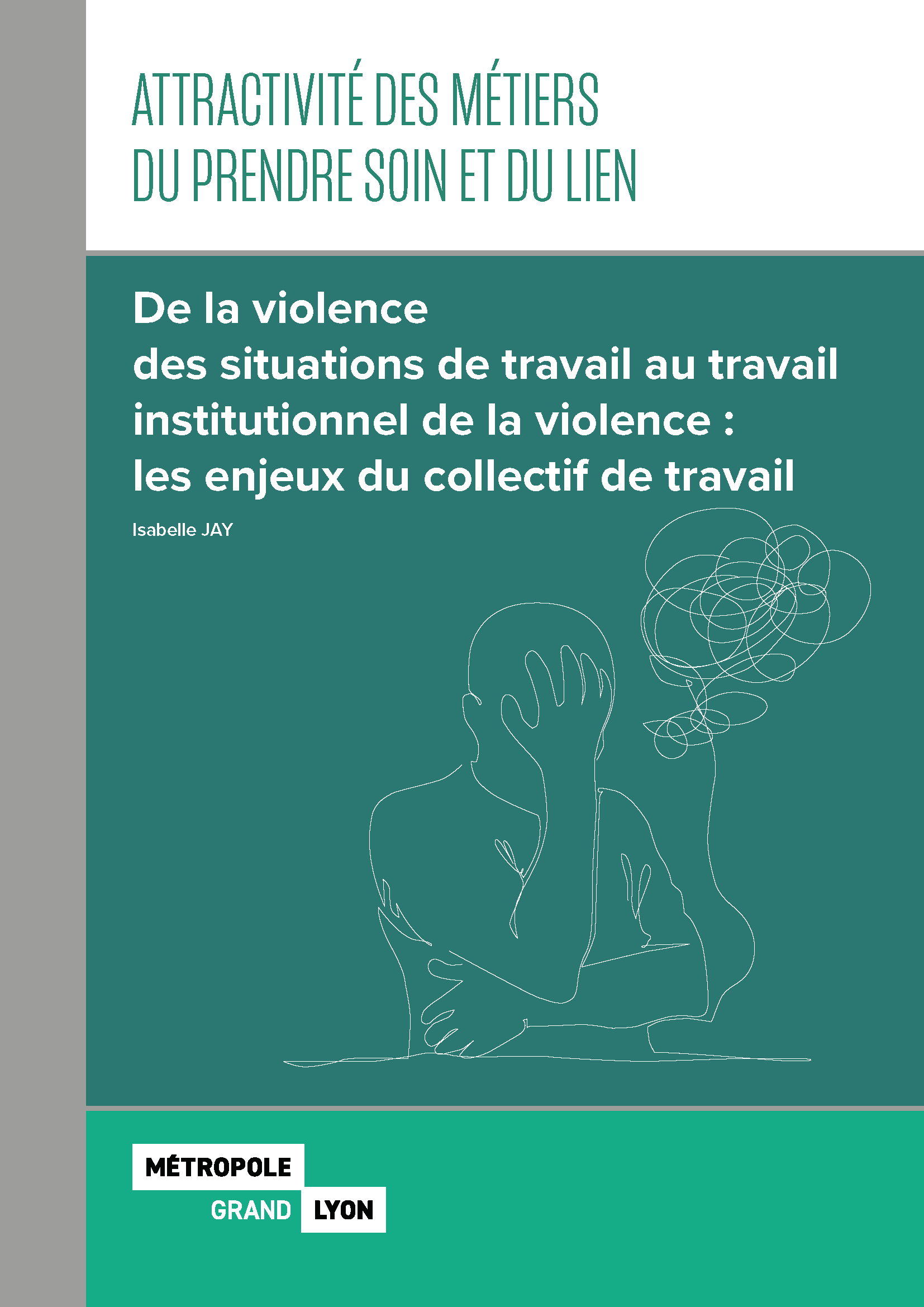Comment percevez-vous l’actuelle situation du logement social en France ?
Nous sommes dans une crise grave et profonde, mais on ne le dit pas. Certes, jamais autant de logements n’ont été construits. Mais très insuffisamment de logements sociaux, encore moins de logements sociaux accessibles et encore moins de logements sociaux adaptés aux modes de vie d’aujourd’hui. Résultat : il y a une inadéquation flagrante entre l’offre et la demande. Les dysfonctionnements sont autant quantitatifs que qualitatifs : les gens n’y rentrent pas et, ceux qui y sont, n’en sortent pas. Les nouveaux logements sociaux sont encore chers et de fait hors de portée de nombreux ménages (les deux tiers de la demande sur le Grand Lyon). Les taux d’effort explosent. Nombre de ménages ne peuvent plus bouger, en particulier d’une commune à une autre. Le logement social aujourd’hui ressemble à un train à l’arrêt où chacun reste figé dans son wagon. C’est dans ce contexte que le droit au logement opposable vient de se mettre en place…
Toutefois, quelques « lueurs modestes » existent ça et là grâce à des dispositifs d’agglomération et à l’intelligence des partenaires : les nouveaux logements sociaux permettent, par exemple, d’accueillir les familles à reloger issues des quartiers en restructuration urbaine en minorant les loyers grâce à des subventions accordées par l’ANRU (Agence Nationale pour le Renouvellement Urbain) aux organismes HLM, pour la production des logements PLUS CD (Prêts Locatifs à Usage Social - Construction Démolition). Cela permet de répondre à une partie de la demande. Mais d’énormes progrès restent à faire au regard de l’importance des besoins.
Quel est votre rôle et votre histoire au sein de la Mission habitat du Grand Lyon ?
Jusqu’à aujourd’hui La Mission habitat du Grand Lyon s’est donnée pour objectif d’augmenter la production de logements sociaux pour atteindre les 20% exigés par la loi SRU et ce dans une recherche d’équité entre les communes. L’objectif est poursuivi dans un esprit de solidarité, en veillant à respecter l’équilibre des territoires, une certaine « mixité sociale » et une amélioration du « vivre ensemble ». C’est également avec le même objectif que sont conduites les opérations de requalification des quartiers sensibles. Au sein de la Mission habitat, mon travail porte principalement sur la maîtrise d’ouvrage des observatoires (demande de logement social, flux, hébergement temporaire), sur le pilotage de l’unité de gestion des réservations du Grand Lyon (plus de 10 000 logements sociaux) ainsi que sur l’enjeu des attributions des logements de façon plus générale.
Je travaille pour le Grand Lyon depuis dix ans, mais je n’ai intégré la Mission Habitat que depuis quatre ans, après 23 ans de ce qu’on appelle aujourd’hui « politique de la ville ». Après avoir fait de la formation, j’ai démarré « ce métier » comme agent de développement dans les cités TASE (Textiles Artificiels du Sud Est) à Vaulx-en-Velin. J’ai ensuite été deux fois chef de projet politique de la ville à Chavanoz (agglomération de Pont de Cheruy, nord Isère), puis à Oullins. Enfin, entre 1986 et 1997, j’ai fondé et développé un bureau d’études (ADYS) sur les dynamiques sociales associées à l’aménagement et au développement des territoires. Il est certain que mon expérience à Vaulx-en-Velin au début des années 1980 m’a particulièrement marqué. J’occupais de fait une fonction de chef de projet, dénomination inexistante alors, et j’étais chargé d’accompagner l’opération Habitat Vie Sociale dans toutes ses facettes (restructuration de l’habitat, aménagement des espaces extérieurs, vie sociale, insertion par l’économique, actions culturelles (la ‘’fête du Sud’’ à l’œuvre encore aujourd’hui en est une émanation...).
En ce début des années 1980, comment s’envisageaient les politiques d’habitat ?
La loi Quillot -1982- instituait déjà le ’’droit à l’habitat’’, concept en évolution... mais précurseur du droit au logement opposable d’aujourd’hui… Les politiques de l’habitat n’étaient pas définies en tant que telles. Elles étaient (encore aujourd’hui, mais un peu moins) « noyées » dans « l’urbanisme » ou dans le « logement ». L’expérience des politiques de la ville a largement contribué à l’émergence de cette notion. Enfin, la notion même de programme local de l’habitat est apparue à la fin des années 80 dans la foulée de la LOV (loi d’orientation pour la ville). Malgré cela, tous les PLH de France ne sont pas encore totalement fixés dans leurs objectifs, montage, mise en œuvre, moyens, évaluation, territorialisation…S’agissant de la question des attributions des logements, la notion même de ’’peuplement’’ (les termes d’occupation sociale et mobilités sont préférables) en étaient à leur balbutiement. Je me souviens d’un immeuble où vivaient des familles avec de nombreux enfants. ‘’On’’ n’avait réuni que des grandes familles d’immigrés, peut être aussi quelque part avec leur consentements. Peut être était-il difficile de s’opposer?... Elles ne souhaitaient pas forcément rester ensemble, mais ‘’on’’ (le système) voulait aussi les voir rester ensemble... Cette situation m’avait marqué car ce n’était pas la première image que j’avais gardé de la France qui était plutôt celle d’un pays peuplé de personnes âgées. En effet, à mon arrivée en France depuis la Tunisie en 1973, lorsque j’errais dans la ville le dimanche, je ne voyais que très peu de jeunes... De fait, la vie sociale dans cet immeuble contrastait fortement avec d’autres réalités, en particulier avec le centre ville. À Chavanoz (nord Isère) où j’ai travaillé ensuite en tant que chef de projet, j’avais fait le même constat. Les grandes familles d’immigrés étaient regroupées dans un bâtiment (le bâtiment A) alors que de nombreux logements autour étaient vacants. Ainsi, la pratique d’attribution des logements consistait souvent à réunir les gens d’une même origine dans un même lieu. Cela arrangeait tout le monde ? En fait, il s’agissait surtout de regrouper ensemble les Arabes, les Algériens. Il est insupportable de loger des gens ensemble uniquement sur ce critère d’origine. À ce jour nous ne sommes pas encore totalement sortis de ce type d’impasse dans nombre de quartiers en France. Les gens ne devraient être logés qu’en fonction de leur demande de logement définie par le type de logement qu’ils souhaitent, son emplacement et les moyens du ménage. Tout autre critère d’attribution n’est pas pertinent et contribuera de fait à creuser les écarts entre les populations...
Cette politique n’était-elle pas une réaction spontanée face à l’arrivée des vagues d’immigration pour lesquelles personne n’était préparé ?
Certes les élus, les techniciens et les bailleurs ont été dépassés par les événements par manque d’anticipation et de politique d’accueil de ces nombreux nouveaux habitants. Mais les bailleurs ont été les premiers à construire et rechercher des solutions, des méthodes, de construire une proximité avec la population. Les premières agences (décentralisées) des bailleurs commençaient à fleurir ici et là (Minguettes, Vaulx en Velin en particulier…). De nouvelles figures professionnelles apparaissaient dans le paysage institutionnel : le chef d’agence HLM, les agents de développement, les chefs de projet. Les premiers grands conflits des banlieues, les rodéos, et les oppositions entre jeunes et forces de l’ordre au début des années 1980 ont été les accélérateurs de ces processus. Les mamans, dubitatives, regardaient les jeunes agir, sans colère, sans fierté, sans vraiment comprendre. Les élus, pas encore tout à fait présents, et surtout les organismes HLM, cherchaient maladroitement la bonne réaction face à cette forte concentration d’immigrés (polonais, siciliens, espagnols, portugais, algériens, français d’origine rurale…) qui générait de sourdes mais profondes peurs. À cette époque, la France ne connaissait pas, ne voulait pas connaître les étrangers, surtout pas les jeunes beurs. On ne les voyait pas encore. La marche des banlieues a été l’occasion de les rendre visibles à la France, même si ce n’était pas encore les BBB de 1998 !
L’État, les élus et les organismes HLM, les travailleurs sociaux, les associations, se sont retrouvés contraints de gérer des réalités nouvelles, complexes et des situations particulièrement difficiles à Villeurbanne, Bron, Vaulx-en-Velin, ou encore aux Minguettes à Vénissieux. Cette crise devait marquer l’histoire même des banlieues. Elle a participé à préfigurer l’avènement de la « politique et des contrat de ville » après Banlieues 89, le DSQ (Développement Social des Quartiers), et dans les années 90, l’apparition de façon plus forte de la figure du « politique » et des élus dans la ville. Parallèlement à ces mouvements et tentatives, nous avons assisté à une nouvelle tendance en matière de peuplement qui consistait à loger en priorité des personnes françaises, d’origine française, pensant ainsi éradiquer la montée de sentiments qui allaient nourrir le FN. On parlait déjà de démolition-reconstruction et, même si le terme n’était pas employé, l’objectif était celui de la mixité sociale en « rééquilibrant » le peuplement. Les techniciens (Vénissieux, Vaulx en Velin…) parlaient de « politique fine de peuplement » à la fin des années 80 début des années 90. Ils avaient déjà compris que ce n’était pas la couleur de la peau qui devait être le critère pour attribuer. Ce n’est qu’ensuite que des glissements sémantiques ont fait émerger la « mixité sociale » sans que les objectifs ne changent, sans que nous regardions les réalités en face.
Comment aujourd’hui abordez-vous ce concept de « mixité sociale » ?
Pourquoi doit-on parler de mixité, la France n’est-elle pas, de fait, un pays mixte ? depuis toujours ? Si l’on reprend notre histoire de France qui est un pays d’immigration, on mesure combien la population française a évolué au fils des vagues d’immigration. Sous le terme de « mixité sociale », on entend parfois priorisation à d’autres publics, et surtout pas de réponses (ou défavorables) aux personnes issues du Maghreb ou de l’Afrique noire, aux personnes d’une certaine couleur de peau ou qui ont un accent… C’est en tout cas vécu ainsi généralement par les personnes originaires de ces pays.
L’enjeu n’est pas la « mixité sociale », mais comment « vivre ensemble » et pourquoi pas, comment « mieux vivre ensemble » ? Les étrangers et surtout les « enfants français de parents étrangers depuis déjà plusieurs générations » sont là. Ils le sont durablement (institution du droit au regroupement familial par V.Giscard d’Estaing…). Ces Français et leurs familles c’est comme la mondialisation, certains veulent lutter contre, mais la mondialisation existe, c’est un fait, une réalité. On a peut-être trop tendance à utiliser des mots et à se rattacher à des « génériques » pour nier certaines complexités et masquer des positions plus difficiles à prendre. Or, l’enjeu qui s’impose aujourd’hui est celui d’un véritable examen de conscience. Nous sommes un pays mélangé, coloré, transformé par les diverses vagues d’immigrations de Pologne, d’Italie, d’Espagne, du Portugal, du Maghreb, de l’Afrique, de la Turquie, Asie du sud est… Elles ont toutes successivement alimenté, transformé et enrichi la population française. Il n’y a qu’à regarder les enfants dans les couloirs et les cours des écoles dans les grandes villes : la mixité est visible. La France a changé. Nous devons vivre ensemble cette nouvelle réalité sociologique. Or, et c’est assez schizophrénique, on demande encore aux « Français de parents immigrés, du Maghreb en particulier », une intégration totale en oubliant leurs racines et en les renvoyant sans cesse à leur différence ! L’enjeu n’est-il pas de faciliter l’enracinement des personnes issues de l’immigration en respectant leurs propres racines ? N’est-ce pas là aussi un enjeu de cohésion sociale tant attendu ? Comment une collectivité (ou des collectivités) peut-elle alors développer de vraies pratiques d’égalité de traitement, les seules à même d’exprimer et de développer la reconnaissance ? Une prise de conscience au plus haut niveau, la professionnalisation des acteurs, l’application du droit, l’égalité de traitement, pour toutes les actions du Grand Lyon et en toute circonstance, sont peut-être une des réponses à cette question. Dans le domaine du logement, cela veut dire, simplifier les démarches pour tous, construire un imprimé unique de la demande, un accueil professionnel, un enregistrement, une instruction des dossiers et des attributions de la même façon pour tous. C’est le sens du projet de fichier commun de la demande locative sociale porté par le Grand Lyon avec ses partenaires et les bailleurs sociaux en particulier. C’est dans ce sens qu’il est possible d’aborder aujourd’hui ce terme de mixité sociale et dans le souci d’action concrète pour plus d’égalité, car il ne sert à rien de rechercher la confiance ou l’adhésion des publics qu’avec des mots. Je terminerai là-dessus en affirmant ceci : oui à la « mixité » si on accepte de construire du logement social dans les secteurs les plus attractifs, les mieux desservis et fournis en services, de loger ensemble des riches et des moins riches, des jeunes et des moins jeunes… Oui à la « mixité » si on va dans le sens du logement pour tous y compris des étrangers, sur des critères de droit et des capacités économiques des personnes uniquement.
Nous savons combien tout cela est difficile à mettre en œuvre, mais je reprendrai bien la formule d’un sociologue (la misère du monde) sur ce propos : « Les lieux (l’école, la cité..) difficiles sont d’abord difficiles à décrire et à penser… », et j’ajouterai, que ce qui est difficile ce ne sont pas les quartiers, ce qui est difficile c’est aussi la vie des gens « licenciés par la vie » dans ces quartiers…
Pourquoi et en quoi votre expérience à Vaulx-en-Velin dans le début des années 1980 vous a-t-elle autant marqué ?
Probablement parce qu’elle m’a conforté dans ma perception profonde que l’habitat ce n’est pas qu’une histoire de béton, mais résolument celle de ceux qui l’habitent, qui désirent y habiter, et de ceux qui sont censés apporter des réponses. La prise en compte des personnes (les bénéficiaires) devrait être notre axe majeur de réflexion, d’intervention et d’actions. On a toujours associé les banlieues à une image urbaine, à des tours et des barres sans prêter réellement attention aux gens qui vivent dedans. Nos représentations, nos modes de faire, nos dispositifs sont construits sous l’angle de l’urbain, de la pierre et du béton. Or, ces quartiers, qui sont une loupe de la société, ont du « jus ». Certes, ils concentrent des personnes qui cumulent des difficultés, mais ils concentrent aussi des envies, des talents, des capacités de résistance et de combat devant les injustices, des comportements d’entraide et de solidarité. C’est dans ce quartier de Vaulx-en-Velin que j’ai appris la dimension socio-économique de la « ressource habitant » dans la construction de la ville et dont il est parfois possible d’évaluer l’apport. Pour illustrer mon propos, un exemple me vient à l’esprit. C’est celui de la négociation pour le maintien des jardins familiaux à la place d’espaces publics alors proposés par la collectivité. On peut facilement calculer le différentiel pour deux hectares… sans compter l’apport économique tangible de cette activité potagère pour les habitants.
Depuis ces années 1980, quelle évolution des modes de vie, des représentations et des réponses institutionnelles percevez-vous ?
Le monde a bien changé, il change encore et il change vite. Nous assistons à une accélération des évolutions des conditions de vie des personnes. Elles ne sont plus linéaires, que ce soit dans le domaine de l’emploi, de la famille, des loisirs et même de l’éducation. La vie est faite de ruptures, d’alternances entre l’emploi, la formation, le chômage. La famille est désormais à géométrie variable. Aujourd’hui, lorsqu’on se place du point de vue de l’institution ou des collectivités, il est impossible de trouver des réponses avec les schémas conçus formatés pour une population stéréotype des trente glorieuses, soit un couple qui travaille avec deux enfants « bien élevés »…. Nous sommes loin du compte avec la composition, décomposition, recomposition des ménages, les changements des cycles de travail et de vie, l’exclusion du travail, l’augmentation de l’espérance de vie… et l’installation durable d’étrangers devenus français à part entière dans notre pays. Ces nouveaux schémas imposent à la force publique de raisonner autrement, d’aller vers les gens, d’abord pour les écouter les connaître, proposer des actions adaptées sans démagogie et sans les illusionner. D’énormes progrès restent à faire en matière de lutte contre les discriminations. C’est pourquoi, il me semble impératif de chercher à être exemplaire dans les réponses, favorables ou non, dans l’application systématique du droit, dans l’égalité de traitement des personnes, en toutes circonstances et en tous lieux.
En même temps, il est nécessaire plus souvent qu’on ne le fait aujourd’hui de savoir sortir du cadre et des schémas habituels, de prendre des risque, de tester, d’expérimenter, d’innover, d’évaluer, de ‘’fabriquer du droit à la ville’’ car c’est dans l’intérêt commun, et re-rentrer dans le cadre sans forcément figer ou fixer définitivement les actions qui réussissent. Nous n’avons pas été éduqués, formés, ou préparés pour cela. Cependant, nos expériences, à l’exemple de celle du déracinement-adaptation que vit chaque immigré, à l’instar des ruptures que nous vivons (familiales, professionnelles, santé…), indiquent aussi qu’il est parfois nécessaire de sortir des sentiers battus pour faire face aux situations d’aujourd’hui. En dépit des souffrances qu’ils engendrent, le déracinement et les ruptures, peuvent aussi être mobilisateurs de nouvelles énergies. Ils sont parfois constitutifs d’une reconstruction parce que porteurs malgré tout d’un espoir et d’une réelle plus value d’expérience. En poussant les limites du cadre établi, j’ai par exemple conduit à Vaulx-en-Velin, une opération de construction de garages avec la SOLLAR (organisme HLM) et des habitants qui souhaitaient monnayer leur main d’œuvre contre la location gratuite d’un garage. L’idée semblait impossible au départ mais en adaptant le cadre, elle a pu se concrétiser. On peut citer un autre exemple à Oullins. L’école de la Saulaie se vidait peu à peu de ses élèves. Seuls les enfants des familles qui n’avaient pas les moyens de partir demeuraient dans cette école où la violence et l’échec scolaire se sont installés au quotidien. Devant cette situation de souffrance incroyable, et après de longues négociations avec les acteurs (les services municipaux, le Maire et son équipe, l’éducation nationale niveau local et rectorat, les autres écoles d’Oullins, les parents d’élèves concernés et non concernés, les associations, et les acteurs sociaux du quartier), la décision fut prise de fermer l’école et d’ouvrir les écoles du centre ville à ces élèves. La collectivité payant le transport et l’accompagnement. Le principe retenu était de ne pas laisser une telle situation persister, de considérer ces élèves comme les enfants de la ville, les jeunes de la cité de demain et de leur ouvrir les portes des autres écoles. Bien sûr, ces décisions sont lourdes car elles rencontrent d’énormes freins. Mais j’insiste pour dire que le cadre le permet. Il n’y a pas de recette miracle. Les réponses sont à construire à partir d’une analyse libre et profonde des situations, sans fuir les réalités et leur complexité, sans nier les oppositions et les conflits et surtout avec une ferme volonté de pendre ses responsabilités. C’est à mon avis, le rôle de tout porteur de mission de service public.
Ainsi, vous pensez que l’action publique est en mutation ?
Les évolutions récentes conduisent impérativement à des nouveaux modes d’agir. Mais prenons garde, ce qui réussit aujourd’hui n’est pas forcément amené à durer ou à faire durer éternellement. L’action publique ne supportera pas longtemps l’économie d’une évaluation permanente quitte à la construire et l’appliquer en marchant. Le temps de la réponse publique se doit aussi d’évoluer. En tant que parent d’élève dans un collège de Villeurbanne, je me suis battu pour qu’une cantine soit ouverte dans cet établissement de six cent élèves. Elle vient d’être inaugurée : 10 ans après !
Aujourd’hui, les habitants attendent des réponses plus rapides et souhaitent participer à leur élaboration, parce qu’ils ont un bout de la réponse et non par ce que c’est la mode d’aller vers les habitants. On le dit depuis plus de vingt ans… Ils ont besoin de toucher ce qu’ils font, car toucher c’est « exister », c’est être là, c’est aussi se prendre en charge. Les réponses se doivent donc d’être modulables et « malaxables » par les gens qui détiennent quelque part une partie de la réponse. Nous sommes donc déjà entrés dans de nouveaux schémas plus hybrides, plus complexes, moins linéaires. La tendance sociale est d’éviter les conflits « pour éviter les problèmes ». Mais il ne s’agit pas de faire le dos rond. Le déni des problèmes est la pire des solutions. La seule méthode, me semble-t-il, consiste à les affronter sans détours, sans a priori, mais avec humilité, parce que les questions sont complexes et que les recettes toutes prêtes n’existent pas. Elles sont à fabriquer au fur et à mesure. De toute façon, il y a un besoin évident d’entrer dans l’ère de la négociation. Ce n’est pas une nouveauté, mais les différents conflits sociaux dans notre pays montrent à chaque fois que nous ne sommes pas sur des schémas de négociations. Dans les pays nordiques, ce que font les partenaires sociaux est intéressant car ils investissent les conflits pour les réguler. Ils sont dans la négociation, les uns reconnaissant les autres, à partir de points de vue différents. En France, il est difficile d’exister sans s’opposer. Comment réagir après des émeutes de banlieues ? Faut-il accorder des financements pour calmer les tensions et avoir la paix ? « Surtout pas de vagues » ? Mais il y a de belles vagues, de belles opportunités pour progresser. Les conflits permettent aussi d’avancer. Nous sommes dans un pays neuf qui fonctionne sur des représentations anciennes et des modalités d’action dépassées mais où, je le redis, le cadre d’action existe. Il suffit de l’appréhender différemment, de titiller ses limites, de ne pas avoir peur de prendre des risques, ni d’utiliser des modes de faire avec des outils ou des points d’appui qui ne demandent qu’à entrer en musique... Cependant, ceux qui sont au pouvoir aujourd’hui en France sont en grande majorité issus du baby boom des trente glorieuses, et ils donnent parfois l’impression d’être assez éloignés de ces nouvelles réalités. Admettons le, une bonne fois pour toute : nous vivons un pays neuf, une nouvelle France, colorée, cosmopolite, mais avec un système ancien, des schémas et des représentations qui ne collent plus. Il faut progresser, oser, sortir des sentiers battus, innover, expérimenter, évaluer, tout en restant solidaires. Et, face à l’actuelle crise du logement, nous n’avons peut-être pas beaucoup d’autres choix.
A l’inverse des baby boomers au pouvoir, les jeunes perçoivent-ils mieux les réalités du monde ?
Il ne s’agit pas d’opposer les uns aux autres. Certains sont plus dans la transmission (tout en étant en apprentissage permanent), les autres sont davantage dans l’apprentissage (avec des ressources mobilisables).
Les jeunes sont-ils plus solidaires, plus tolérants ? Sont-ils plus en phase avec les réalités d’une France colorée ? Comment cherchent-t-ils à comprendre et décoder le monde d’aujourd’hui ? Difficile d’apporter des réponses avec certitude.
En tout cas, ils sont très nombreux à être victimes d’un certain racisme anti-jeunes. Etre jeune aujourd’hui, c’est aussi se faire arrêter par la police plus souvent que les autres, encore plus lorsqu’ils sont « colorés », c’est se faire exploiter dans le travail plus que leurs aînés, c’est avoir des horizons fermés. Les jeunes sont le présent du pays. Mais, ils sont aussi le futur. Ils ont l’énergie pour construire déjà le monde de demain, comme leurs aînés de mai 68 ont quelque part construit celui d’aujourd’hui ?
Nous évoquons la jeunesse comme une globalité. Il convient néanmoins de mesurer le risque de les figer dans une catégorie, comme d’autres classes d’âge, ou d’autres catégories, en fait de plus en plus hétérogènes. C’est pourquoi, il est nécessaire d’aller vers, d’écouter, de comprendre, de reconnaître, de corriger, de se corriger, de sortir des schémas, mais aussi de rester dans l’exemplarité et l’humilité. Mais, et c’est une des grandes difficultés, l’enjeu pour l’action publique porte sur sa capacité à intégrer à la fois le court et le long terme. La prise en compte de ces données doit alimenter la définition de stratégies pour une politique de l’habitat adaptée aux besoins des populations différentes et en mouvement : vaste programme !
La Mission Habitat du Grand Lyon conduit-elle une politique spécifique en faveur du logement des jeunes ?
Je dois dire que le « logement des jeunes » n’est pas directement mon domaine. Néanmoins je peux rappeler quelques chiffres qui me paraissent explicites : entre 2003 et 2006, la demande de logement social des jeunes de moins de 30 ans est passée de 35% à 28% de la demande totale (46 000 en 2006) de logement social dans le Grand Lyon.
Ont-ils d’un coup trouvé plus facilement un logement ? Se sont-ils détournés de ce type de demande ? Se sont-ils autocensurés présupposant qu’ils n’auraient de toute façon aucune chance d’obtenir un logement ? Leurs horizons économiques se sont-ils progressivement fermés ?
Dans le même temps et sur dix ans, l’observatoire de l’habitat transitoire a révélé « une tendance notable au rajeunissement des demandeurs d’hébergement. Les moins de 30 ans sont sur-représentés dans la demande depuis 1997. Parmi eux, les 18-24 ans sont les plus nombreux alors qu’ils ne constituent que 10,7% de la population du Rhône en 1994 ».
Il y a bien une difficulté et une fragilisation du public jeunes par rapport au logement. Ceci dit, nous n’avons pas encore développé de politique ciblée sur certains publics comme celui des jeunes. Alors qu’il serait intéressant d’envisager une politique ciblée, entre autres, en direction des jeunes afin de faciliter les décohabitations, la prise effective d’autonomie, mais aussi leur faciliter une place dans la ville en partant de leurs attentes, de leurs points de vue, et de leur moyens de plus en plus modestes. Pour aller fortement dans ce sens, on peut imaginer une expérimentation sachant que le Grand Lyon (ou d’autres institutions) aurait tout à gagner par exemple à lancer un concours national, voire international pour la construction expérimentale et massive de logements pour les jeunes, pas chers et modernes, comme l’ont fait par exemple les Pays-Bas. Ce serait l’occasion de provoquer une réflexion à l’échelle de la métropole, d’identifier les vrais blocages, de provoquer une implication forte des investisseurs, des collectivités, de grands ou petits groupes d’ingénierie.
Le même type d’expérimentation pourrait porter sur d’autres sujets et je n’en citerai qu’un exemple : quel produit logement ouvrirait la porte à des publics exclus comme les personnes handicapées, les personnes âgées, et ce, dans des logiques de logement inter générationnels ?
Mais il faut reconnaître que des réponses sont possibles faisables et économiques. On peut imaginer par exemple de programmer dans le domaine du logement une douche plutôt qu’une baignoire pour un logement sur deux ou sur trois. Avec un logement accessible pour un fauteuil roulant et avec des couloirs un peu plus larges, on ouvrirait la porte à du logement hlm ordinaire (plutôt que de financer dans le vague) à un nombre très significatif de personnes handicapées, âgées… ceci avec une facture d’eau nettement inférieure. Toutes les statistiques et le bon sens le disent depuis des années…n’est ce pas une entrée concrète dans le développement durable social et économique ?
C’est probablement là aussi que le Grand devrait se positionner en tant que prescripteur. Mais il devrait le faire en jouant un rôle de facilitateur (ici vis-à-vis des hlm, des groupes de pression d’ingénierie, ou des associations) et non pas en tant que centralisateur au sens strict dans la mise en œuvre de nouvelles politiques adaptées aux modes de vie.