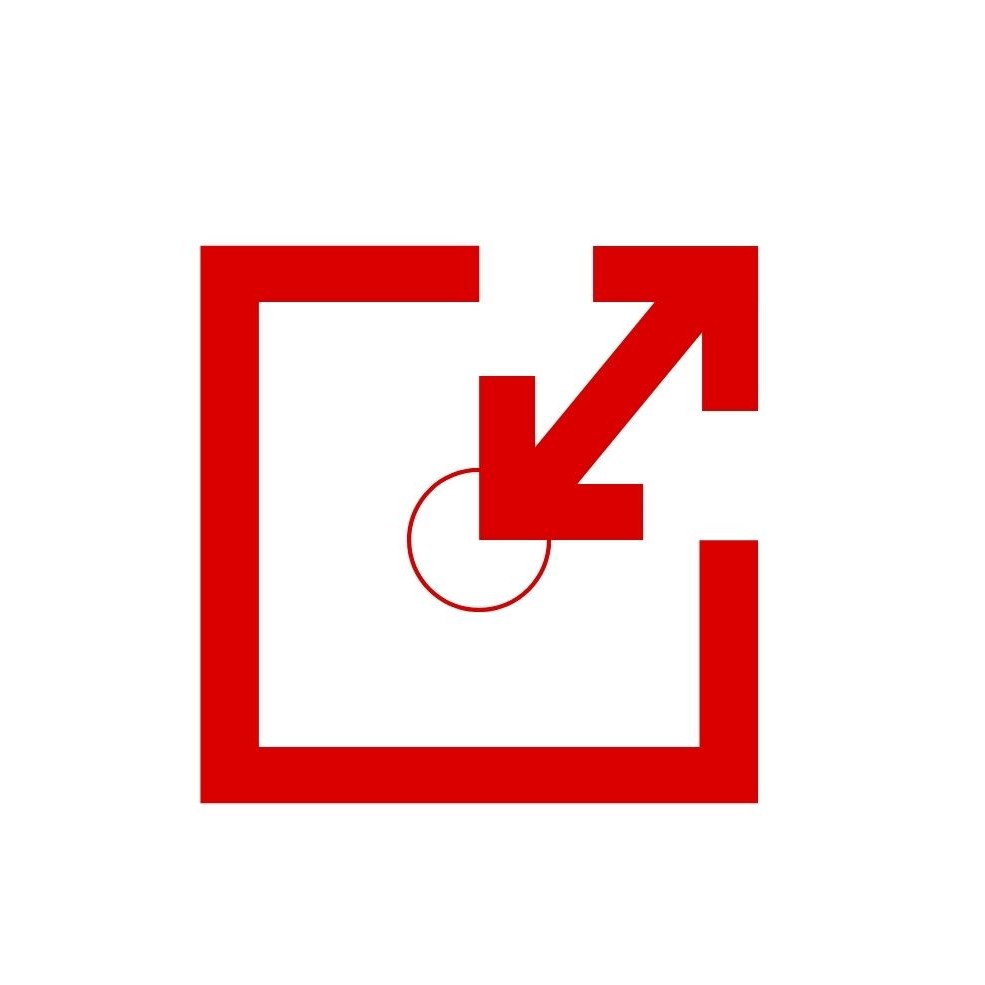Comment la question du risque a-t-elle fait irruption dans vos thèmes de recherche ?
J’y suis arrivée un peu par hasard, à une époque où ce thème était peu étudié. Je travaillais sur les politiques de développement local, c’était le début de la décentralisation. Les cadres concrets et théoriques de l’action publique étaient en pleine recréation, l’Etat central était descendu de son piédestal, et l’on assistait à une tentative de recréer de nouvelles légitimités, de nouveaux cadres d’intervention pertinents (pays, quartiers…), de nouvelles certitudes, en quelque sorte. Les chercheurs en sciences sociales prenaient facilement parti pour ces nouvelles entités délibératives. En travaillant sur les politiques d’attribution territorialisée des logements HLM, je me suis rendu compte qu’avec la décentralisation, le droit devenait plus flexible, construit localement… ce qui pouvait être considéré comme bénéfique, et à la fois comme ouvrant aussi un certain nombre de questions. A un moment donné, un contrat de recherche m’a amené à côtoyer des ingénieurs hydrauliciens, à propos de la gestion des inondations. J’ai été séduite par le rapport à leur objet. Contrairement aux chercheurs en sciences sociales armés de certitudes, ils étaient confrontés à l’incertitude et se posaient des questions semblables aux miennes, car au travers de la gestion des risques, c’est la question de la confrontation à l’incertitude qui se pose ! J’ai conduit plusieurs travaux sur le thème du risque, au départ sur la question de l’eau, de l’assainissement pluvial, des inondations.
Quels changements percevez-vous dans le rapport des acteurs publics aux risques, depuis 20-30 ans ?
Nous avons montré avec P. Vidal-Naquet, J.-P. Galland et J. Theys, dans un séminaire prospectif praticiens-chercheurs organisé par la Délégation à la Recherche et à l’Innovation du Ministère de l’Equipement qui a débouché sur l’ouvrage “conquête de la sécurité, gestion des risques” (1991), que nous sommes passés d’une phase, initiée au 19ème siècle, que nous avons appelée celle de “conquête de la sécurité”, où il s’agissait d’éradiquer le danger en s’appuyant sur la science, avec la croyance-clé qu’il existe chaque fois une solution possible pour arriver à la sécurité, à une phase de “gestion du risque”, où l’on gère la complexité. A partir des années 80, le risque est appréhendé dans un contexte global où interviennent d’autres risques ou enjeux, où l’incertitude règne, où il est moins possible de s’appuyer sur la science et les techniques pour avoir des solutions. Dans cette phase qui est la nôtre aujourd’hui, les solutions doivent être négociées et contextuelles, ce qui favorise le débat public, mais pose aussi des problèmes (le fait de déboucher parfois sur des consensus mous et instables par exemple).
J’ai théorisé cette évolution en parlant de pragmatisme dans les politiques publiques . Je faisais l’hypothèse que nous avions adopté une gestion pragmatique du risque, qu’il s’agisse tant du risque industriel, naturel ou des insécurités urbaines.
Pouvez-vous illustrer la différence entre les deux approches, recherche de sécurité d’un côté et gestion du risque de l’autre ?
A la suite des inondations de Nîmes d’octobre 1988, j’ai engagé une recherche, à la demande du Ministère de l’Équipement pour établir comment, après la catastrophe, les acteurs locaux appréhendaient le risque d’inondation et avaient mis en place une politique de prévention.
Avant la catastrophe, on percevait à Nîmes le risque d’inondation de manière étroite : les rivières débordent et causent des dommages, il faut les empêcher de déborder. En réponse à ce danger, on pensait qu’il suffisait d’intervenir sur le lit des rivières en busant, couvrant, ou élargissant le lit, en édifiant des digues, etc. C’est l’illusion sécuritaire : face à un phénomène et ses effets dommageables, est engagée une action de défense qui tente d’annuler le danger, de le neutraliser, grâce à la mobilisation de moyens techniques. A Nîmes, les habitants avaient oublié qu’il y avait des cadereaux (nom local que l’on donne aux cours d’eau temporaires) qui pouvaient dévaler les pentes de la colline, et converger vers le centre-ville. La politique de sécurité maximale avait abouti à occulter le risque. L’optimisme excessif vis-à-vis de ces dispositifs avait contribué à émousser la vigilance des acteurs publics et habitants, qui, en confiance, avaient construit dans le lit majeur des rivières, contribuant à accroître la vulnérabilité... Cette illusion a conduit à la catastrophe : le matin du 6 octobre 1988, à la suite de pluies diluviennes, la ville de Nîmes était envahie par les flots des cadereaux qui dévalaient des collines. Les cadereaux, couverts car ils débordaient régulièrement dans les propriétés, ont littéralement explosé en raison de la violence de l’orage !
Cette catastrophe a démontré l’intérêt d’adopter une politique de gestion du risque ?
Effectivement, quand on passe à une politique de gestion du risque, il devient nécessaire de prendre en compte l’ensemble des données, d’afficher les risques, de mettre en place toute une série de mesures pour les prévenir (mesures techniques, systèmes de veille, encadrement de la construction, etc.), inventer finalement des solutions complexes qui acceptent une dose “acceptable” de risque… car il est impossible d’annuler le risque. Dans ce modèle, il y a forcément du débat. La décision doit ménager différents types d’intérêts, répartir contraintes et avantages… Les solutions ne sont plus énoncées par les seuls experts, mais négociées, ce qui ne veut pas dire qu’elles ne génèrent pas de conflits et de mécontentement, par exemple lorsqu’est décidée la démolition des habitations construites le long des cadereaux nîmois ! Mais pourquoi interdire ici et non pas là ? Cette démarche conduit à politiser le débat, à le sortir de la seule dimension technique. Il faut prendre en compte une foule d’aspects de la question, où l’interaction est la règle : comment interdire de construire sans entraver le développement économique ?, etc. On entre dans la gestion de la complexité.
Pouvez-vous expliciter davantage ce que signifie pragmatisme dans la gestion des risques par les acteurs publics ?
Le pragmatisme est une tendance forte des politiques publiques, en France, tendance liée à la crise de l’Etat providence et aux croyances qui le soutenaient. Il se traduit par trois basculements.
Premièrement, le pragmatisme se traduit par la relative indétermination des finalités de l’action au départ : la signification de l’action se construit en marchant, au fur et à mesure du résultat de l’action, alors que dans le modèle du conquête de la sécurité on sait que l’on veut : la sécurité !, et on se place dans l’idéal d’un monde intelligible, dans lequel l’incertain n’appartient pas à la nature des choses mais aux limites de notre connaissance.
Deuxième point, on insiste sur la procédure, sur la manière dont il s’agit de décider, plutôt que ce dont il s’agit de décider. En schématisant, on ne dira plus : le niveau de pollution ne doit pas être supérieur à tant, mais on définira au travers d’une commission, de manière procédurale, la manière dont on décide le risque acceptable de pollution, cette notion de risque acceptable étant une définition éminement pragmatique. Les moyens ne sont plus subordonnés à une fin bien identifiée.
L’indétermination porte aussi sur la place à accorder à l’objectif de sécurité par rapport à d’autres objetifs, par exemple dans le débat dans la vidéosurveillance : sécurité versus liberté. En rupture nette avec les formes d’intervention centralisées et impératives, les modes d’action sont plus ouverts, capables de se modifier en cours de route. Il y a une conscience nouvelle de la complexité des systèmes techniques et sociaux, conscience aussi des interdépendances.
Troisièmement, le consensus vient comme garantie, et non pas la science. C’est l’idéal d’un compromis élaboré de manière ouverte, à la suite d’une délibération. Dans les faits, ce n’est pas vraiment le cas, l’opacité est la règle.
Vous avez confronté ce modèle à des terrains d’enquête ?
Ponctuellement. En réalisant une enquête sur le saturnisme infantile, je me suis penchée sur les politiques locales. Avec P. Vidal Naquet et G. Decrop, j’ai également participé à un travail intitulé “les scènes locales du risque”. Nous avons étudié plusieurs scènes où se gérait et se négociait le risque, en l’occurrence des risques naturels et industriels (glissements de terrain, risque d’inondation, risque nucléaire…)
Quels enseignements en avez-vous tirés ?
Nous avons remis en cause l’idée de départ selon laquelle existeraient des “scènes locales” : la métaphore théâtrale suggère une scène, des coulisses, une mise en scène, des acteurs, finalement que les interactions préalables au décisions relatives aux risques se jouent à découvert, sous les yeux du public, alors que ce n’est pas le cas. L’ouverture à la concertation est modeste, la publicisation des arbitrages en matière de prévention ou des préconisations est au cas par cas, les scènes du risque baignent dans une certaine opacité. Ceci dit, l’action préventive est plus affichée (publicité des cartes d’aléas en 1982, information globale des citoyens…) et les citoyens et usagers ont un rôle accru.
Nous n’avons pas comparé ces scènes locales et les modes de gestion des risques mis en place par les autorités publiques.
Dans “Saturnisme infantile et action publique” (L’Harmattan 2003), vous faites le récit de l’émergence d’une politique publique de lutte contre le saturnisme infantile. Vous montrez comment, dans l’agglomération lyonnaise, s’est mis en place un mode original de coopération permettant de gérer de manière pragmatique le risque saturnin.
La configuration des acteurs lyonnais a produit des solutions spécifiques. Contrairement à ce qui s’est fait à Paris, le saturnisme infantile est défini d’emblée comme un problème médical et social. Conséquence : pour le résoudre, la question du logement est centrale.
L’Association Lyonnaise pour l’Insertion par le Logement (ALPIL) a d’ailleurs joué un rôle important (mais non exclusif) dans cette affaire. Elle est intervenue en tant qu’opérateur d’actions relatives au logement de personnes défavorisées. Elle voulait éviter que la lutte contre le saturnisme conduise à une diminution supplémentaire du parc de logements privés à faible prix en centre-ville, qui joue le rôle de parc social. Soutenue par d’autres associations, elle avait le souci d’éradiquer la cause du risque, à savoir l’insalubrité de l’habitat. Après maintes péripéties, la gestion individualisée des cas (par des réunions collégiales) permettra d’adapter l’intervention à la gravité sociale des situations. Cette gestion fine prend en compte l’ensemble des paramètres : relations des locataires avec les bailleurs, désir de relogement des familles, solvabilité des familles… Vis-à-vis des propriétaires, selon les rapport de forces, l’ALPIL joue soit sur l’incitation soit sur la contrainte. L’ALPIL cherchait finalement à combiner l’objectif de réduction du risque et l’objectif de mixité sociale au centre-ville.
Voyez-vous dans cette gestion pragmatique du risque, centrée sur la recherche des solutions efficaces, une caractéristique de la scène lyonnaise ? Y-a-t-il à votre sens une spécificité des acteurs en région lyonnaise dans le rapport au risque et sa gestion ?
Il est indéniable que les acteurs lyonnais ont géré le risque de manière pragmatique. Mais c’est plutôt une conjonction de facteurs : La personnalité des acteurs et le mode de travail des équipes en présence d’abord. L’ingénieur sanitaire, chef du service départemental d’hygiène publique à la DDASS était une femme très ouverte et pragmatique, convaincue qu’il était de sa responsabilité d’agir sur les causes de la maladie, donc sur l’insalubrité. Elle a pris des risques, a discuté avec l’ALPIL, et s’est servie de l’ALPIL comme l’ALPIL s’est servi d’elle pour aller vers une solution… Les trois acteurs principaux sur cette question du saturnisme infantile étaient à Lyon la DDASS, l’ALPIL, et la mairie de Lyon (au travers de son service d’hygiène) ; ils ont su travailler ensemble. A la DDASS de Paris, la direction était débordée par les associations et ne savait pas du tout travailler avec elles.
Mais si la politique locale de lutte contre le saturnisme a pu se mettre en place de cette manière à Lyon, c’est aussi qu’il y avait une “possibilité de jeu” pour gérer cette complexité. A Paris, il y avait beaucoup moins la possibilité de trouver des logements pour des familles nombreuses. Le travail de l’ALPIL a sans doute été rendu possible parce qu’elle disposait de marges de maneuvre. A Paris, une association de ce type aurait sans doute été obligée d’occuper des squatts, de se placer dans une position contestataire, n’ayant finalement pas d’autres moyens.
Au-delà des personnes, voyez-vous des cultures qui imprègnent ou encadrent les jeux d’acteurs ?
La gestion du risque devenant pragmatique, elle dépend des contextes locaux. L’impossibilité de fixer a priori les objectifs et les moyens à mettre en place invite à renvoyer au local la résolution des problèmes. Or, au niveau local, les cultures du risque revêtent des formes très diversifiées. Elles dépendent des facteurs sociaux, des territoires, des enjeux en cause, des relations sociales et des logiques institutionnelles, et de la perception individuelle et collective du danger. En fonction des contextes locaux, la résolution des risques prend des formes extrêmement diverses.
La crainte du risque se manifeste-t-elle davantage au niveau des risques sanitaires, qu’à celui des risques industriels et naturels ?
Les alertes sanitaires ont plus d’impact sur l’opinion qu’un accident localisé, y compris un accident industriel grave, ne serait-ce que parce que les questions sanitaires touchent tout le monde : c’est ce que l’on appelle les “risques réseaux”. Sida, grippe aviaire… on est tous potentiellement concernés.
Va-t-on vers une société de plus en plus sécuritaire ?
Non, sécuritaire veut dire cloisonnement, enfermement, blindage. J’ai l’impression que nous vivons de plus en plus avec l’incertitude, sans sécurité totale.