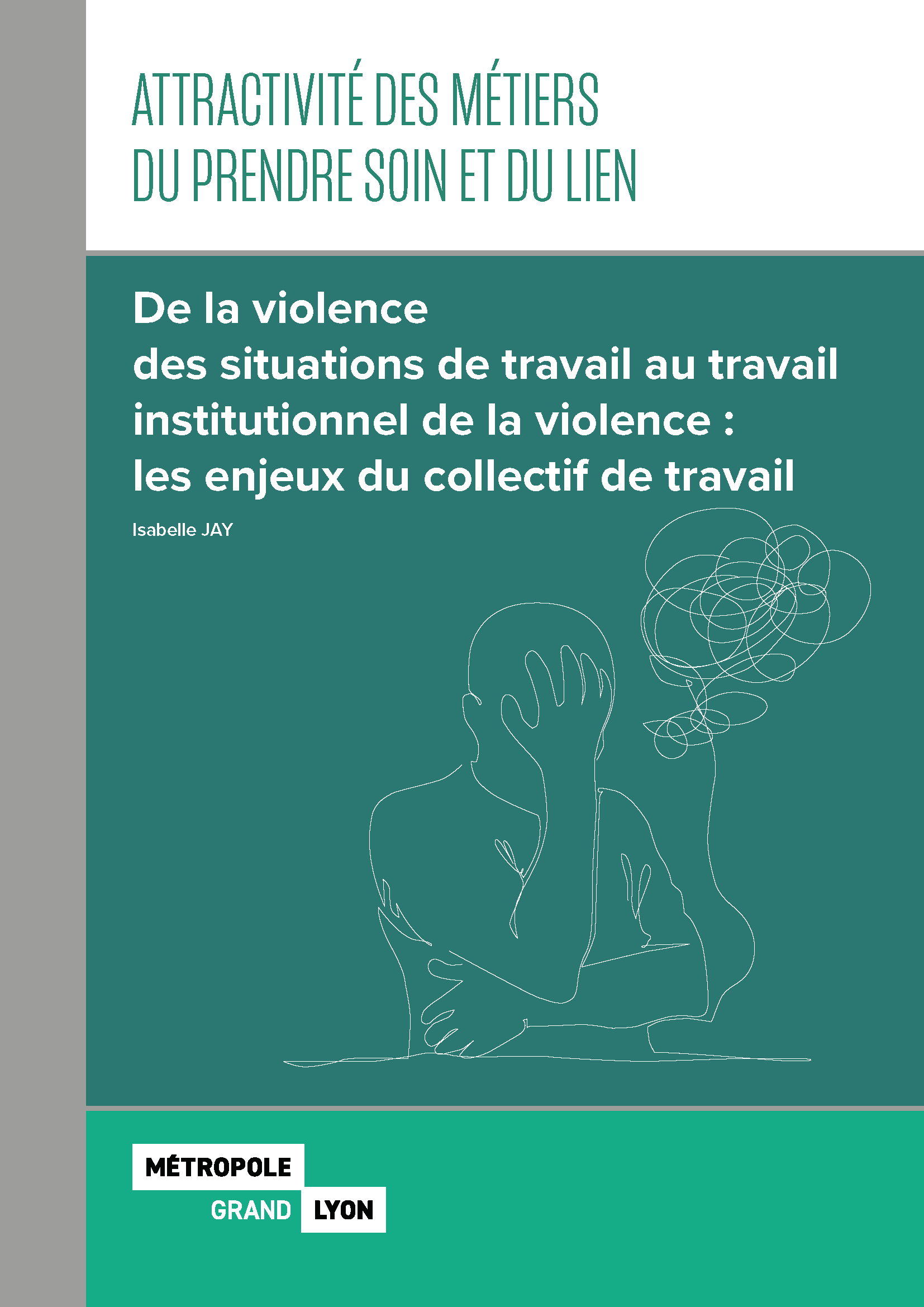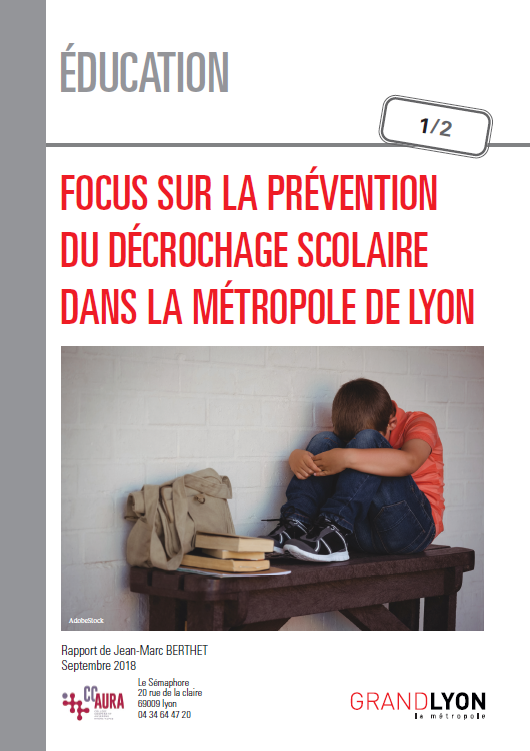L’un des grands bouleversements que l’on vit aujourd’hui réside dans le fait que notre société est devenue une société d’individus, alors qu’elle était auparavant plutôt constituée autour de collectifs. Quels sont, d’après vous, les points les plus révélateurs de cette transformation ? Comment ce passage à la société des individus se traduit-il ?
En préambule, il faut d’abord préciser que ce « passage » dont vous parlez se situe, en réalité, dans un processus au très long cours. L’individuation débute en fait dès la naissance de l’humanité, avec l’émergence de la conscience de soi présente en chaque homme. Il est d’ailleurs intéressant de constater que le terme « individuation » est employé par des préhistoriens et des anthropologues. Simplement, longtemps la société dans laquelle vivaient les hommes n’était pas une société des individus, mais une communauté. Dans ce modèle de la communauté prime la « solidarité mécanique », l’appartenance mécanique au groupe, pour reprendre les termes d’Emile Durkheim. Les membres de la communauté sont solidaires parce qu’ils sont semblables, parce qu’ils vivent de manière presque identique, dans les mêmes conditions. Aujourd’hui, au terme du processus d’individuation, la société des individus est une société très différenciée où les statuts, les rôles, les compétences des uns et des autres sont très variés, où chacun a besoin des différences de l’autre, où la solidarité est devenue « organique ». On est ainsi progressivement passé de la communauté, où le groupe prime sur l’individu, à la société, où la conscience de soi précède la conscience d’appartenir à un groupe, comme l’écrit Norbert Elias. Ce qui prime désormais, c’est l’individu, le sujet qui se définit par son individualité, son historicité, et qui est responsable de son destin. De ce point de vue, le glissement sémantique du terme « sujet », d’abord synonyme de subordination à travers l’expression « le sujet du roi », au sujet acteur et responsable de soi, est éloquent.
Cette figure de l’individu émerge dans tous les champs de l’existence. A l’artisan succède l’artiste qui signe ses œuvres de son nom. Dans le champ politique, on voit se constituer les Etats, la société civile, l’espace public composé d’individus qui se définissent individuellement par leurs droits et leurs devoirs. On voit émerger les droits de l’homme, mais aussi de la femme, de l’enfant, des minorités, etc. On assiste à la sérialisation sans fin des libertés et des droits. Dans le domaine du travail, on sort de l’organisation corporative avec la loi Le Chapelier qui rend le travailleur libre de vendre sa force de travail (mais aussi de se faire exploiter puisqu’elle empêche en même temps la constitution des syndicats). Dans la vie amoureuse, on passe du mariage obligé entre clans ou du mariage arrangé entre familles, au mariage entre deux êtres qui se choisissent. Au sein de l’univers familial se développent des espaces qui participent à la construction de l’intimité de chacun. Ceci est perceptible dans les modes d’habiter : chaque membre de la famille possède, dans l’appartement familial, un micro-territoire en propre.
L’époque moderne, c’est donc bien l’époque de la construction de l’individu, où ce qui fonde la représentation de la société, c’est bien le « je », certes en lien avec les autres, mais où les autres sont dans une extériorité par rapport à soi. Certains pensent que l’on est arrivé aujourd’hui au bout du processus d’individuation, et qualifient l’individu de « post-moderne ». Pour ma part, je partage plutôt la thèse d’Anthony Giddens qui défend l’idée d’un individu « hyper-moderne », dans la continuité du processus de changement que j’ai décrit précédemment.
Quel regard portez-vous sur ces évolutions ? Constituent-elles plutôt une « avancée » pour notre société, ou portent-elles des facteurs d’inquiétude ?
Pour moi, la question principale n’est finalement pas tant de savoir si cela est mieux ou moins bien qu’avant, mais plutôt de savoir quelles sont les conséquences de ces changements, et comment peut-on vivre avec.
Pour autant, il me semble qu’aujourd’hui, on peut affirmer la positivité de l’individuation de la société. Quoique l’on en dise, les libertés individuelles sont maintenant acquises, et par là, les hommes ont conquis leur liberté. Et je crois qu’il vaut mieux être libre que de ne pas l’être. Pour reprendre l’exemple du mariage, ne vaut-il mieux pas choisir son mari ou sa femme que se le voir imposé par la communauté à laquelle on appartient ? Pour reprendre l’exemple du passage de l’artisan à l’artiste, je ne sais pas si l’artiste est supérieur à l’artisan. Pour autant, le fait qu’il se définisse comme sujet acteur, qu’il se libère de certaines règles du jeu, est positif.
On assiste aujourd’hui à l’ouverture des possibles qui témoigne de la liberté des individus. Certes, ce qui fait notre liberté fait aussi nos problèmes, mais on ne peut pas pour autant en conclure qu’il vaut mieux ne pas être libre.
Avec le développement de la société des individus se pose la question du lien social. Il n’est plus aujourd’hui imposé à ses membres par la communauté, il ne va plus de soi. Et pour autant, une société sans lien serait menacée d’éclatement. Est-on justement menacé, comme le disent certains auteurs, d’atomisation de l’individu ? Comment peuvent se créer ces liens aujourd’hui ?
Il existe en effet une lecture un peu catastrophiste de cette évolution, qui constate que chacun est livré à soi-même, qu’il y a beaucoup moins d’échanges, de solidarité entre les gens. Certes, les cadres collectifs qui structuraient les relations entre les individus, qui leur permettaient d’être en lien en permanence, n’existent plus.
Cependant, on ne peut pas dire non plus qu’on est dans une société où chacun est seul face à soi-même. Il existe au contraire de très nombreux liens, facilités par des moyens de communication très variés, rapides et performants. N’est-on pas dans du lien social lorsque deux adolescents qui ont passé leur journée ensemble se téléphonent, et échangent sur Internet dès leur retour du collège ? Avec les nouveaux moyens de transport, ne peut-on pas très facilement aller voir des proches qui sont loin ? Le lien social existe et passe donc par les moyens de communication qui délocalisent complètement la relation. L’évolution technologique donne aujourd’hui à l’individu une totale mobilité, une totale capacité à être seul, tout en étant en lien avec les autres.
Pour autant, puisque ce n’est plus la communauté qui prend en charge les individus, et que revient à chacun la possibilité d’établir des liens avec autrui, cela ne va pas sans effort. Anthony Giddens développe l’exemple des relations d’amitié entre adultes. Différentes des relations familiales, ce sont des relations électives, qui ne sont donc pas obligées. Il montre que le fait d’entretenir son réseau d’amis est rendu possible avec de multiples modes de communication, mais comment aussi cela nécessite un surcroît d’énergie et de temps. Cela nécessite d’être en permanence dans le souci de la relation aux autres, ce qui implique aussi d’être dans le souci de soi.
Il en est de même pour le vivre ensemble : comme aujourd’hui, il ne va pas de soi, il faut le construire, il faut l’entretenir. Comment faire ? C’est une des grandes questions d’aujourd’hui. En tout cas, ce n’est pas dans les tentatives de reconstitution des communautés que l’on trouvera une issue. Je crois plutôt, en suivant Alain Touraine, qu’il faut pousser le plus loin possible l’individualisation de la société, car elle est la base sur laquelle peuvent se construire la solidarité et la fraternité. Il n’est possible de construire du vivre ensemble que par la construction du sujet, que par la pleine et entière conscience de soi. Pour le dire autrement, il me semble que la construction du lien social dépend vraiment de la construction du sujet.
L’individu hypermoderne doit donc être sujet acteur, auteur et responsable de ses choix, de sa vie sociale, de sa trajectoire professionnelle, de son état de santé, de son destin, etc. Comment peut-on soutenir cette construction de soi ? Comment éduquer l’enfant pour qu’il puisse conquérir son autonomie ?
La conquête de l’autonomie du sujet, le fait de devoir « être à la hauteur », sont des notions qui n’ont de sens que dans la société des individus. Et il est très épanouissant d’être autonome, de se sentir « à la hauteur ». Mais cet épanouissement à un prix ; il est difficile et exigeant de l’atteindre. Et c’est pourquoi, Alain Erhenberg définit la dépression, maladie de la fin du XXème siècle, comme « la fatigue d’être soi ». La réflexivité permanente que nous devons avoir sur nous dans un tel contexte est très certainement fatigante. Et elle est plus difficile encore pour les individus fragilisés qui sont en risque d’exclusion.
Alors, comment faire pour éduquer à l’autonomie du sujet ? Il me semble que c’est l’une des grandes missions que s’est donnée notre école actuelle, au travers notamment de l’approche pédagogique de l’appropriation des connaissances.
Aujourd’hui, l’école diffère fondamentalement du modèle de l’école traditionnelle en partie fondée sur l’idéal de Jean-Baptiste de La Salle - le fondateur de l’Institut des frères des écoles chrétiennes. Celui-ci posait comme un idéal à atteindre le modèle du maître qui n’aurait jamais eu à parler, dont les signes et la gestuelle auraient permis aux élèves de savoir ce qu’il attendait d’eux (écrire, recopier, aller au tableau, etc.). Bien entendu, les élèves n’avaient pas la légitimité ou le droit de communiquer. L’école républicaine s’est en partie construite sur ce modèle vertical de la transmission du savoir, où le maître, qui est celui qui sait, transmet à l’élève, qui est lui-même dans une position de récepteur. On ne lui demande pas d’être actif ou autonome.
On est maintenant dans une approche très différente qui vise à rendre les élèves acteurs de leur formation. L’idée est de faire en sorte qu’ils puissent conquérir leurs connaissances pour qu’ils puissent mieux se les approprier, pour qu’ils soient en condition de les faire leur. Cela ne veut pas dire, comme ont pu le caricaturer les critiques de l’approche pédagogique, qu’il revient aux élèves d’inventer leurs connaissances. Mais l’impératif aujourd’hui est bien de lier la transmission des connaissances aux meilleurs moyens de les transmettre qui doivent prendre en compte les changements de notre société, et qui doivent donc permettre à l’élève de se situer réellement dans une position d’acteur, en voie de conquérir son autonomie. Il existe un très large mouvement dans les écoles qui prend en compte ces évolutions et qui se traduit dans la théorie comme dans la pratique. Il en est ainsi de toutes les pédagogies qui affirment que l’enfant doit être au centre du processus d’apprentissage, qui se traduisent concrètement par le fait que l’on demande beaucoup plus aux élèves d’aller chercher l’information, de la vérifier, de trouver eux-mêmes des réponses aux questions qu’ils se posent, etc.
Le problème aujourd’hui est plutôt de faire en sorte que tous les élèves puissent acquérir les connaissances, dès lors que l’on sait que l’autonomie présuppose toute une série de compétences socialement différemment distribuées. Pour cela, l’enjeu actuel de l’école est notamment d’affirmer clairement qu’elle doit transmettre un ensemble de connaissances qui appartiennent à un patrimoine commun, mais que cette transmission doit passer, et ne pourra passer, que par des méthodes dites actives. De ce point de vue, toute tentative de retour à une école où l’élève sera soumis à une discipline à sens unique est vaine. Ce n’est pas cela qui permettra de former des citoyens.
Enfin, pour être acteur, il faut pouvoir être mis en condition d’être acteur. Pour ma part, il m’apparaît que la capacité à comprendre que ce qu’on apprend en vaut la peine est quelque chose qui est fondamental. Pierre Bourdieu, dans Raisons pratiques, évoque le sens étymologique du terme « être intéressé » qui est éclairant pour notre propos, et qui signifie « en être, être avec les autres », autrement dit, « être intéressé aux enjeux du jeu qui se joue ». Ainsi, celui qui est indifférent, qui n’est pas capable de faire des différences entre les enjeux, n’est pas intéressé, et n’est pas partie prenante du jeu qui se joue. L’intérêt pour l’étude commence donc par la nécessaire compréhension que la connaissance a de la valeur. L’enfant qui ne comprend pas ça ne peut pas être acteur du jeu. Il est ainsi fondamental de lui montrer que ce qu’il apprend a de la valeur. Pour autant, il ne faut pas croire non plus que par cette seule motivation, la connaissance peut advenir. En effet, pour apprendre, il faut en plus être à l’aise avec un certain nombre de choses, avec son corps, avec soi-même, avec l’autorité et ce qui la fonde, etc. Si l’enfant ne reconnaît par exemple pas l’adulte comme porteur de connaissances qui ont de la valeur, alors la transmission est vaine. C’est ainsi qu’il n’est pas vrai de dire aux élèves qui échouent que c’est de leur faute s’ils n’y arrivent pas. Certains n’y arrivent pas parce qu’ils sont dans des situations sociales, familiales (etc.) qui ne leur permettent pas d’être disponibles pour participer activement à l’apprentissage.
Ainsi, pour participer à la construction du vivre ensemble, il faut arriver à être sujet, à être acteur. Sinon, on est dépendant, dominé, exclu. Et pour cela, il faut maîtriser des codes, des valeurs, et enfin avoir conscience que cela en vaut la peine. On voit bien ainsi qu’on est dans un double enjeu qui ouvre simultanément deux voies possibles, celle du vivre ensemble et celle de l’exclusion.
Vous évoquez l’importance de l’acquisition progressive de l’autonomie de l’enfant qui passe notamment par sa participation active à la construction des savoirs transmis par l’école. Cependant, n’y a-t-il pas aujourd’hui des obstacles importants qui rendent cette tâche difficile. Je pense notamment au poids très important des médias qui ne vont pas toujours dans ce sens, et à l’influence très forte qu’ils peuvent avoir sur les enfants et les jeunes. Je pense aussi à l’attitude de familles décrites comme étant de plus en plus consuméristes à l’égard de l’école et qui, au-delà des valeurs prônées, exigent surtout de l’école qu’elle puisse permettre l’accès à des diplômes et des positions sociales élevées.
Oui, vous avez raison de souligner ces obstacles. Pour vous répondre, il faudrait montrer comment notre société d’individus est aussi une société de consommation, c’est-à-dire une société où chacun est - relativement - libre dans son action et ses choix et a - relativement - accès à un grand nombre de biens symboliques et matériels. Une société de la liberté et de l’autonomie individuelles, mais aussi une société (c’est son autre face) qu’on peut décrire comme celle des comportements égoïstes et individualistes, c’est-à-dire consuméristes.
Il faudrait également, s’agissant des médias, revenir sur la profusion de l’information - bien de consommation parmi les autres - et donc sur la difficulté dans laquelle nous sommes de construire à partir de cette profusion nos connaissances et nos jugements. Internet illustre à la perfection cette situation dans laquelle nous sommes : l’information est là, riche, multiple, et chacun d’entre nous y a facilement - relativement - accès. Mais c’est à chacun qu’il appartient individuellement, c’est-à-dire seul, de faire preuve de discernement pour s’y retrouver. Ce discernement n’est rien d’autre que ce que l’on appelle, notamment dans la démarche scientifique, l’esprit critique…
Pour en revenir à l’école, je voudrais simplement souligner ici l’importance de son rôle face à ces obstacles. L’éducation doit demeurer une mission régalienne. Je ne dis pas cela au nom d’un quelconque a priori jacobin ; ni dans une volonté de restauration de l’école d’avant, celle dont on affirme qu’elle fonctionnait bien et qui n’est rien d’autre qu’un de nos mythes d’aujourd’hui (construit sur le principe du « c’était mieux avant », principe d’une société vieillissante !).
L’éducation doit demeurer régalienne, parce que seule la collectivité publique, au nom de la volonté publique, peut agir pour confier à l’école – publique par le fait même – la mission de former des hommes et des femmes, des individus, pour une société d’individus, c’est-à-dire une société fondée sur les valeurs de la liberté et de l’autonomie et de l’indispensable fraternité, sans laquelle cette société n’est que déploiement des individualismes, égoïstes et consuméristes. C’est là un point de vue moral, j’en conviens, mais l’éducation n’est jamais rien d’autre qu’une affaire de morale.
Certains auteurs interrogent aujourd’hui la capacité de l’école à former des citoyens, capables de se former une opinion, de la défendre par l’exercice de la parole, de débattre avec d’autres qui seraient porteurs d’une autre opinion. Comment l’école prend-elle en compte ces questions aujourd’hui ? D’après vous, quelles sont ses forces et ses limites de ce point de vue ?
Il y aurait là aussi beaucoup à dire. L’école s’efforce, avec plus ou moins de bonheur et de fortes résistances, d’initier les élèves au débat. L’exercice semble fécond, mais il est aussi périlleux. Il convient toujours de se défendre de l’illusion spontanéiste et de la confrontation des seules opinions. Pour débattre, il faut savoir, c’est-à-dire avoir acquis des connaissances, et être capable de jugement, c’est-à-dire de discernement, de cet esprit critique dont je parlais tout à l’heure.
Plus fondamentalement, la rencontre et le débat avec d’autres et le nécessaire respect de leur point de vue, c’est ce que garantit dans son essence la laïcité. On sait l’importance de cette dernière dans l’histoire de notre école et de notre société. Mais on sait aussi combien cette valeur est aujourd’hui en question. Non pas seulement en raison du développement de courants religieux fondamentalistes, mais plus fondamentalement du fait même de ce qu’est la société des individus, de sa pluralité, de sa diversité, de son métissage… Vaste question sur laquelle il faudrait sans doute revenir !
Pour vous, l’une des crises majeures que l’on vit est la crise de la filiation. Cela questionne en profondeur la transmission. Comment cela s’exprime-t-il ? Quelles questions cela pose ?
Autre vaste question. On assiste en effet à une crise importante, et qui n’est sans doute pas suffisamment pensée, qui touche à la filiation. Les représentations qui fondent l’humanité à nos yeux sont en train de s’effriter. J’entends par ces représentations l’institutionnalisation des différences fondamentales entre les Hommes - les hommes et les femmes, les adultes et les enfants, les générations, et l’assignation de places spécifiques pour chacun et chacune d’entre eux. Aujourd’hui, il est possible de dissocier la sexualité de la reproduction, d’envisager la fabrication d’un être à partir d’un seul être par le clonage. On reconnaît l’homosexualité et bientôt l’homoparentalité, etc.
Peut-être parvenons-nous à la fin d’une époque, d’un cycle, en ces temps où tout se passe comme si nous pouvions - enfin ( ?) - nous débarrasser de ce qui nous lie encore à notre animalité fondatrice ? S’il en est bien ainsi, alors comment chacun d’entre nous peut-il s’inscrire dans une lignée, une histoire, une culture, etc., une filiation ?
A cela s’ajoute un brouillage intergénérationnel très fort ; les places assignées à chaque génération sont mouvantes. On voit notamment apparaître de nouvelles catégories d’âge - les préadolescents, l’adulescence (entre l’adolescence et l’âge adulte) , les seniors (entre 50 et 70 ans, actifs âgés et jeunes retraités) le quatrième âge - qui témoignent de ce brouillage.
Et puis nous savons bien que la profusion d’informations, dont nous parlions tout à l’heure, se double d’une forte accélération de la vitesse de leur obsolescence. A tel point que l’accès à ces informations et la maîtrise des connaissances qu’elles permettent de construire peuvent s’opérer sans qu’il y ait nécessairement recours à la génération d’avant, celle qui en d’autres temps savait !
Par conséquent, compte tenues de toutes ces transformations, on comprend mieux pourquoi la transmission intergénérationnelle semble être aujourd’hui en crise. On comprend mieux que l’école, le lieu de la transmission dans les sociétés modernes, soit, elle aussi, en crise, c’est-à-dire dans la nécessité paradoxale de se transformer radicalement tout en demeurant ce qui fait lien entre les individus individués et les générations qui se succèdent dans un ordre bousculé…