Veille M3 / Pour une meilleure qualité de l’air, l'auto-défense sanitaire ?
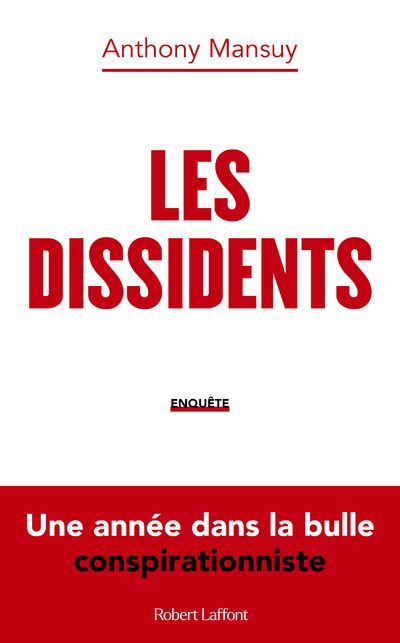
Article
Après la poussée de complotisme constatée pendant la pandémie, quels enseignements tirer pour réconcilier sciences et engagement citoyen ?
Interview de Bertrand LABASSE

<< La question fondamentale n’est pas celle de l’accès au savoir, mais celle du désir de savoir >>.
Bertrand Labasse enseigne la méthodologie de l'information à l'école Supérieure de Journalisme de Lille et à l'Université Claude Bernard Lyon 1. Ancien rédacteur en chef de l'agence de presse AGRAP et des revues Recherche &Industrie et Isotopes, il est notamment l'auteur d'un rapport sur la médiation des connaissances complexes pour la Commission Européenne (1999), de La Communication scientifique ; logiques et méthodes (Université de Lyon/Editions Colbert, 2001) et de Une Dynamique de l'insignifiance, à paraître aux presses de l'Enssib.
Pourquoi a-t-on du mal en France à diffuser la culture scientifique et technique ?
A mon sens, d'abord parce que l'on ne prend pas la diffusion des connaissances au sérieux. Les problèmes que pose cette diffusion n'apparaissent pas, on fait comme si tout allait de soi, comme s'il n'y avait qu'à agir. De ce fait, la principale réponse que l'on apporte est du type "construisons davantage de canaux culturels", comme des musées, des chaînes thématiques, des expositions. Tout cela est très bien, mais on reste dans un modèle de l'offre que l'on n'interroge pas. Or, vous pouvez toujours accroître l'offre de culture scientifique, ce n'est pas ça qui empêchera la grande majorité des gens de lui préférer le sport ou la variété. Comme l'a très joliment dit Philippe Breton, le partage des connaissances "n'est pas d'abord une affaire d'accès au savoir, mais bien plutôt une manière de poser la question, fondamentale, du désir de savoir. " Il parlait là d'Internet, mais on peut généraliser. Du reste, le problème des nouveaux médias est exactement de même nature.
Est-il possible qu'il n'y ait pas de désir de savoir, que l'on soit peu intéressé ou dans une logique de désintérêt ?
Ce qu'on enseigne aux journalistes et aux étudiants en sciences quand ils suivent des cours de communication, c'est de simplifier, mais on ne leur apprend guère à se poser la question de l'intérêt. Or, on est passé d'une situation de relative rareté de l'offre d'information il y a cinquante ou cent ans, à un système pléthorique où la ressource rare n'est pas l'information, mais l'intérêt, l'attention, et le temps que l'on peut y consacrer. Je ne parlerais pas à ce propos d'une logique de désintérêt : les gens ne sont pas inertes, ils s'intéressent à beaucoup de choses. Simplement ce ne sont pas toujours les choses auxquelles on voudrait qu'ils s'intéressent en priorité. Il n'y a pas de têtes vides, chacun accumule des connaissances dans ses domaines de prédilection. Si vous feuilletez un magazine consacré à un loisir que vous ne connaissez pas, par exemple le surf, la hi-fi, la moto, vous serez frappé par sa technicité : pour un non initié, c'est à peine compréhensible et bigrement ennuyeux. Même la vie de la jet set suppose qu'on sache de qui il s'agit. Etant personnellement peu compétent en la matière, j'ai parfois du mal à suivre des magazines dits "populaires". Prenez un journal étranger parlant des vedettes locales de la télévision et de la vie publique : vous mesurerez toutes les connaissances qu'implique la lecture de n'importe quel sujet. Le problème, c'est que les domaines d'intérêt spécifiques sont de plus en plus nombreux, et que, du fait de la formidable explosion de l'offre sur tous les sujets, l'information disponible est de plus en plus fragmentée. L'espace public de la communication semble ainsi se morceler entre des thèmes de connaissances spécifiques qui, eux aussi, se fragmentent en îlots toujours plus spécialisés. Personne n'est idiot, mais il se pourrait bien que l'on s'intéresse de moins en moins aux mêmes choses, ce qui est assez loin du modèle fusionnel de "société du savoir" - sous entendu du savoir commun" dont on parle si souvent et si hâtivement.
Il est important de remarquer que les phénomènes d'intérêt et de désintérêt sont largement cumulatifs, individuellement et socialement : si vous avez quelques connaissances sur un sujet, vous serez plus susceptible de vous intéresser à des choses nouvelles sur ce sujet, car vous pourrez établir des liens entre elles. A l'inverse, moins vous en savez, moins vous avez envie d'en savoir. Donc, si l'on souhaite qu'au-delà la petite élite culturelle qui va dans les musées et regarde Arte, les gens s'intéressent aux sciences, le problème est de rendre ces sujets assez séduisant pour soutenir la concurrence cognitive des autres domaines d'intérêt.
Faute de distanciation, les scientifiques sont mal armés pour affronter cette évolution. D'une part ils pensent que ce qui les intéresse en propre devrait intéresser les autres ; d'autre part, ils ne sont généralement pas prêts à s'interroger sur le coût épistémologique de l'attractivité. Ils ont l'espoir de la diffusion d'un savoir scientifique à la pureté relativement préservée, sans que le prix épistémologique de la séduction soit payé. C'est légitime, bien sûr, mais ça n'aide pas à élargir les publics de la science. Je note aussi, au passage, que la diffusion des savoirs scientifiques et la diffusion de la culture scientifique ne sont pas forcément synonymes, même si on les mélange souvent, mais c'est une autre question.
Par ailleurs, le problème ne touche pas que les scientifiques : les politiques et même les journalistes ont aussi du mal à prendre en compte la question de l'intérêt et de la fragmentation de l'attention. Comme vous le savez, les taux de participation aux scrutins électoraux ne cessent de chuter. Le lectorat de la presse aussi. Et pendant ce temps, beaucoup de journalistes continuent à rapporter les nouvelles comme si leur intérêt allait de soi, sans se donner la peine de les problématiser. Prenez une information comme "la banque centrale américaine a décidé hier de maintenir ses taux directeurs " : si l'on fait l'effort de se demander en quoi c'est intéressant, si l'on en fait comprendre les raisons, les conséquences, si l'on problématise l'information, elle peut devenir absolument passionnante. Mais si on se contente de la rapporter passivement, comme si son importance et ses enjeux étaient évidents, on ne fait qu'accroître ce vague brouhaha de l'information, cette sorte de bruit de fond qui n'a pas de sens pour la plupart des gens et qui ne peut pas résister à la concurrence cognitive de leurs domaines d'intérêts particuliers. Et on perd des lecteurs, des auditeurs, des citoyens...
Est-on prisonnier, en France notamment, d'une vision trop figée de ce qu'est la culture scientifique et technique ?
On est prisonnier de la construction même de l'objet culture scientifique et technique. Cette notion est discutable en elle-même : je ne crois pas que l'on puisse séparer la culture scientifique et technique de la culture tout court. D'abord parce qu'on risque ainsi de la confiner dans des ghettos culturels - des emplacements réservés, qu'il s'agisse de lieux physiques, de tranches horaires ou de rubriques spécifiques - alors que les questions scientifiques sont au centre de la vie de tous les jours et que l'actualité "générale" renvoie souvent à des notions très complexes. Ensuite parce que la culture scientifique, si on la prend dans son habituel sens restreint, n'est ni plus ni moins importante que la culture économique, juridique, politique, etc. Or, si l'on fait beaucoup d'efforts pour la première, on s'intéresse beaucoup moins aux autres, tout aussi indispensables à la compréhension de notre vie en société. Tout ceci repose sur un conception classique mais assez élitiste et surtout très superficielle, inspirée du modèle des "deux cultures" de C. P. Snow, lequel oppose d'un côté la culture scientifique et de l'autre la culture littéraire et générale. Si l'on regarde les données, on voit que ça ne tient pas. L'opposition fondamentale est entre l'intérêt pour les idées, les savoirs, la compréhension du monde et le désintérêt pour ces mêmes choses. Dans laquelle de ses "deux cultures" C. P. Snow aurait-il rangé "Loft Story " et le salon de l'auto ?
Tout ce qui tend à présenter la Science avec un grand S comme quelque chose à part tend à la réduire au rang de curiosité pittoresque ou, pire, de château des sortilèges, au lieu de revendiquer son rôle central dans l'intelligence du monde réel. De toutes façons, d'un point de vue académique, la science c'est tout ce qui dispose d'une section au Conseil national des universités, ce qui inclut évidemment tous les savoirs sur l'homme et la société. Cela dit, il serait intéressant de se demander par exemple pourquoi les sociologues s'impliquent beaucoup moins dans l'animation de la semaine de la science que les physiciens. Peut-être qu'on ne les incite pas beaucoup à y participer, mais peut-être y a-t-il d'autres raisons plus profondes, que je ne me risquerai pas à explorer. En tout cas, quand le ministère de la recherche commande une étude sur les rapports entre sciences et citoyens, il ne s'agit pas de l'ensemble des disciplines qui relèvent de ses attributions mais des seules sciences de la nature. C'est assez curieux et assez dommage.
La même vision figée prévaut-elle en ce qui concerne les moyens de diffuser cette culture, en ne tenant pas assez compte de la presse, des films, de la SF par exemple ?
Elle prévaut encore plus à ce niveau, mais il y a de bonnes raisons pour ça. C'est que, dès que l'on se donne la peine d'y réfléchir, tout ce à quoi on arrive est extrêmement déplaisant. Par exemple le fait que cette diffusion ne passe que dans une proportion dérisoire par les vecteurs culturels "légitimes " : les expositions, les conférences... En réalité, une fois sorti de l'école, l'essentiel de ce que l'on apprend du monde vient des médias de masse, directement ou indirectement. Même si c'est un ami ou un parent qui vous apprend quelque chose, où celui-ci l'a-t-il donc appris ? Rarement à la source. Ça me fait penser à une astuce des camionneurs. Pendant une de leurs grèves, très impopulaire, ils avaient un petit autocollant qui disait simplement : "si vous l'avez, c'est qu'un camion l'a apporté " . Si l'on y songe, c'est assez juste et, d'un point de vue rhétorique, c'est très fort. On pourrait en dire autant des connaissances sur le monde, qu'il s'agisse de la géopolitique, de la santé ou de la conquête spatiale : "si vous le savez, c'est qu'un média l'a rapporté ". De ce point de vue, qu'on le veuille ou non, les données sont sans appel : hors du cénacle des érudits, la diffusion de la culture repose essentiellement sur des processus marchands qui transforment ces connaissances en objets de consommation. Ce sont des processus fondamentaux mais qu'il est tentant de se masquer. Les missionnaires aux idées pures ne pouvaient concevoir que l'essentiel de la civilisation, avec tous les guillemets que l'on peut mettre à ce mot, passait par les marchands, même si ceux-ci ne faisaient pas le tri entre le bon et le mauvais. De la même façon, les missionnaires culturalistes préfèrent multiplier les initiatives sympathiques mais d'une portée limitée que de prendre en compte les logiques d'un système qu'ils abhorrent et qui véhicule le bon comme le mauvais. Et il ne s'agit pas seulement des médias d'information : diverses indications donnent à penser que Star Trek et Jurassic Park sont les principales sources d'intérêt pour les sciences, très très loin devant les dispositifs institutionnels.
Si l'on produit et l'on diffuse l'information "information scientifique et technique ou information concernant d'autres domaines", sans se poser la question de l'intérêt et des outils, est-ce parce que l'on ne se rend pas compte de la difficulté de la diffusion des connaissances ?
Certainement, et c'est là un point commun entre la question du journalisme, celle de la "société de l'information " et celle de la diffusion de la culture scientifique. Tous ces thèmes baignent dans ce que j'ai appelé une culture de l'évidence. Tout paraît simple, chacun sait ce qu'il faudrait faire et ne pas faire. Quand on discute par exemple avec des scientifiques, cette attitude est frappante. Lorsqu'il s'agit de leur domaine, ils estiment qu'il faut des connaissances spécifiques pour en juger, et ils ont raison. Mais quand il s'agit de la communication scientifique ou des médias, ils n'auraient pas l'idée d'ouvrir un livre sur la question, leur opinion leur suffit. Un demi-siècle de recherches en sciences de l'information et de la communication, et plusieurs décennies de travaux souvent excellents sur la diffusion de la culture scientifique sont totalement ignorées. Dommage, parce que si l'on ne se donne pas la peine de dépasser les idées toutes faites, et souvent erronées, on se prive de toute chance d'améliorer ces processus.
Cela dit, ces travaux ne fournissent pas pour autant des clés prêtes à servir ou des recettes pratiques. C'est du reste l'un des problèmes cruciaux de ce domaine : la profonde fracture entre le champ des recherches et celui des pratiques. Pour simplifier, on peut dire que les anglo-saxons ont une longueur d'avance dans ce domaine, parce qu'ils ont une tradition très pragmatique, parfois trop pragmatique, de recherche appliquée en communication. En France, on ne manque ni de savants ni de praticiens, mais on manque terriblement de vrais experts àla jonction des deux. D'où la place laissée dans ce domaine à des gourous, des modèles et des recettes plus pittoresques que pertinents.
Cela signifie-t-il qu'il faille former les journalistes et les scientifiques aux techniques de communication et de diffusion des connaissances ?
Il y a un consensus international sur le fait que former les scientifiques à la communication est l'un des défis les plus cruciaux que l'enseignement supérieur ait à relever. Mais à aucun moment, on ne se demande si on est capable de les former : dispose-t-on vraiment des compétences, des modèles, des méthodes ? Ces questions n'apparaissent dans aucun des innombrables rapports et tables rondes qui ont abordé ce thème. Là encore, le message général est : "il faut agir, et vite". Or la communication des informations complexes implique une forte réflexion méthodologique et même épistémologique. On ne peut pas se contenter de dire aux étudiants : faites des phrases courtes, à la voix active, et vous serez clairs et intéressants.
Il en va de même pour la formation des journalistes : là aussi, on s'en tient souvent à des préceptes techniques simplistes, souvent complètement faux d'un point de vue psycholinguistique et, de toutes façons inadaptées au traitement des sujets complexes. Ensuite, on entend souvent dire "c'est important mais ça n'intéressera pas les gens ". Ça en dit plus long sur les compétences techniques de celui qui le pense que sur les compétences cognitives de ses lecteurs ou auditeurs. Ou alors, on se réfugie dans ce que les anglo-saxons appellent le "dumbing down " : être toujours plus simpliste.
Or la question est ailleurs : comment rendre les choses assez intéressantes pour qu'un large public - pas seulement une élite socioculturelle - ait envie des les comprendre ? Heureusement, beaucoup d'autres journalistes ont du talent et une idée plus relevée de leur métier. Mais c'est largement une question d'instinct, puisque les journalistes, comme d'ailleurs les scientifiques et les pouvoirs publics, pour ne pas parler des consultants et autres pseudo-experts, ne savent à peu près rien de ce que comprennent les gens, de ce qui peut vraiment les intéresser : il n'y a pratiquement pas de travaux là-dessus en France. C'est du reste un problème plus général, qui concerne toute la méthodologie de la communication publique.
Si la pédagogie du journalisme n'est pas à la hauteur des problèmes que rencontre ce métier, c'est aussi parce qu'elle n'a guère de recherche technique sur laquelle s'appuyer.
Si vous pensez que l'information est quelque chose d'important pour la société, ou simplement si, pour une raison ou pour une autre vous n'êtes pas satisfait de ce que vous voyez au journal télévisé de 13h, dites-vous bien ceci : il n'y a pas en France de crédits pour le développement de l'enseignement du journalisme et de sa méthodologie, ni pour la recherche appliquée dans ce champ, pas plus, d'ailleurs, que pour la vulgarisation scientifique. Ces domaines sont laissés à l'abandon. Peut-être parce que les pouvoirs publics pensent, eux aussi, que tout est très simple en ces matières. En tout cas, on a le journalisme qu'on mérite. Au regard du soutient à la recherche professionnelle qui lui est accordé - infiniment moins que pour l'étude des coléoptères - on peut même dire que l'on a un journalisme bien meilleur que celui que la collectivité mériterait. Comment peut-on à la fois dire que quelque chose est capital, le critiquer, déplorer ses insuffisances et, dans le même temps ne rien faire pour lui permettre éventuellement de s'améliorer ? C'est là un de ces paradoxes qui abondent lorsqu'on s'intéresse à ces thèmes, et qui conduit à dire qu'en réalité, on ne les prend pas au sérieux. Quand on commencera à respecter ces domaines, à s'interroger sérieusement sur les problèmes qu'ils affrontent ou subissent, alors de nouvelles pistes pourront s'ouvrir. Sinon, on en restera aux gesticulations et aux lamentations.
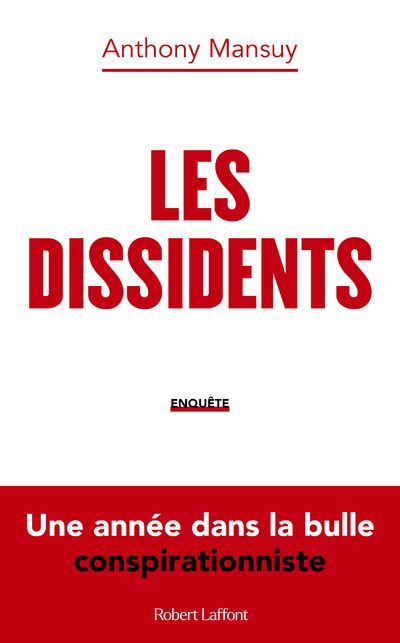
Article
Après la poussée de complotisme constatée pendant la pandémie, quels enseignements tirer pour réconcilier sciences et engagement citoyen ?

Texte de Marianne CHOUTEAU
Comment proposer un cadre normatif à l’exercice de la recherche tout en permettant une indispensable liberté scientifique ?

Des bulletins pour approfondir vos connaissances au sujet de la vie des sciences humaines et sociales de la Métropole Lyon-St Étienne

Étude
Huit récits d'aventures scientifiques dans la région lyonnaise.

Étude
Ce document retrace les collaborations entreprises ou réalisées au cours des 5 premières années d’existence du Grand Lyon en tant que Métropole.
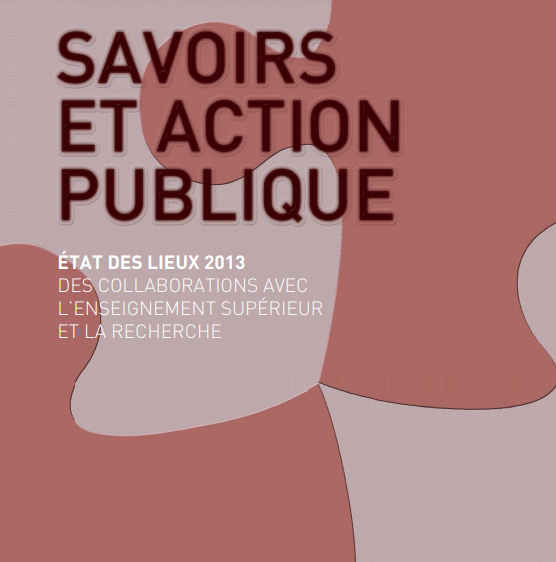
Étude
Cette nouvelle édition traduit un renouvellement significatif des projets engagés avec les sphères académiques. Parmi la cinquantaine de collaborations recensées, la recherche de connaissances au service de l’action apparaît comme un fil conducteur.
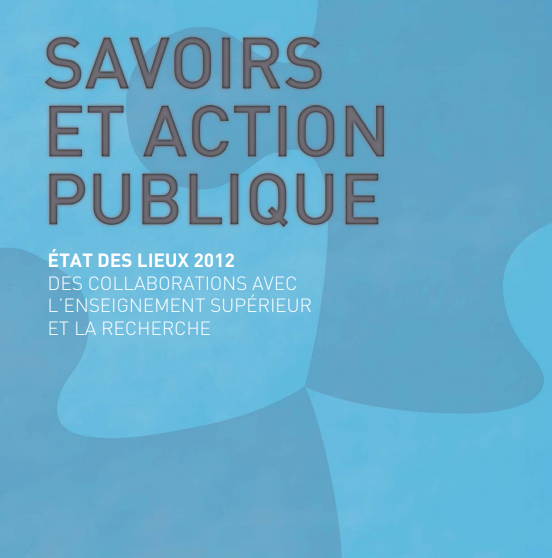
Étude
Cette nouvelle édition du livret des partenariats de recherche entre le Grand Lyon, l’Agence d'urbanisme de Lyon et les milieux académiques s’étoffe en présentant 52 collaborations engagées.

Étude
L’état des lieux présenté dans ce document montre que les collaborations du Grand Lyon et celles de l’Agence d’Urbanisme avec les établissements d’enseignement supérieur et de recherche ne sont pas récentes.

Étude
Qui a peur du grand méchant Mooc ?