Le travail social et la prévention du radicalisme à l’heure du numérique

Interview de Johann Rony et Olivier Carbonnel
Assistants de service social et psychologue
Interview de Yazid IKDOUMI
<< S'il faut prendre acte que dans la différence tout n'est pas religieux, il faut reconnaitre le fait religieux et lui donner des lieux >>.
Yazid Ikdoumi est directeur du Grand projet de Ville (GPV) de Vénissieux et président de la Coordination des Berbères de France. A l'époque de cette interview il est chef de projet à Saint Priest.
Dans cette interview, datant de 2001, il donne son point devue sur l'augmentation des signes de pratiques religieuses, la dimension du social derrière le religieux et enfin sur l'importance d'une reconnaissance de la dimension laïque des cultures d'origine.
Interview réalisée pour le Cahier Millénaire3, n°23, pp 64-65, juin 2001.
Est-ce que les signes de pratiques musulmanes vous semblent, dans ces dernières périodes devenus plus présents ?
Ils sont présents dans l’histoire de ce pays depuis longtemps. Ils sont simplement devenus plus visibles. Mais remettons d’emblée les choses en perspective : ces signes révèlent autant, si ce n’est plus, un phénomène social que strictement religieux. En effet l’Islam me semble fonctionner, dans des familles que je côtoie, comme un ciment. Il est appelé et vécu comme un système de valeur sociales et structurantes. Par exemple, j’ai vu des familles qui étaient en souci de « tenir » leurs enfants. Elles en ont appelé à l’école coranique pour faire acquérir des valeurs, morales peut-être, mais d’abord structurantes du rapport aux autres, pour ces enfants. Et dans leur esprit, il s’agissait bien d’une éducation sociale et pas uniquement spirituelle. En ce sens c’est une délégation à quelque chose de connu, et pas une déresponsabilisation. Par ailleurs comment imaginer que cet Islam pourrait être un objet monolithique, n’ayant rien à voir avec ce que vivent concrètement les individus et leur histoire d’ici. Cette religion est profondément travaillée par les questions de cette société là et pas une autre. Imaginez les questions que peut poser le mariage mixte et vous verrez à quel point la dimension sociale travaille le religieux.
C’est si peu évident et pour trop peu de gens ?
C’est un problème de contact et de parole. S’il n’y a pas de communication sur nos quartiers, cela ne peut qu’entraîner des problèmes, des distances et des clichés sur l’autre. Cette absence de communication laisse aussi la place à une approche nourrie de la situation internationale, ce qui se passe dans le monde et de l’autre côté de la Méditerranée, entre autre. Se substitue alors à l’autre, réel, une projection.
Pourriez-vous illustrer cette dimension du social derrière le religieux ?
Tout le monde a besoin de savoir d’où il vient. Mais il y a une manière d’avoir conscience de ses origines fortement référée à la dimension religieuse. C’est un raccourci réducteur mais sûrement dû à la faiblesse de la transmission. La religion devient la partie visible, synthétisant une différence, qui en s’affichant traduit la mise à l’écart par la mise en différence. En ce sens l’apparence du barbu habillé dans une tenue d’ailleurs, peut séduire des jeunes qui se sentent de toute façon à l’écart, pour traduire cette exclusion en différence assumée. Il peut leur donner l’impression d’une sorte de cohérence, entre ce qu’ils sont et ce qu’ils paraissent, clairs avec eux-mêmes en somme. De la même manière, la séduction exercée par le discours religieux de Tarek Ramadan, s’explique à mon avis par la manière dont elle cible, prend en compte et donc valorise les jeunes. Le contenu religieux vient en second. Peu de gens, de ceux qui s’y référent, pourraient vraiment définir sa pensée. Si l’on prend le Ramadan c’est un moment de remaillage sociétal, de solidarité et l’on n’en voit que la dimension religieuse.
Par rapport à ce que vous décrivez, quelles sont les pratiques des acteurs des politiques publiques qui pourraient constituer une réponse ?
Il nous faut banaliser et donner des repères identitaires objectifs qui ne se réduisent pas à la religion. Rétablir la dimension laïque des cultures d’origine, saisir toutes les occasions pour traiter la langue parmi d’autres langues, cette culture parmi d’autres cultures. Au même titre que pour les Basques, les Bretons, etc... c’est à la société, c’est à la France dans son ensemble de s’en occuper, pas au ghetto. Ces revalorisations et cette reconnaissance doivent s’exercer dans des cadres d’échanges et d’ouverture, en faisant jouer leur rôle aux structures et aux services de droit commun. Par exemple, l’enseignement de la langue arabe au centre social ne me semble pas une bonne idée, c’est source de malentendu et de dévalorisation. Le statut de l’école me semble bien mieux adapté pour la nature de cette activité. Ce qu’il faut viser c’est la reconnaissance d’espaces publics interculturels, pour le citoyen réel, tel que sa vie traverse les institutions et s’y retrouve, pas un citoyen théorique, dont les dimensions de différences culturelles seraient condamnées à l’invisibilité et donc apparentées à la religion. En sortant de ces confusions, on imagine mal ensuite que naturellement un curé en soutane ou un barbu en tenue afghane, soit animateur dans l’espace public.
Les institutions vous semblent avoir mûri les bonnes réponses à toutes ces questions ?
On sent tout de même un blocage. De la part des institutions, la réflexion n’est pas suffisamment traitée. S’il faut prendre acte que dans la différence tout n’est pas religieux, il faut reconnaître le fait religieux et lui donner des lieux. Ces lieux existent, mais il y a encore des demandes de proximité qui ne trouvent pas de réponses claires. La question se pose avec autant d’acuité par ce que la religion musulmane est une religion de populations à faibles revenus. Il faut bien constater que les démarches privées, reposant sur le portage financier par les croyants, ont de la peine à aboutir. Le fait, dans ces conditions, de ne pas gérer l’espace religieux amène des dysfonctionnements de locaux qui n’étaient pas prévus pour ça. C’est une sorte de détournement. Face à ces situations les acteurs de terrain n’ont pas d’orientation particulière. Chacun fait avec sa sensibilité, ses méthodes. Il faut qu’un cadrage institutionnel vienne vite, et serve de repère aux acteurs de terrain. Il y a des moyens pour aider au traitement de ces questions. On pourrait travailler avec les associations issues de l’immigration et c’est ce qu’on essaye de faire. Mais ces associations fondent et baissent les bras, entre autres parce qu’on leur demande de faire la preuve d’abord qu’elles ne sont pas communautaristes. Elles sont usées par l’injonction trop souvent répétée de mettre en œuvre un islam à la française. Je pense à deux autres chantiers, qui peuvent contribuer à des orientations institutionnelles. Il faut être attentif au besoin de se projeter ailleurs que dans le quartier. Les habitants dépendent d’un dispositif souvent périmétré, pour la commodité des interventions. Il ne faut pas que nous obtenions du même coup, un effet pervers d’enfermement, qui empêcherait les citoyens de participer au projet social d’ensemble. Je pense aussi que si nous avons fait l’apologie des parents (travailleurs, etc...) il faut produire le discours de valorisation de leurs enfants, de leur place dans l’histoire et de l’histoire de ce pays tel qu’il se construit, avec eux. Il y a un double mouvement nécessaire de l’un vers l’autre, celui de la personne accueillie et celui de la société accueillante

Interview de Johann Rony et Olivier Carbonnel
Assistants de service social et psychologue

Les métiers du prendre soin souffrent d'un fort turnover. Pourtant, les facteurs d'engagement dans ces métiers très humains ne manquent pas. Alors, que se passe-t-il ?
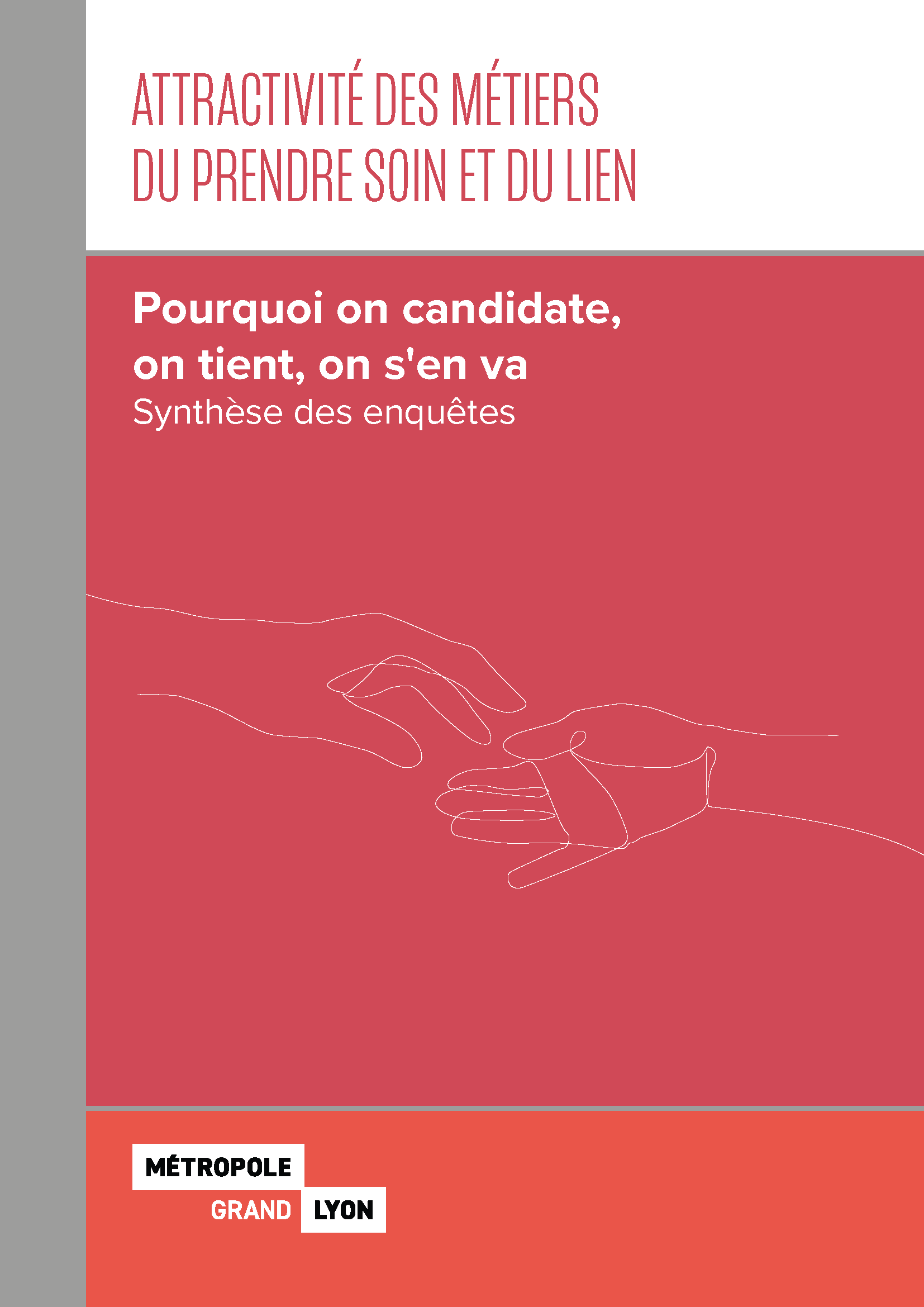
Étude
Comment expliquer le manque d'attractivité des métiers du prendre soin ? pourquoi on candidate, on tient, on s’en va ? Retrouvez la synthèse des enseignements des différentes enquêtes conduites sur ces questions.
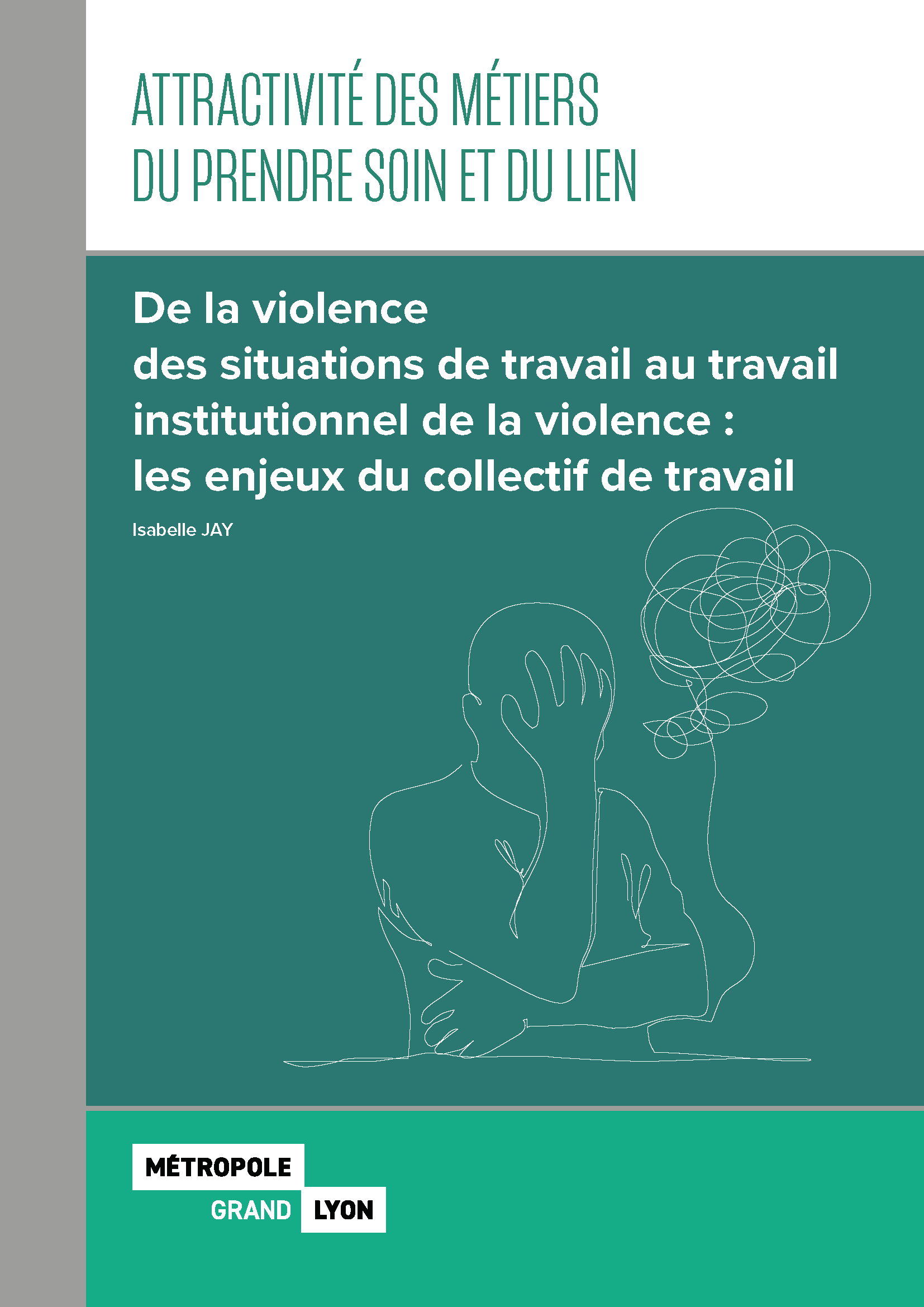
Étude
Lorsque les contraintes ne permettent plus aux professionnels de surmonter les aléas, quelle place donnée à l’autonomie et au collectif de travail pour affronter les difficultés ?
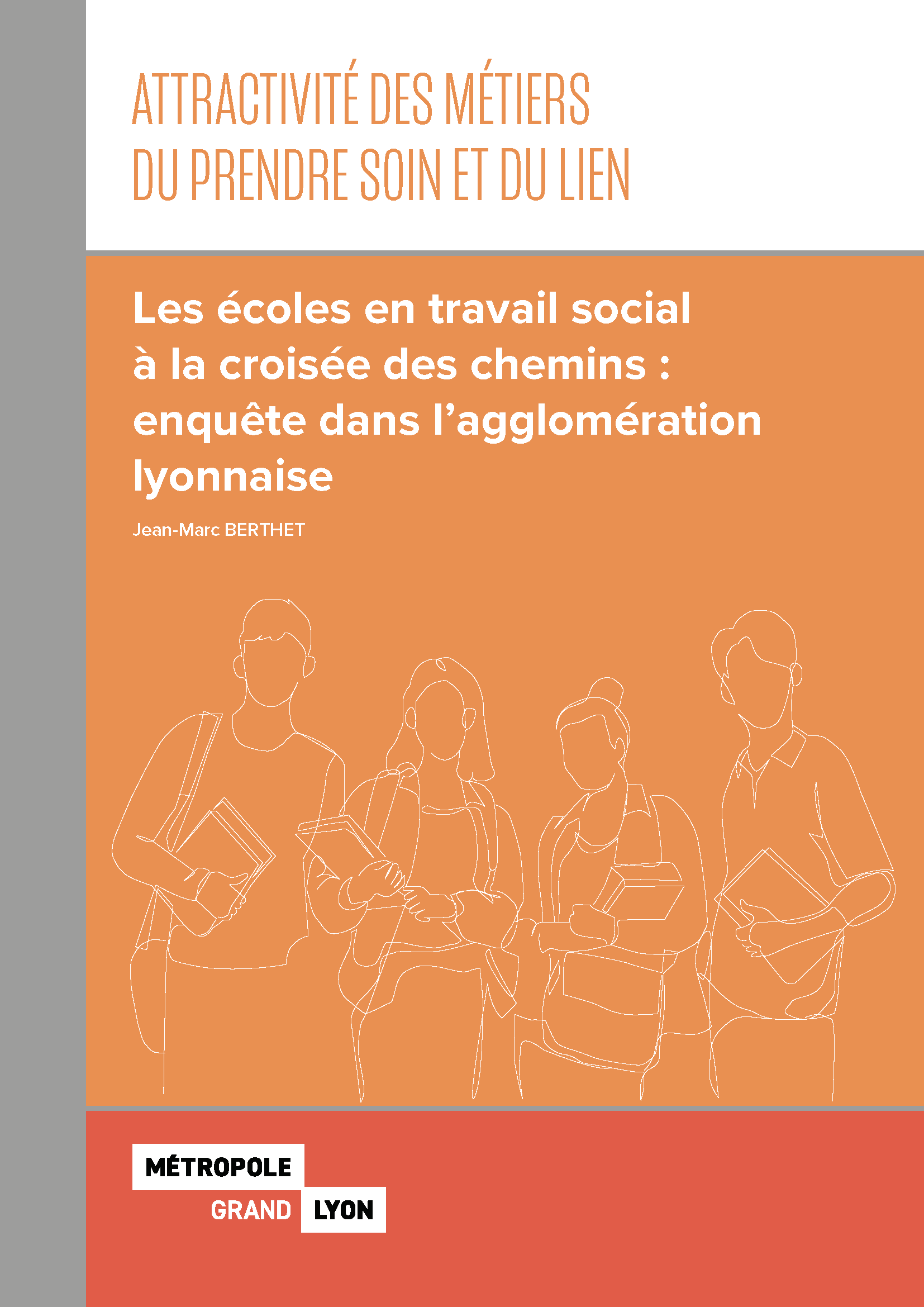
Étude
Les travailleurs sociaux diplômés ne sont plus au centre du paysage dans la mesure où de nombreuses autres personnes exercent des métiers dans le social sans forcément être titulaires d'un des diplômes.
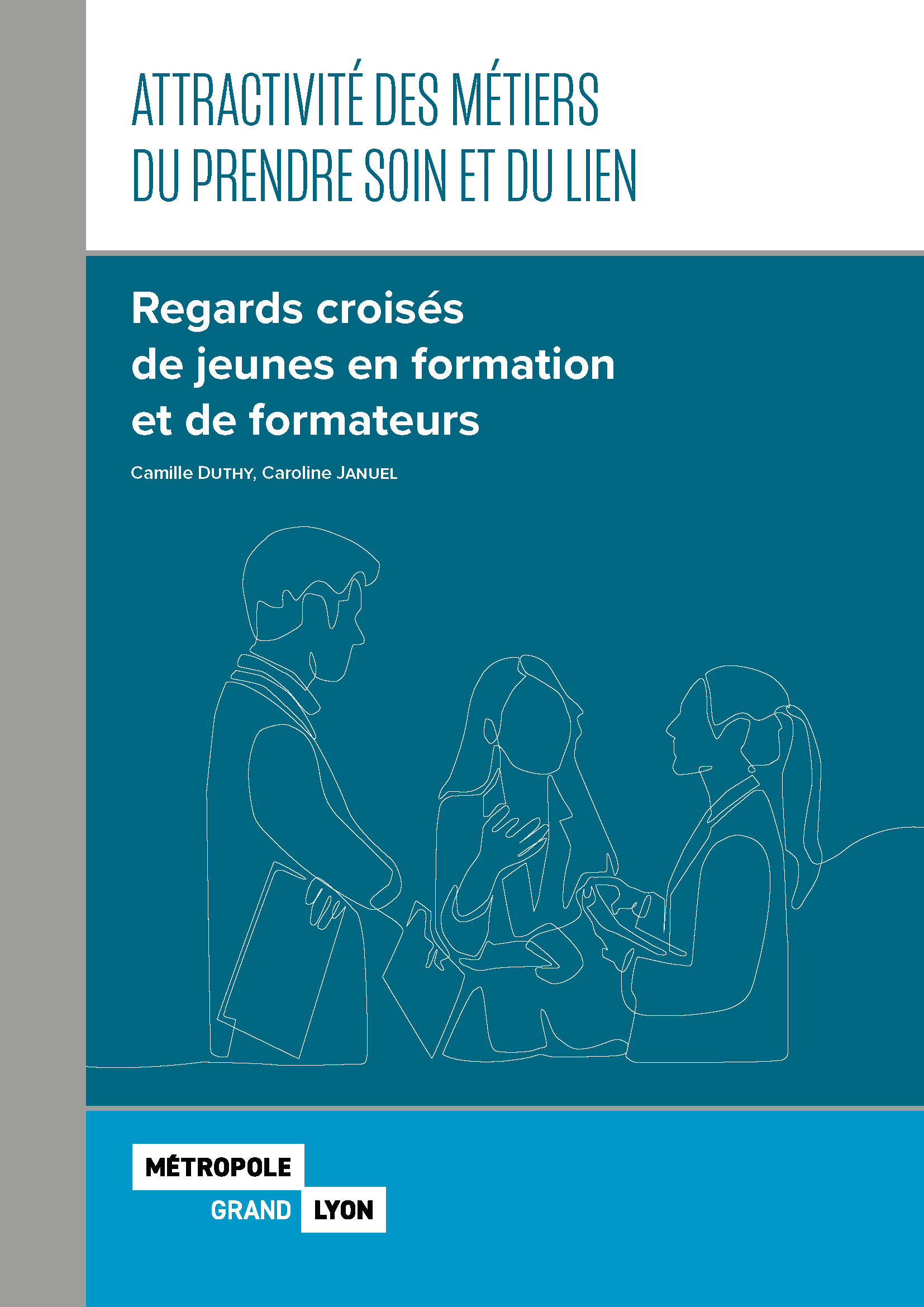
Étude
Comment et pourquoi être solidaires, auprès de qui et sur quels sujets ? ces questionnements font apparaître un renouvellement des causes et des approches portées par la jeunesse.

Étude
Les femmes migrantes et/ou racisées sont surreprésentées dans les emplois du prendre soin les moins valorisés. Est-ce le signe que ces métiers sont attractifs pour ces personnes ou faut-il y voir l’effet de dynamiques structurelles d’assignation ?
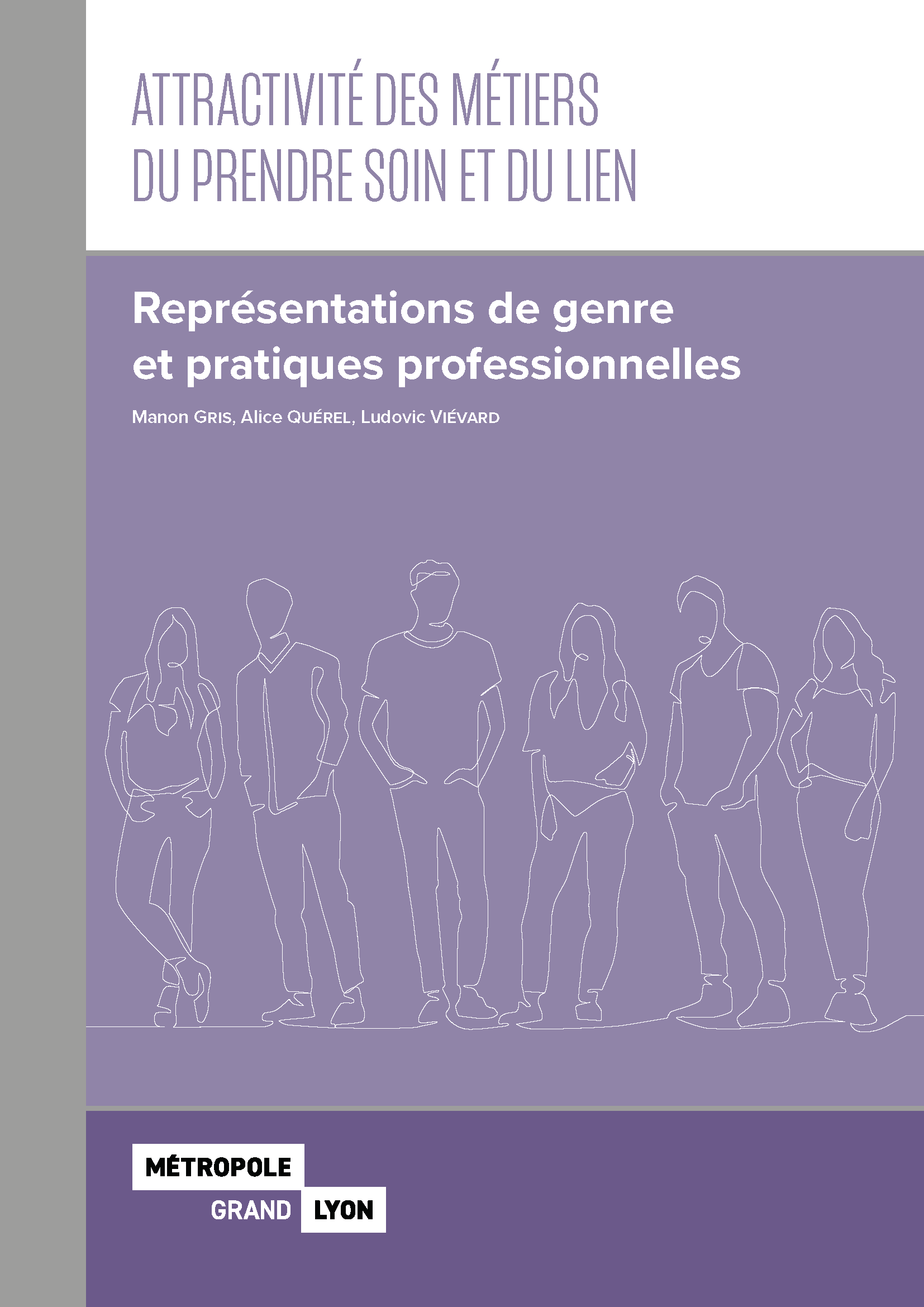
Étude
La masculinisation des métiers du care, si elle progresse, n’est que récente et peu avancée. Des enquêtés de sexe masculin nous disent pourtant l’attrait qu’ils éprouvent pour l’aide et le soin à la personne.
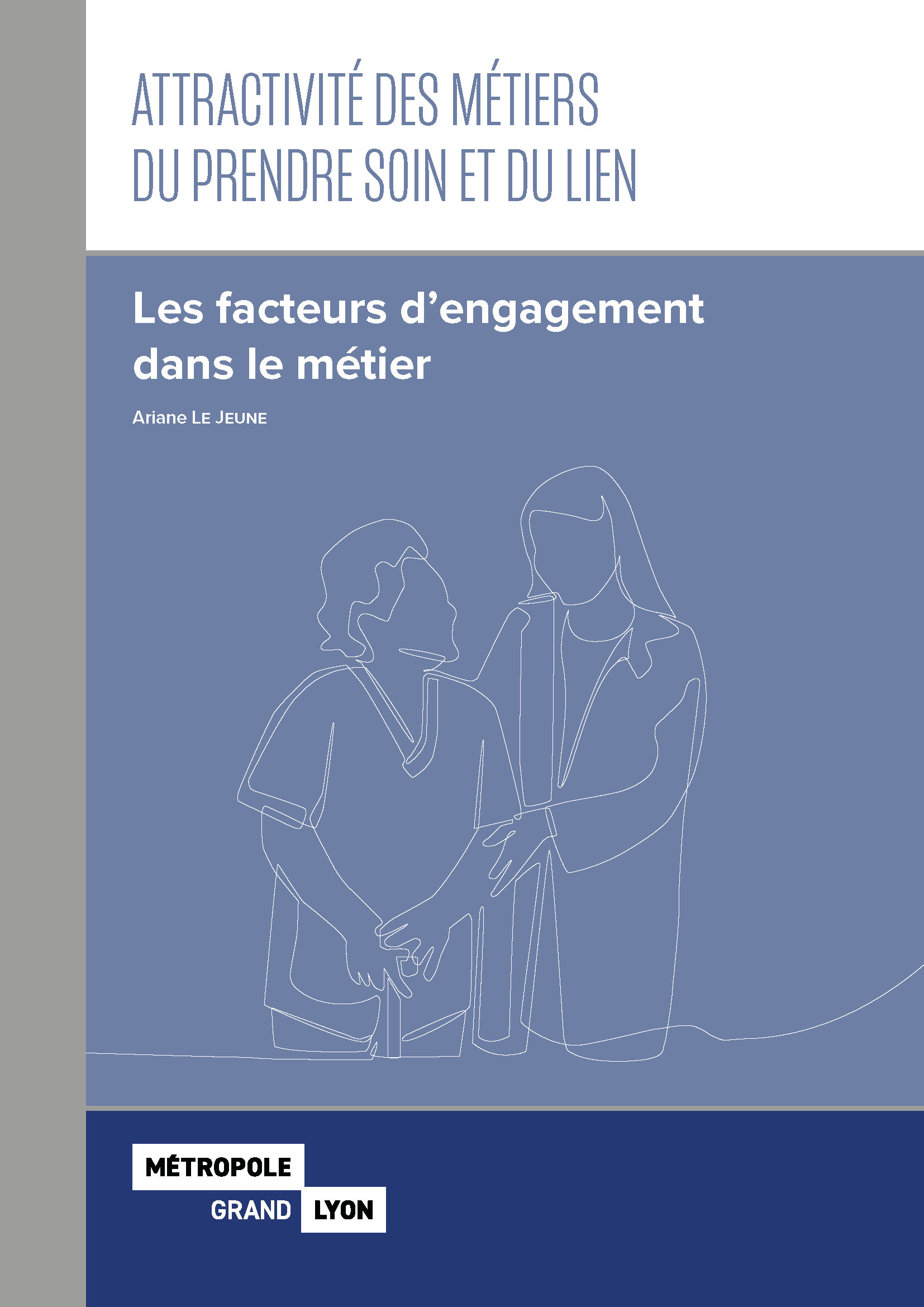
Étude
Si l’entrée dans les métiers de l'aide à la personne se fait parfois parce que l’on n’a guère d’autre choix, les facteurs d’engagement mobilisant des valeurs fortes de solidarité et d’humanité sont souvent présents.