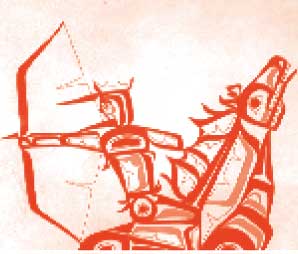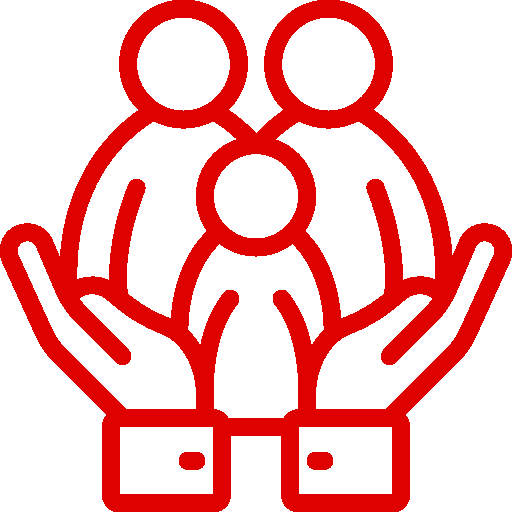Texte écrit pour la revue M3 n°2
Étienne Rodin est sociologue et consultant, auteur de "L'horreur managériale", éditions L’Échappée, 2011.
Face aux enjeux globaux du développement durable, les pouvoirs publics doivent pouvoir impliquer les entreprises tant leur activité agit sur les territoires, mais comment ?
Une des voies est leur mobilisation volontaire via leur responsabilité sociale. Derrière ce concept récent et fédérateur, Étienne Rodin révèle la permanence de la rivalité politique entre libéralisme et interventionnisme.
L’importance de l’économie dans la vie tant matérielle que psychique des individus est rivée à celle du travail salarié. Dès la révolution industrielle, l’institutionnalisation du salariat fut un facteur décisif pour fidéliser la main d’œuvre dans les manufactures. Cet enrôlement fut une réussite tant le travail salarié apparaît aujourd’hui comme la forme typique de l’emploi durable ou précaire. Cependant les conditions de vie dans les manufactures des XVIIIe et XIXe siècles étaient loin d’être agréables pour ce nouveau salariat. Pour qu’elles deviennent vivables, un certain nombre de conditions furent réunies comme, outre l’amélioration des conditions de travail, l’octroi d’un temps de repos conséquent. Plus tard les congés payés permirent de bénéficier de loisirs toujours plus diversifiés et étendus, associés au dynamisme des Trente Glorieuses qui autorisa le déploiement de la société de consommation. La société du travail a enfanté la société des loisirs, la société des biens et des services. La société de consommation est une société de compensation. Elle fut dotée (via d’inévitables rapports de force entre patronat et salariat relayés sur le terrain politique) d’ingrédients compensatoires qui la rendent relativement confortable, dès lors que l’on a rejoint le courant dominant d’un mode de vie qui reste, à l’échelle du monde et de l’Histoire, minoritaire. La distribution des salaires par les entreprises est à présent le moyen de répartir parmi la population une partie de la richesse générée par les activités productives marchandes. C’est dire que les entreprises, pourvoyeuses de revenus, sont des acteurs incontournables de la vie dans les sociétés développées. Elles représentent les organisations maîtresses de la société de croissance fondée sur le double impératif de produire et consommer. De ce fait, la part de responsabilité des entreprises dans la bonne marche de la société est grande. Il suffit de mesurer l’impact d’une fermeture de site industriel sur un territoire pour voir aussitôt s’assombrir les esprits des élus, des partenaires économiques et, bien entendu, des salariés concernés. La zone d’influence d’une entreprise dépasse ses murs.
L’entreprise à l’épreuve du soupçon
Depuis l’après-guerre jusque dans les années 1970, notre société n’a guère douté d’elle-même. Mais les évidences d’une croissance éternelle dont les bénéfices seraient — grâce à l’action de l’État garant de la protection sociale et des entreprises chargées d’assurer des revenus réguliers à la population — redistribués dans la société ne vont plus d’elles-mêmes tant « la crise » est passée par là. Celle-ci persiste à troubler la fête, engendrant chômage de masse et déficits. En outre, l’image des entreprises se voit malmenée par des pratiques récurrentes contribuant à leur mauvaise réputation. Les médias se font régulièrement l’écho de groupes aux comptes flamboyants empressés de licencier, de firmes délocalisant pour s’implanter dans des pays où les droits de l’homme — et du salarié — ne comptent pas, ou bien détruisant sans vergogne leur environnement tout en l’exploitant. Le soupçon qui place l’entreprise comme l’ennemie potentielle du social essaime, d’autant plus que les enjeux du « développement durable » élargissent l’étendue du soupçon à l’environnement dans son ensemble. La fin des Trente Glorieuses inspire une évaluation contrastée de l’impact des entreprises sur la société. L’appât du profit entre dans une relation ambiguë avec le bien-vivre; immodéré, il peut être considéré comme une force antisociale contraire au bien commun, dévoreuse d’écosystèmes. De fait, l’entreprise et la société sont entrées dans une relation de dépendance conflictuelle. La défiance le dispute à la séduction. Pour l’entreprise, la société est une réserve de main d’œuvre mais c’est aussi, et surtout peut-être, une réserve de consommateurs dont il faut séduire les appétits pour mieux les satisfaire. Néanmoins les entreprises fournissent aussi des emplois, paient des impôts en fonction de leurs (bons) résultats, et donc contribuent à la richesse des nations, des territoires et des populations.
La société de croissance est de surcroît une société sur laquelle pèsent des menaces écologiques à propos desquelles le consensus ne fait que s’élargir, sinon au plan des remèdes, au moins sur celui du diagnostic. Ces menaces résultent d’un mode de vie qui est aussi un mode de développement issu de la révolution industrielle.
Un concept nouveau
C’est pour faire face à la poussée des contraintes — et aux dangers — que le concept de développement durable fut élaboré et largement diffusé dans les sociétés développées. À la fin des années 1990, la notion de « responsabilité sociale d’entreprise » (RSE) est venue donner le change à une société civile qui a pris progressivement conscience des enjeux sociaux et écologiques d’une mondialisation souvent brutale. Associations, ONG, syndicats, mouvements altermondialistes et pouvoirs publics ont massivement pointé du doigt le rôle des entreprises, plus précisément celui des firmes multinationales, et l’impact du business sur le devenir du monde : inégalités sociales, risques environnementaux, exclusion, changement climatique, risques sanitaires, mépris des droits de l’homme… La financiarisation de l’économie est régulièrement accusée d’agrandir l’écart entre capital et travail, entre effort et enrichissement, entre profit et partage, entre une poignée de nantis ultra fortunés et des populations en voie de précarisation croissante. Il serait toutefois inexact de réduire l’implication sociétale des entreprises à ces seules 20 dernières années. Rappelons pêle-mêle le paternalisme des premiers entrepreneurs considérant les besoins extra-professionnels de leurs employés ; le philanthropisme des capitalistes nord-américains les poussant à financer des œuvres de bienfaisance ; le mouvement coopératif souhaitant réduire l’écart entre dirigés et dirigeants dans un cadre démocratique; le mouvement mutualiste associant solidarité et gestion mutualisée ; sans oublier l’économie sociale et solidaire cherchant à concilier activité économique et utilité sociale… Autant d’exemples illustrant cette volonté ancienne de
« moraliser » l’économie et d’élargir la vocation des entreprises aux questions sociales et politiques. Les organisations entrepreneuriales peuvent se déclarer « militantes » en intégrant un volet social dans leurs pratiques, en évaluant leur impact sur la société et l’environnement pour tenter d’en corriger les errances, sans oublier malgré tout que leur loi suprême reste celle des recettes et des dépenses. Un doute émerge cependant. À travers la RSE les entreprises marquent une hésitation : faut-il gérer les nuisances ou les supprimer ?
La RSE, outil du consensus et de l’image
Contrairement au mouvement coopératif porteur d’une tradition encore, plus ou moins, contestataire, la RSE a ceci de particulier : démarche proactive (comme diraient les managers), elle s’inscrit dans le contexte d’une mondialisation au sein de laquelle Margaret Thatcher affirmait : « There is no alternative ». Observée à l’écart de toute naïveté, la RSE apparaît comme une stratégie visant à désamorcer les contestations en intégrant dans les règles de gestion des entreprises des principes et des critères qui concernent des impacts et des acteurs extérieurs à leurs périmètres. Loin de lutter contre le système, l’argumentaire de la RSE est le fruit de la culture bureaucratico-managériale de l’évaluation (donc de la certification) et de la démonstration de performance. Souvent fondée sur l’adhésion volontaire, la RSE se traduit par des normes et des référentiels non juridiques de portée internationale dont la légitimité dépend d’un intense travail de communication associé à celui des agences de notation et des officines de conseil. Elle applique les remèdes que le système libéral s’autoadministre pour démontrer sa bonne foi symbolique tout en essayant de réguler ses pratiques. La RSE se révèle ainsi l’alibi, producteur de justifications et de consensus, qui permettra de conforter une légitimité malmenée par la course en avant de l’hypercapitalisme. En tant que stratégie, la RSE, observe Michel Capron (1) , est soit « réactive » (lorsque l’entreprise est prise en défaut à l’occasion d’un évènement critique auquel elle répond pour redorer son blason), soit « proactive » (lorsqu’elle agit dans l’espoir d’obtenir un « avantage compétitif » qu’elle exploitera pour se distinguer sur le marché et renforcer symboliquement l’aura de sa marque). Les deux s’avèrent simultanément possibles.
Un patronat d'influence
Au-delà des enjeux de management interne, la RSE est une posture politique. Lorsqu’une entreprise se soucie de son impact à l’extérieur, auprès de ses « parties prenantes » et dans sa « sphère d’influence », elle en vient évidemment à se soucier de la société, du territoire et de sa population, terrains de l’action publique. Si la RSE s’érige théoriquement comme un garde-fou face aux méfaits du capitalisme, elle apparaît aussi dans ses effets, mais de manière plus subtile, comme un moyen pour les managers de conquérir des espaces qui leur étaient traditionnellement extérieurs. En France, une figure emblématique de ce patronat d’influence est celle de Claude Bébéar. Fondateur d’AXA, mais également de l’Institut du mécénat et de la solidarité – Entreprendre pour la Cité, et du think tank Institut Montaigne, l’ambition de ce patron est clairement d’inspirer une politique libérale « réformiste » visant à préserver le capitalisme de ses excès pour mieux le conserver. En 2004, à la demande de Jean-Pierre Raffarin alors Premier ministre, il fut à l’origine d’un rapport sur l’intégration des minorités visibles largement relayé dans les médias. La charte de la diversité en a découlé, recueillant plus de 3 000 signatures. Or le discours de Claude Bébéar n’est pas seulement significatif en raison de son audience, il l’est et politique (versant public). Côté privé, la communication énoncée vise à provoquer une prise de conscience du milieu entrepreneurial sur ce qui est présenté comme un fait indubitable : le profit exige et suppose une société équilibrée et stable; le chaos social et environnemental n’est pas propice aux affaires. Il convient donc que les entreprises, à des fins autant correctives que préventives, intègrent dans leurs pratiques managériales cette dimension sociétale. Non par altruisme mais pour leur intérêt bien compris. Côté public, le discours, tel qu’il est inscrit au fronton internet de l’Institut Montaigne, affirme que le débat public en France est trop accaparé par l’administration et les partis politiques, et que manquent les voix de ce que Bébéar appelle « la société civile ».
Seulement voilà, la société civile selon Bébéar, ce n’est pas « le peuple » mais l’entreprise et sa sphère d’influence, incluant des associations pour l’action sociale, et des partenaires commerciaux pour l’action économique.
À la recherche du bien commun. Mais lequel ?
S’occuper de RSE n’opère, philosophiquement, aucune rupture avec le modèle libéral. La rhétorique de la responsabilité le prolonge et le positionne stratégiquement face aux enjeux nouveaux, sociaux et écologiques, rouges, roses ou verts, dont il accouche. Elle cherche à convaincre l’opinion et provoquer le consensus en prônant l’aménagement d’un système virtuellement vertueux. Problèmes nouveaux, doctrine ancienne. La logique sous-jacente n’est innovante en rien, en rien elle ne rompt avec le modèle. Elle en clame au contraire la vertu intrinsèque, dans une lignée intellectuelle proche de celle d’Adam Smith — qui n’était pas d’abord économiste puisqu’il enseignait la philosophie morale. En résumé : si nous voulons que le modèle économique perdure et que la société nous soit profitable, il nous faut faire preuve d’un minimum de vertu morale envers autrui. Cette bienveillance n’est pas fondamentalement altruiste, elle est guidée par le désir qu’autrui contribue, plus ou moins directement et avec un brin de bonne volonté, à la satisfaction de nos intérêts. Alors la « main invisible » assurera la convergence des intérêts particuliers dans le sens de l’intérêt général. Il s’agit finalement de proclamer la « coïncidence des intérêts privés avec l’intérêt général ou la compatibilité des vices privés avec le bien public », selon la formule teintée d’ironie de l’anthropologue Gilbert Rist. L’argumentaire est vieux comme la conquête capitalistique de la planète. Nul besoin, donc, d’un Grand Régulateur volontariste ; le Marché se suffit à lui-même, il s’autorégule. Cette réduction du rôle de l’État opérée par Adam Smith sera plus tard poussée à son comble par l’économiste ultralibéral Milton Friedman et ses compagnons de route libertariens : ils ne voient en l’État qu’un fauteur de troubles faussant le jeu économique et sociétal.
Une nouvelle concurrence
Au motif de leur RSE, les entreprises institutionnalisent leurs propres normes au nom du bien commun. Cette préoccupation de l’intérêt général, lorsqu’elle débouche sur des partenariats effectifs entre pouvoirs publics et privés, signifie que le pouvoir privé peut aussi devenir, le cas échéant, concurrent du pouvoir public. L’entreprise se hisse à la hauteur de l’État. « Les discours sur la RSE, soulignent Catherine Bodet et Thomas Lamarche, peuvent être lus comme autant de productions de légitimité visant à instituer un rôle social élargi pour la firme. Se déclarant responsables à l’égard de la société et des générations futures en dehors d’un cadre légal dûment validé et institué, les grandes entreprises se situent dans le registre de la définition de ce qu’est l’intérêt général. » L’enthousiasme devant le « capitalisme
enchanté » de la RSE ne doit donc pas endormir la vigilance, si l’on admet encore les valeurs spécifiques — de justice sociale, rien de moins — jusqu’ici portées par l’État. En ces temps d’économisme triomphant, la RSE représente un pas que fait l’entreprise dans le jardin de la puissance publique. Avec elle ou contre elle ? Le pouvoir privé génère ses propres normes, et, à force de lobbying, peut, selon les circonstances, prétendre contrecarrer l’initiative publique en s’arrogeant certaines de ses prérogatives — soft law auto-institutionnalisée, pseudo contrainte non obligatoire (2) contre hard law non dérogatoire venue de l’État. Demandons-nous alors si la RSE avance en cheval de Troie d’un hypercapitalisme qui verrait des financiers, des managers et leurs alliés politiques redéfinir le « bien commun » en fonction d’intérêts ambigus, ou si elle est le signe d’une prise de conscience génératrice d’avantages et de régulations socio-écologiques désintéressés, impartiaux et… durables. Un constat s’impose enfin : depuis 20 ans la RSE n’est parvenue ni à enrayer ni à réparer la casse sociale et les désordres environnementaux. Ses preuves ne sont pas faites et ses insuffisances politiques apparaissent, en revanche, criantes.
_______________________________________________________________________
(1) Michel Capron, La responsabilité sociale d’entreprise. L’Encyclopédie du Développement Durable n°99 – juillet 1999.
(2) Cf. Article de Catherine Bodet et Thomas Lamarche, « La Responsabilité sociale des entreprises comme innovation institutionnelle. Une lecture régulationniste ». Revue de la régulation - Capitalisme, Institutions, pouvoirs. Maison des Sciences de l’Homme – Paris Nord. N°1, Juin 2007.