Quand les services urbains font appel à la recherche

Interview de Jean CHAPGIER
Ingénieur à la Direction de l'eau du Grand Lyon
Interview de Bernard CHOCAT

<< Dès 1973/74, la Courly a demandé un soutien technique à l’INSA pour essayer de construire un modèle de réseau d’assainissement lyonnais >>.
Propos recueillis par Cédric Polère, le 24 avril 2009
Bernard Chocat dirige le Laboratoire de Génie Civil et Ingénierie Environnementale (LGCIE) de l’INSA de Lyon. Au milieu des années 70, une coopération se noue entre l’INSA et le service de l’Assainissement de la Communauté urbaine de Lyon pour construire un modèle du réseau d’assainissement lyonnais. Alors jeune assistant à l’INSA, Bernard Chocat fait d’un problème de la Communauté urbaine son sujet de thèse. Cette coopération montrera ses bénéfices au fil des années, ce qu’atteste aujourd’hui la reconnaissance internationale en matière d’hydrologie et de gestion des eaux pluviales des laboratoires lyonnais, autour de l’INSA et du CEMAGREF, et de la direction de l’Eau du Grand Lyon. Cette initiative pionnière mettra le Grand Lyon sur une voie qu’il entend aujourd’hui systématiser, en devenant un partenaire de processus d'innovation.
Comment débute l’histoire de la coopération entre l’INSA et le service de l’Assainissement de la Communauté urbaine de Lyon ?
A mon début de carrière dans l’Education nationale, dès 1973/74, le directeur général des services techniques de la Communauté urbaine, Fernand Pauwels, et André Poncet, le directeur de l’Assainissement ont demandé un soutien technique à l’INSA pour essayer de construire un modèle de réseau d’assainissement lyonnais.
Quelle était la situation ?
Avant la création de la Communauté urbaine, il y avait plusieurs syndicats intercommunaux qui s’occupaient d’assainissement et un système non seulement hétéroclite mais mal connu, avec des plans mal adaptés. Ils ont posé la question à l’INSA : êtes-vous capables de faire un bilan de notre patrimoine, et dire comment il fonctionne à l’échelle de l’agglomération ? J’ai choisi cette question comme sujet de thèse, avec comme correspondant à la Communauté urbaine Guy Peyrreti, à l’époque jeune ingénieur docteur en géologie. Quelques mois plus tard, Daniel Seguin a commencé une thèse sur l’évaluation des coefficients d’imperméabilisation à prendre en compte dans des calculs, en fonction des typologies d’urbanisme. Il fallait recueillir des données et construire un modèle de fonctionnement pour savoir quelles étaient les zones bien et mal dimensionnées. Cela s’est traduit par le logiciel SERAIL dont le premier modèle a été élaboré en 1978, avec comme partenaires le Service Assainissement de la Communauté urbaine et la société ICARE. Un gros travail a été fait avec Guy Peyrreti. C’est l’un des premiers outils informatiques qui permettait de faire une simulation.
Qu’ont donné les simulations ?
A l’époque, la Courly avait un projet de grand collecteur qui récupérait l’eau de l’est de l’agglomération pour l’amener vers le grand collecteur de la rive gauche du Rhône. Les simulations ont montré que cette solution était inefficace et risquait de provoquer des inondations très importantes dans le centre de Lyon. Une solution alternative consistant à continuer à infiltrer les eaux pluviales dans la plaine de l’Est et à construire deux collecteurs de ceinture, dits Nord vers la future station de la Feyssine et Sud a alors été élaborée. La première étude a fait la démonstration de l’intérêt que la Communauté urbaine avait de travailler avec le monde de la recherche. Une énorme erreur avait été évitée grâce à cette collaboration. Dans un même temps, on a pensé qu’il faudrait changer de technologie, avoir autre chose que du tuyau et utiliser l’infiltration.
Depuis lors, on a l’impression qu’un noyau stable de collaboration s’est mis en place entre l’INSA et la Communauté urbaine. Denis Hodeau, actuel directeur de la direction de l’Eau du Grand Lyon n’a-t-il pas été votre élève ?
C’est vrai, le noyau reste le même, autour de Guy Peyrreti, Jean Chapgier, Denis Hodeau, Gérard Caviglia du côté de la Communauté urbaine… Denis Hodeau était à l’époque un de mes étudiants ; sorti de l’INSA en 1975, il était au bureau d’études dirigé par Gérard Caviglia, qui est devenu directeur, avant que Denis Hodeau soit lui-même directeur. Ces filiations sont bénéfiques car les services techniques ont besoin de structures, d’entreprises, de bureaux d’études qui soient dans le même état d’esprit.
La collaboration entre la Communauté urbaine et l’INSA a été fructueuse si l’on en juge par le leadership lyonnais sur les questions d’eau. A quoi cette réussite est-elle dûe ?
A l’époque, l’eau était un sujet neuf. Sur ce sujet, la communauté scientifique s’est structurée à l’échelle internationale à partir de la fin des années 70. Notre chance, c’est que l’INSA ait participé à cette émergence à l’échelle internationale, et que cela soit intervenu au début de la Communauté urbaine. Nous avons eu aussi la chance de montrer que le projet communautaire de grand collecteur était calamiteux, donc de démontrer dès le début ce que l’on pouvait apporter.
Que se passe-t-il après la réalisation du logiciel SERAIL ?
Au début des années 80, nous avons continué à travailler sur la modélisation, mais le contexte a changé avec les lois de décentralisation de 1982-1983. Le service technique de l’urbanisme, service étatique de soutien aux collectivités locales a disparu. Jean-Claude Deutsch, directeur des équipements urbains, m’a sollicité pour monter un groupe d’action régional sur l’eau. Le Groupe de Recherche Rhône-Alpes sur les Infrastructures et l'Eau (GRAIE) est créé en 1985, en particulier en relation avec Guy Peyrreti. Le GRAIE a pour vocation de diffuser l'information, de sensibiliser et mobiliser des chercheurs et des acteurs opérationnels sur des questions liées à la gestion de l'eau dans la ville. Le GRAIE, au début, fonctionnait avec des bénévoles, puis il nous a fallu embaucher du personnel. Il devenait nécessaire que la Communauté urbaine considère soit que le GRAIE a une raison d’être, pour construire une culture régionale et partagée de l’eau et dans ce cas le soutienne financièrement, soit qu’il ne vaut pas la peine de continuer à exister.
Qu’advient-il ?
Le soutien politique, avec un financement à la clé est arrivé avec le mandat de Michel Noir. Une convention cadre sera signée entre le GRAIE et le Grand Lyon, nous facilitant grandement la tâche. Depuis, une subvention est accordée tous les ans dans le cadre d’une convention quadriennale. Elle est aujourd’hui centrée sur le soutien recherche aux applications en assainissement.
Le GRAIE gère-t-il directement les projets de recherche avec le Grand Lyon ?
Non, le GRAIE intervient uniquement sur la valorisation de la recherche et la coordination des acteurs. Les actions de recherche sont menées directement avec les établissements. Par exemple, en ce qui concerne mon laboratoire, lorsque le Grand Lyon souhaite une prestation, il passe par INSAVALOR, filiale de valorisation de l’INSA de Lyon. Dans ce cadre contractuel nous travaillons sur les questions de maintenance du réseau, de gestion de patrimoine, d’envasement… Les projets ont des ampleurs très différentes. Il peut s’agir de travaux d’expertise sur des questions pratiques ou de recherche plus amont associées à des thèses. Concernant les thèses, soit la recherche est commandée par la Communauté urbaine à travers une question qui nous est proposée, soit il nous arrive de proposer un sujet et de demander un soutien technique.
Que devient, pendant tout ce temps, le logiciel SERAIL ?
Au milieu des années 80, la préoccupation du service de l’Assainissement de la Courly portait moins sur la modélisation que sur la structuration des données. Cela a donné lieu au premier système d’information géographique de la Communauté urbaine. Des thèses sont soutenues à l’INSA, dont celles de Catherine Riosset et de Laurence Lupin qui contribuent au nouveau système informatique du service de l’Assainissement, GESICA, appuyé sur cette base de données urbaines. L’objectif est que l’ensemble des personnes ayant besoin d’informations sur le réseau, service études, égoutiers, exploitants, service clientèle disposent des mêmes informations. Le Laboratoire Méthodes de l’INSA est impliqué. Alors que SERAIL a été abandonné, le travail sur la modélisation reprend de l’importance ; nous développons un nouveau logiciel de simulation, CEDRE qui lui-même sera à l’origine du logiciel aujourd’hui utilisé par le Grand Lyon, CANOE.
Aujourd’hui, la direction de l’Eau utilise donc le logiciel CANOE. Qu’est-ce au juste ?
C’est un Logiciel d’hydrologie urbaine multi-usages pour gérer l’assainissement. Opérationnel depuis 1995, il a été conçu et réalisé par notre laboratoire LGCIE et le Laboratoire d'Hydraulique de France de Grenoble (actuellement SOGREAH), en collaboration avec le Ministère de l'Agriculture et des collectivités territoriales ayant une longue expérience de l'utilisation de l'informatique technique dans le cadre de la modélisation des réseaux d'assainissement : Grand Lyon, Lille Métropole, Rennes, Strasbourg, les départements de Seine Saint Denis et du Val de Marne.
Pourquoi l’avoir créé ?
Il existait le logiciel CEDRE, facile d’utilisation, et le logiciel CAREDAS, développé par SOGREAH, bien plus performant mais destiné à des hyperspécialistes. L’idée a été de marier les deux. Pour concrétiser cette idée, il fallait trouver des financements. Un club d’utilisateurs s’est solidarisé pour apporter des fonds et assurer le développement du produit. Nous avons fait le choix de produire sans être uniquement commercial et de faire en sorte que si un problème se présente, des techniciens soient à la disposition des collectivités pour programmer et résoudre les problèmes. Une collectivité ne peut porter ça à elle seule. L’INSA qui contractualise avec chaque collectivité, est l’animateur du projet. Pour nous c’est intéressant, car CANOE est un outil de valorisation de nos résultats de recherches, il est extrêmement performant pour nous.
Peut-on dire que votre laboratoire LGCIE réalise de la recherche & développement ? Dépose-t-il des brevets ?
Le positionnement du laboratoire est orienté vers la recherche appliquée et l’ingénierie. Il part toujours d’une question pratique, d’une demande de résolution, et fabrique des méthodes, des connaissances et participe à l’élaboration d’outils.
Il est souvent dans une recherche dite prénormative, qui cherche à bâtir des connaissances qui vont servir à définir des normes, ce qui est d’ailleurs très difficile à protéger par un brevet.
Où est l’innovation dans le travail de votre laboratoire ?
Elle se situe notamment dans la structuration des données informatiques, dans la construction de modèles de simulation, dans le développement de nouvelles solutions, dites alternatives, pour gérer les eaux pluviales ou dans les procédés pour mieux gérer les réseaux d’assainissement. Nous travaillons aussi, dans une moindre mesure, sur les réseaux de distribution de l’eau potable.
Quelle est la part de recherche ?
Nous avons besoin de données fiables sur le fonctionnement du système pour mener à bien ces travaux. Par exemple en ce qui concerne les risques liés à l’infiltration, comment savoir si l’eau de pluie que nous laissons s’infiltrer risque de polluer la nappe ?
Pour réaliser ce type d’étude et évaluer les performances des ouvrages il faut mettre en place des campagnes de mesures des débits et de la qualité de l’eau. Pendant longtemps, on mettait en place une campagne à chaque nouvelle étude. Or la mesure in situ était très difficile : on mettait un an à installer le matériel, puis six mois à le faire marcher, ensuite on attendait les pluies pour n’ en mesurer correctement qu'une ou deux... Cela coûtait cher et était extrêmement frustrant, car il n’y avait pas de continuité dans les mesures.
C’est la raison pour laquelle nous sommes arrivés à l’idée, avec la Communauté urbaine, qu’il fallait construire un observatoire pérenne des flux d’eau et de polluants produits par l’agglomération, notamment pour connaître l’impact de ces flux sur les nappes, dans l’Est de l’agglomération, mais aussi dans les ruisseaux et rivières de l’Ouest de l’agglomération, notamment l’Yzeron. La création de l’Observatoire Terrain sur l’Hydrologie Urbaine (OTHU) vient de là. Cette nouvelle étape a permis de renforcer considérablement les partenariats.
Si je vous comprends bien, la création de cet observatoire était une question de rentabilité ?
Oui, sur une campagne de mesures, on dépensait 15 mois pour rien et 3 mois d’utile. En installant des appareils sur une durée de 15 ans, on pensait pouvoir connaître les évolutions sur le long terme. Cela revient à mettre en place un suivi continu. Mais pour cela, il fallait multiplier par dix les moyens techniques et humains pour traiter les données.
Vous avez parlé de partenariats ?
Une quinzaine d’équipes de recherche sont associés à l’OTHU, qui reste malgré tout très lyonnais. Il regroupe les universités Lyon 1, Lyon 2, Lyon 3, l’INSA, l’ENTPE, le CEMAGREF, BRGM, l’Ecole Centrale. En matière de disciplines, il fait appel à l’hydrologie, la climatologie, l’hydrobiologie, la sociologie. Nous faisons fonctionner ce dispositif pour un travail d’observation instrumentale. L’OTHU est une structure originale, à la fois une fédération scientifique, qui renforce de manière très forte la compétence scientifique de l’agglomération, et à la fois un programme de recherche finalisée, qui rassemble. Le programme que nous avons adopté s’appuie su un objectif à long terme (construire un modèle général du cycle de l’eau dans l’agglomération lyonnaise) qui se décline en objectifs sur 4 ans.
L’OTHU doit pouvoir apporter une réponse à la question que les gens n’arrivent pas à résoudre en arrivant à leur bureau. A cette occasion, il est apparu que beaucoup des questions posées étaient déjà résolues, mais que les scientifiques n’avaient pas fait passer l’information.
Concrètement, que produit l’OTHU ?
Tout ce qui est produit par l’OTHU aboutit à des préconisations, des règles pratiques. Par exemple, dans le guide technique des bassins de rétention, on dit comment faire. Ces préconisations englobent des aspects philosophiques, par exemple : jusqu’à quel endroit doit-on protéger le sol ? A-t-on le droit de polluer le sol ? Comment renouveler le sol ?… C’est un travail collaboratif.
Peut-on dire que cet observatoire est unique en France ?
Non, d’autres observatoires existent : l’OPUR (Observatoire des Polluants Urbains) à Paris et le SAP à Nantes, observatoire de l’environnement urbain. Ces trois observatoires travaillent aujourd’hui de manière conjointe. Il faudrait de la même manière que les collectivités aillent vers davantage d’inter-collectivité dans le portage du développement d’outils. C’est nécessaire, même si c’est compliqué sur le plan politique…
Comment l’OTHU est-il financé ?
Un financement récurrent est apporté, pour assurer la continuité des mesures, par le Grand Lyon, l’Agence de l’eau, la Région Rhône-Alpes, le Ministère du développement durable. Pour analyser les données, nous obtenons des financements européens et de l’Agence nationale de la recherche. Le pôle de compétitivité Axelera est aussi une source de financement, à travers de grands projets, comme Rhodanos.
Tous les trois ans, les spécialistes mondiaux de l’eau se retrouvent lors d’une conférence internationale, les Journées Novatech. Pourquoi avoir créé cet événement ?
Novatech est apparu dans un cadre un peu particulier, celui de la réflexion à Lyon sur l’intégration urbaine de techniques alternatives. Aujourd’hui, on essaye de développer la ville sans impacter l’eau, ou de « développer des villes sensibles à l’eau », on parle aussi de « low impact development ». Notre raisonnement a été le suivant : pourquoi ne pas associer au salon Pollutec un événement sur les nouveaux outils de gestion de l’eau pluviale ? D’où Novatech, une conférence qui a réuni 200 personnes, dans le cadre de Pollutec 1992. Tous les grands experts sont venus. Novatech est organisé par le GRAIE tous les trois ans. Cela valorise ce que nous réalisons avec l’OTHU. En 2007, avec 700 personnes pendant trois jours, c’était le plus grand congrès au monde en matière d’assainissement pluvial. Pour Lyon, c’est un retour d’image : Lyon appartient à un site d’innovation majeur en matière de gestion de l’eau.
Peut-on parler de communauté scientifique à Lyon sur le thème de l’eau ?
Oui, un bon indicateur en est que le Laboratoire LGCIE de l’INSA a été le seul laboratoire au monde à avoir été deux fois à la présidence du Joint Community on Urban Drainage, référence mondiale sur l’assainissement pluvial.
L’OTHU représente une cinquantaine de chercheurs dans les laboratoires de la Région, et permet de développer l’expertise de plusieurs centaines d’ingénieurs dans les bureaux d’étude de la région lyonnaise.
Je comprends qu’il existe une tradition de coopération entre le Grand Lyon et l’INSA, mais le partenariat avec les industriels fonctionne-t-il aussi bien, dans le pôle de compétitivité Axelera notamment ?
En effet, ce que je remarque, en tant que membre du conseil scientifique d’Axelera, c’est qu’il n’est pas simple de faire du partenariat industriel… Nous avons par exemple obtenu que le Grand Lyon soit aujourd’hui plateforme européenne du « Water Supply Sanitary Technology Plateform ». Cette plateforme technologique dans le domaine de l’eau est supportée par une collectivité (le Grand Lyon), une communauté scientifique et une communauté industrielle (Véolia et Suez). La Communauté urbaine est responsable de la plateforme et le laboratoire LGCIE de l’INSA de son animation. Le partenariat marche assez mal, par manque d’enjeux clairs pour les industriels, et parce qu’il est difficile pour le Grand Lyon d’être à la fois partenaire d’un industriel, et client.
Dans le cadre d’Axelera, qu’apporte le Grand Lyon aux projets de recherche ? Des financement, des sites… ?
Cela dépend. A l’INSA, quand nous avons réalisé une recherche sur les tranchées d’infiltration avec SOGEAH Rhône-Alpes, le Grand Lyon a participé en mettant le terrain à disposition mais n’a pas apporté de financement. Dans le cadre du programme Rhodanos, le Grand Lyon est financeur du projet de façon directe et indirecte car le projet utilise les données produites par l’OTHU. Du coup, le financement se fait par la Communauté urbaine à la fois en tant que contributrice au financement de l’OTHU, et à la fois par la Délégation Générale au Développement Urbain du Grand Lyon, qui finance Rhodanos. Pour autant, c’est la direction de l’Eau qui est dans le comité de suivi…
Quels sont les déclencheurs de l’innovation dans le domaine de l’eau ?
Pour qu’il y ait besoin d’innovation, il faut une multiplicité de raisons favorables plus un facteur déclencheur qui est souvent une catastrophe (au sens du mathématicien Tom), par exemple une inondation, ou un changement réglementaire drastique. A partir de là, les techniciens, les bureaux d’études et les entreprises développent des savoir faire et des compétences. L’innovation peut se développer par « niches ». Par exemple, dans certaines villes, à Bordeaux, Lille, Douai, Lyon, l’utilisation de techniques alternatives dans le domaine de l’assainissement pluvial est devenu la règle, alors d’autres continuent à « faire du réseau » comme on en faisait il y a 30 ans. Les déclencheurs peuvent être multiples. A Bordeaux, il fallait une technique pour continuer à urbaniser la ville centre sans risque d’inondation. L’innovation est aussi favorisée quand les hommes politiques disent qu’il « faut faire ».
Dans sa thèse de doctorat consacrée à l’histoire du réseau d’assainissement lyonnais (« L’égout, patrimoine urbain… »), le géographe Franck Scherrer a montré que ce réseau, en s’étendant, a posé rapidement la question de la pertinence des périmètres communaux et a finalement donné naissance à l’intercommunalité lyonnaise. En tant que chercheur et bon connaisseur du réseau lyonnais, qu’en pensez-vous ?
Cela ne m’étonne pas. Le territoire de l’eau est imposé par le relief et la gravité, et cette configuration physique impose une solidarité entre l’amont et l’aval. La question de l’adéquation des territoires techniques de l’eau avec les territoires administratifs est fondamentale. Les communes étant beaucoup trop petites en matière de gestion de l’eau, la supra-communalité devient la règle.

Interview de Jean CHAPGIER
Ingénieur à la Direction de l'eau du Grand Lyon

Interview de Laetitia Dablanc
urbaniste et enseigne à l’Université Gustave Eiffel

Interview de Samuel Deprez
maître de conférences (HDR) en aménagement et urbanisme à l’Université Le Havre Normandie

Article
Si la transition écologique doit s’envisager comme une réorientation globale et transversale de nos modes de vie, les enjeux de mobilité devront être saisis comme l’un des dénominateurs communs aux différents secteurs d’activité à transformer.

Ce dossier traite de la mobilité dans l’espace géographique, de l’idée de mouvement au cœur des imaginaires de notre société et des manières d'en décoder le fonctionnement social.

Étude
Découvrez Mémoires - Rétroprospective, le podcast de Millénaire 3, sur les 45 ans d’histoire de la Communauté Urbaine de Lyon (1969-2014).

Article
Comment la métropole lyonnaise a-t-elle évolué en 20 ans et quelles sont les grandes mutations qu'elle a vécues ? Dans ce texte Olivier Roussel, géographe et urbaniste, explique, à travers 7 concepts, le travail réalisé pendant 20 ans avec les équipes de l’Agence Urbalyon.

Étude
Cette étude propose une revue de la littérature en sciences sociales pour mieux appréhender les attitudes et comportements des habitants en matière de propreté urbaine.
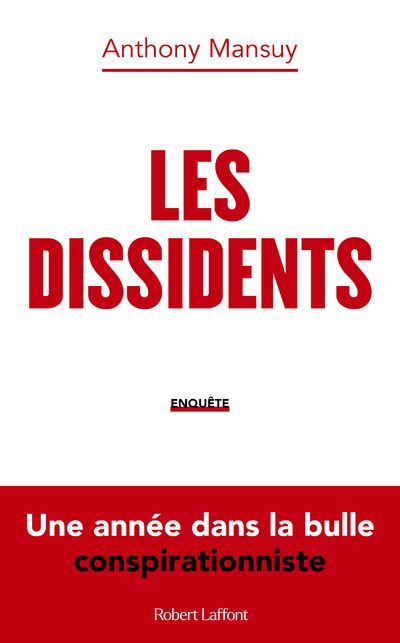
Article
Après la poussée de complotisme constatée pendant la pandémie, quels enseignements tirer pour réconcilier sciences et engagement citoyen ?