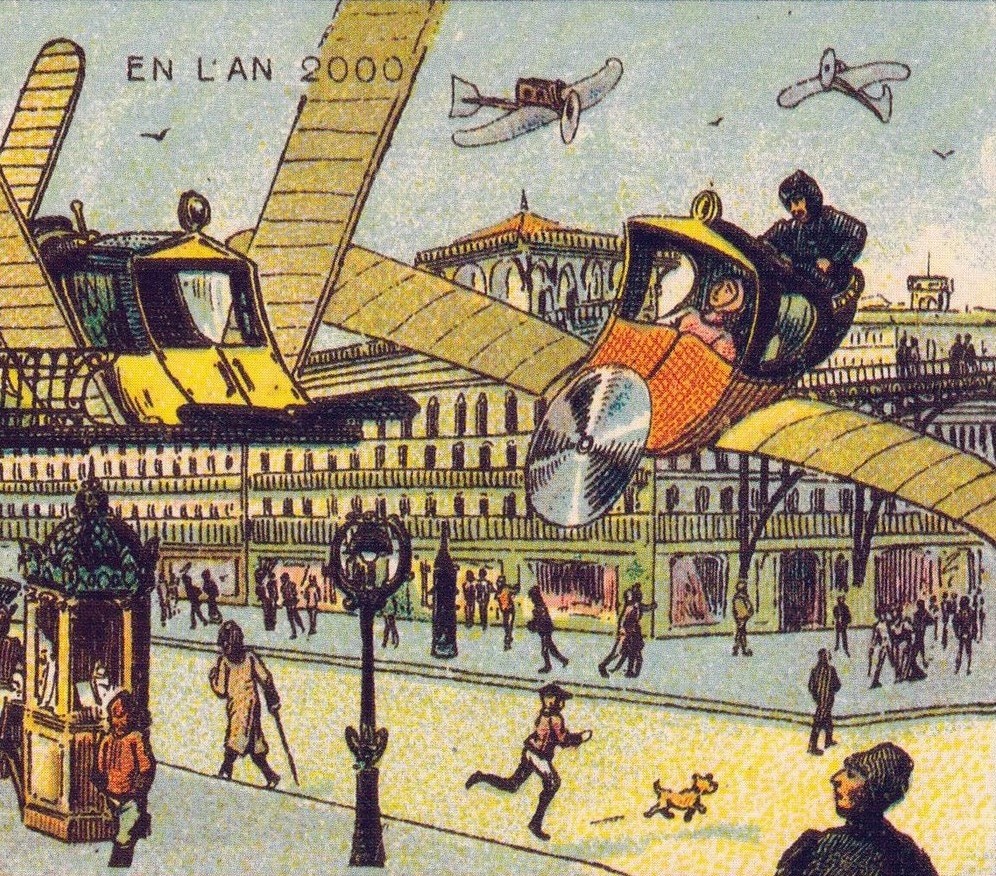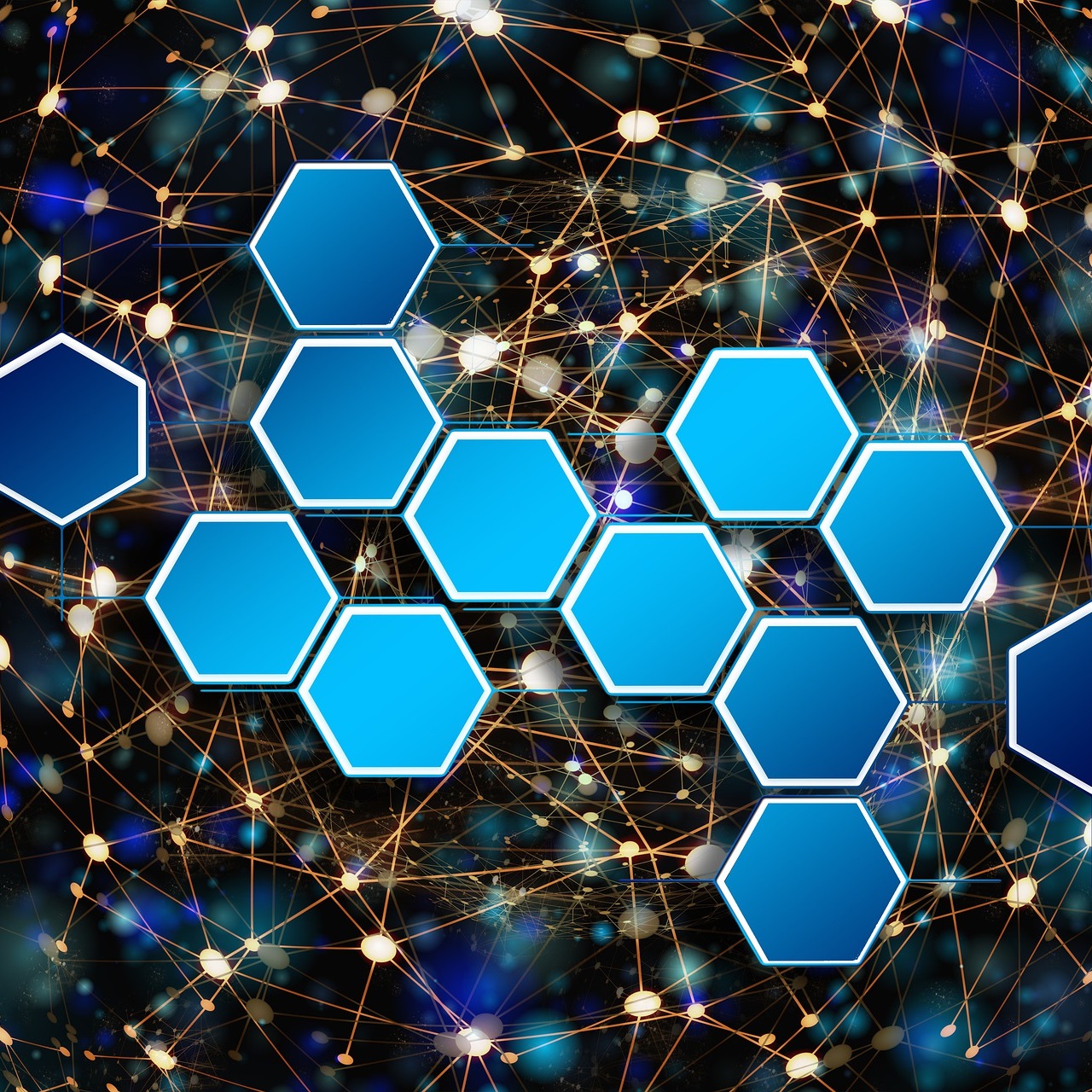J’ai lu avec intérêt votre article « science fiction et science politique » publié sur votre blog. Pourquoi avoir abordé la question de l’apport potentiel de la science fiction à la pensée de l’avenir ?
Je suis un lecteur assez ancien de science fiction, mais je ressens surtout une insatisfaction face aux sciences sociales actuelles. Nous sentons bien qu’elles sont face à des évolutions du monde qu’elles n’arrivent pas à saisir, car leurs bases de réflexion sont de moins en moins adaptées. La littérature de science fiction fait partie de ces bases de réflexion autres que l’on gagnerait à ne pas ignorer. C’est un matériau intéressant, qui pose des hypothèses et essaie de prendre la voie de la fiction pour voir où elles peuvent mener. Les œuvres de science fiction ne se contentent pas de raconter des histoires dans des univers plus ou moins éloignés de notre réalité. Ce qui m’intéresse, c’est que c’est une manière de poser des hypothèses audacieuses sur le futur, car les auteurs peuvent se permettre des explorations que nous oserions difficilement faire dans la recherche académique.
Les récits de science-fiction ne sont donc pas à prendre comme des tentatives pour prédire ou annoncer l’avenir, mais comme des dispositifs exploratoires, permettant de mettre à l’épreuve des éléments de futurs possibles. Il est possible ensuite de travailler les hypothèses posées de manière fictionnelle. La science fiction offre du coup un territoire de réflexions qui peuvent être reconnectées à des enjeux sociopolitiques actuels. La base de questionnement d’un roman de science fiction, « que se passerait-il si… ? », paraît simple, mais elle est très féconde car elle permet de reprendre avec une grande liberté les prémisses posées au départ, et de suivre l’enchaînement des effets au plus loin de leurs conséquences logiques. Cet exercice n’est pas complètement réductible à la fiction puisqu’il exploite le registre de la « conjecture romanesque rationnelle», pour reprendre l’expression de l’écrivain Pierre Versins.
Les sciences sociales peinent à suivre les évolutions actuelles : que voulez-vous dire ?
J’ai l’impression qu’elles sont en retard d’un train. Des évolutions très fortes sont en cours mais nous ne les voyons pas, enfermés que nous sommes dans une espèce de routine intellectuelle. Ma discipline, la science politique, couvre certains champs et certaines évolutions, mais en laisse passer d’autres. Je pense notamment à la technique. Les évolutions techniques sont telles que leur influence est beaucoup plus forte que bien des sujets qui mobilisent les politologues. Des modifications de la Constitution par exemple ne changent pas fondamentalement les choses, alors que l’évolution technologique qui donne naissance à l’Ipad a sans doute une influence bien plus profonde. Et là il faut admettre que la réflexion sur ce que ces évolutions pourraient produire est davantage du côté de la science fiction.
Autrement dit, des formes de pensées trouvent leurs limites, et une prise de conscience essaye de se faire sur la nécessité de trouver autre chose. Les rythmes des évolutions socio-techniques vont tellement vite qu’il n’est plus possible de rester dans les cadres de pensée qui prévalaient auparavant, ce qui implique de revoir les méthodes et les matériaux que l’on utilise. C’est par exemple ce que semble faire, d’une autre manière, Bruno Latour avec son Ecole des Arts Politiques à Science po Paris.
Justement, existe-t-il des laboratoires universitaires qui prennent au sérieux la science fiction, et l’utilisent dans un cadre de prospective ?
À l’Université du Québec à Montréal, la Chaire de responsabilité sociale et de développement durable a amorcé une recherche qui mobilise la science-fiction pour y trouver des pistes pour dessiner les traits de sociétés alternatives capables de résoudre les défis écologiques. Leur idée est de reprendre la littérature de science fiction et de voir quels scénarios ont été explorés fictivement pour sortir d’une crise écologique, ou gérer des enjeux écologiques.
Un groupe de recherche cherche à repérer des œuvres de science fiction, romans ou films, qui explorent le fonctionnement d’une société post-écologique, c’est-à-dire d’une société aux prises avec des dérèglements environnementaux majeurs, dans le but de les analyser et d’en discuter pour dégager des scénarios. La science-fiction étant une manière d’essayer de décrire comment il serait possible d’habiter les mondes en préparation, il n’est pas étonnant qu’elle ait été pénétrée par les enjeux de chaque époque et qu’elle les ait traduits. C’est le cas des enjeux écologiques, comme c’est le cas aussi des enjeux démographiques par exemple.
D’autres expériences existent, au sein de l’Université d’Oxford, avec le Future of Humanity Institute qui s’est donné pour mission d’étudier la manière dont les technologies futures pourraient affecter la condition humaine, à la fois du point de vue des potentialités ouvertes et des risques.
Vous parlez de la science fiction comme forme d’expérimentation. Pouvez-vous expliquer ce que vous entendez par là ?
L’expérimentation n’est pas seulement une démarche empirique, elle peut être aussi mentale. A ce titre, la science fiction peut être considérée comme une forme d’expérimentation. Le devenir post-humain est ainsi expérimenté par la science-fiction depuis des années. Dans les récits, on a vu apparaître de plus en plus d’individus bénéficiant de nouvelles techniques appliquées aux corps et aux esprits. La littérature cyberpunk est remplie de multiples interfaces cerveau-machine. On rejoint la thématique du cyborg, hybride d’humain et de machine, qui a ouvert un vaste champ de réflexion. Ces récits fonctionnent en quelque sorte comme des expérimentations qui aident à se demander dans quelle mesure ces prothèses et modifications pourraient finir par changer l’être humain lui-même.
Comment percevez-vous la circulation d’idées et de réflexions entre chercheurs en sciences sociales et auteurs de science fiction ?
Cette circulation d’idées n’apparaît pas, car un scientifique, et a fortiori en sciences sociales, a souvent un peu de honte d’admettre qu’il s’est inspiré d’auteurs de science fiction. Pour cette raison, cela a été pour moi une grosse surprise qu’une revue de science politique, « Raisons politiques », accepte et publie, en novembre 2010, mon article « Ce que la science fiction pourrait apporter à la pensée politique ».
Qu’apporte la fiction à la pensée de l’avenir?? Doit-on mettre en avant sa fonction de signal d’alarme, de révélateur des envers d’horizons que l’on pensait positifs, d’expression des craintes et aspirations d’une société, d’aide à penser des situations problématiques…?
La science-fiction est couramment utilisée comme un moyen d’alerter, avec une potentialité éventuellement critique et une dimension politique, du fait des questionnements et des sujets mis en scène. Souvent aussi, l’analyse des œuvres de science fiction, soit en sciences sociales, soit en littérature, reste sur l’axe utopie-dystopie. J’avais envie de casser cet axe, de ne pas retomber dans ce qui me semble devenir une espèce d’ornière.
Ce qui m’intéressait était d’appréhender ces œuvres comme des champs d’expériences. Parce qu’elle permet d’ouvrir les cadres de l’imagination, la science-fiction peut être exploitée comme un réservoir d’expériences potentielles qui aide à réfléchir sur les avenirs possibles et leurs conditions de réalisation. L’indétermination du futur permet de faire varier les conditions que pourraient rencontrer les collectivités humaines à venir. J’ai envie de considérer la science fiction comme un vaste magasin en extension continue, où seraient disponibles différentes gammes d’expériences de pensée. Si l’on se concentre sur la question de savoir si ce sont des utopies ou des dystopies, on retombe sur des schémas anciens, tendanciellement sclérosants, qui nous empêchent d’exploiter le potentiel de ces réflexions.
Ce qui m’intéresse avant tout, c’est que par ses montages spéculatifs, la science fiction peut être un support et un vecteur de réflexivité collective, autrement dit de mise en forme et de mise en circulation de sujets de réflexion. Pour schématiser, la science fiction travaille la façon dont l’humanité change en raison de ce qu’elle produit. Mon hypothèse est que la science-fiction représente une façon de ressaisir l’enjeu du changement social, la question de ses conséquences, et de la maîtrise desdites conséquences. La science-fiction s’exprime sur les mutations plus ou moins profondes de nos sociétés, et plus précisément sur les trajectoires que ces transformations semblent pouvoir prendre.
En préparant la réflexion, en lui donnant des accroches, la science fiction contribue aussi à ce que l’on évite d’être désorienté devant des situations problématiques. Les hypothèses fictionnelles peuvent ou pourraient aider à ouvrir des espaces de débat et ainsi à construire ou restaurer une forme de responsabilité collective à l’égard de ce qui n’est pas encore advenu, mais qui pourrait constituer le futur. C’est la raison pour laquelle j’estime que la science-fiction peut aussi produire autre chose que de l’étonnement, le fait au contraire de ne pas être étonné face à des évolutions, lorsqu’on voit des événements ou des situations survenir, une impression de familiarité, de déjà-vu. La science-fiction contribue certainement à préparer les esprits. Ce qui est sûr, c’est qu’elle participe à la construction et à la diffusion, sur un mode souterrain, d’images du futur, de nouveaux repères, ce qui fait que la société n’est pas totalement surprise des évolutions qui surviennent, acceptera plus facilement certaines évolutions. Cette dimension me semble peu explorée : peu d’investigations portent sur cette fonction de préparation à ce qui sera le réel, alors même que des sujets comme les biotechnologies, la sélection génétique, le clonage, ou l’hyper-surveillance invitent à le faire.
Vous avez pu écrire que la science fiction est un dispositif de problématisation des trajectoires du changement. Que voulez-vous dire ?
Les auteurs de science fiction créent un cadre qui paraît le plus cohérent possible pour faire fonctionner leurs hypothèses. Ils prennent une hypothèse et la poussent, la font fonctionner tant qu’il est possible de le faire, en gardant une relative cohérence. Ce travail de l’auteur peut se rapprocher de ce qui est considéré comme une « description dense » dans l’anthropologie interprétative puisque, grâce à l’évocation de contextes culturels, techniques, sociaux, il s’agit de rendre crédible la description de systèmes censés fonctionner dans des époques futures.
Il est intéressant à mon avis de considérer la science fiction comme un travail de problématisation. Parler de problématisation, c’est envisager l’enclenchement d’un processus, où ce qui paraissait évident va pouvoir être questionné et constitué comme objet pour la pensée. La science-fiction problématise ainsi les applications de la science, par des mises en situation des avancées scientifiques et des innovations technologiques. Alors que nos sociétés sont marquées par une immersion de plus en plus profonde dans des environnements technologiques, la science-fiction est, presque depuis ses origines, une façon de problématiser les rapports entre les humains et les machines. Elle l’a fait par exemple de plus en plus souvent à travers une question majeure : qu’est-ce que l’humanité peut déléguer aux machines ? Je réfléchis en ce moment par ce biais sur le rôle et les effets potentiellement politiques des intelligences dites « artificielles ».
Les œuvres de science-fiction peuvent d’ailleurs participer à des processus de problématisation plus large, en testant le basculement dans un autre système technique, en cherchant à entrevoir quels pourraient être les effets induits, en introduisant des questionnements éthiques et politiques. C’est ce qui a pu se passer récemment avec les nanotechnologies. Certains annoncent ou espèrent une révolution technique, mais ses effets paraissent au moins aussi indéterminés que les potentialités des innovations attendues. D’où les nombreuses incertitudes de ceux qui essayent de réfléchir à ces effets. Les explorations en science-fiction sont une manière d’imaginer comment les nanotechnologies pourraient restructurer les relations sociales, en miniaturisant des appareillages plus ou moins courants. Dans « L’âge de diamant », un roman de Neal Stephenson, les nanotechnologies ont redessiné la vie quotidienne et les relations humaines. Et on s’aperçoit que les résonances imaginaires qu’offre la science-fiction peuvent jouer un rôle dans les débats publics sur ces nouvelles technologies.
Vous avez engagé des travaux sur la décroissance soutenable, la consommation durable. Dans quelle mesure la consommation durable remet-elle en cause nos modèles économiques, ouvre-t-elle à des alternatives?? Plus généralement, comment voyez-vous le lien entre la pensée utopique, les expérimentations sociétales où des collectifs vont essayer de mettre en place des fonctionnements alternatifs, et la mise en place de modèles alternatifs en matière de relation sociale ou d’économie ?
Ce qu’on appelle la consommation durable me semble un cran en dessous des enjeux, elle risque d’être largement en décalage par rapport à la masse des débordements à recadrer, a fortiori si les incitations à la consommation restent fortes. C’est la raison pour laquelle je regarde d’autres initiatives, comme le mouvement des villes en transition, en me demandant en quoi ces alternatives pourraient avoir un potentiel supérieur de transformation. Ce qui est assez curieux, c’est qu’elles obéissent à des formes de gouvernementalité qui ne sont pas très éloignées dans leur manière de fonctionner des rationalités et des dispositifs existants.
Plus globalement, je commence à travailler, dans le cadre d’un projet de recherche provisoirement intitulé « Ni État, ni marché ? Sur les possibilités d’un au-delà du gouvernement », sur les expérimentations alternatives qui essaient de se situer en dehors de l’État et du marché. Ces deux réifications, État et marché, forment un couple très pesant dans la réflexion et l’organisation politiques actuelles, avec l’inconvénient d’annihiler les possibilités de penser en dehors de ce couple. D’où la question qui est le point de départ à ce projet de recherche : au stade de développement des sociétés contemporaines, des possibilités d’organisation et de fonctionnement du collectif peuvent-elles encore exister en dehors de l’État et du marché ? Comment pourraient-elles être pensées, théorisées et réalisées? Est-il encore possible de produire des véritables alternatives en face des logiques qui se sont construites au fil des derniers siècles ?
Ce projet de recherche envisage donc une exploration et une analyse des propositions théoriques et pratiques de prise en charge des affaires collectives qui prétendent se situer en dehors des régulations étatiques et marchandes. Cela implique de commencer par faire une sorte de repérage et de tri parmi une multitude d’initiatives qui prétendent s’orienter vers un horizon alternatif : systèmes d’échange locaux, écovillages, communautés de partage, etc. Les expériences pratiques à l’écart de l’État et du marché, nombreuses dans l’histoire, ont pris des chemins variés : expérimentations autogestionnaires, formes d’économie solidaire, etc. Il s’agit aussi de comparer les rationalités, les modes d’organisation et les bilans de ces différentes expériences, afin de percevoir les modèles d’action utilisés pour développer des espaces alternatifs. Là aussi, c’est un espace de réflexion qu’on peut ouvrir. Si l’articulation des éléments précédents fonctionne, l’étape finale pourrait consister à envisager les possibilités d’une reconstruction théorique, en cherchant à dégager des pistes pour conceptualiser cet « en-dehors? ».
Ma dernière question quitte le champ de la science fiction. Les collectivités territoriales essayent de plus en plus de jouer sur les comportements des individus ou usagers pour réaliser leurs objectifs, en matière de propreté ou de mobilité par exemple. Comme vous avez travaillé sur cette thématique, en publiant un article notamment (« De l’objectivation des risques à la régulation des comportements. L’information sur la qualité de l’air comme instrument d’action publique »), quelle est votre lecture de la capacité des politiques publiques à orienter ou réguler les comportements?? Faut-il une éthique ?
Les initiatives de manipulation des comportements me semblent problématiques. J’ai essayé aussi de le montrer dans un papier sur la consommation durable. Pour reprendre en l’adaptant le vocabulaire de Michel Foucault, on assiste à la production d’une forme de gouvernementalité où, formellement, il y a toujours autant de liberté, mais où l’on incite de plus en plus les individus à modifier leurs comportements. C’est très ambigu. Qui définit la norme ? Pour faire quoi ? Car après tout, la demande faite aux personnes de modifier leurs attitudes ou comportements s’effectue en laissant en place un cadre plus général qui peut lui-même être considéré comme une source plus profonde des problèmes.
On nous demande de trier nos déchets dans nos cuisines, mais sans que le cadre d’ensemble ait changé, alors que la production d’emballages potentiellement polluants continue : il faudrait revenir aux logiques économiques sous-jacentes, celles entre autres du circuit dominant de la grande distribution qui fonctionne selon le principe du libre service, supposant par exemple d’individualiser les portions d’aliments et de les rendre facilement disponibles grâce à des emballages jetables. Le non-questionnement de ce type de logique suscite une forme de déplacement de la responsabilité et une demande d’adaptation vers les individus, alors que d’autres acteurs, bien plus puissants, arrivent à modifier les politiques publiques pour garder leur position et défendre leurs intérêts. C’est une sorte de déplacement des responsabilités et du fardeau moral qui me pose question.
En matière de déchets, il faudrait avant tout remonter la chaîne des causalités, se demander d’où viennent les déchets et qui en induit la production. Plutôt que de demander à ce que les seuls usagers ou les consommateurs les gèrent en bout de chaîne, il serait judicieux de mettre en question l’ensemble du système qui produit ces déchets. Là, on touche le système économique et on est sur d’autres enjeux, plus macro, et sur les modèles de développement qui ont profondément imprégné les dernières décennies.