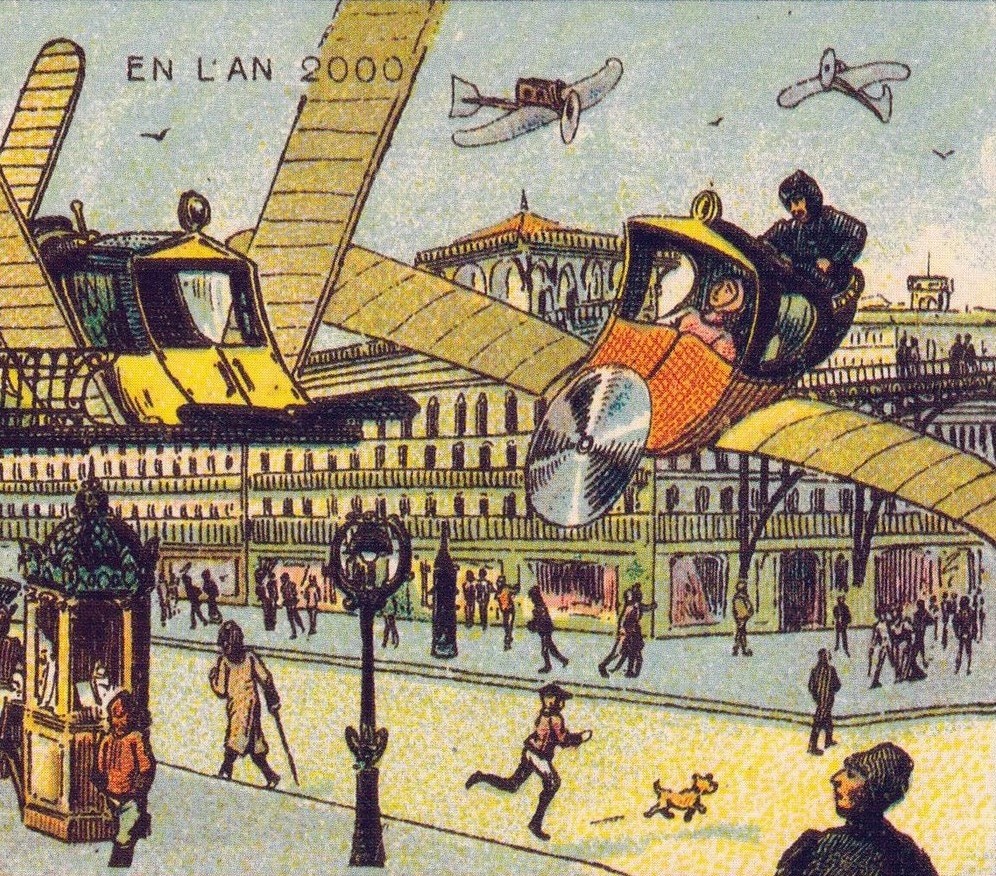Comment la « prospective du présent » est-elle née ? Tout part de la RATP je crois…
L’équipe de prospective à la RATP été créée en 1981. Elle a donc 30 ans, une longévité remarquable pour une équipe de prospective ! 1981 est le moment de l’arrivée de la gauche au pouvoir, de la nomination d’un président communiste à la RATP, de la relance de la recherche au niveau gouvernemental.
Le contexte a joué un rôle important. La RATP venait d’achever une intense période de modernisation technique ; les ingénieurs commençaient à perdre pied à cause des problèmes récurrents d’insécurité ; la conception des transports de la RATP paraissait à revoir ; la direction avait changé avec un président non plus ingénieur, mais économiste, prêt à écouter nos propositions et un directeur général adjoint sensible à la recherche, favorable à une réflexion interne de prospective non finalisée.
Pour ma part, entrée à la RATP avec un doctorat de mathématiques, j’ai créé, puis animé pendant 14 ans, l’équipe de Recherche opérationnelle. Ayant cherché à appliquer des méthodes mathématiques au transport, j’ai progressivement élargi mes champs d’intervention au domaine de l’organisation, de l’aide à la décision et de l’analyse de systèmes. En 1981 un diagnostic a mis en évidence le décalage entre la recherche à la RATP, recherche technique et sectorielle, et les enjeux de la ville et des transports qui sont d’abord des enjeux des sciences sociales. Voici la raison pour laquelle, à l’époque, nous avons fait un pari sur les sciences sociales. Nous avons alors créé deux dispositifs.
D’une part, un dispositif externe de partenariat Université-Recherche-Entreprise, intitulé « Crise de l’urbain futur de la ville », qui a été piloté notamment par deux éminentes personnalités, l’historien Jacques Le Goff et le géographe Marcel Roncayolo ainsi que, pour la RATP, Louis Guieysse, directeur général adjoint. Nous avions choisi pour ce séminaire les meilleurs chercheurs dans toutes les disciplines des sciences sociales. Chaque mois, nous nous réunissions d’abord à l’Ecole Normale Supérieure, puis à l’EHESS. Nous avons également organisé deux colloques à Royaumont et deux colloques à Cerisy en 1985 et 1987. Cette démarche a donné lieu à de nombreuses publications.
D’autre part, un dispositif interne, le projet de recherche et d’apprentissage Réseau 2000, qui a mobilisé un groupe projet faisant appel à tous les métiers de la RATP ainsi qu’à de nombreux chercheurs externes. Ce sont ces deux dispositifs qui, conduits en parallèle durant cinq ans, ont lancé la prospective à la RATP.
Il faut noter qu’en France, selon les circonstances, les pôles les plus actifs de prospective ou d’innovation se déplacent souvent d’une organisation à une autre. Le ministère de l’Equipement avait tenu cette fonction jusqu’au début des années 80. C’est ensuite la RATP qui est devenue, pendant la période suivante, un nœud de réseaux pour la prospective.
Une prospective menée en interne dans une entreprise, sur une durée longue, est-ce une force ?
Selon que l’on parle de la démarche ou de l’équipe en charge de son animation, la réponse peut être différente. Quand j’ai créé la prospective à la RATP en 1981-1982, je n’ai pas voulu créer une équipe. J’ai fait appel à un cadre de chacune des grandes directions de l’entreprise, à mi-temps, pour travailler en réseau. Quand j’ai quitté la prospective en 1986 pour la direction des études informatiques, toujours à la RATP, mon successeur, Georges Amar, a voulu avoir le confort d’une équipe permanente, au risque de réduire sa capacité à mobiliser de manière transversale l’ensemble de l’entreprise.
Concrètement, comment la prospective a-t-elle été développée au sein de la RATP ?
Selon les périodes, l’équipe de prospective de la RATP a été constituée de cadres de l’entreprise (de 3 à 6), de chercheurs associés (2 ou 3), de doctorants (jusqu’à 4) et de stagiaires (pour des durées variables). L’équipe fonctionnait comme un nœud de réseau hybride faisant le lien entre plusieurs mondes : le monde de la recherche en sciences sociales, le monde de la ville et des transports, le monde de l’entreprise. A la fois proche du terrain et de la direction, en relation avec les partenaires sociaux, elle était un lieu où l’on parlait librement et à partir duquel on pouvait interpeller la direction générale. Une forme de contrat tacite nous donnait la liberté de dire, à la prospective, ce qu’un responsable de la stratégie ne pouvait pas dire...
Quel était le rôle d’un chercheur associé dans l’équipe de prospective ?
Au début des années 1980, le gouvernement cherchait à rapprocher la recherche universitaire de la recherche industrielle. Une des seules suites institutionnelles du séminaire Crise de l’Urbain, Futur de la Ville a été le détachement d’Isaac Joseph, sociologue des interactions, spécialiste de l’espace public, professeur de l’université de Lyon, à la RATP, où il est resté 20 ans comme chercheur associé. Nikolas Stathopoulos pour sa part a réalisé sa thèse en contrat CIFRE à la RATP puis y est resté de nombreuses années comme chercheur associé. La fonction d’un chercheur associé dans une équipe de prospective est importante. Ses caractéristiques sont, d’une part une appartenance à plusieurs mondes (celui de la recherche ou de l’université, celui de l’entreprise, celui des transports…) qui lui confère une double légitimité (extérieure d’abord, intérieure s’il sait la construire), d’autre part un travail à temps partiel mais dans la longue durée, comportant un volet externe (enseignement, recherche, conseil) et un autre dans l’entreprise où, sans position hiérarchique, il dispose d’un bureau, participe à la vie quotidienne de l’équipe, prend en charge l’animation de recherches.
La RATP a ainsi offert à Isaac Joseph un site d’accueil adapté à ses recherches sur les villes et les transports. Au contact des questions qu’a rencontrées l’entreprise publique aux diverses étapes de sa modernisation, il a su accompagner des projets d’innovation technologique, commerciale ou organisationnelle. Citons l’exemple du programme sur les gares avec, comme point d’orgue, le dispositif mis en place à la Gare du Nord pour « répondre modestement à la question des gestionnaires de la gare concernant les normes communes d’accès et de régulation d’un espace en voie de rénovation, destiné à être accessible à des voyageurs internationaux et des banlieusards ».
Comment est arrivée la notion de « prospective du présent » ?
Quand j’ai repris la prospective à la RATP, en 1997, après avoir occupé diverses autres fonctions à l’intérieur de l’entreprise, j’ai aidé Jean-Paul Bailly, devenu président, dans des rapports que lui avait confié le Conseil Economique et Social. Notamment, en 1998, pour celui qui, désigné à l’origine « Prospective et décision publique », a été intitulé à l’arrivée « Prospective, débat et décision publique ». La nouveauté ne réside pas dans ces termes mêmes mais dans leur mise en relation : la prospective alimentant le débat qui conduit à la décision publique. C’est à cette époque que nous avons introduit, je crois, sur une suggestion de Gérard Demuth, ancien directeur de la Cofremca, la notion de « prospective du présent ».
Pourquoi mettre l’accent sur le présent alors que la prospective a toujours été définie, depuis Gaston Berger, comme la faculté d’éclairer une décision qui se fait au présent, en tenant compte de l’avenir ?
Quand nous parlons de prospective du présent, ce n’est pas de l’urgence que nous parlons, mais d’un présent duratif, temps de l’initiative. Avec Jean Chesneaux (auteur d’« Habiter le temps », Bayard, 1987), on considère le passé comme temps de l’expérience, le présent comme temps de l’action et l’avenir comme horizon de la responsabilité. Nous rejoignons aussi les analyses de François Jullien, dans « Les transformations silencieuses », quant aux mutations qui sont à l'œuvre, mais que nous ne percevons qu’à certains moments. La prospective du présent ne prétend pas anticiper un futur incertain et complexe, mais tente de détecter dans le présent les signaux faibles, les germes du futur, déjà là, mais que nos outils d’observation et de pensée ne nous permettent pas de reconnaître. Pour les appréhender, il faut décaler les regards, faire des détours par d’autres modes de pensée et de perception, notamment en introduisant le champ du sensible et les activités artistiques.
Cela pourrait être l’objectif d’une sociologie ? Il existe d’ailleurs une « sociologie du présent »…
Oui peut-être, mais, alors que la prospective du présent vise à construire et à partager des connaissances pour l’action, la sociologie a une prétention scientifique. Et, ce faisant, elle s’attache davantage à faire des diagnostics critiques sur le passé ou le présent qu’à détecter les initiatives innovantes ou à imaginer de nouveaux modes de pensée ou d’action. A l’inverse, la prospective du présent fait un pari d’optimisme méthodologique et, plus qu’aux dysfonctionnements, s’intéresse à ce qui marche, aux trains qui arrivent à l’heure…
Quelle est la place de la recherche dans cette prospective ?
Démarche empirique, connaissance pour l’action, la prospective n’a pas de prétention scientifique. Mais, pour se développer, elle a besoin d’intégrer des savoirs pratiques et des savoirs experts et, pour monter en généralité, elle requiert des capacités de conceptualisation et des outils méthodologiques. La prospective réalisée à la RATP, distincte de la stratégie, était proche de la recherche et organisait une bonne part de ses interventions autour de recherches-actions.
Pour que la prospective soit entendue, influente, vous dites qu’il faut combiner deux sources de légitimité. Pourquoi ?
En effet, pour faire de la prospective dans une telle entreprise, il faut avoir une double légitimité : une légitimité scientifique et une légitimité interne. Avec une légitimité seulement externe dans le monde académique, l’influence de la prospective à l’intérieur de la structure restera faible. A l’inverse, en bénéficiant seulement d’une légitimité interne, on se trouve pris dans des jeux d’autorité et de pouvoir qui rendent impossible l’exercice de l’impertinence nécessaire à la prospective.
Souvent, on a tendance à basculer d’un côté ou de l’autre. Pour ma part, j’ai eu la chance d’être en même temps responsable de la prospective à la RATP et de diriger Cerisy, ce qui m’a permis d’acquérir cette double légitimité.
Les travaux menés sur les questions d’insécurité à la RATP ont-ils été fondateurs ?
Oui et non. Non car ils sont venus tardivement, et que les principaux travaux de la prospective ont porté sur les nœuds (les gares, les stations) du réseau, sur l’espace public, sur les usages du transport, sur les services et les métiers.
Oui, car les études sur la sécurité ont été, d’une certaine façon, à l’origine de la prospective du présent. Réalisées par l’équipe de Michel Wieviorka au CADIS, ces recherches ont dépassé le cadre du transport pour traiter également de l’école et d’autres services publics, en France et à l’étranger (voyez « Violences en France » édité en 1999 au Seuil). Pour la RATP, le diagnostic a été le suivant : loin d’être seulement la conséquence de problèmes sociaux subis par l’entreprise, l’insécurité est une coproduction entre, d’une part des jeunes aux comportements inciviques et d’autre part, une entreprise qui présente un certain nombre de dysfonctionnements, quant à ses dessertes, ses horaires, ses tarifs. Ces dysfonctionnements sont à l’origine d’un double ressentiment et d’une double logique de protection et de victimisation. Les chercheurs ont présenté leurs résultats au comité exécutif de la RATP. Attentif à leur analyse, Jean-Paul Bailly leur a suggéré d’aller sur le terrain faire état de leurs travaux. Et là il a fallu constater que les agents rencontrés, machinistes ou syndicalistes, n’ont guère été surpris et ont dit que « c’était évident » et qu’ « ils savaient ».
Un sociologue Eric Macé, resté trois mois dans un dépôt de bus pour dialoguer avec les agents, a alors repéré qu’une ligne de bus, la 171, pour améliorer les relations entre les jeunes de banlieue et les agents, avait lancé une campagne de communication baptisée « Respect », qu’une autre ligne avait initié une démarche qualité... L’idée est alors venue de tenter d’inverser la logique afin de co-produire ensemble de la sécurité. Prenant en compte ces initiatives de terrain qui cherchaient à trouver des solutions à leur niveau, on s’est alors posé la question : ET SI on pouvait co-construire de la sécurité ?
Voilà un exemple de reformulation où, à partir d’un diagnostic négatif, il est possible d’inverser la logique, en posant une question commençant par ET SI… et en imaginant un énoncé positif du problème. C’est dire que la prospective consiste d’abord, plus qu’à trouver des solutions à des problèmes mal formulés, à poser les bonnes questions.
Ces démarches ont-elles « marché », ont-elles eu des résultats ? C’est une façon de vous poser la question d’une utilité de la prospective que l’on pourrait objectiver de manière concrète…
Il est difficile de dire si la prospective « marche » ou « ne marche pas », il me semble que le principal est qu’elle contribue à stimuler l’intelligence des acteurs et à les mettre en mouvement.
Je ne suis pas sûre que la prospective ait aidé la RATP à résoudre ses problèmes de sécurité… mais elle a permis à certains acteurs de mieux comprendre la complexité des situations dans lesquelles ils se trouvaient et de prendre un peu de recul par rapport à des réponses à trop court terme. Et il est difficile de dire comment les choses auraient évolué si l’on n’avait pas engagé les démarches qui ont été conduites.
Si j’examine concrètement les décisions qui ont été prises à la suite d’études prospectives, je peux en citer quelques-unes : la prise en compte de l’importance des lieux, des stations, au–delà des lignes, dans les réseaux de transport ; la sensibilisation aux nouveaux rythmes urbains avec la mise en place du « Noctilien » (bus de nuit) et le choix de la ligne 1 pour l’automatisation du métro… Mais il faut rester modeste en prospective.
En revanche, les idées mûrissent et, des années plus tard, on s’aperçoit qu’elles ont fait leur chemin. Il me semble que les leçons de la prospective passent beaucoup plus par la formation des personnes lorsqu’elles se trouvent confrontées à de nouvelles responsabilités, que par la publication de rapports ou la transmission formelle des résultats. Le rôle des dirigeants est à cet égard considérable. C’est grâce à Jean-Paul Bailly, alors président de la RATP, que l’on a pu faire valoir, quand il s’est agi de décider quelle serait la future ligne de métro de Paris qui serait automatisée, alors que les syndicats et les techniciens avançaient d’autres solutions, qu’il fallait choisir la ligne 1, celle qui correspondait le mieux aux pulsations de la ville et devait en conséquence pouvoir fonctionner 24h/24. Le point négatif, c’est qu’à défaut de dirigeants, dans les entreprises ou les collectivités territoriales, qui s’intéressent, écoutent, sollicitent, se mettent en écho à ce type de démarche, la prospective du présent a du mal à s’exercer. Christian Blanc, et plus encore Jean-Paul Bailly, sont des dirigeants qui ont le souci d’être accompagnés dans leur réflexion, par des questionnements même indisciplinés.
Pourquoi s’intéresser à des initiatives, comme les démarches de ces lignes de bus. C’est parce que les solutions qui émergent vont permettre de résoudre des problèmes ?
C’est avant tout parce que les dirigeants, comme les chercheurs en général, sont confinés dans leur cage de verre et ne perçoivent pas la même réalité que les gens de terrain! Un exemple : faire travailler des groupes de voyageurs et de machinistes de la RATP nous a permis de proposer des solutions au problème des poussettes dans les bus, insolubles au niveau d’un comité exécutif.
La décision de mettre en place le « Noctilien », un service de bus nocturne, a été obtenue de la même manière. Ne sortant guère la nuit, les dirigeants ne percevaient pas les problèmes de transport qu’on y rencontrait. Les réflexions sur les nouveaux rythmes urbains ont ainsi été à l’origine de décisions comme Le Noctilien ou l’automatisation de la ligne 1. Ces réflexions sont issues d’un colloque de Cerisy en 1996 « Entreprendre la ville, nouvelles temporalités, nouveaux services » (l’Aube, 1997). A l’issue de ce colloque, Jean-Paul Bailly m’a demandé d’animer un groupe de travail du Conseil national des transports sur les temps de la ville. Un ouvrage publié en 2001 aux éditions de L’Aube en est issu : Nouveaux rythmes urbains : quels transports ? Nous nous sommes mis à travailler systématiquement sur les questions temporelles. Je continue d’ailleurs à m’en préoccuper sous divers angles : par exemple, j’ai organisé à Deauville, en novembre dernier, un atelier prospectif intitulé « Temps de vie, temps de ville ». Je vous conseille la lecture de l’ouvrage « Accélération » de Hartmut Rosa (la Découverte, 2010) qui met en évidence un triple phénomène d’accélération (accélération technique, accélération des rythmes de vie et accélération du changement social) menaçant à la fois la personne dans son intégrité, le dialogue intergénérationnel et le temps de la démocratie.
La prospective du présent met l’accent sur le débat dans le processus qui conduit de la prospective à la décision. D’où est-ce venu ?
Quand Alain Obadia a pris la responsabilité de la prospective de la RATP en 1996, il a eu le sentiment que les travaux de l’équipe s’étaient éloignés de la stratégie de l’entreprise et privilégiaient la relation avec les chercheurs externes. Pour réduire cet écart et réinscrire la prospective au centre des enjeux de la direction générale, il a monté un groupe de réflexion stratégique qui associait, à l’ensemble du comité exécutif de la RATP, quatre experts, François Ascher pour la ville, Armand Braun pour l’entreprise, Ricardo Petrella quant aux enjeux écologiques, et Gérard Demuth à propos des modes de vie. A partir de ces travaux a été publié l’ouvrage Quand les transports deviennent l’affaire de la cité, parlons-en avec la RATP, où, pour la première fois, est apparue la notion de « prospective de présent ».
Toutefois l’accent sur le débat vient principalement de Jean-Paul Bailly, qui se préoccupait beaucoup du dialogue social, notamment quand il était directeur général adjoint chargé des ressources humaines. Convaincu du lien entre dialogue social et prospective, il a introduit le débat entre la prospective d’un côté et la décision de l’autre. Il y a chez Jean-Paul Bailly, vrai pédagogue, le souci de nourrir le débat par la prospective afin de prendre de bonnes décisions, opportunes, stratégiques, capables d’être mises en œuvre. A cet égard, il est nécessaire de restituer le processus de décision dans toute sa durée et de désacraliser le moment de la décision, ce qu’Armand Hatchuel nomme le « spasme décisionnel ».
La prospective du présent aurait-elle pu s’appeler « prospective du quotidien » ? Il semble y avoir un souci fort du quotidien…
Oui, un fort souci du quotidien, de la vie des gens, avec la volonté de reconnaître leur vitalité, leur capacité à inventer, face à la complexité, des solutions innovantes. La prospective du présent, prospective sociétale en quelque sorte, opère dans des lieux où l’on rencontre du public: à la RATP, quatre millions de voyageurs chaque jour dans les réseaux ; à la Poste, tous les Français au bout de la sacoches des facteurs. Actuellement, je travaille sur le problème du « vivre ensemble à tous les âges », en m’intéressant aux enfants, aux adolescents, aux personnes qui prennent de l’âge, alors que la tendance me paraît être de privilégier la réflexion sur les « actifs ».
Quelle est votre perception des outils classiques de la prospective, scénarios, consultation d’experts, etc. ?
Sur le fond, je reproche à la prospective classique, avec ses méthodes par identification de composantes et construction de scénarios, de ne pas faire évoluer les formes de pensée et de raisonnement, de ne pas s’efforcer à un renouveau conceptuel. Elle ne considère pas comme un enjeu principal la capacité d'une pensée complexe à reformuler les questions de manière à ouvrir le champ des possibles, ni à dénouer des situations paradoxales au travers de processus d'apprentissage et d'innovation.
Or nous ne disposons pas des concepts et des formes de raisonnement qui nous permettent d’appréhender la complexité de la société contemporaine. Les outils classiques ont tendance à se substituer à la véritable réflexion prospective et, avant d’avoir bien posé les problèmes, vont trop vite aux solutions… Cela conduit alors à restreindre le champ des possibles et à la pensée unique. La prospective du présent est une tentative de recomposition conceptuelle et s’efforce de développer une intelligence collective des situations qui articule savoirs experts, savoirs profanes et expériences sensibles. Il me semble que c'est dans le colloque de Cerisy, Expertise, débat, vers une intelligence collective (L'Aube, 2002), que nous avons essayé d'aller le plus loin dans cette perspective, mais aussi plus récemment dans celui sur La Sérendipité (Hermann, 2011).
Est-il possible de combiner les approches ?
Dans une certaine mesure, oui. Les scénarios peuvent être fructueux lorsqu'ils sont utilisés, non pas dans la perspective d'être appliqués réellement, mais lorsqu'ils permettent d'élargir les termes du débat. Malheureusement il n'est pas rare que, quand on a développé des outils compliqués, on ne fasse pas passer les instruments avant les fins. Pour ma part, il m’arrive de participer à des démarches classiques, en tentant au moment adéquat de faire évoluer les questionnements, de les mettre en récit, de leur donner de la chair…
C’est ce qui s’est passé dans le cadre d’une prospective lancée par l’INRA, en 2006-2007-2008, sur « Les nouvelles ruralités en 2030 ». Présidé par Rémi Barré, expert en prospective classique, le groupe d’experts au sein duquel j’avais été conviée, a connu, au début, des controverses assez vives, pour produire finalement des résultats très riches qui ont fait l’objet d’une publication aux éditions Quae et donné lieu à un grand nombre de restitutions devant diverses instances. Alors que Rémi Barré cherchait un modèle de ruralité applicable à la France entière et voulait en quantifier les conséquences, une fois les scénarios produits, j’ai fait valoir qu’il serait intéressant d’introduire le vécu des gens et de prendre en compte la spécificité des territoires. Transformant ces scénarios en récits, on s’est finalement mis d’accord sur le fait que, plutôt que de choisir un seul modèle de ruralité, on pouvait en combiner plusieurs afin de prendre en compte la variété des contextes temporels et spatiaux.
Evidemment, le fait de remettre en cause les méthodes de la prospective classique suscite des réactions. A la DATAR je suis persona non grata pour « France 2040 », car l’on ne souhaite pas que des prospectivistes critiquent les méthodes qu’ils entendaient appliquer…
Prospective en entreprise, prospective dans les collectivités territoriales, qu’est-ce qui change ?
Par expérience, il me semble possible d’aller plus loin dans une entreprise en raison des possibilités d’action sur le terrain. Dans les collectivités territoriales, la légitimité est plus grande pour poser les questions politiques, mais la tendance est forte à ce que la prospective devienne un « outil de com ».
La prospective du présent est-elle pratiquée, en France ou à l’étranger ?
C’est le point dur : la prospective du présent n’a ni moyens de recherche, ni prise en charge institutionnelle, pour se développer et aller au-delà des pratiques et des intuitions. Les seuls outils que j’ai utilisés sont les colloques de Cerisy, qui offrent de précieux temps de débat et d’approfondissement. Depuis que j’ai pris ma retraite de la RATP, j’ai réussi à conserver de multiples terrains qui me permettent de faire de la prospective et enrichissent ma réflexion. Néanmoins, la prospective du présent n’est enseignée nulle part…
Le monde de la prospective a-t-il été, malgré tout, changé d’une manière ou d’une autre par la prospective du présent ?
Pas fondamentalement, mais la prospective du présent rejoint certaines démarches soucieuses de comprendre les mutations de la société et l’émergence du nouveau, même si elles ne se nomment pas ainsi. Beaucoup font de la prospective du présent sans le savoir… Pour autant, des collectivités territoriales semblent se situer de plus en plus dans cette perspective, comme l’a indiqué récemment l’appel d’offre de « Nantes 2040 » ou des demandes qui me sont faites pour intervenir comme « grand témoin », par exemple dans la démarche « Reims 2020 ».
Quelle est la place du « terrain » dans votre pratique de la prospective ?
Elle est première. La prospective du présent s’est développée à partir du constat de désajustement, fait dans le rapport Bailly déjà cité, entre une société civile mieux formée, pleine d’idées, capable d’innovation et des institutions encore trop rigides, fonctionnant selon des modèles mécanistes.
Le livre de Michel Callon, Pierre Lascoumes et Yannick Barthe « Agir dans un monde incertain » (Seuil 2001) m’a beaucoup influencée. Il en appelle à une démocratie dialogique qui s'enrichit des apprentissages et des expérimentations issus de « forums hybrides ». Associant au-delà des experts tous les acteurs concernés, en mettant en scène des controverses, il établit une différence entre la « recherche confinée » et la « recherche de plein air », recherche appuyée sur les savoirs profanes, qui tirent de leur vécu et de leur expérience quotidienne, des connaissances qui n'apparaissent pas au scientifique enfermé dans son laboratoire (c’est le cas notamment des malades atteints de myopathie qui, bien qu’ils ne soient pas neutres, sont associés à la recherche…).
La prospective du présent est également une « prospective de plein air » : les savoirs experts sont nécessaires mais convoqués dans un second temps, après avoir tiré parti des savoirs profanes aptes à faire voir les signaux faibles. Plus axée sur les signaux faibles que sur les tendances lourdes, la prospective du présent s’efforce d’articuler expériences et expertises.
Peu après sa création autour des années 1998-2000, la mission prospective du Grand Lyon partait aussi du postulat que l’intelligence est partout, qu’il faut repérer les initiatives innovantes pour les valoriser. Ces idées étaient sans doute partagées…
C’est vraiment le discours de la prospective du présent. Mais il est ensuite nécessaire de construire, de concevoir, de développer des outils, ce qu’a fait Georges Amar lorsque, après mon départ à la retraite, il a repris l’équipe de la RATP en l’intitulant « prospective et conception innovante ». En effet, l’innovation tient une place centrale dans la prospective du présent qui énonce, face à un futur incertain, et loin des extrapolations coutumières, un impératif d’invention. La prospective exerce un grand rôle, face aux changements sociétaux, dans le renouvellement des concepts.
Par exemple, alors que nous vivons en bonne santé près de 15 ans de plus qu’il y a cinquante ans, on ne dispose pas des concepts pour penser ces phénomènes qui imposent, au-delà des débats sur les retraites et la dépendance, une prise en compte globale des trajectoires de vie où se multiplient les différents âges (une longue jeunesse, une longue vieillesse). J’en veux pour preuve qu’on ne sait même pas nommer, outre le terme commercial de « senior », les personnes qui, à 65 ans, sont retraitées et ont encore 15 ans à vivre en bonne santé.
Avec le recul, quelles seraient les principales fonctions de la prospective ?
La prospective consiste d’abord à poser les bonnes questions, elle est à situer davantage du côté du questionnement que de l’apport de solutions. Elle vise ensuite à accompagner les processus d’apprentissage et de changement des acteurs en situation de responsabilité. Alors qu’avec l’accélération des rythmes de vie, nous tendons à rester le « nez dans le guidon », la prospective permet de prendre du recul afin de dénouer des contradictions, a priori insurmontables, en se donnant le temps de l’échange, de l’apprentissage, de l’expérience… Elle permet de s’affranchir de la pensée binaire, de décaler les regards, d’ouvrir le champ des possibles, de trouver, face à la complexité, des voies de sortie….
Ouvrir le champ, est-ce ici que vous rejoignez l’idée de futurs possibles ?
Un point qui heurte certains à l’encontre de la prospective du présent tient à l’articulation entre futur possible et futur souhaitable, et particulièrement à ce qui paraît normatif dans l’idée de futur souhaitable. Les tenants de la prospective « classique » estiment qu’il convient, à partir d’une combinaison des tendances lourdes, d’envisager tous les futurs possibles, rêve de l’ingénieur et du technicien qui ne veut pas prendre partie.
Mais cette volonté d’imaginer tous les possibles, sans remettre en cause les bases conceptuelles, conduit finalement à une sorte de pensée unique qui ne permet pas d’ouvrir un champ suffisant pour envisager des mutations en elles-mêmes imprévisibles. La plupart des outils dont dispose cette prospective ne remettent pas en cause les modes de pensée eux-mêmes. Or la prospective consiste à ouvrir des champs nouveaux auxquels on ne pensait pas, et à ce moment-là, les acteurs se sentent enthousiastes. La prospective n’est pas un « exercice » technique, c’est un engagement pour changer la société…
Le clivage idéologique gauche-droite traverse-t-il la prospective et ses débats ?
Nécessairement, quand nous parlons de futur souhaitable et que nous travaillons avec un Alain Obadia, syndicaliste CGT, membre de la direction nationale du parti communiste, appelé au cabinet de Martine Aubry en 1997, nous ne sommes pas très à droite… Mais les débats politiques ne sont pas trop présents au sein des travaux de prospective, ce sont plutôt des débats de société, liés aux positions que l’on prend par rapport au changement.
Pour revenir sur l’expert, quel est son rôle, son apport ?
Je distingue l’expert du chercheur. Le chercheur accompagne la prospective en lui fournissant des éléments de réflexion et en l’aidant, sur la base d’observations de terrains et de confrontations d’acteurs, à proposer des concepts nouveaux et à capitaliser les savoirs profanes et les expériences sensibles. Une part considérable de mon travail à la RATP était de faire travailler ensemble, sur un même objet (les métros, les transports, les voyageurs…), des chercheurs en sciences sociales émanant de disciplines différentes. Par exemple, sur Météor, on a pu faire travailler ensemble Isaac Joseph, Jean-Pierre Segal, Philippe Zarifian et beaucoup d’autres. L’important est d’organiser la recherche autour des questions qui intéressent l’entreprise, sachant que le chercheur développe sa propre problématique de recherche (que j’appelle « autotélique », c’est-à-dire se définissant elle-même à mesure de ses questionnements internes). Ensuite une fois les recherches accomplies, il convient de présenter les résultats aux acteurs de l’entreprise dans des termes qui leur sont familiers et non dans le langage des chercheurs.
L’expert, qui ne fait pas toujours la recherche lui-même, peut intervenir directement dans le débat public en faisant cet effort de traduction. Il aide à énoncer un point de vue, propose des interprétations à partir de résultats empiriques, donne des conseils. Tel était le cas des experts qui ont participé au comité prospective initié par Alain Obadia. Ce qui me paraît essentiel et que nous avons toujours fait à la RATP, c’est d’éviter les gourous en organisant un débat contradictoire.
En prospective du présent, nous n’introduisons pas d’emblée les experts. Nous partons du repérage de terrain, d’enquêtes et d’observations sur les vécus et les pratiques des gens. C’est la raison pour laquelle j’ai toujours choisi des terrains — la RATP ou la Poste — qui mettent en scène de forts enjeux sociétaux ! Mais quand vient le moment de la conceptualisation, l’intervention des chercheurs et des experts est nécessaire. Il en va de même, dans le cas où des démarches participatives fournissent des matériaux très variés dont il convient de tirer la substantifique moelle.
Expérimenter, est-ce une façon de faire de la prospective ?
L’expérimentation est une phase importante, mais elle peut comporter des risques, au moment de son éventuelle généralisation. A la RATP, on nous laissait toujours expérimenter en levant, le temps de l’expérimentation, les contraintes. Mais dès qu’on envisageait la généralisation d’expérimentations jugées fructueuses, toutes les contraintes revenaient avec leur cortège de réglementations et le monstre froid avait souvent raison des volontés de changement. Des projets bourrés de bonnes intentions, tels de nouveaux services en station, sont ainsi devenus, à l’arrivée, des projets de télésurveillance. Ce qu’il faut comprendre, c’est qu’il n’en va pas de l’expérimentation sociale comme de l’expérience technique et que l’on ne peut pas d’abord développer un prototype, puis le généraliser. Il convient plutôt de gérer des processus de changement selon une démarche d’apprentissage progressif, ce que Marcel Roncayolo, s’agissant de projets urbains, appelle une logique de « présents successifs ».
Qu’est-ce qui vous frappe aujourd’hui dans l’évolution de la prospective ?
Il me semble que, du côté des urbanistes, des architectes, ou des designers, il y a un vrai besoin de penser les évolutions sociétales. Ils en appellent à un renouvellement des concepts, qui leur permettent de penser autrement qu’à travers des catégories comme celle de la « mixité sociale » ou de « densité », de penser l’ « urbanité », la « diversité », l’ « intensité » de savoir comment les populations transforment leurs modes de vie. Une démarche très intéressante à laquelle j’ai participé récemment est le comité d’aménagement durable du projet Seine-Arche, opération d'urbanisme ayant pour objet d'aménager un territoire traversant Nanterre de La Défense jusqu'à la Seine. Un groupe multidisciplinaire, mis en place par l’EPASA et présidé par Georges Mercadal, avec la participation d’élus de Nanterre, a permis un échange très intéressant entre experts et urbanistes des équipes opérationnelles chargés des projets (je renvoie à mon exposé au colloque de Cerisy, Lieux et liens, à paraître aux éditions l’Harmattan en 2011).
Vous travaillez avec des designers, par exemple dans « La Poste 2020 » qui est à la fois une démarche de prospective et une démarche d’innovation de service. Pourquoi ?
Le travail avec les designers est très fructueux de part et d’autre. D’un côté, comme je le disais, les designers ont besoin de travailler sur les évolutions sociétales. D’un autre côté, les prospectivistes, qui échangent surtout de la parole ou du texte, ont besoin de concrétiser leurs concepts et leurs analyses, ce que leur permet de faire, au travers d’images ou d’objets, les designers. C’est en ce sens qu’ils sont des accélérateurs pour conduire des démarches de prospective participative.
Ainsi, dans la démarche « La Poste 2020 » qui a mobilisé dans des groupes de réflexion près de 500 personnes dans 5 départements français, j’avais demandé au designer Brice Dury d’imaginer les objets de la Poste en 2020, ce qui a permis d’introduire dans les débats des représentations imaginées accélérant la compréhension des participants. Le recours à l’image est un moyen d’élargir les modes d’observation du réel. De plus en plus, nous nous efforçons d’introduire dans les démarches conduites des expériences sensibles, qu’il s’agisse du vécu quotidien des gens ou d’expériences artistiques. Travaillant sur le programme Pluslonguelavie.net animée par la Fondation Internet Nouvelle Génération (FING), nous avons réalisé des enquêtes qualitatives très approfondies (conduites par la psychosociologue Catherine Espinasse) afin de formuler les bonnes questions, qui servent maintenant de bases à la conception par des designers de micro-scénarios visant à imaginer des solutions innovantes quant à la mobilité des personnes âgées dans le monde rural.