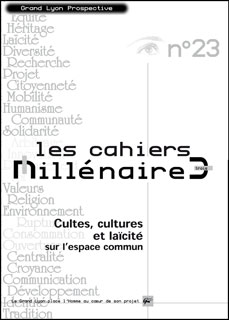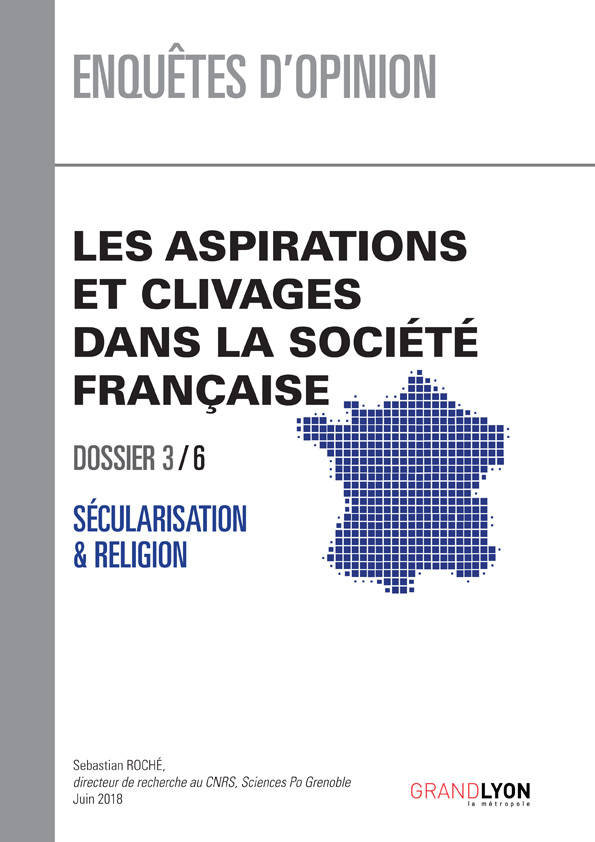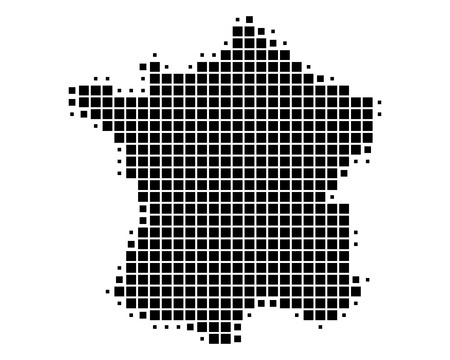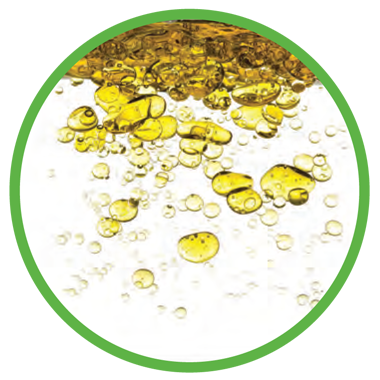Vos travaux de recherche sont centrés sur ce que vous avez appelé les « faits religieux ». Comment comprendre cette expression et quelle distinction permet-elle par rapports aux autres approches disciplinaires ou méthodologiques traitant des religions ?
En 1993, lorsque j’ai créé, avec quelques collègues, le Centre interdisciplinaire d’études des faits religieux (CEIFR) à l’EHESS, ce syntagme avait pour but d’indiquer que l’objet de recherche au cœur de nos travaux n’était pas seulement les grandes religions, mais la dimension religieuse des faits sociaux dans toutes leurs dimensions. La religion n’est pas réductible aux systèmes organisés de croyances. Elle n’est pas non plus réductible à l’expérience de la transcendance. Celui qui, par exemple, croit en une force supérieure parce qu’il est touché par un paysage, le soleil, etc., peut être mystique. En revanche, celui qui affirme sa foi au Dieu d’Isaac, d’Abraham et de Jacob, s’inscrit, lui, dans la continuité d’un récit et sa transmission. Le croyant religieux légitime toujours ce en quoi il croit en faisant référence à la continuité d’une lignée croyante dans laquelle il s’inscrit. C’est sur ce point essentiel que j’ai construit mon travail afin de proposer une alternative aux approches traditionnelles, substantivistes d’un côté — appuyées sur les croyances et en particulier les croyances au surnaturel —, fonctionnalistes de l’autre côté — appréhendant la religion à travers les fonctions sociales qu’elle remplit. Je me situe donc dans une perspective tierce, centrée sur la modalité du croire, qui renvoie à la manière que chaque individu a de s’inscrire dans la continuité d’une lignée, à la fois à travers ses croyances, et/ou à travers les gestes qu’il pose. C’est là le point central que véhicule la notion de « faits religieux ». L’intention originelle était donc d’échapper au tropisme habituel faisant des grandes religions la seule porte d’entrée dans la dimension religieuse des faits sociaux. L’expression a ensuite été utilisée et popularisée au singulier, notamment par Régis Debray dans le rapport qu’il a remis à Jack Lang, en 2002, sur L’enseignement du fait religieux dans l’École laïque. A partir de ce moment, l’expression est sortie du cercle des chercheurs pour gagner à la fois le vocabulaire politique et médiatique. Mais, pour moi, le pluriel est important et je me méfie de l’usage au singulier qui peut laisser supposer que l’on désigne un phénomène homogène dont l’essence serait repérable et identique partout.
Vous expliquez que la sécularisation des sociétés occidentales est un effet de la Modernité caractérisée par trois grands traits : rationalité, autonomie et individualisation du sujet. Mais vous pointez un paradoxe qui est que, en même temps qu’on constate bien cette sécularisation, on doit également tenir compte d’une réactivation des faits religieux. Comment éclairer ce paradoxe ?
Des analyses déjà anciennes, produites par Émile Durkheim ou Max Weber, et qui remontent donc à la fondation de la sociologie, constataient (et annonçaient) une sécularisation des sociétés occidentales. Sous l’effet de la modernité, certains ont même annoncé une disparition des religions. Pourquoi ? Parce que l’autonomie du sujet le conduit à s’émanciper des traditions reçues pour produire lui-même son histoire. De même l’individualisation croissante va dans le sens d’un effritement des systèmes constitués du sens pour faire plus de place au « sur-mesure ». Enfin, la rationalité et la montée de la science ont décrédibilisé les explications religieuses du monde et du cosmos. En Angleterre, par exemple, le darwinisme a déclenché une véritable crise de la croyance religieuse. Cependant, si l’on constate bien quelque chose de l’ordre d’une sécularisation de la société, qui s’annonce dès la Réforme en France et s’accentue au 18e siècle avec le mouvement des Lumières, le religieux n’a pas pour autant disparu. Il s’est recomposé, en se démarquant des institutions religieuses et en accordant plus de place aux choix individuels. C’est là un effet des traits de la modernité : individualisation et autonomie plus fortes conduisent chacun à « bricoler » son propre récit de sens. Pour illustrer cette évolution, j’ai suggéré qu’à côté de la figure déclinante du « pratiquant » qui se conforme aux obligations fixées par les institutions religieuses, on avait vu passer au premier plan deux autres figures de l’individu religieux : celle du « pèlerin » (l’individu qui chemine) et celle du « converti » (l’individu qui choisit de s’inscrire volontairement dans telle ou telle famille religieuse). Mais, dans le même temps, pour que ce récit individuel tienne et acquiert une légitimité, il doit être partagé, d’où l’effloraison paradoxale des petites communautés à laquelle on assiste à partir de la fin des années 1960.
Comment comprendre, à partir de votre analyse, la dimension identitaire, voire politique, constitutive du religieux ?
Une précision en préambule. La dimension identitaire — et notamment la constitution d’identités dures —, n’est pas le tout du fait religieux contemporain. On assiste à une polarisation croissante de la scène religieuse. D’un côté, les identités dures qui sont la partie émergée de l’iceberg, visibles parce que bruyantes et actives. De l’autre côté, la partie immergée, sans doute plus importante mais moins visible, est la prolifération de tous les petits récits de sens que les individus fabriquent.
Ceci posé, la formation d’identités dures s’explique par trois facteurs. Le premier est l’incertitude. Avec la modernité nous sommes entrés dans une ère du changement, lequel produit de l’incertitude. Mais celle-ci est désormais accrue du fait de l’accélération vertigineuse des changements qui nous affectent. Cet effet d’instabilité lié au changement est inséparable – second facteur – du processus de dissolution des communautés organiques (famille, communautés professionnelles etc.) et des appartenances à travers lesquelles les individus trouvaient leurs marques et forgeaient leur identité sociale. À cela, s’ajoute un troisième facteur, la remise en question des « grands récits » de la modernité qui donnaient un sens au changement : celui touchant au progrès illimité lié au développement de la science et de la technique ou celui touchant à l’expansion irrésistible des idéaux démocratiques. Comment, dès lors, les individus font-ils face à l’incertitude et à la peur que celle-ci génère ? Ils doivent construire subjectivement leur propre identité en composant avec ce qu’ils ont à disposition : leurs ressources culturelles et sociales, leurs attentes, leurs expériences. Pour ceux qui sont les moins dotés socialement et culturellement, les discours religieux qui inscrivent les individus dans des lignées croyantes constituent une formidable matière première identitaire. On n’est jamais religieux tout seul, mais seulement à travers la reconnaissance d’une appartenance à une continuité, à une histoire partagée. Pour des individus coupés de leur propre histoire (par exemple par l’effet de la colonisation), en déficit d’intégration et de reconnaissance sociale, l’inscription dans le religieux peut être une manière de revendiquer une identité sociale et de la rendre visible.
Cette analyse éclaire bien la dimension identitaire du fait religieux. Mais comment comprendre la dimension politique ?
Qu’y a-t-il derrière les situations les plus radicales de perte de son histoire et de bricolage de la mémoire pour se réinscrire dans une continuité à partir de la ressource religieuse ? L’aspiration à une alternative de vie. Cette logique peut aller jusqu’à nourrir un désir de rupture : on proteste contre un présent qu’on ne supporte pas, en se référant à un passé réinventé la plupart du temps comme un Age d’or, afin de faire advenir un futur tout autre. Au regard de cette aspiration religieuse à un changement radical et intégral de la vie, il y a deux attitudes possibles. La première consiste à former des communautés séparées du monde, à l’instar des moines. La seconde consiste à engager la lutte pour faire advenir ce monde nouveau, en se constituant en une avant-garde militante. Ces deux expressions de l’intégralisme religieux traversent toute l’histoire religieuse. Paradoxalement, dans un monde ultra-sécularisé comme le nôtre, mais qui est confronté à une crise profonde du discours politique et de l’exercice démocratique, ces deux expressions religieuses de l’aspiration au changement sont susceptibles de retrouver une forte plausibilité pour des individus et des groupes frustrés d’accès au débat public et à la reconnaissance sociale. Avec des conséquences directement politiques.
Est-ce là un des facteurs expliquant la reconquête de l’espace public par le religieux et la prise de parole du religieux dans le débat politique, délaissé depuis plusieurs décennies ?
Une société pluraliste où fleurit une offre religieuse diverse voit naître une forme de concurrence entre les discours religieux, concurrence renforcée par la circulation des croyants et le développement d’une religosité de convertis. Il est clair que le retour présent des catholiques en politique, alors que depuis des années la ligne était le silence, n’est pas sans rapport avec cette situation de concurrence des identités dans une société qui n’avait jamais, jusqu’à une date récente, été affrontée à la question de la pluralité religieuse et de sa gestion. En France, la modernité politique s’est construite en s’arrachant à la domination hégémonique du catholicisme romain, construite par des siècles d’histoire. Le refoulement du religieux opéré par la modernité a donc été essentiellement le refoulement du catholicisme romain. Or, aujourd’hui, l’espace politique et médiatique n’est plus occupé par une grande religion dominante entourée de petites minorités, mais par une mosaïque de minorités dont le catholicisme lui-même fait partie. C’est le grand fait nouveau. Deux groupes sociaux - qui d’ailleurs se recoupent pour partie - ont subi un immense choc social, économique, psychologique et culturel dans les 60 dernières années : les agriculteurs et les catholiques. Dans les deux cas, il s’agissait de majorités qui sont devenues des minorités, et les deux trouvent une difficulté considérable à recomposer leur identité.
La loi de 1905 sur la laïcité a été conçue dans cette période d’hégémonie du catholicisme. La pensez-vous toujours adaptée dans ce contexte nouveau de mosaïque d’expression du religieux ou faudrait-il évoluer vers un modèle laissant plus de place aux communautés ?
Effectivement, la laïcité a été pensée et construite au début du XXe siècle avant tout pour protéger la République des empiètements du catholicisme dans la sphère publique. Ceci étant, la question de savoir si la laïcité à la française répond aux enjeux contemporains peut bien être posée, il n’empêche que c’est le modèle que nous avons hérité de notre histoire singulière. Les régimes américains ou britanniques de gestion du fait religieux ne sont pas transposables parce qu’ils ne relèvent pas de la même histoire. Prenons l’exemple des États-Unis. Les Américains sont attachés autant que nous le sommes à la séparation de l’Église et de l’État, mais pour des raisons diamétralement opposées aux nôtres. Les Pères pèlerins ont quitté l’Europe pour échapper à la persécution religieuse des États. Leur préoccupation, en organisant leur nouveau monde, était donc inverse : non pas protéger l’État de la religion, mais protéger les religions de l’intrusion de l’État. Ils ont donc institué la liberté religieuse comme la mère de toutes les libertés et fait en sorte que les communautés religieuses soient entre elles dans une situation de parfaite égalité. Voilà la matrice de la démocratie américaine et elle n’est pas transposable en tant que telle à la France. La laïcité est un marqueur de notre culture et sans doute une des valeurs les plus fortes de notre identité politique et culturelle.
Une fois cela réaffirmé, on doit cependant constater que la situation contemporaine met en défaut l’organisation concrète de la laïcité. Aujourd’hui, le problème n’est pas tant la séparation de l’Église et de l’État, que les conditions de possibilité sur lesquelles repose cette séparation. En effet, la laïcité postule que les individus sont libres de leurs croyances et de leurs pratiques religieuses, que celles-ci sont strictement privées, et que la vie cultuelle peut s’exprimer librement sous la protection de l’État, tant qu’il n’y a pas de trouble à l’ordre public. Il n’y a donc clairement pas de volonté antireligieuse dans la laïcité : la liberté de croyance est une liberté publique que l’État garantit. Mais la clef de la difficulté actuelle, c’est que la laïcité est organisée à partir de l’idée que les structures religieuses sont capables d’organiser et de contrôler les expressions religieuses découlant de cette liberté de croyance. La laïcité postule la capacité régulatrice de l’institution religieuse. Or c’est cette capacité régulatrice qui est en question aujourd’hui, et pour plusieurs raisons. Cette dérégulation institutionnelle du religieux concerne même le catholicisme romain : du fait de l’individualisation et de la pluralisation interne, l’autorité ecclésiastique est débordée par des mouvements divers, un point rendu manifeste lors de la Manif’ pour tous, par exemple. D’autre part, il y a désormais en France des religions fortement représentées qui ne sont pas hiérarchiquement structurées : c’est le cas de l’islam qui n’a pas d’autorité centrale. Tous les ministres de l’intérieur ont voulu faire pour l’islam ce que Napoléon avait fait pour le judaïsme avec le Consistoire : favoriser la création d’instances représentatives permettant une auto-administration de l’islam de sorte que l’État n’aurait pas à intervenir. Compte tenu de la complexité du paysage de l’islam en France, il a fallu, contre toute évidence laïque, que l’État prenne en charge lui-même, et à marche forcée, la constitution d’une autorité de l’islam en France et la fasse accepter aux Musulmans. Déjà, s’agissant du judaïsme, l’opération, quoique conduite par les communautés juives elles-mêmes sous la pression de l’Etat, n’avait été que partiellement concluante. Le Consistoire régule une partie seulement du judaïsme français. Demeure cependant pour l’État l’intérêt d’avoir un interlocuteur officiel, ce qui n’est pas tout à fait le cas pour le Conseil Francais du Culte Musulman dont la représentativité est régulièrement mise en cause par les musulmans eux-mêmes. On voit donc à quel point les conditions de mise en œuvre de la laïcité sont rendues complexes parce que les attendus sur lesquelles celle-ci repose ne sont plus les mêmes dans un paysage religieux marqué par la dé-institutionnalisation.
La loi de 1905 « garantit le libre exercice » du culte. À sa création, dans le cadre d’un catholicisme dominant, le législateur connaissait assez bien ce en quoi consistait l’exercice du culte. Aujourd’hui, dans un contexte de grande diversité des attentes cultuelles et des demandes rituelles, est-ce que cette disposition n’est pas de plus en plus difficile à tenir ?
Les demandes sont effectivement désormais plurielles et nouvelles. Prenons l’exemple de la religion en prison. Dans les prisons françaises, il fut un temps où les prisonniers devaient déclarer leur religion à l’entrée et s’ils étaient catholiques, ils étaient obligés d’assister à la messe : l’Église et l’État considéraient ensemble que la religion était un moyen de réformer les consciences et de moraliser les détenus. C’est dire si la laïcité composait avec les religions. Le cas des prisons est très intéressant. Il a donné lieu à une étude approfondie (La religion en prison au prisme d’une sociologie de l’action) conduite, à la demande du Ministère de la Justice, par trois chercheures françaises Céline Béraud, Claire de Galembert et Corinne Rostaing. Elles montrent bien que les aumôneries catholiques, juives et protestantes sont bien prévues mais que le dispositif est défaillant s’agissant des musulmans qui sont une fraction significative de la population carcérale. L’une des conséquences de ce déficit est l’apparition de leaders religieux plus ou moins autoproclamés. La question se pose donc de façon urgente de l’organisation de l’aumônerie musulmane en prison. On voit que la nécessité d’assurer un minimum de régulation oblige l’État à intervenir. La pluralité des demandes met effectivement l’État dans une situation où il doit assurer une égalité de traitement entre les religions, et c’est assez nouveau. Le même problème se pose, on le sait, avec les lieux de culte.
À ce sujet, on a parfois l’impression d’une inégalité de traitement, non pas de la part de l’État, mais de celle de la population qui acceptera le voile des bonnes sœurs ou le bruit des cloches, mais pas le voile musulman ou le bruit du muezzin. Se sont, là encore, des effets de crispations identitaires ?
Les dimensions religieuses, politiques et identitaires sont toujours mêlées. Mais il faut se rendre compte à quel point la matrice culturelle catholique à partir de laquelle la France s’est fabriquée est prégnante dans la très longue durée de l’histoire. Je parle bien ici de culture et non de croyances. Quand Sartre dit dans L’Être et le néant, « Nous sommes tous catholiques », il ne voulait évidemment pas dire que nous croyons tous au Dieu chrétien et catholique, mais que tous nous sommes marqués par cette culture. Avant la Révolution, il faut s’en souvenir, l’Église catholique tenait absolument tout : écoles, hôpitaux, état civil, etc. Elle était l’institution mère, et d’ailleurs, nos institutions laïques, pensées en réaction à l’Église, ont été construites comme son miroir, afin de contrer le pouvoir qu’elle détenait. Quant Charles Renouvier parlait de « l’État moral et enseignant », il répondait directement à la formule « mater et magistra », « mère et enseignante » appliquée à l’Église. Songez à l’armée des instituteurs faisant face à l’armée des prêtres ! Cette matrice, en positif ou en creux, définit notre culture. Les clochers font partie de notre paysage, non pas dans un registre religieux, mais dans celui de la culture. Dé-consacrer une église qui n’est plus ouverte au culte suscite des tollés en France, y compris parmi ceux qui n’y mettent jamais les pieds. Cette matrice est religieusement évidée, mais elle fait encore partie de notre mémoire de longue durée, même si elle est soumise à un processus probablement inexorable d’« exculturation ». Dès lors, il n’y a pas lieu de s’étonner que les éléments nouveaux qui s’affirment sur cette scène puissent être perçus comme provocants et déstabilisent un système de représentations que personne n’interroge plus. Avoir une église au centre d’un village est une évidence, même si on n’est pas croyant. Avoir un minaret est une création nouvelle qui renvoie à une réalité nouvelle avec laquelle il faut apprendre à vivre. Quand on vit dans un monde de sens unifié et qu’apparaissent de nouveaux partenaires, cela crée bien sûr des perturbations. Et, dans un contexte d’incertitude, celles-ci vont être perçues comme des menaces. Ce qui est en cause, c’est la manière dont ce qui est considéré comme « allogène », à un moment donné, sera en fin de compte intégré à notre récit commun en y faisant sens. Ce n’est pas un hasard si la mosquée de Paris, construite en 1920 par le gouvernement français en hommage aux Musulmans morts pour la France, n’a jamais posé de problème. D’autres lieux de culte dont l’arrivée ne s’insère pas dans un récit national aussi univoque provoquent donc des tensions. Il faut bien sûr appeler à la résorption de ses crispations identitaires, mais pour cela il ne suffit pas d’évacuer les problèmes en disant qu’il y a toujours eu des Musulmans en France ou en insistant benoîtement sur la nécessité de la pluralité ou du vivre-ensemble. Il faut entendre la puissance de l’imaginaire et des représentations. On sait que les villages où l’on vote le plus pour le Front National sont les villages qui ne connaissent pas l’immigration. On ne fait pas bouger si facilement les représentations.
Précisément, comment lutter contre ces représentations ?
Il y a une seule solution : c’est l’éducation. Et comme il faut peu compter sur la famille, qui a tendance à reproduire très logiquement l’ordre du connu d’un vécu familial, c’est de l’Ecole qu’il faut avant tout attendre cette éducation au vivre ensemble. En lui en donnant pleinement les moyens.