Veille M3 / Un jour, la ville sans Lune ni l’Autre ?

Article
La Lune, symbole d'une altérité radicale à notre monde ?
Interview de Jean-Pierre LE Goff

<< Les jeunes générations ont été placées dans des situations paradoxales, impossibles à assumer, ne sachant plus à quel modèle identificatoire se raccrocher >>.
L’époque ne cesse de faire état d’un malaise ou d’un déclin spécifiquement français. La France semble vivre dans un climat de dépression tant collective qu’individuelle. Le rapport au monde ne va plus de soi, tant l’ouverture internationale remet en cause la continuité de bon nombre de repères du quotidien. Devenu autonome, l’individu a le sentiment d’être livré à lui-même, dans les moments favorables comme dans les situations difficiles. Le politique, de son côté, semble replié sur lui-même, sur ses propres logiques électorales, bien incapable de proposer une nouvelle intelligibilité du monde et de maintenir une capacité à agir sur le réel. Ce double sentiment d’insécurité et d’impuissance paraît particulièrement prégnant dans notre pays. Mais si le tableau est bien connu, qu’en est-il des racines du mal ? Dénonçant la domination actuelle d'une optique gestionnaire faisant du changement et de l'adaptation des fins en soi, Jean-Pierre Le Goff montre que vouloir renouer avec une vision désirable et porteuse de l'avenir suppose de savoir réinterpréter le sens de la trajectoire historique de la France pour révéler les ressources et les potentialités inexplorées de notre héritage humaniste et républicain.
Philosophe de formation, écrivain et sociologue français, Jean-Pierre Le Goff est chercheur au CNRS (UMR Institutions et dynamiques historiques de l'économie de l'Université Paris 1). Il est également président du club Politique Autrement qui explore les conditions d'un renouveau de la démocratie dans les sociétés développées.
Vos derniers ouvrages témoignent de l’idée que la France serait engagé depuis une quarantaine d’années dans un long processus de décomposition culturelle. Que faut-il entendre par décomposition culturelle ?
Par décomposition culturelle, j’entends l’érosion d’un ethos conçu comme un ensemble de représentations, de valeurs, de types de comportement qui imprègnent plus ou moins consciemment la société, engagent des conceptions de la vie individuelle et collective, du rapport à son propre pays, de l’éducation des enfants et du rapport à la finitude… Autant d’éléments transmis tant bien que mal à travers les générations et qui, en France particulièrement, sont liés à un vieil héritage chrétien et républicain. Or, ceux-ci sont mis à mal par un certain nombre d’évolutions sociétales, tout particulièrement dans la seconde moitié du XXe siècle. Cette décomposition culturelle a produit des effets dedéstructuration anthropologique que nous avons du mal à regarder en face.
Souvent par peur de se faire accuser d’être nostalgique ou « passéiste » par un courant moderniste particulièrement présent dans les grands médias, pour qui le « changement » est devenu une fin en soi dans un monde chaotique que personne à vrai dire ne paraît être en mesure de maîtriser. Dans mon dernier livre La fin du village. Une histoire française – qui est le fruit d’une longue enquête sur les évolutions d’un bourg provençal depuis la seconde guerre mondiale jusqu’à aujourd’hui –, apparaît une réalité qui se manifeste hors du champ mental de la majorité des élites et des cadres dirigeants : une partie des Français sont fatigués, non pas de la modernité, mais du modernisme entendu comme une fuite en avant impliquant des sacrifices et des efforts incessants, qui mène le pays on ne sait où et le défigure d’une manière telle qu’il devient impossible pour eux de s’y retrouver.
L’émergence de la société de consommation constitue semble-t-il un premier facteur de décomposition. En quoi la montée de l’individu et de la consommation marchande a-t-elle changé les mentalités ?
Le développement de la production et de la consommation qui suit la période de reconstruction de l’après-guerre n’est pas en soi un facteur de décomposition. Il constitue une amélioration considérable des conditions de vie et de bien-être matériel avec l’accession à un certain nombre de biens de consommation tels que l’automobile, la télévision, le frigidaire ou la machine à laver… Sous le double effet de l’expansion économique et des mécanismes de protection sociale de l’État, les individus se sont trouvés libérés du poids de leurs communautés premières d’appartenance, ils se sont dégagés des règles et des modèles de conduite traditionnels.
Pour autant, cette modernisation s’est accompagnée d’un malaise diffus. L’apparente satisfaction générale masquait un vide du sens dont témoignaient le « nouveau roman », les films de Jacques Tati et de la « Nouvelle vague » ou d’Antonioni… Le développement de la consommation, du loisir et des médias a considérablement valorisé le l’individualisme consumériste, le bonheur privé. Comme l’écrivait alors un sociologue français, Joffre Dumazedier, le loisir, produit de l’évolution de l’histoire, est « vécu comme une valeur extérieure à l’histoire » : « L’homme de loisir tend à être ingrat à l’égard du passé, et indifférent à l’égard de l’avenir. Ce n’est pas là une attitude active de citoyen et de travailleur, mais cette attitude existe et se développe . » Ainsi, l’importance accordée au travail, la vision d’une histoire en marche vers toujours plus d’émancipation se sont trouvées confrontées à la nouvelle réalité de la consommation et des loisirs modernes qui ont fait valoir un nouvel individualisme de masse pour qui le rapport à la collectivité et à l’histoire n’est plus le même.
Autre facteur majeur de changement selon vous, le mouvement de « mai 68 ». Au-delà de ses aspects positifs, cet évènement serait également porteur d’évolutions régressives ?
Dans mon livre sur mai 1968, j’ai interprété l’événement en France comme un moment de libération de la parole, de catharsis et de transition entre deux mondes, dans une société qui s’est modernisée à grande vitesse depuis la fin de la seconde guerre mondiale mais qui néanmoins demeure encore attachée à une certaine « idée de la France ». La révolte étudiante a fait écho au malaise d’une société qui, du point de vue des valeurs et des mentalités, est au carrefour entre deux époques et hésite à franchir le pas. La contestation de ce qu’on appelle alors la « société de consommation » est en fait traversée par une interrogation inquiète sur les effets de cette nouvelle société dans la vie individuelle et collective. Ce moment de libération de la parole et de critiques multiples a permis une remise en cause salutaire des pouvoirs et des bureaucraties installées. Des aspirations nouvelles à l’autonomie et à la participation individuelle et collective aux affaires publiques se sont exprimées. Ces aspirations peuvent être interprétées comme des exigences qui s’inscrivent dans le développement des sociétés démocratiques.
Mais elles n’en sont pas moins marquées par ce que j’appelle « l’héritage impossible » de mai 68. Celui-ci est constitué par trois traits marquants : une critique de l’autorité, du pouvoir et des institutions qui les confond et les réduit à la domination, à la dictature voire au fascisme ; en contrepoint à cette représentation du pouvoir-domination, s’affirme une exigence d’autonomie érigée en absolu et qui veut être « négation de toutes les structures verticales », remise en cause de toute relation impliquant un rapport dissymétrique entre les individus ; enfin, un rapport à l’histoire marqué par une dépréciation et une vision noire du passé des pays développés. Le passé se trouve réduit à ses pages les plus sombres : répressions et massacres, guerres et domination coloniale, répression et fascisme… Le « roman national » et l’héritage culturel propres aux différents pays sont remis en cause de façon radicale, si bien que le passé apparaît sans ressources et la transmission impossible. Ces trois caractéristiques de l’héritage impossible de mai 68 vont s’exacerber dans les années suivantes et, produire sur le long terme des effets sur tous les symboles traditionnels de l’autorité, et plus particulièrement sur les deux principaux vecteurs de la transmission que sont la famille et l’école.
Quelle est justement la nature de cette crise de la transmission entre génération ?
Dans mon livre, La Gauche à l’épreuve, j’avance l’hypothèse que le fossé entre les anciennes et les nouvelles générations est aujourd’hui plus important que celui entre les baby boomers et leurs parents. Les effets de la « révolution culturelle » de mai 68, combinés avec la fin des Trente Glorieuses et le chômage de masse ont amené une rupture entre les générations plus problématique que celle des années 1960 et 1970 . Les nouvelles générations constatent amèrement que la situation économique et sociale s’est dégradée par rapport à celle de leurs parents qui ont été jeunes dans la période des Trente Glorieuses. Avec le développement du chômage des jeunes et de la précarité, le passage à l’âge adulte est rendu plus difficile. Il en va de même avec les difficultés de logement qui prolongent la cohabitation parents/jeunes, maintiennent des liens de dépendance qui peuvent demeurer infantiles, surtout quand les parents assument mal leur rôle d’adultes et le conflit avec leur enfant devenu adolescent.
En moins d’un demi-siècle, le rapport des jeunes et des adultes, de même que le rapport des jeunes aux institutions et à la société, ont profondément changé ; l’éducation des enfants, dans la famille et à l’école n’est plus la même et le service militaire a été supprimé. L’enfance et la jeunesse ont été idéalisées au nom d’un épanouissement individuel qu’il ne faut pas contrarier. L’idée d’une créativité enfantine qu’il faut laisser s’exprimer en libérant les enfants des carcans contraignants du passé est devenue hégémonique. La garde et l’éducation des enfants ont été de plus en plus prises en main par des spécialistes qui entendent développer l’autonomie, la créativité et la « citoyenneté » des enfants dès leur plus jeune âge. Ces méthodes d’éducation mettent en œuvre un nouveau rapport à l’enfance et à l’adolescence qui brouille les repères, les distinctions entre adultes, enfants et adolescents.
Les jeunes générations ont été placées dans des situations paradoxales, impossibles à assumer, ne sachant plus à quel modèle identificatoire se raccrocher. Dans le même temps où l’on proclamait leur autonomie et leur créativité, elles se sont trouvées soumis de plus en plus tôt à des systèmes d’évaluation et de contrôle, à des objectifs de résultats et de performance à tout prix . Ce type d’éducation a favorisé le sentiment de toute-puissance chez les enfants, en même temps que de nouveaux déséquilibres, et l’on a vu apparaître de nouveaux types d’individus agités, contrôlant mal leurs affects et leurs pulsions, ayant une grande difficulté à se décentrer et à se concentrer. Dans le même temps, l’augmentation des séparations et des divorces, des « familles monoparentales » ou « recomposées » a globalement aggravé cette situation.
Selon vous, l’émergence de la pensée écologique durant les années 1970, loin d’offrir de nouveaux repères, va justement va accentuer cette vision sombre de l’histoire. L’écologie politique serait elle-aussi trop binaire ?
Ce n’est pas l’écologie comme telle et la réalité des problèmes environnementaux qui sont en question, mais la façon dont ces réalités s’inscrivent dans des discours porteurs de représentations pessimistes. La fin des années de l’expansion économique de l’après guerre s’amorce avec la crise du pétrole et les rapports du club de Rome qui soulignent les limites des ressources naturelles, la croissance démographique et les dangers que fait peser sur la planète le développement de la production industrielle. L’écologie politique naît précisément au carrefour de la fin des Trente glorieuses en fournissant un type de réponse bien particulière aux « désillusions du progrès » qui se sont exprimée en mai 68.À l’inverse de l’utopie insouciante de Mai 68 et du messianisme révolutionnaire, l’écologie politique développe à ses origines une vision noire, catastrophique du présent et de l’avenir de l’humanité. Au règlement de compte historique mené par le gauchisme issu de mai est venu s’ajouter la critique du « productivisme » et de ses effets sur l’environnement et la planète. L’histoire de l’humanité semble désormais « marcher à l’envers » et si une prise de conscience et un changement total des mentalités n’ont pas lieu, l’humanité court à sa perte. À la vision d’un progrès historique dont la modernisation de l’après guerre ne représentait qu’un moment – exceptionnel à bien des égards –, s’est substituée une vision naturaliste des évolutions et une représentation sombre de l’humanité courant à la catastrophe. Le passé réduit une fois encore à ses pages les plus sombres ne constitue plus un point d’appui et l’avenir est désormais ouvert sur de possibles régressions économiques et sociales et sur des catastrophes naturelles. La montée des thèmes écologistes accompagne une désarticulation des sociétés et de l’histoire qui est l’une des sources importantes du malaise Français et européen.
L’entrée dans une époque de chômage de masse n’a-t-elle pas également contribué à déstabiliser la société française ?
Depuis le milieu des années 1970, nous subissons un chômage de masse qui a profondément déstructuré la société. On a parlé à l’époque d’une « parenthèse » mais nous attendons toujours la « fin du tunnel ». Le chômage de masse n’est pas seulement un problème d’ordre économique et social. Dans les sociétés développées, l’entrée dans le monde du travail constitue un élément essentiel du passage à l’âge adulte. Elle permet de sortir des communautés premières d’appartenance que sont la famille, le cercle des relations privées ou communautaires, pour s’inscrire dans des rapports sociaux de coopération et de conflit. Le travail permet à l’individu de se confronter à l’épreuve du réel, de se sentir utile à la collectivité et d’acquérir une autonomie en « gagnant sa vie ». Parce que ces éléments sont des conditions clé de l’estime de soi dans une société moderne, le chômage de masse a produit des effets puissants de déstructuration anthropologique et sociale.
Avec l’exacerbation de la concurrence des pays émergents au faible coût de main d’œuvre, la mondialisation a entrainé des pertes massives d’emplois dans les secteurs industriels. À droite comme à gauche, le schéma de base de la modernisation n’a pas fondamentalement varié : la bataille pour la compétitivité des entreprises dans l’économie mondiale est une condition pour retrouver la croissance et l’emploi ; cette compétitivité passe par le développement des nouvelles technologies et de la formation. Cette orientation comporte sa part de vérité mais ne règle pas la question de l’emploi. Elle passe sous silence les effets de la concurrence du coût du travail dans une économie mondialisée régie par les lois du libre échange : à moins de considérer que tout le monde puisse devenir ingénieur, cadre ou technicien, on voit mal comment une telle orientation pourrait concerner les catégories peu ou pas qualifiées et celles qui sont désocialisées. Les populations des anciennes régions industrielles ont vu leurs emplois disparaître au fil des ans, sans que les nouvelles activités puissent compenser les emplois perdus. Ces catégories populaires ont eu le sentiment d’être les laissés pour compte de l’ouverture économique, les aides sociales et les formations proposées représentant un pis aller à l’absence de travail. Des catégories entières de population se sont ainsi retrouvées dans une situation de précarité et de déshérence qui constitue un terrain favorable à la démagogie et à tous les extrémismes.
Dès lors, la promotion des vertus du marché n’a-t-elle constituée une vision politique de substitution ?
Le triomphe du modèle du marché s’inscrit dans « l’ère du vide », de l’insignifiance des années 1980. Contrairement à ce que la gauche affirme trop facilement, la « dictature des marchés » n’est pas responsable de tous nos maux. La question mérite d’être posée autrement : pourquoi la France et les autres démocraties européennes n’ont-elles pas su s’y opposer ? Autrement dit : que s’est-il passé au cours de ces trente dernières pour que le dogme économique libéral – et non le libéralisme comme tel – ait triomphé ? Que s’est-il passé pour que le modèle du fonctionnement du marché ait été considéré comme une référence centrale et un modèle pour l’ensemble des activités, et ce, dans un pays comme la France dont l’identité était liée à une certaine idée de la culture et de la politique, de son rôle dans l’histoire et dans le monde ?
La réponse à ces question n’est pas seulement à chercher dans le champ économique, mais dans la rencontre qui s’est opérée entre la logique du marché et une décomposition des ressources sociales, politiques et culturelles qui jusqu’alors s’opposaient à son hégémonie et l’encadraient. Le développement du modèle marchand dans l’ensemble des sphères de l’activité est lié à une « désymbolisation » qui appréhende le monde sous l’angle de la mécanique et de l’utilitarisme, de l’efficacité et de la rentabilité à courte vue dans tous les domaines de l’existence individuelle et collective. Le présent coupé de toute épaisseur historique est devenu autoréférentiel et le fonctionnement dominant des marchés, comme celui des grands médias audiovisuels, incarne on ne peut mieux ce nouveau monde chaotique et insignifiant.
Comment prendre la mesure de la nocivité cette situation sur le vécu et l’imaginaire individuels et collectifs du pays ?
La France se morcèle sous le double effet du chômage de masse et de l’absence de signification historique qui donne figure humaine au nouvel état du monde. Quand le passé apparaît sans ressource et l’avenir indiscernable, le présent devient existentiellement flottant. L’individu est désaffilié, autocentré et s’investit dans des activités multiples. L’activisme managérial et « communicationnel » des organisations masque cette insignifiance historique par un surinvestissement du présent et une réactivité qui ne laissent plus d’espace et de temps pour réfléchir à ce que l’on fait. Avec le déclin du sens historique et de l’institution, la recherche de la réalisation de soi prend la forme d’une autoconstruction qui met en jeu ses propres forces, sa volonté, ses qualités personnelles et ses compétences, dans une stratégie de compétition et de réussite individuelle visible dans le présent. L’individu se doit d’être autonome et performant dès le plus jeune âge, en même temps qu’il doit manifester tous les signes de son épanouissement. Le développement de la thématique du « développement personnel » englobe ces deux dimensions. Le modèle de la performance se double de celui d’un « mieux-être » supposant de parvenir à un rapport harmonieux avec soi-même (« Être bien dans son corps et dans sa tête » et « mourir en bonne santé »), avec les autres (« Rester maître de ses émotions et maîtriser les conflits ») et avec la nature (« Vivre en, harmonie avec elle »). De multiples outils managériaux et thérapeutiques ont fait leur apparition pour tenter de répondre à ce double objectif paradoxal.
À l’autre pôle, les exclus de la modernisation et de la compétitivité vivent le temps du chômage et de la « galère ». Dans les milieux défavorisés, deux phénomènes inquiétants n’ont cessé d’additionner leurs effets : d’une part le chômage de masse et le développement de la précarité, d’autre part la dislocation de la structure familiale, gentiment rebaptisée « famille recomposée ». La prise d’antidépresseurs peut servir d’anesthésiant pour « gérer » tant bien que mal de telles situations. On « vivote » grâce à l’aide sociale, avec au mieux du « travail au noir » de temps en temps, et l’on passe son temps comme on peut. Il en résulte une dégradation du rapport à soi-même et aux autres qui, si elle se prolonge, entraîne l’individu dans une spirale délétère. À la pauvreté ancienne a succédé ce que j’ai appelé, d’un mot familier, la « déglingue » caractérisée par cette combinaison d’absence de travail et de dislocation de la famille et des liens traditionnels d’appartenance et de solidarité au sein d’une collectivité. Cette situation de déglingue entraînent souvent des drames qui nourrissent la rubrique des faits divers des journaux. Elle a conduit également à donner une place sans précédent à la psychologie dans la culture contemporaine qui accompagne l’érosion du sens historique et des institutions. Elle peut alors servir d’infirmerie sociale, à l’image des cellules d’aide psychologiques qui se sont répandues dans la société.
Vous expliquez que ces différents facteurs de décomposition vont nourrir une crise profonde de la représentation politique dans notre pays. Le tournant de la rigueur de 1984 ne marque-t-il pas un tournant sur le plan du projet politique ?
En 1984, la gauche a opéré un tournant dans sa politique économique tout en n’assumant pas clairement ce changement aux yeux de l’opinion. S’est mise en place une « façon déconcertante de gouverner » marquée par l’incohérence et la fuite en avant. Cette nouvelle façon de gouverner sur fond d’impuissance à endiguer le chômage de masse a entraîné un fossé entre gouvernants et gouvernés, fossé qui n’a cessé de se creuser au fil des années. La gestion au mieux des contraintes, l’adaptation dans l’urgence et la précipitation à un monde immaîtrisable sont devenus le seul horizon de la politique, faute de capacité à expliquer clairement l’état du monde actuel et de tracer une nouvelle vision du progrès. Les spécialistes de la communication qui conseillent la droite comme la gauche et manient les petites phrases chocs et les slogans, ont alors acquis un poids en plus important. Les rhéteurs de la post-modernité vont ériger le constat et le commentaire des évolutions dans tous les domaines en références bouclées sur elles-mêmes. Les politiques eux-mêmes se sont voulus modernistes et « branchés ». Rappelons-nous que l’organisation du défilé qui a célébré le bicentenaire de 1789 à Paris a été confiée à un publiciste. Faute d’un projet structurant, les politiques vont faire du surf sur les évolutions dans tous les domaines et une « demande sociale » éclatée et de plus en plus victimaire.
Le politique ne devrait-il pas faire preuve de davantage d’audace pour appréhender l’avenir, c'est-à-dire de capacité à résister à l'émotion, à la peur, à l'intimidation, à l’habitude ?
Sans nul doute, mais cela implique le courage de rompre avec le « nouvel air du temps », avec la démagogie victimaire et de sortir du carcan du court terme. Les politiques vivent de plus en plus dans une campagne électorale permanente où les intérêts clientélistes l’emportent souvent sur l’intérêt général et sur la nécessité d’unir le pays face à l’ampleur des défis qui lui sont posés. En l’affaire, l’audace, si elle ne veut pas dégénérer en nouvelle « fuite en avant », doit s’accompagner d’une claire conscience de l’état actuel du pays et d’une réflexion historique et prospective. Cela ne va pas de soi parce que la déculturation historique concerne aussi une partie des élites politiques pour qui le changement est devenu un maître mot et dont le langage s’aligne sur celui de la communication et du management. Dans les moments difficiles de son histoire, la France a pu compter sur les qualités propres à certains hommes d’État et le pays dispose encore de réserves dans ce domaine.
A l’heure de la société de l’information et de la connaissance, le politique ne devrait-il pas faire de la pédagogie une valeur essentielle de son action ?
Ce que vous appelez la société de l’information et de la connaissance s’accompagne d’une absence de réflexion sur les finalités et d’une difficulté à faire des choix clairs et cohérents. Nous vivons dans une société de plus en plus bavarde où l’on peut facilement croire qu’on a changé le monde quand on a beaucoup parlé sur lui, où l’épreuve du réel s’efface sous le poids des analyses, des commentaires et des débats à l’infini. Dans mon dernier livre, La fin du village, je n’ai pas voulu prendre une position de sociologue classique dans une position de « surplomb » des phénomènes afin d’en démonter les mécanismes, mais je me suis immergé dans la vie d’une collectivité. J’ai voulu réintégrer les données objectives dans une « chair de l’histoire » qui donne sens aux choses et aux événements, dans un récit historique avec ses drames et ses passions, avec ses hommes et ses femmes « en chair et en os » qui se trouvent confrontés à des situations souvent difficiles et tragiques. C’est la condition pour affronter la réalité et ne pas se payer de mots.
Jamais, historiquement, une société n’a disposé d’autant d’informations sur elle-même à l’aide de statistiques, de rapports d’expertise et d’audits en tout genre qui se sont multipliés et entassés depuis des années, jamais l’activisme « communicationnel » et managérial n’a été aussi grand… Dans le même temps, le fossé n’a cessé de se creuser entre les élites qui vivent dans l’entre-soi et les citoyens ordinaires. Tel est le paradoxe qu’il s’agit précisément de comprendre en examinant l’état des ressources intellectuelles, morales, sociales et politiques de la France d’aujourd’hui. La difficulté du pouvoir politique n’est pas une simple affaire de pédagogie, même si celle-ci demeure une valeur essentielle à l’action, elle est le signe d’une fracture sociale et culturelle avec une bonne partie de la population. Elle est liée à l’absence d’intelligibilité globale du monde actuel et d’une claire vision d’avenir dans lequel le pays puisse se retrouver.
Vous appelez à un sursaut du pays qui passerait par une réhabilitation de l’estime de soi du peuple français. Quel est la portée de ce chantier pour l’avenir ?
C’est pour moi la clé d’une nouvelle dynamique et cette réhabilitation est inséparable d’une réappropriation des acquis de notre propre histoire. Un pays qui ne croît plus en lui-même est ouvert à tous les conformismes et à toutes les servitudes. À force de considérer négativement notre passé, à le trouver « ringard », on finit par perdre la confiance et l’estime de soi-même, sans lesquelles tout renouvellement et création sont impossibles. En France, il existe une perte de confiance et une mésestime de soi qui concernent moins les domaines scientifique et techniques que les ressources politiques et culturelles liées à notre propre histoire. La mise à mal de l’histoire nationale a été poussée assez loin. Un nouvel « air du temps » a versé dans une « mémoire pénitentielle » et un règlement de comptes qui n’en finit pas, entretenus par des minorités qui s’érigent en justiciers du passé et encouragent le ressentiment.
Après un siècle dramatique qui a connu coup sur coup deux guerres mondiales, le totalitarisme et la shoah, enfin les guerres coloniales, les pays européens sont entrés dans une phase critique de leur histoire, marquée par l’érosion de leur dynamique tant sur le plan interne que dans leur capacité à peser dans les affaires du monde. La France a subi particulièrement ce contrecoup. Son passé est apparu en décalage avec le monde d’aujourd’hui et l’idée d’un pays porteur d’un message universel à l’égard des peuples du monde a laissé place à une sorte de banalisation vide de grande ambition. On peut faire valoir que la réalité du pays et sa puissance effective sont depuis longtemps en décalage avec ses prétentions – le gaullisme représentant le dernier moment historique où une certaine « idée de la France » a été maintenue, non sans écart avec les évolutions des mœurs et des mentalités. En fin de compte, ce sont nos propres ressources internes, la façon dont nous les percevons et nous appuyons sur elles qui sont en question.
Comment pouvons-nous nous réinscrire dans une perspective historique ?
Je crois que nous assistons à la fin d’un cycle historique de décomposition et qu’il existe un besoin de renouer les fils du « roman national » en l’insérant dans l’Europe et le nouvel état du monde. L’histoire demeure ouverte sur les possibles. Mais pour définir ce que nous voulons être et peser à nouveau sur l’avenir, il importe de savoir ce à quoi nous tenons dans ce qui nous a été légué tant bien que mal à travers les générations. Redisons-le, un pays qui rend insignifiant son passé se condamne à ne plus inventer un avenir porteur de progrès.
La période critique de l’histoire que nous traversons implique, à mes yeux, non seulement d’être attentifs aux « réserves d’humanité » et aux pratiques nouvelles dans les différentes sphères d’activité, mais elle nécessite également un travail de reconstruction intellectuelle de longue haleine qui ne se confond pas avec les échéances politiques. Il s’agit de faire le lien entre les intellectuels qui mènent une réflexion théorique et ceux qui se trouvent en situation d’action et de responsabilité dans les différentes sphères d’activité. L’intelligibilité du monde contemporain et l’analyse des évolutions doivent pouvoir s’accompagner de la réappropriation de notre héritage, en discernant ce qui dans cet héritage peut constituer des ressources essentielles pour nous confronter aux défis du présent. C’est en confrontant ces évolutions à l’héritage culturel qu’il nous paraît possible de donner figure humaine à un monde en plein bouleversement. Cette reconstruction implique non pas une rupture radicale mais une opération de « recreusement » et de reconstruction qui permettre de faire valoir les ressources et les potentialités inexploitées de l’héritage humaniste et républicain, afin d’aider au renouvellement des modes de pensée et d’action. Comme le dit si bien la philosophe Hannah Arendt, c’est parce que nous vivons dans un monde moderne qui n’est plus structuré par la tradition que nous pouvons nous réapproprier avec un regard neuf les ressources de cette tradition. C’est ce que j’appelle faire de la politique autrement en dehors du champ partidaire, en menant une réflexion libre et autonome au sein même de la société.
Pour aller plus loin avec Jean-Pierre Le Goff :

Article
La Lune, symbole d'une altérité radicale à notre monde ?

Article
Dans un monde qui se réenchanterait pour mieux se réconcilier avec le non-humain, que nous dirait-il de nos anomies actuelles ?

Article
Synthèse du colloque organisé par Tempo Territorial et la Métropole de Lyon – Retour sur les interventions du jeudi 9/11/2023.

Article
Synthèse du colloque organisé par Tempo Territorial et la Métropole de Lyon – Retour sur les interventions du vendredi 10/11/2023.

Article
Aurianne Stroude, sociologue spécialiste de la transformation des modes de vie en lien avec les enjeux écologiques, décrypte le changement social qui opère au-delà des évolutions individuelles.

Article
S’appuyant sur une importante revue de littérature, cet article décrit la façon dont les modes de vie se structurent progressivement autour de trois variables.

Étude
Cette étude propose cinq monographies – Bogotá, Pontevedra, Milan, Zurich et Lahti – explorant le lien entre « massification » des changements de mode de vie et nouvelles manières de travailler au sein des collectivités publiques.
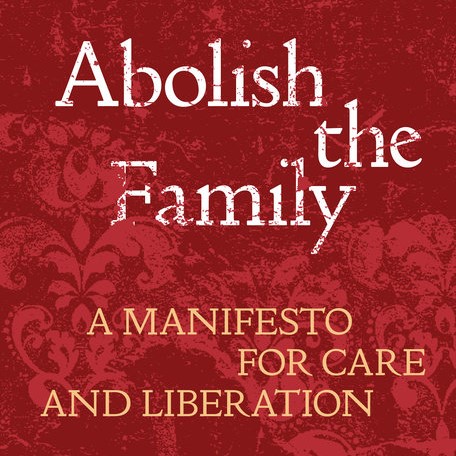
Article
La famille, considérée parfois comme valeur suprême est pourtant un important marqueur d’inégalités. Dès lors, qu’en faire ? Peut-on envisager l'abolition de la famille ?
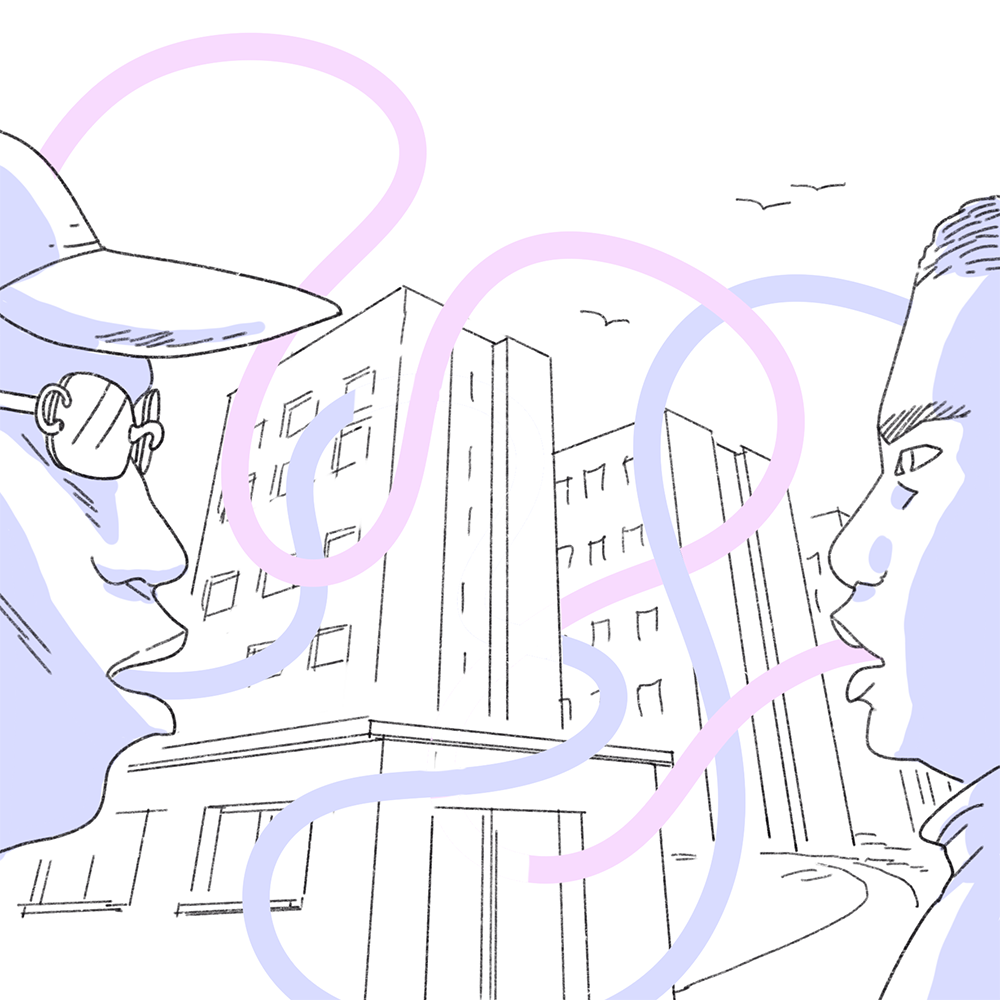
Article
A priori, pour le grand public, le Grand Lyon n’est pas une place forte du rap hexagonal. Pourtant, de nombreux acteurs ont solidement posé depuis 30 ans les fondations de la scène locale, à l’échelle d’une agglomération qui regorge de talents cachés.