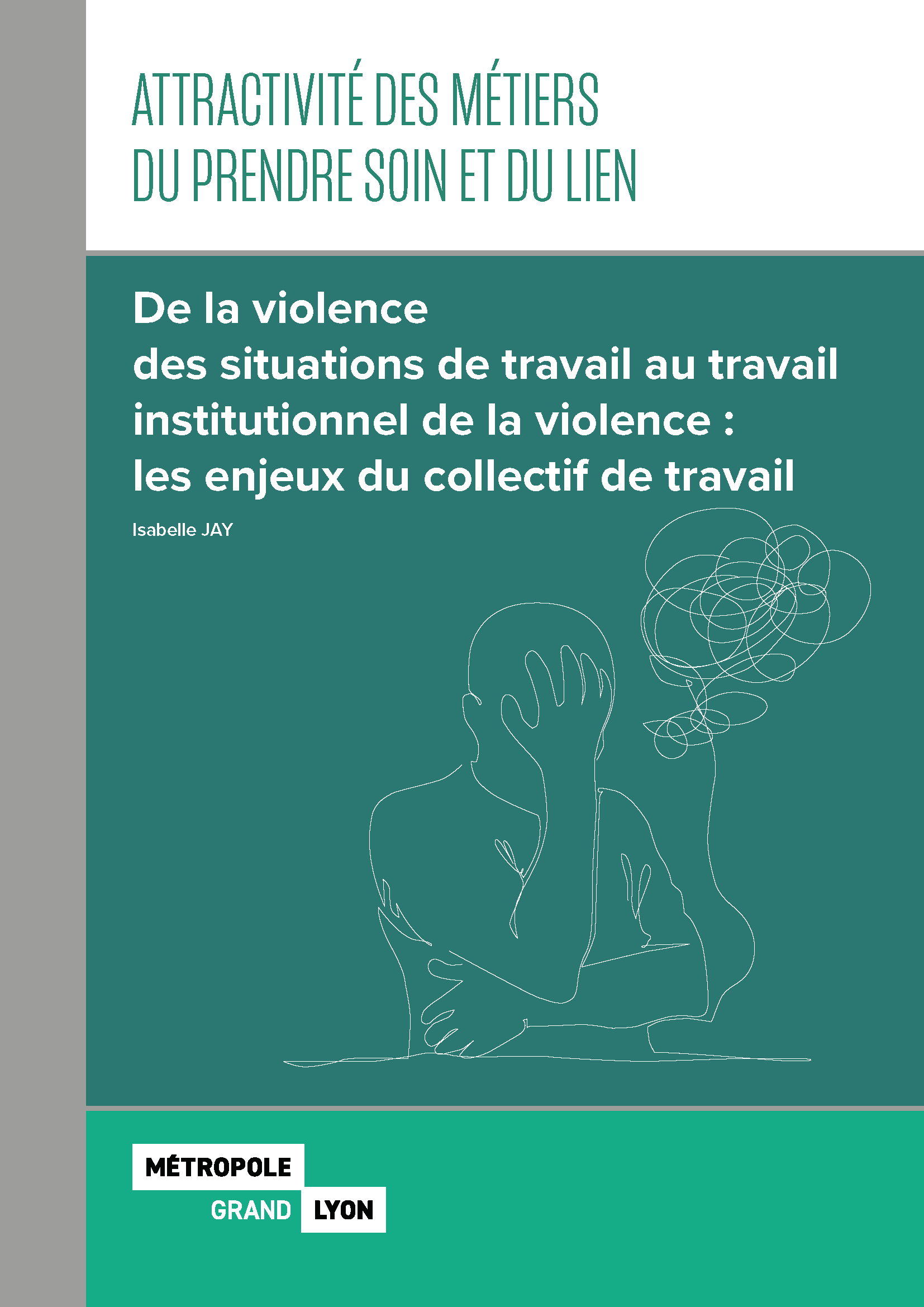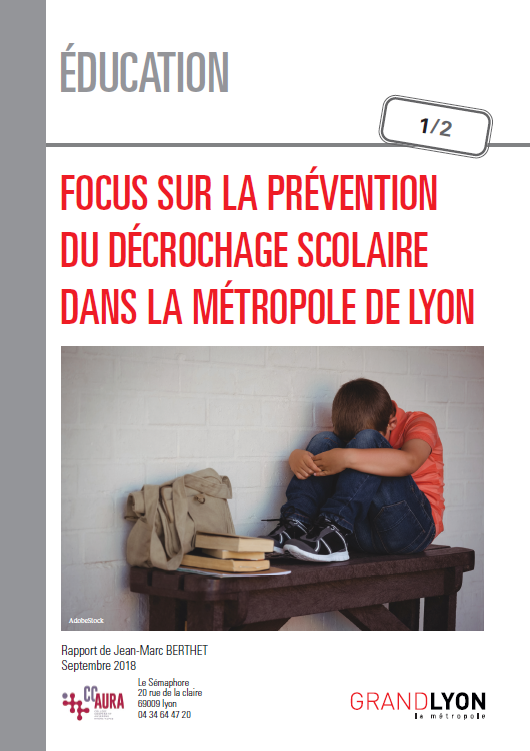Lorsque l'on parle de « dialogue Science-société », on constate une évolution certaine dans l'emploi des termes. On est passé de « vulgarisation », à « culture scientifique » puis à « médiation », comment évaluer ce que cette évolution veut dire ? De quoi est-elle représentative ?
Le terme « vulgarisation » remonte au XIXe siècle. C'est Auguste Comte qui va théoriser le concept et le nommer. A l'époque, il identifie un besoin de transfert de connaissances d'une discipline à une autre. Puis, cela se transforme en « science populaire » petit à petit avec l'idée que les savants vont pouvoir enseigner leur savoir à une population profane. Il n'est pas ici question de médiation puisque ce sont les savants eux-mêmes qui vulgarisent leurs connaissances. Pour eux, cela signifie qu'ils transforment un langage complexe en langage simple et qu'ainsi ils pourront atteindre les populations non-instruites. On sait aujourd'hui que la médiation va bien au-delà de cela.
L'expression « culture scientifique » a quant à elle émergé dans les années 1970 avec notamment Jean-Marc Lévy-Leblond qui a fait le constat que les scientifiques eux-mêmes étaient incultes par rapport à leur propre discipline et par rapport aux autres. Cette « mise en culture des sciences » était bénéfique aux scientifiques eux-mêmes. Jean-Marc Lévy-Leblond appelait à une « auto-critique » de la science. Il dénonçait un centrage disciplinaire académique hors sol : aucune culture scientifique, aucune notion d'histoire et de philosophie des sciences, etc.
Un autre des arguments développés à cette époque est que les scientifiques sont payés par l'Etat français, donc par de l'argent public en conséquence de quoi, ils doivent des comptes à la société. Cette idée a été porteuse puisqu'elle a conduit à la création en 1991 de la Fête de la Science par Hubert Curien.
Après, on parle davantage de médiation. C'est un rapprochement avec ce qui se passe dans l'Art contemporain et les réflexions initiées par Jack Lang où on tente de faire se rapprocher les œuvres et le public. Le rôle du médiateur devient central. Les acteurs de la médiation scientifique revendiquent leur attachement au domaine de la culture. L'idée qui est fortement développée ici au CCSTI de Grenoble est que nous souhaitons faire comprendre aux gens qu'ils font partie d'un tout, qu’ils sont concernés plus qu’ils ne le pensent par les sciences et les techniques. Aujourd'hui, il y a une discussion entre « médiation scientifique » et « science-société ». Ce débat vient en partie de l'Europe où, pour la Commission européenne, il est davantage question de « communication scientifique » ou « d'éducation scientifique ». Ces terminologies viennent du fait que pour les pays anglo-saxons ou du Nord, il y a de la culture dans la communication ou l'éducation. Donc, pour mettre tout le monde d'accord, on a collectivement adopté l'expression « science et société ». L’Europe a d’ailleurs créé un département « Science in society» (abandonné aujourd’hui) où il était question de problématiques plus larges telles que l'éthique, la place des femmes dans les sciences et l'éducation aux sciences.
Le Centre de Culture Scientifique, Technique et Industriel (CCSTI) de Grenoble, la « Casemate », est le premier centre à avoir été créé en France, pouvez-vous revenir sur les conditions qui ont prévalu à sa création en 1979 ?
Deux éléments ont contribué à la création matérielle de ce CCSTI. Le premier est l'accueil à Grenoble en 1968 des Jeux Olympiques d'hiver. Cet événement a, sans conteste, permis un développement territorial important. Grenoble a pu se développer : le village Olympique a été construit pour l'occasion, la ville a procédé à des aménagements d'infrastructures pour rendre l'accès plus facile et des stations de ski ont augmenté leur capacité d'accueil (construction de logements, de remontée mécanique, d'un tremplin à Saint-Nizier). Cet événement a donné un élan dynamisant pour la ville entière, tout domaine confondu. Le deuxième est la création de la Maison de la Culture de Grenoble (MACU), également en 1968. Dès l’origine, un service « sciences » est conçu à l'intérieur même de cette Maison de la Culture. Il y a, en effet, des scientifiques militants et convaincus d'une nécessité de partage des connaissances. Ce service « sciences » va organiser des conférences, des ateliers et proposer la création d'expositions. A l'époque, seul le Palais de la Découverte en faisait. Dès 1972, la Maison de la Culture propose donc une exposition avec le CNRS appelée « Images de la recherche ». Pendant plusieurs années, les activités de culture scientifique seront donc hébergées par la Maison de la Culture. Mais, rapidement, des questions de place vont se poser. Calibrée pour accueillir des spectacles de danse, de théâtre, de chant, etc. la MACU ne l'est pas pour la culture scientifique. Comment faire des expériences de chimie par exemple dans un espace confiné où il n'y a pas d'évacuation des fumées ? Des conflits d'utilisation vont également émerger lorsque le Centre de création des Alpes va davantage se développer et que la Compagnie Gallota va également produire des spectacles de façon plus récurrente.
Un autre point non négligeable et peut-être central est la différence de conception de la médiation entre les animateurs culturels et les animateurs scientifiques. Alors que les premiers revendiquent un certain engagement – social ou politique – les deuxièmes se veulent être dans la neutralité de la connaissance. Les animateurs du spectacle vivant par exemple dénonçaient les risques de certaines technologies comme la robotique et l'informatique ; tandis que les animateurs scientifiques estimaient que ce n’était pas là leur rôle, que c’était au public de faire sa propre opinion après avoir été informé. Ce qui est intéressant est que ce clivage se retrouve encore aujourd'hui lorsqu'il est question de débats « science-société ». Pour certains, il suffit d'informer et de faire comprendre tandis que pour d'autres, il faut dénoncer et alerter.
Face à tout cela, la question de créer un lieu culturel dédié aux sciences et aux techniques va alors s'imposer.
A l'époque, Catherine Tasca, directrice de la Maison de la Culture et Hubert Dubedout, maire de Grenoble, vont accompagner cette scission et soutenir la création d'une association en faveur de la culture scientifique. A l'époque, il n'existait rien en France. Les locaux de la Casemate sont donc ré-aménagés pour accueillir cette association qui deviendra en 1979 le CCSTI de Grenoble. Cette installation allait aussi dans le sens d'une rénovation du quartier, qui à l'époque, était un peu laissé à l'abandon.
Cette première création a été relayée au niveau national puisque elle se fait en collaboration avec la Délégation Générale à la recherche scientifique et technique (DGRST), la Ville de Grenoble, le Département de l'Isère et l'ancêtre de ce qui deviendra plus tard la Région. Les institutions scientifiques comme le Centre National de la recherche Scientifique (CNRS), les Universités et le Commissariat à Énergie Atomique (CEA) ont également joué un rôle central dans la mise en place du CCSTI. Toutes ces entités seront donc membres à part entière de l'association et le restent encore aujourd'hui. Les élus communistes de l'époque ont fortement soutenu la culture scientifique et technique. Le CCSTI de Grenoble est aussi issu de l'association Peuple et Culture, cela a été très prégnant dans sa création.
Pensez-vous que le fait que Grenoble soit une ville « scientifique » ait joué un rôle particulier ?
Oui, c'est évident. Toutefois, il faut se rendre compte que la création du CCSTI s’inscrit dans le mouvement d'une autonomisation des acteurs de la culture scientifique et technique. Dès 1981 et la loi sur la décentralisation, d'autres centres ont été créés. Ce sont avant tout les politiques locaux qui permettent la création des CCSTI. Les politiques nationaux prennent le relais mais l'initiative vient du local et cela ne peut fonctionner sans un appui des élus locaux, des universités et des institutions de recherche scientifique locales. Au sein de l'université de Grenoble, il y avait des chercheurs qui étaient sensibilisés aux questions relatives au « dialogue science-société ». L'approche était globalement de dire « on n'est pas dans notre tour d'ivoire, nos recherches n'ont de sens que si elles sont comprises et acceptées par la société ». Le problème, aujourd'hui, est que dans la plupart des cas – et notamment pour Grenoble – cela reste des initiatives individuelles. Les enseignants-chercheurs vont se mobiliser individuellement et mettre en place des actions : dans les classes, sur les marchés, par le biais d'associations. Mais, malheureusement, ce n'est pas pensé globalement par l'Université. C'est vrai qu'aujourd'hui c'est un peu différent pour le Rhône puisque l'Université de Lyon est l’une des rares universités françaises à avoir créé un service « Science-société ». Cela devient problématique lorsque l'on a des questions socialement vives comme celles qui touchent les nanotechnologies, les biotechnologies voire même le nucléaire, car lorsque ces enseignants-chercheurs prennent la parole individuellement lors de manifestations diverses, le public ne sait pas au nom de qui s'exprime le chercheur. Est-ce en son nom propre ? Est-ce au nom de l'université voire de son laboratoire de recherche ? De même au niveau de l'université, cela reste problématique car elle n'a pas de visibilité globale des actions menées individuellement par les chercheurs. Il n'y a pas vraiment de pilotage et de fait, cela ne correspond à aucune stratégie.
Quels pourraient être les moyens mis en œuvre par les universités pour proposer une véritable stratégie « Science-société »?
Il faudrait certainement s'appuyer sur ce qui existe déjà et construire à partir des dynamiques en place. En d'autres termes, faire une espèce « d'ingénierie inverse ». Voir ce qui existe, quelles sont les actions menées, pour qui, comment et les intégrer dans ce que pourrait être une stratégie d'université pour ces questions-là.
Cela permettrait aussi d'évaluer les opérations menées auprès des différents publics. De voir si elles sont efficaces. Enfin il faudrait associer des professionnels afin de ne plus s’appuyer de fait sur la bonne volonté des enseignants-chercheurs qui reste bien évidemment nécessaire.
Certains CCSTI ont un lieu d'autres non, est-ce aussi représentatif d'une certaine stratégie ?
Pour moi, la question du lieu est centrale. S'il y a un lieu, la stratégie mise en place ainsi que les différentes actions ne sont naturellement pas les mêmes que s'il n'y en a pas. Les CCSTI qui n'ont pas de lieu permanent sont davantage des « cellules d'ingénierie » de projets. Mais quand on n'a pas de lieu, pas de vitrine pour montrer ce qui est fait, il est beaucoup plus difficile d'exister.
Il y a des exemples de CCSTI dans des universités, comme à Lausanne, avec le « Centre éprouvette » qui est un établissement en interface avec la recherche, avec l'enseignement et avec le débat public. Ce lieu accueille des chercheurs, des scolaires, des étudiants, etc., provoque du débat, anime des interactions avec les différents publics. Il y a aussi à Dublin la « Science Gallery » du Trinity College qui marche très bien car il est intégré dans des réseaux internationaux de culture scientifique . Tout en étant en même temps, un service de l'Université de Dublin. Cela correspond à une stratégie du Doyen de l'université. En d’autres termes, avec ces exemples, on voit qu’un lieu cela permet d'identifier les actions mises en place. Cela permet aussi d'accueillir du public et d'offrir un espace culturel. Cela n'empêche évidemment pas la mise en place d'actions « hors les murs », dans les classes, dans la rue, les centres commerciaux – bien au contraire !
Pensez-vous qu'il y a des sciences et ou des techniques qui nécessitent plus de dialogue science-société ? On pense notamment aux nanotechnologies ainsi qu'aux biotechnologies évidemment ?
Toutes les sciences en général et les développements technologiques en particulier me semblent devoir être discutés en société. Mais il est vrai que les nanotechnologies et les biotechnologies nous renvoient d'emblée à la question des technosciences. Jean-Marc Lévy-Leblond et d'autres auteurs ont proposé ce concept en mettant en avant qu'elles avaient des enjeux différents des sciences classiques car notamment, elles impactent directement le quotidien et elles nécessitent des budgets très importants. Les plateformes technologiques nécessaires à la recherche dans le domaine des nano ou des biotechnologies sont très coûteuses et nécessitent des fonds publics mais également privés. Ce qui ne va pas sans poser certaines questions. On passe à un nouveau régime de « science en société », comme le soulignerait Dominique Pestre1 . En effet, cela pose vraiment la question des financements. Cela a un impact direct sur la société : comment choisir les crédits ? Pourquoi dans ce domaine plutôt qu'ailleurs ? Ce sont des choix politiques voire industriels où la société a vraiment son mot à dire ; sinon on pourrait se poser la question de la démocratie. De ce point de vue-là, ces sciences ou technologies ont vraiment besoin d'être mises en débat.
Qu'est-ce qui fait qu'un dispositif « science-société » va être efficace ?
Le problème des dispositifs « science-société » est que, parfois, ils réduisent les questions à celles du « pour » ou du « contre » ou celle du risque. Cela diminue le débat « science-société » tant dans son objectif que dans son essence même. Cela l'instrumentalise aux besoins politiques voire même parfois aux envies de certaines associations qui vendent du dialogue « science-société » comme des prestations démocratiques clés en main. Prestations qui au demeurant ne font qu'accentuer la distance entre le monde de la science et la société. Le débat scientifique ne peut jamais être posé en termes de « pour » ou « contre » : pour ou contre les nano ? Pour ou contre le téléphone portable ? Pour ou contre la biologie de synthèse ? Et cette façon simpliste de faire est largement relayée par certains médias, qui véhiculent hélas une image caricaturale des sciences. Or, les attentes du public sont plus exigeantes, elles se manifestent rarement en pour ou contre. Malheureusement, en retour, les représentations que certains scientifiques ou certains politiques peuvent avoir de ce public, sont parfois simplistes. Ils s'imaginent qu'il faut simplifier au maximum les informations pour qu'il puisse s'en saisir. Mais cela est erroné.
Une des premières questions à se poser est de savoir : qui veut quoi ? Pourquoi veut-on réduire la complexité des questions scientifiques et sociales ? Si cela est pour fabriquer de l'acceptabilité sociale, ou apaiser une crise, cela n’entre pas, de mon point de vue, dans les missions d’un CCSTI. Pour nous, l'idée n'est pas de calmer les opposants ou de les faire taire. S'il n'y a plus d'opposition exprimée c'est que nous ne sommes plus dans une démocratie. Mais ce qui m'intéresse en priorité, ce sont les personnes qui ne s'expriment pas forcément mais qui ont besoin d'une compréhension du monde, comme savoir pourquoi il y a des opposants par exemple, quelles représentations sont véhiculées et pourquoi. Il y a quelques années, à l'échelle de l'agglomération grenobloise, il y a eu des « rencontres des parties prenantes » au sujet des nanotechnologies. On s’est alors rendu compte finalement que les résultats de ces discussions n’étaient pas applicables. Il y a une espèce de prise en otage du public car la finalité de ces débats et surtout « l’opérationnalité » ne sont pas clairement formulées.
Que vont devenir les recommandations émises par les citoyens ? Quelles décisions vont-elles permettre de co-construire ? C'est exactement dans ce cas de figure que les conférences nationales sur les nanotechnologies ont été conçues. Ce qui a immanquablement conduit à un échec. Une autre ambiguïté est que souvent, les gens pensent que le débat public sert uniquement à la prise de décision. En participant à un débat public, on intervient sur la prise de décision. Or, cela ne sert pas seulement à cela. Le débat public a avant tout des vertus pédagogiques. Il permet de partager et commenter des informations et de faire entendre des points de vue contradictoires. Il permet aussi de faire découvrir d'autres parties prenantes. Par exemple, lors de débats sur les nano, on n'a pu se rendre compte de l'importance des avis des médecins du travail.
A la Casemate, vous tentez en ce moment la mise en place de dispositifs plus participatifs de type DIY, pouvez-vous en expliquer le principe et comment cela permet-il de mieux s'approprier les connaissances ?
Ce projet, Immédiats, soutenu par le Grand Emprunt, est mené sur 4 ans et, est développé avec cinq autres centres à l'échelle nationale. Il s'agit davantage une approche vers la technique que vers la science. On traite plus de la culture technique, technologique, industrielle ou de l'innovation que de la culture scientifique proprement dite. Même si la science revient très vite dans notre « fab-lab » grâce notamment à l'intervention de professeurs de physique et/ou de maths. On développe des outils interactifs mais qui vont plus loin que ce que nous connaissons déjà. Ce n'est pas une interactivité « pousse-bouton » comme on voit habituellement. Cela s'inscrit plutôt dans la filiation anglo-saxonne des musées de science où on apprend en fabriquant. Mais cet apprentissage par soi-même en expérimentant ne se fait pas tout seul, bien au contraire. Il est accompagné, de façon non-dogmatique, par des médiateurs ou des personnes du « fab-lab » et il se fait en partage avec d'autres participants. Cela fonctionne avec des publics très différents en âge et en catégorie socioprofessionnelle. Cette démarche peut aboutir à des projets artistiques – nous avons des designers et des artistes en résidence – ou des projets d'entrepreneuriat - on se rapproche des incubateurs de l’agglomération pour travailler – ou de projets de loisirs créatifs lorsqu'il s'agit d'une démarche plus personnelle. Le point commun est la culture numérique de fabrication par prototypage rapide. Cela permet de mettre en relation des choses qui paraissaient être à distance. Cela permet au public d’avoir accès, via le numérique et des communautés en ligne, à des machines dont certaines peuvent coûter 25000€. Nous sommes en relation avec d'autres « Fab-Lab » dont celui du Massachussets Institute of Technology (MIT). Nous téléchargeons des « patrons » d'objets techniques pour les modifier par exemple et puis, une fois les objets construits, nous republions nos patrons sur le site de partage. Il y a vraiment l'aspect personnel à la fabrication avec la possibilité de construire soi-même son objet et puis il y a l'esprit collectif, de partage avec un nouveau rapport au savoir qui est constitué par une communauté (comme dans les réseaux sociaux, ou sur Wikipédia).
Peut-on avec ce mode de faire bien faire comprendre les enjeux sociaux de la science ?
Cela dépend vraiment de la science. Mais dans notre projet, nous avons focalisé les questionnements sur l'innovation, car c'est vraiment un thème central en ce moment. Avec le DIY, nous permettons au public de comprendre « par le faire » et ainsi, de prendre conscience des enjeux liés aux sciences et aux techniques. Par exemple, avec les ateliers que nous proposons aujourd’hui, il y a une prise de conscience de la notion de « temps ». Pour fabriquer un objet, il faut du temps. Dans notre société de consommation, voire même dans le monde du numérique, tout est immédiat. Tout doit être immédiat. Or, quand on est face à un problème concret de construction, on se rend compte qu'il faut du temps. On se rend compte aussi que ça ne fonctionne pas à tous les coups, qu'il peut y avoir des erreurs et que ce n’est pas grave, au contraire, l’erreur permet d’avancer ! Et puis, et ce n'est pas rien, quand on est face à un problème de construction, on se rend compte que l'on crée des déchets et qu'il va falloir les gérer. Que fait-on de ses déchets ? Comment cela se passe-t-il lorsqu'on est au niveau industriel ? Cela nous permet d'aborder les questions relatives du tri ? Des idées émergent de la pratique et avec nos outils de médiation, on arrive à tirer les fils. Cela nous permet de sortir d'une façon de faire très française qui consiste à réfléchir et à faire les choses ensuite. Là, on invente, on fabrique, on expérimente et cela nous permet de réfléchir aux implications sociales, aux modifications que cela pourrait entraîner, etc.
De plus ces « Fab-Lab », nous permettent de faire se rencontrer les gens de milieux sociaux, d'âges et de cultures différents.
L’association grenobloise Bioponey est venue créer un « Fab-Lab » végétal à la Casemate, en forme d’expérimentation grandeur nature sur la culture hors sol en milieu urbain. Ce projet a été mis en place avec les habitants des quartiers Saint-Laurent et Villeuneuve. On fait des ateliers pour fabriquer des pots spécifiques pour des tomates, des plantes aromatiques ou autre. Ces pots sont susceptibles d'être placés sur des terrasses ou des balcons et avec un système de mini-robots arroseurs qui donne la quantité d'eau nécessaire à la plante là où elle en a besoin. De fait, en participant à ces ateliers, les gens sont interpellés sur la nature en ville et sur le lien entre nature et technique également.
Lorsqu'on organise ensuite un débat sur lien entre nature et ville par exemple, les échanges sont beaucoup fructueux parce que les participants ont touché du doigt des problèmes concrets liés à cette thématique. De fait, on gagne en qualité, cela permet de faire davantage ressortir les contrastes et de les comprendre. Cela donne du relief à ce qui est débattu.
On peut ainsi envisager d'autres thèmes de cette façon comme la bioéthique et traiter de sujets très complexes. Cela éviterait de se retrouver dans des situations où il y a d'un côté ceux qui sont « pour » qui s'empoignent avec ceux qui sont « contre » qui rendent le débat complètement stérile.
Il faudrait pouvoir développer des dispositifs de ce type là mais aussi des conférences comme Auguste Comte, des expositions plus classiques, etc.
Il me semble qu'en effet la multiplicité des formes joue un rôle important. Plus nous sommes capables de proposer des choses diverses et plus nous sommes susceptibles de toucher un public large.
Les attentes des publics sont très diverses. Si certains sont friands de dispositifs comme le DIY, d'autres trouveront plus leur compte avec une exposition. De même sous le terme exposition, on peut mettre plusieurs réalités : une exposition classique avec des panneaux, ou quelque chose de plus interactif, ou encore des fictions, des débats participatifs, etc.
De fait, comment faire en sorte que ce débat existe réellement et que les scientifiques et les industriels y prennent part ?
Dans le Conseil d'Administration du CCSTI de Grenoble, il y a des industriels. Ces questions-là les touchent de plein pied. Pourquoi, tout simplement parce que l'environnement social de l'entreprise est très important. Les industriels ne s'implantent pas dans des milieux hostiles. Par exemple, ST Electronics s’était installé dans un pays en voie de développement où l'environnement n'était pas hostile mais plutôt « ignorant ». Certes, la main d’œuvre était moins chère mais il y avait un énorme décalage entre les produits high-tech produits par l'entreprise et les habitants du pays. Donc il était impossible de former des cadres, des ingénieurs et quand l'usine avait un problème, il était très complexe de trouver une solution rapidement. L'environnement social et culturel pour une entreprise est très important. Les dispositifs « science-société » contribuent aussi à ce que ne se créé pas un fossé entre les habitants d'un pays, d'une région, d'un quartier et les entreprises. Les entrepreneurs en sont bien conscients. Ils ont un intérêt très clair. De plus, s'ils veulent recruter des jeunes, ils ont conscience qu'il faut qu'ils s'implantent dans un lieu éduqué, avec une appétence pour l’innovation, la création, l’expérimentation. Cela explique aussi le « I » de CCSTI.
Pour les scientifiques, on est à peu près dans les mêmes dispositions. La recherche scientifique avance aussi dans un terreau fertile où il y a par ailleurs production et circulation de savoirs. Les scientifiques, même lorsqu'ils sont sur des domaines très fondamentaux, ne peuvent se passer du monde extérieur.