L’égalité : comment la concrétiser ?
Étude
Interview de Robert CASTEL
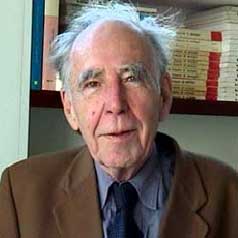
<< Je constate qu’il y a des gens qui décrochent et qui n’ont plus ces moyens minimum pour faire société >>.
Propos recueillis le 9 mai 2012 par Cédric Polère
Philosophe et sociologue, Robert Castel analyse avec rigueur, depuis "Les Métamorphoses de la question sociale, une chronique du salariat" (1995), les liens qui existent entre le travail, ses conditions, la protection sociale, ainsi que les conséquences qui découlent de l’affaiblissement de la société salariale. Il ose ainsi une analyse d’ensemble des mutations de nos sociétés, qui convoque tout à la fois les phénomènes de fragilisation de l’individu, de désaffiliation, la transformation du rapport au risque. Après La montée des incertitudes : "Travail, protections, statut de l’individu" (2009), il a publié "Nous avons quelque chose à vous dire... Paroles des jeunes des quartiers" (2010), puis avec Claude Martin "Changements et pensées du changement" (2012). Dans le cadre de la démarche « Grand Lyon Vision Solidaire » nous l’interrogeons ici pour mieux comprendre comment se transforme le lien entre travail, protection et solidarité, progrès social et progrès économique, et connaître son analyse sur les inégalités.
Dans la manière de relier progrès social et progrès économique, qu'est-ce qui change entre la période des Trente Glorieuses et la période que nous connaissons depuis lors ?
Le compromis social de la fin du capitalisme industriel, qui s’est épanoui dans les années 1960 et au début des années 1970, se caractérisait par une certaine forme d’équilibre : un équilibre entre les intérêts du marché, des entreprises et de l’économie — rappelons que la période qui a suivi la Seconde guerre mondiale a connu un développement économique intense et continu – et les intérêts des travailleurs. Une dynamique ascendante reliait développement économique et progrès social. Durant cette période, des protections et des droits forts — droit à l’indemnisation du chômage, droit à la santé, droit à la retraite… — associés au travail, ont été mis en place, faisant sortir les ouvriers du paupérisme terrible qui caractérisait le début du capitalisme industriel. Cet équilibre n’était pas seulement un compromis soumis à la négociation permanente, il se traduisait en réglementations et en lois, donc en mesures qui relèvent du droit, et dont l’Etat était le garant. Ce compromis était donc sous garantie étatique. De manière concrète, ces droits et protections se cristallisaient pour une bonne part dans ce que les juristes appellent le statut de l’emploi, c’est-à-dire un emploi pratiquement assuré dans sa durée avec la prédominance des CDI, un salaire au moins égal au SMIC indexé sur la croissance, et des conditions encadrées par le droit du travail. Comme tout compromis, il n’était pas totalement satisfaisant, mais il traduisait un relatif équilibre entre des intérêts divergents. Cette situation a prévalu jusqu’au début des années 1970, au moment où l’on a commencé à parler de la « crise ».
Avec la crise, comment la situation se transforme-t-elle ?
Cette crise a d’abord a été sous-estimée, elle a été rattachée à des événements assez conjoncturels comme le renchérissement du prix du pétrole en 1973. De manière progressive néanmoins, nous avons pris conscience de la transformation fondamentale en cours. Avec un peu de recul, nous pouvons dire que nous sommes sortis du capitalisme industriel pour entrer dans un nouveau régime du capitalisme, qui se caractérise par une mise en compétition généralisée au niveau de la planète, qui concerne les individus comme les territoires et les Etats entre eux. C’est ce que nous nommons la mondialisation. Dans cette perspective, les régulations collectives comme le droit du travail, les protections sociales, apparaissent comme des obstacles à la nécessaire mise en mobilité et la recherche de compétitivité. Par analogie avec la « grande transformation » décrite par Karl Polanyi, ce bouleversement qui s’était produit en Europe occidentale au moment de l’implantation du capitalisme industriel, nous pouvons dire que depuis une quarantaine d’années se déroule une grande transformation du même type, de plus en plus placée sous l’hégémonie du capital financier dérégulé. La dynamique de ce changement est économique, alors que ses effets les plus notables sont politiques et sociaux. La mise en concurrence exacerbée produit des gagnants et des perdants, des riches qui deviennent plus riches et des pauvres qui ont tendance à devenir plus pauvres, et le seraient davantage si n’étaient pas maintenus un certain nombre de protections.
Par référence au compromis social trouvé dans les années 1960-1970, existe-t-il aujourd’hui un nouveau compromis, un nouvel équilibre, ou au contraire y aurait-il une absence de compromis, un déséquilibre ?
Nous ne pouvons ni parler de compromis pour caractériser la phase actuelle, ni davantage de nouvel équilibre, il s’agit clairement d’un déséquilibre, d’une déstructuration. J’éviterai néanmoins un discours catastrophiste. Toutes les régulations qui se sont construites à la fin du capitalisme industriel ne sont pas obsolètes. Il existe encore une Sécurité Sociale en France, c’est loin d’être négligeable. Néanmoins, il est incontestable que nous assistons à un affaiblissement, à l’effritement des régulations et des protections existantes dans les sociétés occidentales. C’est une dynamique qui va dans le sens de la décollectivisation, de l’éclatement des collectifs, et contribue à ce que les individus sont de plus en plus renvoyés à eux-mêmes et à leur impuissance. Je crois comme Norbert Elias que nous sommes de plus en plus dans une « société des individus » ; mais le malheur est que tous les individus, loin de là, n’ont pas les capacités minimales et les supports de base pour être des individus à part entière.
Nous serions dans une « société d’individus », mais en même temps, tous les individus n’en seraient pas… Qu’est-ce que cela signifie ?
Je veux dire que pour être des individus au sens sociologique, conduire sa vie, être maître de ses choix, il est indispensable d’avoir une certaine indépendance, et pour cela disposer de supports ou de ressources de bases. Quand on est au RSA, ou que l’on ne sait pas si on aura du travail demain, il ne me semble pas que l’on puisse être positivement un individu. Cela n’a rien à voir avec une incapacité personnelle, c’est une carence des moyens nécessaires pour exister comme un individu à part entière.
Je crois profondément, même si c’est assez banal, que l’individu n’est pas un atome isolé, qu’il ne descend pas du ciel doté de toutes ses capacités d’autonomie. L’individu est une construction sociale et historique. Un individu tout seul, cela ne tient pas debout, l’histoire sociale le montre bien. Pour s’en tenir à l’histoire de la classe ouvrière, les travailleurs ont pu devenir des individus à part entière à partir du moment où ils ont eu des droits, des droits qui dépendaient de leur appartenance à des collectifs, à des collectifs qui les protégeaient, qui leur permettaient de sortir d’un face-à-face avec l’employeur qui les réduisait à l’impuissance.
Faudrait-il revenir sur la valorisation inconditionnelle de l’autonomie individuelle ?
L’autonomie de l’individu est une grande, une magnifique idée, à la base de nos démocraties modernes, énoncée par exemple dans la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Pour autant, malgré cette déclaration, l’ouvrier agricole, le paysan misérable, l’artisan vivant au jour la journée, le prolétaire, n’étaient pas considérés comme des individus autonomes. La réalité de l’autonomie n’était incarnée que par les notables et les propriétaires. Même après l’instauration du suffrage universel masculin en 1848, un prolétaire était peut être un individu politique, il avait le droit de vote, mais socialement il n’était rien. Les transformations sociales qui ont culminé après la Seconde guerre mondiale en Europe ont en quelque sorte rapatrié dans la communauté nationale la masse de ces travailleurs. Durant un moment relativement heureux, les prérogatives complètes de l’individualité ont été largement partagées dans ce qu’on peut appeler une citoyenneté sociale, qui s’est associée à la citoyenneté politique alors qu’elle en était auparavant séparée. Dans la société salariale, une très grande partie de la population jouissait de prérogatives sociales, ce que j’appelle des supports, c’est-à-dire à la fois un minimum de ressources financières, mais aussi de droits pour avoir une certaine indépendance sociale et économique. Depuis lors, ces supports se défaisant, certains individus ne peuvent plus être vraiment des individus. C’est là que la pensée libérale, ou de droite, comporte une part de naïveté, car elle fait comme si on pouvait quand même les traiter comme des individus, ce qui paraît partir d’une bonne intention. Mais en faisant l’impasse sur les conditions nécessaires pour être un individu, elle aboutit à stigmatiser ceux qui ne réunissent pas ces conditions, en les rendant responsables de leur état de déréliction.
Vous avez parlé de collectifs qui se défont : comment cela se manifeste-t-il de manière concrète ?
Dans le monde du travail, considérez une grande entreprise comme Renault. Il y a quarante ans, on y trouvait des collectifs de travail forts, des syndicats qui prenaient en charge les intérêts des travailleurs, des conventions collectives, de la solidarité. Je ne dis pas que c’était un monde merveilleux, il y avait des luttes et des injustices évidemment, mais il y avait des forces collectives en arrière-plan du compromis social que j’ai évoqué. Maintenant, ces grands collectifs ont été cassés, l’entreprise fonctionne par appel à la sous-traitance, elle embauche des intérimaires qu’il est facile de vider, et même les salariés qui font partie du noyau de l’entreprise sont souvent mis en concurrence au sein de petites unités de production ou de recherche… Ces données sociologiques sont établies par de multiples études, comme Retour sur la condition ouvrière (1999) de Michel Pialoux et Stéphane Beaud, à partir d’une enquête dans les usines Peugeot de Sochaux. Une telle analyse pourrait être établie pour de nombreux secteurs de la vie sociale.
Certes, il existe actuellement des contestations, des tentatives de regroupement, des nouveaux collectifs qui portent cette exigence de supports et de solidarité, mais si l’on veut être réaliste, il faut admettre que leur poids est sans aucune mesure avec le poids qu’ont pu avoir les syndicats de salariés. Nous en sommes là, dans une situation guère confortable, où les incertitudes sont nombreuses. L’avenir est incertain, mais cela ne signifie pas que le pire soit certain.
Quel rôle gardent les États en matière de solidarité et de protection sociale ?
Les systèmes de protection ont été construits dans un cadre national. Ce n’est pas un hasard si les politiques sociales les plus ambitieuses se sont élaborées dans certains pays privilégiés à l’échelle de l’économie monde comme la France, la Grande-Bretagne, ou l’Allemagne. Un des effets de l’européanisation et de la mondialisation est une perte de pouvoir de ces Etats. Les dynamiques économiques se déroulent beaucoup moins qu’avant dans un cadre national, ce qui engendre des contrôles nationaux insuffisants sur cette sphère. L’Etat social a perdu une partie de son pouvoir, mais en même temps, nous ne voyons pas apparaître d’alternatives convaincantes à d’autres échelles. C’est une des immenses difficultés actuelles. En dépit de quelques réalisations, on ne peut pas parler aujourd’hui d’une Europe sociale, au sens fort du mot ; à l’échelle mondiale, une instance comme le Bureau International du Travail a un pouvoir extrêmement faible au regard des dynamiques économiques. En l’absence de passage de relais, nous sommes obligés de penser qu’il ne faut pas enterrer trop vite les Etats nations. Nous devons reconnaître qu’en France par exemple, c’est encore au niveau national que se prennent les décisions essentielles qui concernent les politiques sociales et les équilibres du marché, nous en avons eu une dernière illustration avec le conflit sur les retraites. Les débats de ce type, extrêmement importants, ont encore lieu dans un cadre national, même si ce cadre n’est plus l’échelle la plus souhaitable pour apporter les réponses.
En matière d’inégalités, vous avez pu dire que leur creusement n’est pas l’essentiel…
Je pense que la question du creusement des inégalités est importante, mais qu’elle ne constitue pas le seul problème. Vous avez parlé des « Trente Glorieuses ». Durant cette période d’incontestables progrès économiques et sociaux, les inégalités n’ont presque pas bougé, la proportion par exemple entre le salaire d’un cadre et celui d’un ouvrier est restée presque inchangée. Pour autant, elles étaient moins tragiquement vécues qu’aujourd’hui parce qu’elles n’étaient pas figées, et parce que nous assistions à une amélioration du sort de tous. Comme le disait le secrétaire général de Force Ouvrière, André Bergeron, il y avait du « grain à moudre ». Les partenaires sociaux étaient engagés dans des négociations collectives sur le partage des bénéfices de la croissance. Demain devait être meilleur qu’aujourd’hui, c’était à la fois une réalité, et une croyance à un mieux-être situé dans le futur, qui signifiait que l’on paraissait assuré de son avenir. Pour cette période, j’ai proposé de parler de « gestion régulée des inégalités » : les situations des groupes et des personnes étaient échelonnées selon un continuum de positions, ce qui permettait de comparer les positions et de poser la question des inégalités, rien à voir avec la situation du maître et du prolétaire au début de l’ère industrielle, où les conditions étaient non pas inégales, mais incommensurables. Le fait que soit posée la question des inégalités a attesté de la victoire des orientations réformistes, consistant à améliorer le sort des travailleurs, sur l’option révolutionnaire de l’affrontement des classes sociales antagonistes. Mais le point sur lequel j’insiste, c’est que tout le monde ou presque avait fini par disposer des protections de base pour faire partie de la société, pour être inséré dans le circuit des échanges sociaux, même s’il existait de grandes disparités entre les catégories de travailleurs.
Pouvez-vous prendre un exemple ?
Un ouvrier qui prenait sa retraite avait certes une petite retraite, bien inférieure à celle d’un cadre, mais il avait un droit à la retraite, et des conditions de base pour continuer à faire partie de la société, notamment une indépendance minimum, économique et sociale. J’ai parlé de cette société salariale comme un « continuum différencié de positions », parce que malgré les grandes différences et inégalités liées à la stratification sociale, la société salariale formait un ensemble, et surtout, donnait lieu à des protections communes à tous. De ce point de vue, il me semble que le droit à la retraite exemplifie ce caractère de solidarité propre à ce type de société, qui rappelle d’ailleurs ce que Emile Durkheim appelle la « solidarité organique ». Dans un corps, les membres ne sont pas identiques, mais ils font partie d’un même ensemble. Il y a interdépendance entre tous les membres de la société, comme il y a interdépendance entre les parties du corps humain. C’est cela qui avait été approximativement réalisé. Il restait des groupes marginalisés, le « quart-monde », mais on pensait qu’il allait se résorber. Bref, tout le monde ou presque avait le moyen de faire société.
Aujourd’hui, je constate qu’il y a des gens qui décrochent et qui n’ont plus ces moyens minimum pour faire société. Cela concerne le bas de l’échelle sociale, mais aussi le haut. On peut se demander si par exemple certains patrons de multinationales ou certains joueurs de football font partie de notre monde. En tout cas, ils ne sont plus inscrits dans ce continuum différencié de position que j’évoquais tout à l’heure. En termes de solidarité, de cohésion sociale, c’est extrêmement grave.
Les territoires sont-ils simplement les espaces où s’inscrivent les inégalités, ou quelque chose de nouveau se joue dans les inégalités territoriales ?
C’est une très grande question, il est difficile d’y répondre en quelques mots. Il y a bien une spécificité des questions territoriales et à juste titre, cette spécificité est de plus en plus reconnue et analysée pour elle-même. On a souvent eu tendance à penser la question des inégalités principalement à partir du travail et des disparités dans l’ordre du travail. Mais ces inégalités s’inscrivent sur un territoire et elles sont vécues au moins autant sur ce plan que dans les espaces de travail, ceci d’autant plus qu’un nombre croissant d’habitants n’ont pas accès au travail. Ils vivent leur condition à partir de leur ancrage territorial, plutôt que comme une condition de travailleur.
Pour autant, il me paraît erroné d’opposer les questions territoriales et les questions du travail, ou de dire, comme le font certains, que « la question urbaine » aurait remplacé « la question sociale ». C’est plutôt d’un glissement qu’il s’agit, qui renvoie à la crise contemporaine du travail. Les inégalités territoriales m’apparaissent comme une cristallisation et parfois une dramatisation du dysfonctionnement des formes d’intégration qu’assurait le travail. On peut aussi y voir l’actualisation d’une question sociale qui a commencé à se poser dans l’ordre du travail, y compris à partir de son absence (chômage) ou de la prolifération de ses formes dégradées (précarité). Il y a bien du « nouveau » qui se déploie sur le territoire, cette nouveauté pourrait être la projection ou la traduction spatiale des nouveaux paramètres de la question sociale. Mais tout ceci serait bien entendu à approfondir, à nuancer et à discuter.
Le débat n'a jamais été aussi vif sur les contreparties à attendre en échange du bénéfice de la solidarité collective, avec par exemple le projet gouvernemental de plusieurs heures par semaine de travail social à réaliser par les bénéficiaires du RSA... Comment l'interpréter ?
L’affirmation d’un droit au secours est une fort belle idée, qui avait été énoncée par la Convention et que la Troisième République a ensuite reprise. Quelle que soit sa condition, chaque membre de la nation a le droit d’être traité comme un citoyen. Cette idée va de pair avec une certaine inconditionnalité de l’aide sociale, de l’assistance, de la protection : les malheureux ont un droit indiscutable à être secourus. Depuis une quarantaine d’année, la dynamique de mise en concurrence de tous contre tous nous a éloigné de cette idée, et a renforcé simultanément l’idée que non seulement il y a des gagnants et des perdants, mais que les perdants le sont par leur faute : n’ayant pas assez fait pour éviter la situation médiocre dans laquelle ils se trouvent, ils sont responsables de leur sort, d’où par exemple l’expression « chômeur volontaire » que je trouve assez obscène. En 1970, il y avait environ 350 000 chômeurs en France, aujourd’hui on en compte au moins trois millions, est-ce à dire qu’il y aurait 2,7 millions de feignants de plus en France ? Le pouvoir politique a fait beaucoup pour cette stigmatisation des perdants, parlant d’assistés vivant au dépend de la France qui se lève tôt, pour citer notre ancien président de la République. Malheureusement, ces idées, y compris le racisme et la xénophobie qui peuvent les accompagner, ont aussi une assise populaire. Dans cette situation de mise en concurrence de tous contre tous, celui qui paraît être l’ennemi, le concurrent, c’est le voisin, surtout s’il est d’origine immigrée.
Cette insistance sur les contreparties indique-t-elle que l’on quitte le modèle d’une solidarité inconditionnelle ?
En tout cas cette insistance est dans la logique du néolibéralisme, qui a imposé une représentation du monde assez dominante, où le rôle de l’Etat devient celui d’armer les individus pour faire face à la concurrence. A ceux qui n’en sont pas capables, tant pis pour eux, on leur attribuera une médiocre allocation de subsistance, tout en essayant de la leur faire payer. La mesure sur le RSA est symptomatique de cette évolution. Comme si un RSA de 475 euros par mois pour une personne seule était un privilège exorbitant qu’il faudrait faire payer par des travaux forcés, en vous faisant bien sentir que vous n’appartenez pas au régime commun.
Le modèle assurantiel reste-t-il le noyau de notre protection sociale ?
En France, comme en Allemagne et dans d’autre pays, l’essentiel de notre système de protection a été un système assurantiel, financé surtout par des cotisations salariales et patronales. François Ewald dans son livre L’Etat providence (1986) a parlé de « société assurantielle ». Aujourd’hui, ce modèle est en crise à cause de la dégradation des situations de travail : chômage de masse, précarisation, ce qui engendre une crise financière en même temps qu’une crise de légitimité, alors que des voix s’élèvent pour critiquer le fait qu’une minorité de travailleurs et de patrons devrait cotiser pour une majorité d’inactifs, chômeurs et retraités, d’autant que la durée de vie s’allonge. Avec cette crise, les formes de protection se transforment, les individus sont renvoyés à des formes inférieures de secours, en tout cas inférieures aux assurances tirées du travail. Les protections tendent à devenir conditionnelles, délivrées sous conditions de ressources.
Il me semble que pour financer un système de protection assez fort, nous ne pouvons plus nous restreindre aux seules cotisations salariales et patronales. Il faudra en passer par l’impôt notamment. Cette évolution est enclenchée, puisque Michel Rocard a créé la CSG, qui couvre aujourd’hui une grande partie des dépenses de santé.
Vous avez pu affirmer que le développement économique et l’exigence sociale ne sont pas nécessairement antagonistes, et que le capitalisme n’a pas intérêt à avoir des individus corvéables à merci. Pourquoi ?
Si nous laissons les dynamiques économiques à elles-mêmes, nous risquons d’aller dans le mur, comme l’illustre l’état de la crise actuelle ou la situation de la Grèce. Il convient donc de domestiquer le marché, de l’encadrer par des régulations, ce qui relève de la politique et de l’Etat, de lois, de règles. Mais il est peut-être possible aussi de s’appuyer sur le capitalisme lui-même, dont certains fonctionnements n’ont pas cette dimension impitoyable de la recherche du profit pour le profit. Par exemple un chef d’entreprise intelligent peut comprendre, surtout s’il ne dépend pas trop exclusivement de ses actionnaires, l’intérêt de maintenir une culture d’entreprise pour que ses salariés soient compétitifs. De tels salariés ne peuvent pas être ce qu’ils devraient être au nom même des exigences du capitalisme — autonomes, responsables, porteurs d’initiatives, polyvalents, capables de s’adapter aux changements… — s’ils n’ont pas un minimum de sécurité et de protection, et s’ils sont traités comme des travailleurs jetables. Il pourrait y avoir ainsi une forme de recomposition des termes du compromis social, y compris au sein de l’entreprise.
Ce que l’on appelait la « flexisécurité » par référence au modèle danois, ou encore les parcours professionnels sécurisés sont-ils un des éléments de la réponse ?
Il me semble qu’un des grands défis, sinon le défi essentiel que nous avons à surmonter est de trouver une conciliation entre la mobilité et l’existence de droits qui apportent une sécurité. La mise en mobilité du monde du travail est une donnée importante, sans doute irréversible. Le monde du travail est et sera de plus en plus mobile, fait de moments de transition, de passage d’un emploi à un autre. Mais pour que ces changements ne se traduisent pas par la déclaration d’« inemployabilité » des travailleurs qui ne peuvent pas suivre ce mouvement, il est indispensable que soient associés de nouveaux droits à cette situation de mobilité. J’aime bien la formule d’Alain Supiot, « donner un statut aux travailleurs mobiles », elle illustre très bien cette exigence. Ces droits seraient une des formes du nouveau compromis qui permettrait de surmonter la précarisation, cette calamité qui reconfigure actuellement le monde du travail. Les individus ne seraient plus stables au sens où ils occuperaient à vie un statut immuable de l’emploi : ils passeraient par des périodes de transition, de recyclage, de formation, mais au lieu que ce soit dans l’incertitude du lendemain et la précarité, ils conserveraient des droits. Quand la CGT parle de « Sécurité Sociale professionnelle » ou la CFDT de « sécurisation des trajectoires professionnelles », c’est avec des nuances une solution de ce type qui se cherche. Mais elle s’inscrit dans des rapports de force qui ne sont pas nécessairement favorables. Ainsi le MEDEF est contre de telles solutions, puisque moins il y a de droits et plus il y a de flexibilité, mieux cela vaut pour le patronat.
Je ne crois pas que l’on puisse maintenir le statu quo en termes de protections, de garanties, de droits, alors que le contexte s’est profondément renouvelé. Il faudra établir un nouveau compromis, si on veut l’appeler ainsi, en redéployant les droits sociaux tout en tenant compte de la situation actuelle. Il n’est pas exclu, on peut même l’espérer, voire même en entrevoir des indices, qu’un nouveau compromis se mette en place, qui serait le nouveau compromis de ce capitalisme mondialisé.
Le travail est-il une valeur d’avenir, et une valeur centrale en matière de cohésion sociale ? Certains font valoir qu’il est devenu périphérique, que de plus en plus de choses — intégration sociale, engagement, construction du sens de l’existence… — se jouent en dehors du travail…
Il y a une confusion très souvent faite entre l’importance du travail et la consistance du travail. Il est incontestable que dans nos sociétés, en raison de sa précarité et de l’importance du chômage, le travail a perdu beaucoup de sa consistance. Mais cela ne signifie pas du tout qu’il ait perdu de son importance pour les gens, on pourrait même penser à certains égard le contraire. Les enquêtes sociologiques montrent que le chômeur et le précaire sont bien plus préoccupés, voire obsédés par la question du travail, que celui qui est assuré d’un emploi stable. Cette distinction étant rarement établie, on entend des bêtises sur la fin du travail. Mais partout dans le monde, en Europe comme en Chine, la plupart des gens dépendent de leur travail, il n’y a pas eu d’alternative globale à cette réalité-là. Cependant il me faut ajouter une précision essentielle, surtout quand j’entend la défense du travail qu’a illustré notre ancien président de la République, associée à la condamnation des « assistés » : il y a travail et travail. Je crois que le travail mérite d’être défendu, affirmé comme une valeur qui continue d’être fondamentale, mais pas n’importe quel travail, pas le travail dans n’importe quelles conditions, pas la précarité et les petits boulots. Les protections et les droits doivent s’adapter aux formes nouvelles du travail, mais sans valider certaines de ses formes actuelles qui n’assurent pas la dignité des travailleurs.
Faut-il alors repenser le travail, réactualiser notre pensée du travail ?
Oui, y compris dans sa relation au salariat. Historiquement, c’est autour du travail salarié que se sont constituées les protections les plus fortes — ce n’est pas pour rien que l’on parle de « société salariale » —, quitte à ce qu’elles se diffusent ensuite plus largement. Contrairement à ce que l’on peut penser, le salariat reste hyper majoritaire : en France, près de 90% de la population active est salariée. Il est possible que dans l’avenir, comme l’indique le parcours d’autres pays, des organisations différentes du travail se développent. D’où certaines apologies du travail indépendant, où l’on serait son propre maître, en oubliant que l’on peut être complètement instrumentalisé par un donneur d’ordre, et passer soixante-dix heures devant son ordinateur par semaine ! Tout un ensemble de nouvelles questions vont se poser en fonction des transformations encore à venir dans l’organisation du travail, mais elles ne remettent pas en question la nécessité d’associer des protections fortes au travail quel qu’il soit.
En dehors du travail proprement dit, quelles seraient les valeurs d’avenir ?
Je me méfie du prophétisme. Il est toujours possible de dessiner des utopies, mais ce qui nous manque aujourd’hui, c’est le socle sur lequel les asseoir. Je dirais qu’il faudrait travailler à reconstruire ce que Léon Bourgeois appelait une « société de semblables ». On pourrait penser que c’est horriblement ringard parce qu’il en a parlé à la fin du 19ème siècle, mais je pense que cela continue à être une assez bonne traduction sociologique de ce qu’en termes politiques on appelle une démocratie. Nous pourrions nous atteler à reconstruire cet idéal d’une société de semblables, dans un monde plus différencié, plus mobile, en nous demandant ce qu’il faut pour y parvenir. A mon sens, il faudrait que tous les citoyens aient par exemple une sécurité sociale minimale garantie, un socle de droits de base du côté de la santé, de l’éducation, de la retraite, de la formation permanente, du logement… , sans doute une dizaine de droits qui garantissent aux individus ce socle nécessaire pour être en interaction avec leurs semblables.
Ce socle de droits semble être autre chose qu’un revenu d’existence…
Oui, parce que contre un tel revenu qui ne serait qu’un médiocre revenu de subsistance, je parle de droits, c’est très différent ! Si l’Etat attribue à tous une allocation universelle, ou un revenu de citoyenneté, qui sera très réduit, il ne permettra pas d’être un citoyen à part entière. Je suis résolument contre, car ce serait une façon de botter en touche, en accordant à chacun de quoi ne pas crever de faim. Mais comme ce sera insuffisant, l’allocataire sera obligé de chercher du travail et d’accepter n’importe quel boulot. A mon sens, cela contribuerait à institutionnaliser la précarité, à moins, ce qui est complètement irréaliste, que ce revenu soit un revenu minimum suffisant, au niveau du SMIC par exemple. C’est la raison pour laquelle je plaide plutôt pour une sécurité sociale minimale garantie qui procurerait des ressources de base à partir de la reconnaissance de droits.
Vous parlez de la solidarité comme interdépendance des parties d’un même corps social : or, reconnaître cette interdépendance va à l’encontre d’une tendance de fond, portée par l’individualisme, celle de l’individu libre de ses choix, libre des liens qu’il tisse, voire même, libre de se sentir un semblable d’autrui…
Dans la modernité tardive, il y a une chose étonnante pour une personne de ma génération : la complaisance à l’individu sans s’interroger sur les exigences que cela implique. Je disais, et c’est sincère, qu’être un individu est une valeur suprême, mais cela ne signifie pas que l’individu doive être une sorte de souverain isolé, qui refuse l’interdépendance. Méfions-nous de la tentation d’enfermement dans la souveraineté de l’individu. L’individu est un sujet social, il est interdépendant et mieux vaut qu’il le sache et l’admette.
Je reconnais que cela pose un problème difficile, car de plus en plus, les jeunes en particulier revendiquent comme une valeur en soi le fait d’être un individu, sans ajouter ou sans savoir que cela exige une participation et des supports qui ne sont pas des supports individuels, par exemple des droits. Un droit, c’est le contraire de l’individuel, c’est une construction collective, mais cela me paraît essentiel pour structurer l’individu, même dans ce qu’il a de plus individuel.
Récemment, la direction de la prospective du Grand Lyon a réalisé des entretiens sur la question de la solidarité : le philosophe Patrick Viveret estime que toute solidarité imposée socialement finit par être en danger, contrairement à la solidarité choisie dont il fait l’apologie ; le sociologue Jacques Ion fait référence à vos travaux en s’exclamant « vive la désaffiliation ! » et se félicite que les solidarités soient moins contraintes, enfermantes qu’autrefois, mais liées à un engagement volontaire d’individus autonomes. Etes-vous d’accord avec ces analyses qui valorisent la solidarité choisie, par contraste avec la solidarité contrainte ?
C’est vrai qu’il existe des familles de pensée différentes, même au sein de la gauche. A dire vrai, je me méfie de ces discours et assume mon désaccord avec Patrick Viveret ainsi qu’avec les sociologues qui sous-estiment le poids des contraintes. C’est facile de célébrer la liberté, mais il faut avoir le réalisme de penser que la contrainte et les droits sont nécessaires. Il faudra toujours que je paie mes impôts, mais il n’est pas nécessaire que je sois content de le faire. Dès lors que je le fais, je suis objectivement solidaire, c’est l’essentiel, et je contribue ainsi à construire une société solidaire, ce que je ne ferais pas nécessairement si on me laissait choisir.

Les métiers du prendre soin souffrent d'un fort turnover. Pourtant, les facteurs d'engagement dans ces métiers très humains ne manquent pas. Alors, que se passe-t-il ?
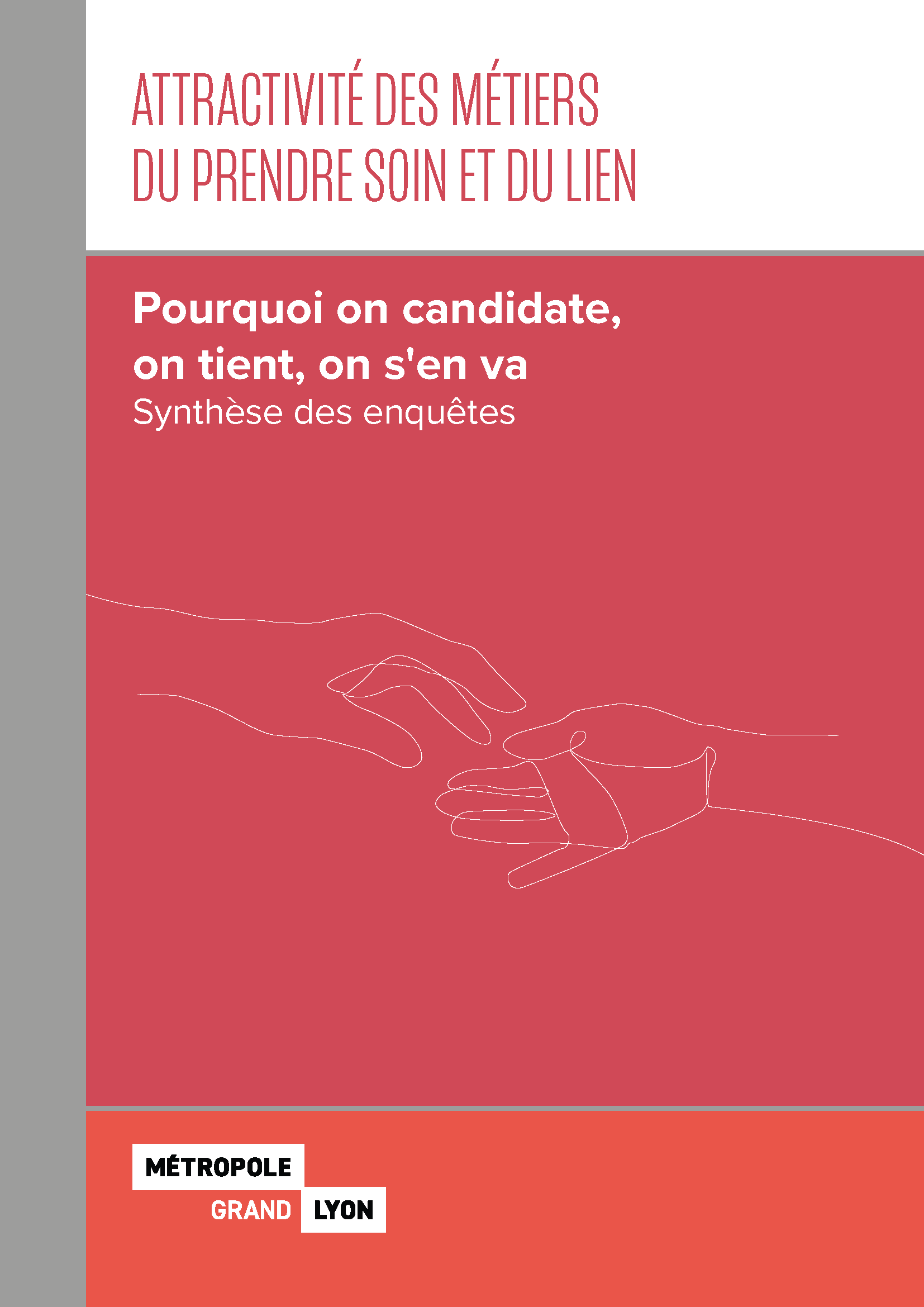
Étude
Comment expliquer le manque d'attractivité des métiers du prendre soin ? pourquoi on candidate, on tient, on s’en va ? Retrouvez la synthèse des enseignements des différentes enquêtes conduites sur ces questions.

Étude
Ce rapport détaille les enseignements issus de l’étude, à travers une analyse des représentations sociales du sport, et des orientations pour la conception de terrains sportifs de plein air en libre accès.

Étude
La demande en matière de sports de plein air en accès libre augmente. Pourtant, il n’est pas facile de trouver des endroits propices à ces activités, notamment pour les femmes. Ce cahier d’inspiration entend donner des clefs aux porteurs de projets.

Article
Cheminer vers la sobriété : L’altruisme est-il le balancier nécessaire à cette démarche de funambule ? « Pas si simple », répond la mathématicienne Ariadna Fossas Tenas

Article
En 2022, la loi bioéthique ouvrait le don du sang aux homosexuels dans les mêmes conditions aux hétérosexuels. En matière de sentiment d’appartenance à une catégorie sociale, que nous apprennent les controverses qui ont abouti à cette évolution ?

Interview de Elies Ben Azib
Directeur du Centre social La Garde à Marseille
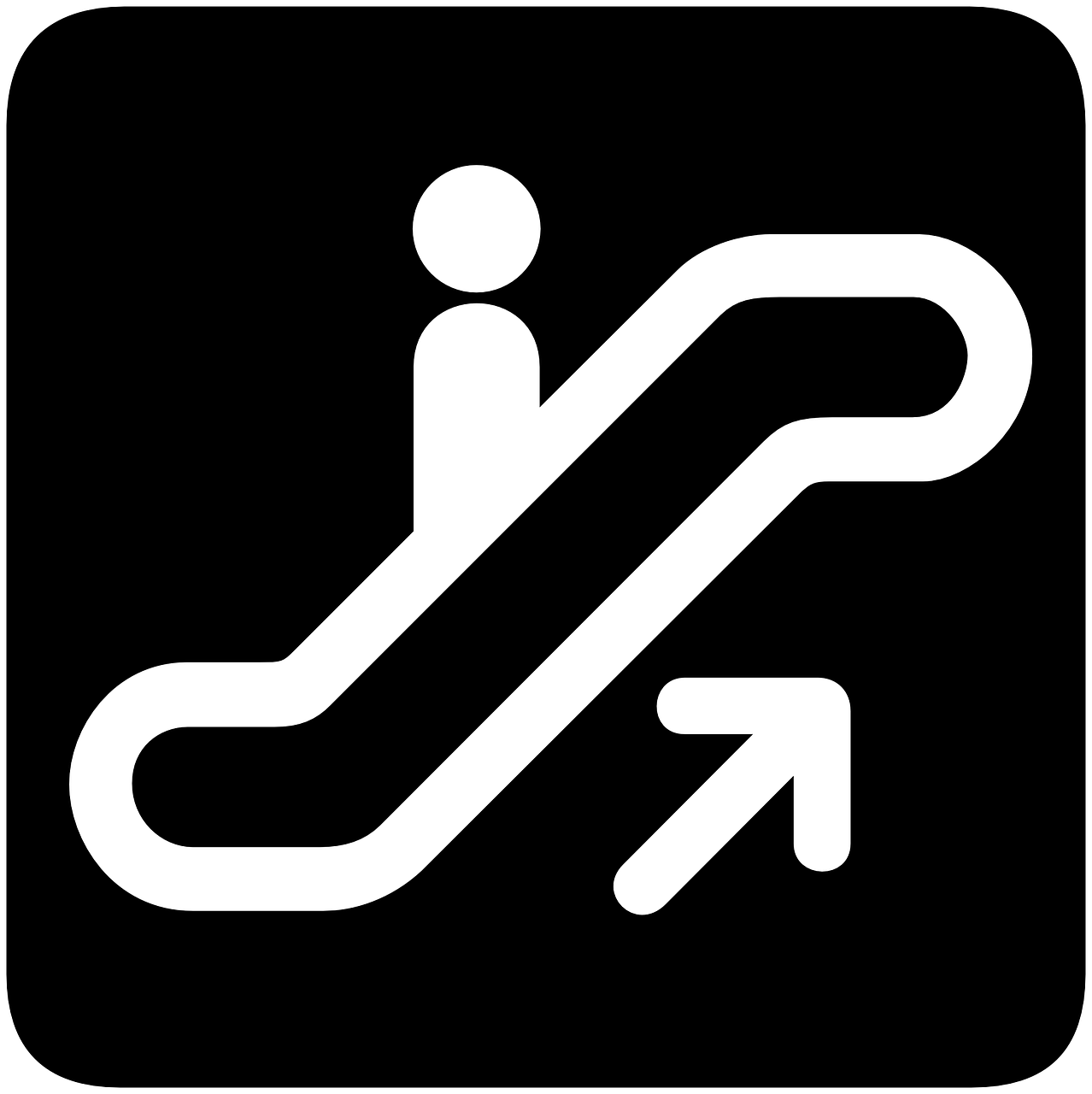
Texte d'Emmanuelle Santelli
Dans le cadre d’une étude effectuée par le Groupe de Recherche sur la Socialisation, (UMR 5040 CNRS, Lyon II), Emmanuelle Santelli étudie les parcours des populations d’origine maghrébine dans une perspective intergénérationnelle : comment se construisent les trajectoires professionnelles en référence aux parcours des parents.
Ce texte s’appuie sur une enquête effectuée sur les descendants d’immigrés algériens qui ont eu des parcours réussis.