Veille M3 / « Mangerons-nous encore ensemble demain ? »
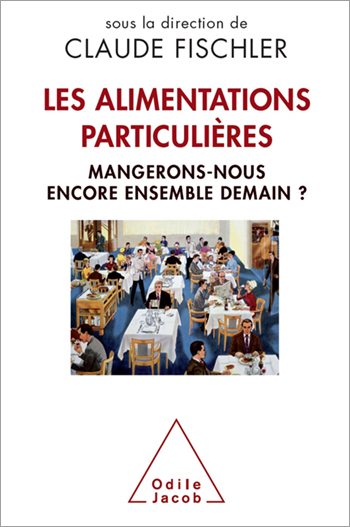
Article
Alors que les particularismes alimentaires se multiplient, peut-on perdre le goût des autres ?
Interview de Philippe VIDELIER

<< 80 % des Arméniens de Décines en 1931 avaient plus de dix ans au moment du génocide, c'est-à-dire qu'ils l'avaient présent en eux, et il leur fallait reconstruire une existence dans un milieu qui leur était étranger >>.
Philippe Videlier est historien, chercheur au CNRS et auteur du livre Décines, une ville des vies, éditions Paroles d’Aube.
Propos recueillis par Stéphane Autran, le 12 avril 2012.
Vos travaux ont montré que les communes de la banlieue lyonnaise doivent une large part de leur développement à l’immigration dans le contexte de la seconde révolution industrielle. Est-ce le cas à Décines ? Et quels éléments la rapprochent ou la distinguent d’autres villes ?
Le développement contemporain de Décines s’inscrit dans une dynamique d’agglomération, avant même que n’existe la notion d’agglomération telle que nous la connaissons aujourd’hui. Il est en quelque sorte le résultat de ce que les économistes appellent « la main invisible » : des nécessités, des choix ou des contraintes économiques couplées à des hasards, heureux ou malheureux, de l’histoire.
Lyon a longtemps ignoré sa périphérie, à l’exception de Villeurbanne qui, dès les années 1930, s’est dotée d’une identité forte avec les Gratte-Ciel et qui pesait déjà d’un grand poids. La couronne industrielle s’est plutôt développée dans l’indifférence ou la méfiance de la ville centre, comme effet d’une division sociale de l’espace extrêmement tranchée. L’Est lyonnais a été entraîné dans le mouvement industriel puissant du vingtième siècle et s’est métamorphosé d’un coup, entre la guerre de 1914 et les années vingt. C’est le cas de Vénissieux, Vaulx-en-Velin ou Décines. La métallurgie, la chimie, le textile artificiel nécessitaient une main d’œuvre nombreuse, que la population locale ne pouvait fournir.
C’est pourquoi l’immigration étrangère s’est imposée comme une composante majeure de ces secteurs en mutation. Vénissieux, par exemple, un bourg de moins de cinq mille habitants avant 1914, atteint une population de huit mille à la fin de la guerre, du fait de l’installation d’un arsenal (l’Atelier de Chargement, qui explose en 1918, causant d’immenses dégâts) et des usines Berliet ultramodernes, créées pour la production à la chaîne de camions et de chars. L’essor industriel va se poursuivre dans les années vingt et c’est ainsi que les cités de l’Est lyonnais, ont conquis dans l’agglomération la place qui a été la leur jusqu’à la grande crise de désindustrialisation.
Dans le quart de siècle qui précède la Seconde Guerre mondiale la croissance de l’Est lyonnais est impressionnante. Alors que Lyon progresse d’un peu moins de 9 %, Villeurbanne croît de 91 %, Vénissieux de 233 %, Vaulx-en-Velin de 462 %. Bien sûr, il s’agit d’un côté d’une ville-masse à l’évolution lente, et de l’autre des bourgades projetées brutalement dans une modernité inattendue. Penser qu’en deux décennies Vénissieux passe de moins de cinq mille à seize mille habitants (1911-1931), penser qu’en une seule décennie Décines bondit de mille cinq cents à sept mille habitants (1921-1931) donne une idée de la brutalité du changement, du choc que cela signifiait pour la population sédentaire et du choc que cela signifiait aussi pour la population migrante.
Alors que les étrangers ne forment que 6 % de la population « vénitienne » (comme on disait alors) en 1911, ils sont 44 % en 1931, près de la moitié. A Vaulx-en-Velin, 48 %. Et à Décines 55 % en 1931, plus de la moitié de la population. La banlieue s’est donc affirmée comme un territoire en mouvement, modelé et structuré par l’industrie, dépendante du marché du travail. Le processus d’industrialisation, au profit de l’agglomération, a été pour ainsi dire analogue dans l’ensemble des communes concernées : installation d’usines géantes faisant affluer des populations.
Mais pour chaque commune, la situation était spécifique, et là entrait la part du hasard. Ainsi à Vénissieux, les étrangers de l’entre-deux guerres étaient-ils essentiellement Espagnols et Italiens, des gens venus de régions particulières pour des motifs que l’on dirait aujourd’hui « économiques » : les provinces de Murcia et d’Almeria, régions minières entrées en crise sérieuse avec la guerre de 1914, la région de Frosinone au sud de Rome dont l’agriculture peinait à nourrir la population. Alors qu’à Décines ont afflué les Arméniens rescapés du génocide de 1915-1917, c’est-à-dire d’un traumatisme historique. On peut reconstituer les processus par lesquels telle population arrive et se fixe dans tel endroit. C’est là le travail de l’historien et une recherche passionnante.
Mais dispose-t-on de sources suffisantes et fiables pour construire une histoire de l’immigration ?
En réalité, de très nombreuses sources, d’une grande variété, permettent la reconstitution d’une histoire des populations : tout d’abord, ce qui concerne l’état civil, conservé par les communes, les registres des naissances, des mariages, des décès, qui gardent trace de chaque individu ; les registres de recensement aussi, qui autrefois consignaient avec précision et régularité, tout les cinq ans, l’ensemble de la population sur des listes nominatives, par rue, par famille, avec indication d’âge, d’origine, de nationalité, de profession (cela ne se pratique malheureusement plus et les historiens du futur le regretteront amèrement).
Il y a aussi ce que l’on appelle la documentation « qualitative » : correspondance entre administrations, enquêtes de la préfecture, rapports de police, procès-verbaux municipaux, échanges de toutes sortes entre la mairie ou le département et les citoyens, les entreprises, les associations. Cela est très précieux et livre une abondance de données par lesquelles on peut découvrir le passé le plus oublié.
Et puis il y a les récits de vie des plus anciens qui apportent un éclairage essentiel, irremplaçable par leur caractère singulier, concret, et qui rapprochent l’historien de l’ethnologue. Bien sûr, à la différence des documents écrits, ces archives de la mémoire nous échappent souvent faute d’avoir été recueillies à temps. C’est pourquoi on ne peut que se féliciter de toutes les initiatives prises en ce sens. Lorsqu’il a pu être conservé, le récit de vie devient lui-même matériau d’archives, destiné à être confronté à d’autres sources, analysé, réintégré dans un corpus plus large permettant une compréhension d’une histoire non plus individuelle, mais collective et partageable.
Décines a parfois été appelée la « Petite Arménie », cela est-il fondé ?
Décines ne serait pas Décines si un consortium, « une combinaison d’intérêts et de compétences », ainsi qu’il se présentait, lyonnais, hollandais, suisse, n’avait décidé d’implanter en ce lieu, bourgade rattachée alors au département de l’Isère, sur la frontière de l’agglomération, une grande usine de soie artificielle, comme on disait à l’époque, et de faire appel à une main d’œuvre sans attaches ni traditions, qui ne soit pas « contaminée par les quartiers ouvriers de la ville », selon l’expression crue des promoteurs. Par des intermédiaires, ils allèrent donc chercher leurs ouvriers dans les camps de réfugiés de Grèce, des gens dans le malheur et la précarité.
La Société Lyonnaise de Soie Artificielle (SLSA, devenue ensuite SLT, Société Lyonnaise de Textiles) fournissait tout : les contrats, le travail et pour les plus chanceux, à l’arrivée, le logement dans des cités ouvrières. En échange, l’entreprise disposait de salariés qui lui étaient attachés. On comptait ainsi en 1931, date du recensement, plus de mille cinq cents Arméniens à Décines, la quasi-totalité habitant le quartier dit de « la Soie », c’est-à-dire des alentours de l’usine, vers le canal de Jonage. Plus du tiers des habitants du quartier à cette époque étaient Arméniens.
Par force, ces immigrés occupaient des emplois d’ouvriers (à 95 %). Ils constituaient une société en rupture totale avec leur vie antérieure, la vie d’avant la catastrophe, qu’ils avaient vécu dans leur chair : 80 % des Arméniens de Décines en 1931 avaient plus de dix ans au moment du génocide, c’est-à-dire qu’ils l’avaient présent en eux, et il leur fallait reconstruire une existence dans un milieu qui leur était étranger, par la langue et les mœurs, par l’histoire et la géographie. Pour cette raison, pendant tout un temps, la mémoire du génocide fut ensevelie dans les consciences individuelles. Pour beaucoup, la transmission passa au-dessus d’une génération. Il existe à Décines, place de la Libération, un monument « en mémoire des 1 500 000 Arméniens massacrés lors du génocide de 1915 », œuvre du sculpteur lyonnais René Damas. La première pierre a été posée le 24 avril 1965, c’est-à-dire un demi-siècle après les événements. Tout ce temps, donc, s’était écoulé avant que la mémoire ne s’exprime.
Pour quelles raisons la reconnaissance du génocide de 1915 est-elle devenue une question d’actualité très forte ?
La reconnaissance du génocide, bientôt cent ans après les faits, n’est pas essentiellement une question d’identité, c’est lutôt revendication de justice, la revendication que n’importe quelle victime d’un crime est en droit d’attendre dans une société civilisée. Mais là, il s’agit d’un crime de masse, imprescriptible, commis par un Etat qui n’existe plus : l’empire Ottoman, et un régime disparu : le gouvernement appelé à l’époque « Jeune-Turc », du parti dit « Union et Progrès », bien qu’il représentât les forces les plus régressives et ait conduit le pays à sa perte.
Malheureusement l’Etat Turc actuel nie le caractère criminel de cette période afin de forger une représentation illusoire de son histoire. Pour beaucoup de nos contemporains, cette attitude est incompréhensible, puisqu’elle ravive en permanence la douleur des victimes et maintient la Turquie dans un océan d’ignorance, empêchant l’apurement du passé et créant un imbroglio diplomatique dont elle ne peut se dépêtrer.
Imagine-t-on un instant l’Allemagne niant la réalité du génocide perpétré par les nazis et menaçant quiconque veut rappeler l’Histoire ? Evidemment une telle chose est impensable et, précisément, l’Europe n’aurait pas pu se bâtir sans un rapport commun au passé. L’attitude irrationnelle de la Turquie trouve une explication dans sa propre société : le fait que ce pays soit passé de l’Empire ottoman autocratique à un régime de dictature nationaliste dont les séquelles perdurent encore. De ce point de vue, la reconnaissance du génocide arménien est aussi importante pour l’avenir de la Turquie qu’elle l’est pour les générations arméniennes présentes.
La République française, en votant une loi de reconnaissance du génocide, a simplement fait sienne une part d’histoire de ses compatriotes dont les aïeux, quatre générations en arrière, sont arrivés de contrées dévastées et ont apporté leur contribution à notre nation. Rappelons que le premier Décinois mort au champ d’honneur dans la guerre de 1940 s’appelait Garabed Derboghossian, tué le 16 juin 1940 et décoré à titre posthume de la Médaille militaire et de la Croix de Guerre. Il habitait à Décines la rue Nansen, honorant le nom du Haut-Commissaire aux Réfugiés de la Société des Nations qui fournit un passeport aux apatrides. Et le nom de Garabed Derboghossian est gravé désormais sur le monument : « Décines-Charpieu, à ses enfants morts à la guerre ».
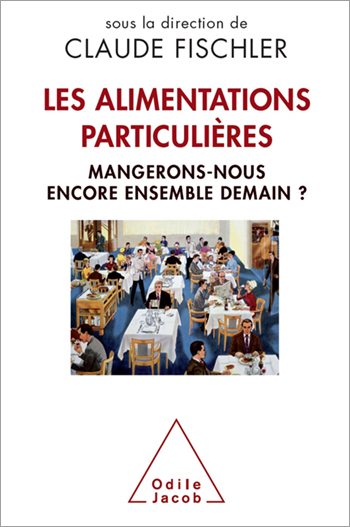
Article
Alors que les particularismes alimentaires se multiplient, peut-on perdre le goût des autres ?

Étude
Les femmes migrantes et/ou racisées sont surreprésentées dans les emplois du prendre soin les moins valorisés. Est-ce le signe que ces métiers sont attractifs pour ces personnes ou faut-il y voir l’effet de dynamiques structurelles d’assignation ?
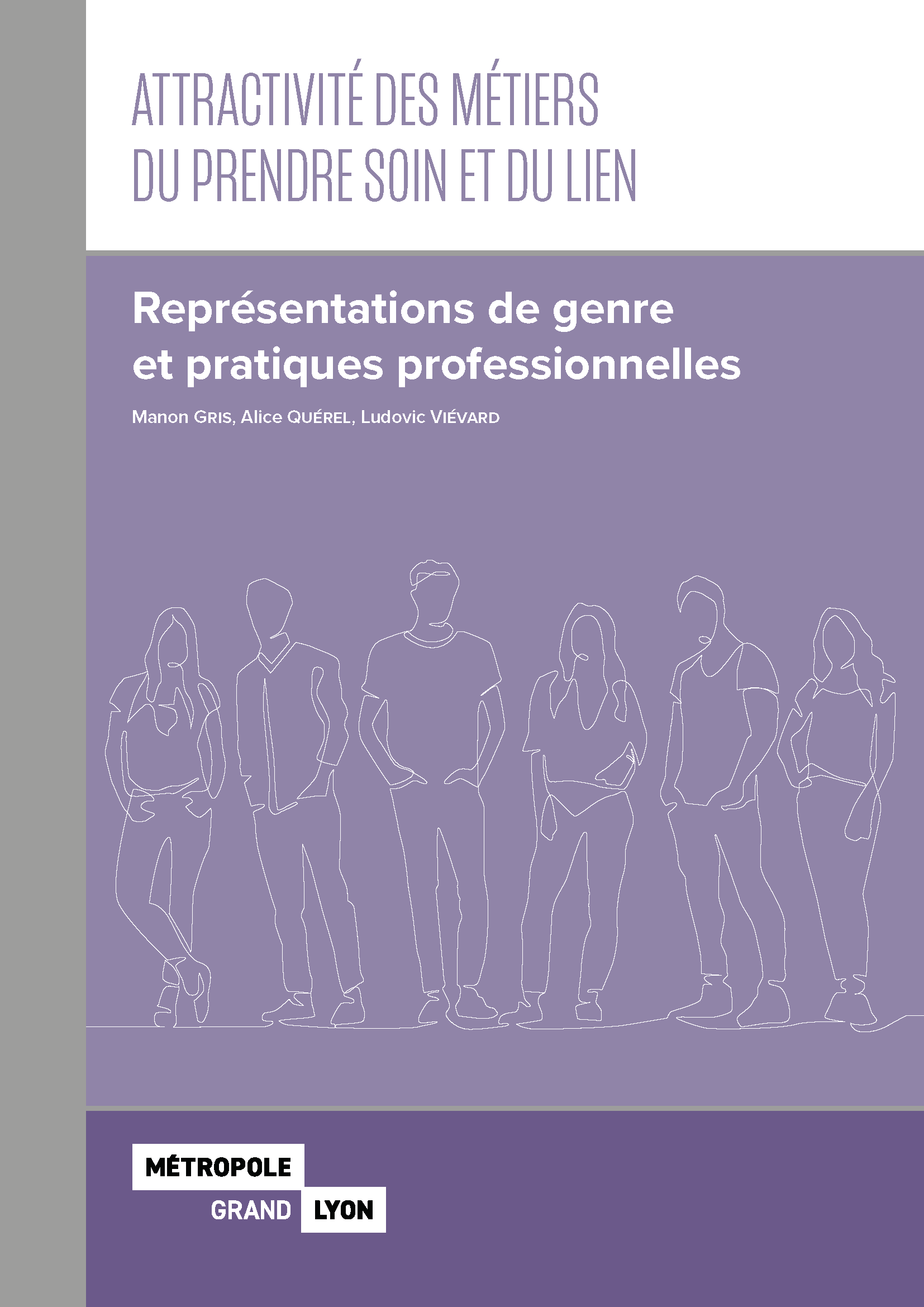
Étude
La masculinisation des métiers du care, si elle progresse, n’est que récente et peu avancée. Des enquêtés de sexe masculin nous disent pourtant l’attrait qu’ils éprouvent pour l’aide et le soin à la personne.

Étude
Ce rapport détaille les enseignements issus de l’étude, à travers une analyse des représentations sociales du sport, et des orientations pour la conception de terrains sportifs de plein air en libre accès.

Étude
La demande en matière de sports de plein air en accès libre augmente. Pourtant, il n’est pas facile de trouver des endroits propices à ces activités, notamment pour les femmes. Ce cahier d’inspiration entend donner des clefs aux porteurs de projets.

Interview de Corinne Lachkar
Costumière
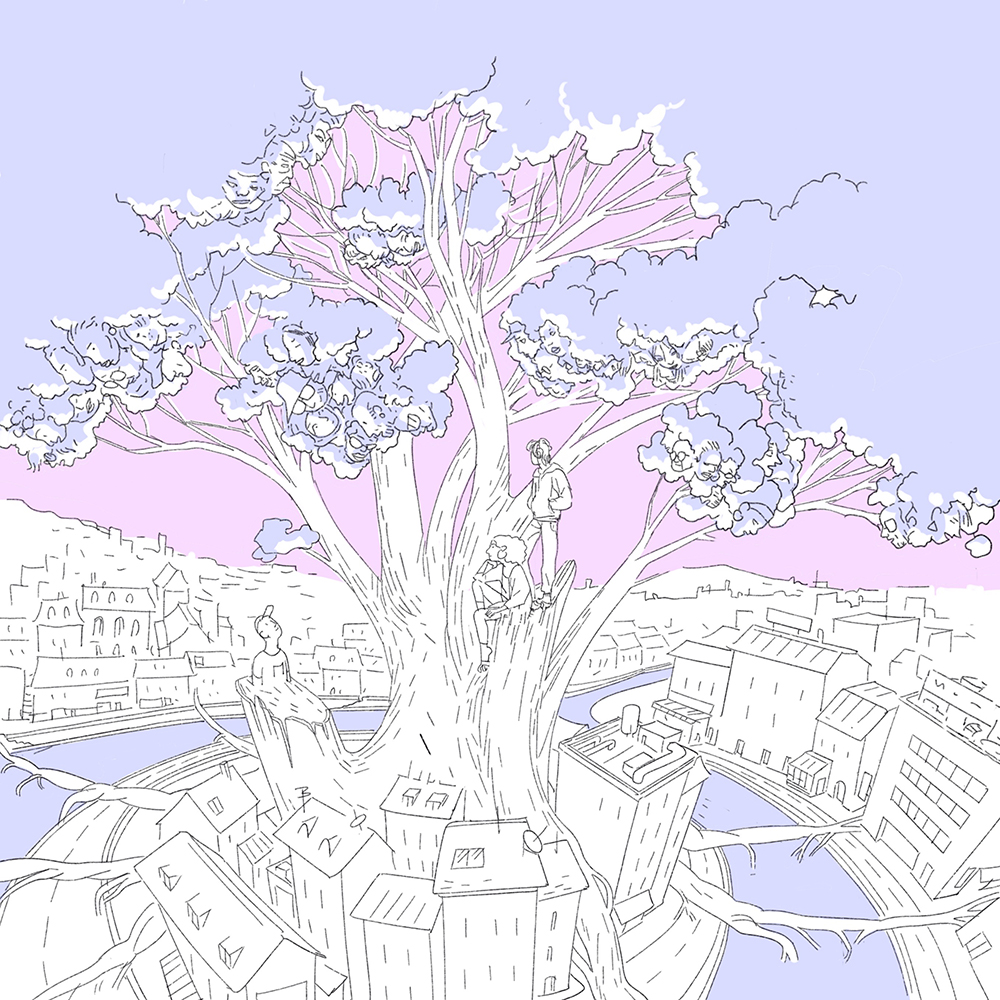
Article
Négocier et construire ses appartenances c’est faire une série de choix qui influent sur notre point de vue sur le monde et la position où l’on nous situe dans la société. Ces processus complexes sont au cœur des apports des sciences humaines et sociales.

À travers les différentes ressources que nous vous proposons, nous explorons ces processus sociaux en tension, afin de nourrir un débat public particulièrement sensible lorsqu’il est question d’identité(s).

Article
En 2022, la loi bioéthique ouvrait le don du sang aux homosexuels dans les mêmes conditions aux hétérosexuels. En matière de sentiment d’appartenance à une catégorie sociale, que nous apprennent les controverses qui ont abouti à cette évolution ?